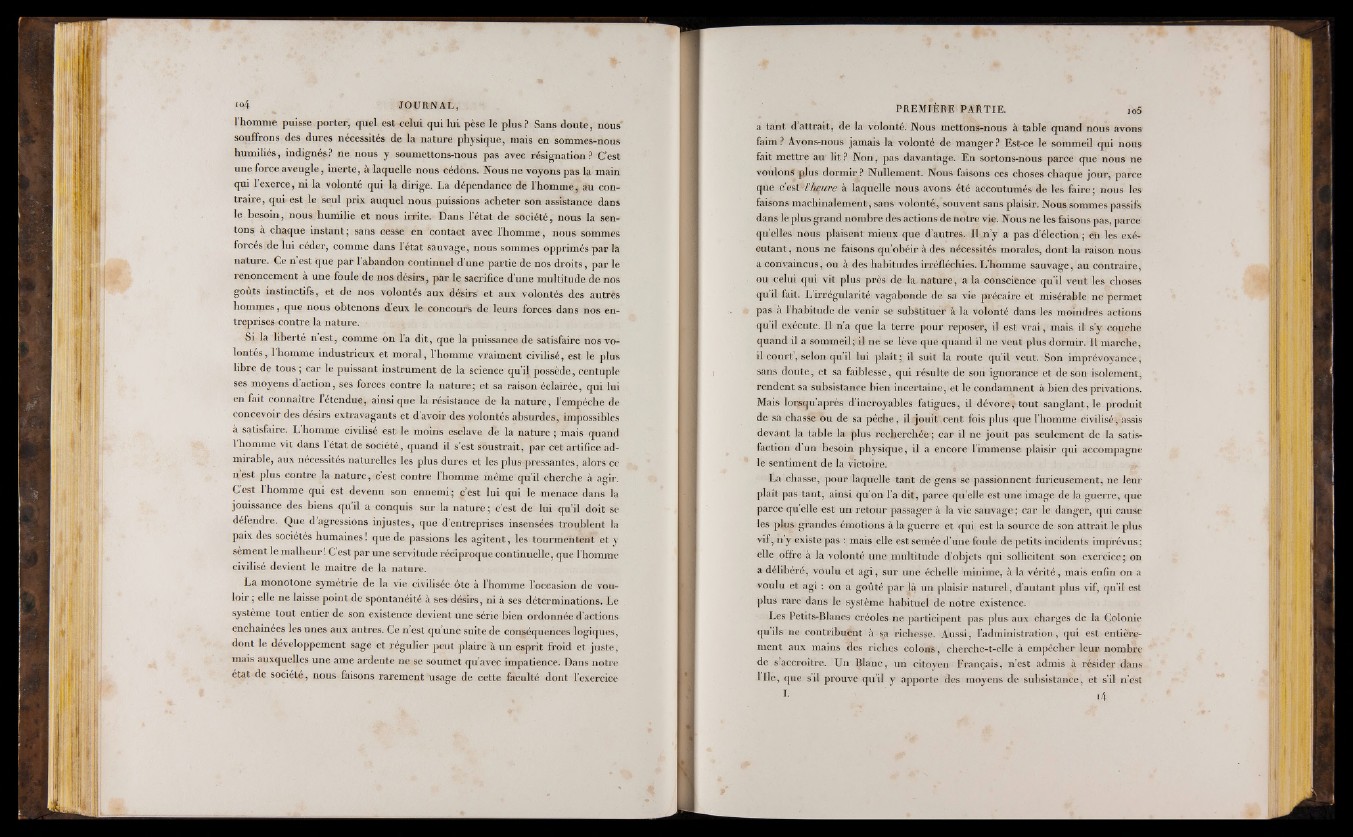
l’homme puisse porter, quel est celui qui lui pèse le plus? Sans doute, nous*
souffrons des dures nécessités de la nature physique, mais en sommes-nous
humiliés, indignés? ne nous y soumettons-nous pas avec résignation? C’est
une force aveugle, inerte, à laquelle nous cédons. Nous ne voyons pas la main
qui l’exerce, ni la volonté qui la dirige. La dépendance de l’homme, au contraire,
qui est le seul prix auquel nous puissions acheter son assistance dans
le besoin, noua humilie et nous irrite. Dans l’état de société, nous la sentons
à chaque instant; sans cesse en contact avec l’homme, nous sommes
forcés de lui céder, comme dans l’état sauvage, nous sommes opprimés par la
nature. Ce n est que par 1 abandon continuel d’une partie de nos droits, par le
renoncement à une foule de nos désirs, par le sacrifice d’une multitude de nos
goûts instinctifs, et de nos volontés aux désirs et aux volontés des autrès
hommes, que nous obtenons deux le concours de leurs forces dans nos entreprises
contre la nature.
Si la liberté n e s t, comme on la dit, que la puissance de satisfaire nos volontés
, 1 homme industrieux et moral, l’homme vraiment civilisé, est le plus
libre de tous; car le puissant instrument de la science qu’il possède, centuple
ses moyens daction, ses forces contre la nature; et sa raison éclairée, qui lui
en fait connaître rétendue, ainsi que la résistance de la nature, l’empêche de
concevoir des désirs extravagants et d’avoir des volontés absurdes, impossibles
à satisfaire. L homme civilisé est le moins esclave dë la nature ; mais quand
1 homme vit dans 1 état de société, quand il s’est soustrait, par cet artifice admirable,
aux nécessites naturelles les plus dures et les plus pressantes, alors ce
nest plus contre la nature, c est contre 1 homme même qu’il cherche à agir.
Cest 1 homme qui est devenu son ennemi; c’est lui qui le menace dans la
jouissance des biens qu’il a conquis sur la nature; c’est de lui qu’il doit se
défendre. Que d agressions injustes, que d’entreprises insensées troublent la
paix des sociétés humaines ! que de passions les agitent, les tourmentent et y
sèment le malheur ! C est par une servitude réciproque continuelle, que l’homme
civilisé devient le maître de la nature.
La monotone symétrie de la vie civilisée ôte à l’homme l occasion de vouloir
; elle ne laisse point de spontanéité à ses déèirs, ni à ses déterminations. Le
système tout entier de son existence devient une série bien ordonnée d’actions
enchaînées les unes aux autres. Ce n est qu une suite de conséquences logiques,
dont le développement sage et régulier peut plaire à un esprit froid et juste,
mais auxquelles une ame ardente ne se soumet qu’avec impatience. Dans notre
état de société, nous faisons rarement usage de cette faculté dont l’exercice
a tant d’attrait, de la volonté. Nous mettons-nous à table quand nous avons
faim ? Avons-nous jamais la volonté de manger ? Est-ce le sommeil qui nous
fait mettre au lit? Non, pas davantage. En sortons-nous parce que nous ne
voulons” plus dormir^? Nullement. Nous faisons ces choses chaque jour, parce
que c’est H'heure à laquelle nous avons été accoutumés de les faire; nous les
faisons machinalement , sans volonté, souvent sans plaisir. Nous sommes passifs
dans le plus grand nombre des actions de notre vie. Nous ne les faisons pas, parce
qu’elles nous plaisent mieux que d’autres. Il n ’y a pas d’élection ; en les exécutant
, nous ne faisons qu’obéir à des nécessités morales, dont la raison nous
a convaincus, ou à des habitudes irréfléchies. L’homme sauvage, au contraire,
ou celui qui vit plus près de la nature, a la conscience qu’il veut les choses
qu’il fait. L ’irrégularité vagabonde de sa vie précaire et misérable ne permet
pas à l’habitude de venir se sub§tituer à la volonté dans les moindres actions
qu’il exécute. Il n’a que la terre pour reposer, il est v ra i, mais il s’y couche
quand il a sommeil; il ne se lève que quand il ne veut plus dormir. Il marche,
il court", selon qu’il lui plaît;, il suit la route qu’il veut. Son imprévoyance,
sans doute, et sa faiblesse, qui résulte de son ignorance et de son isolement,
rendent sa subsistance bien incertaine, et le condamnent à bien des privations.
Mais lorsqu’après d’incroyables fatigues, il dévore;4 tout sanglant, le produit
de sa chasse ou de sa pêche, ilqouit\cent fois plus que l’homme civilisé^ assis
devant la table la plus recherchée ; car il ne jouit pas seulement de la satisfaction
d’un besoin physique, il a encore l’immense plaisir qui accompagne
le sentiment de la victoire.
La chasse, pour laquelle tant de gens se passionnent furieusement, ne leur
plaît pas tant, ainsi qu’on l’a dit, parce qu elle est une image de la guerre, que
parce quelle est un retour passager à la vie sauvage; car le danger, qui cause
les plus grandes émotions à la guerre et qui est la source de son attrait le plus
#§§ n’y existe pas : mais elle est semée d’une foule de petits incidents imprévus;
elle offre à la volonté une multitude d’objets qui sollicitent son exercice; on
a délibéré, vôulu et agi, sur une échelle minime, à la vérité, mais enfin on a
voulu et agi : on a goûté par là un plaisir naturel, d’autant plus vif, qu’il est
plus rare dans le système habituel de notre existence.
Les Petits-Blancs créoles ne participent pas plus aux charges de la Colonie
quils ne contribuant à sa richesse. Aussi, l’administration, qui est entièrement
aux mains des riches colons, cherche-t-elle à empêcher leur nombre
de s accroître. Un Blanc, un citoyen Français, n’est admis à résider dans
' Ile, que s’il prouve qu’il y apporte des moyens de subsistance, et s’il n’est
L ï 4