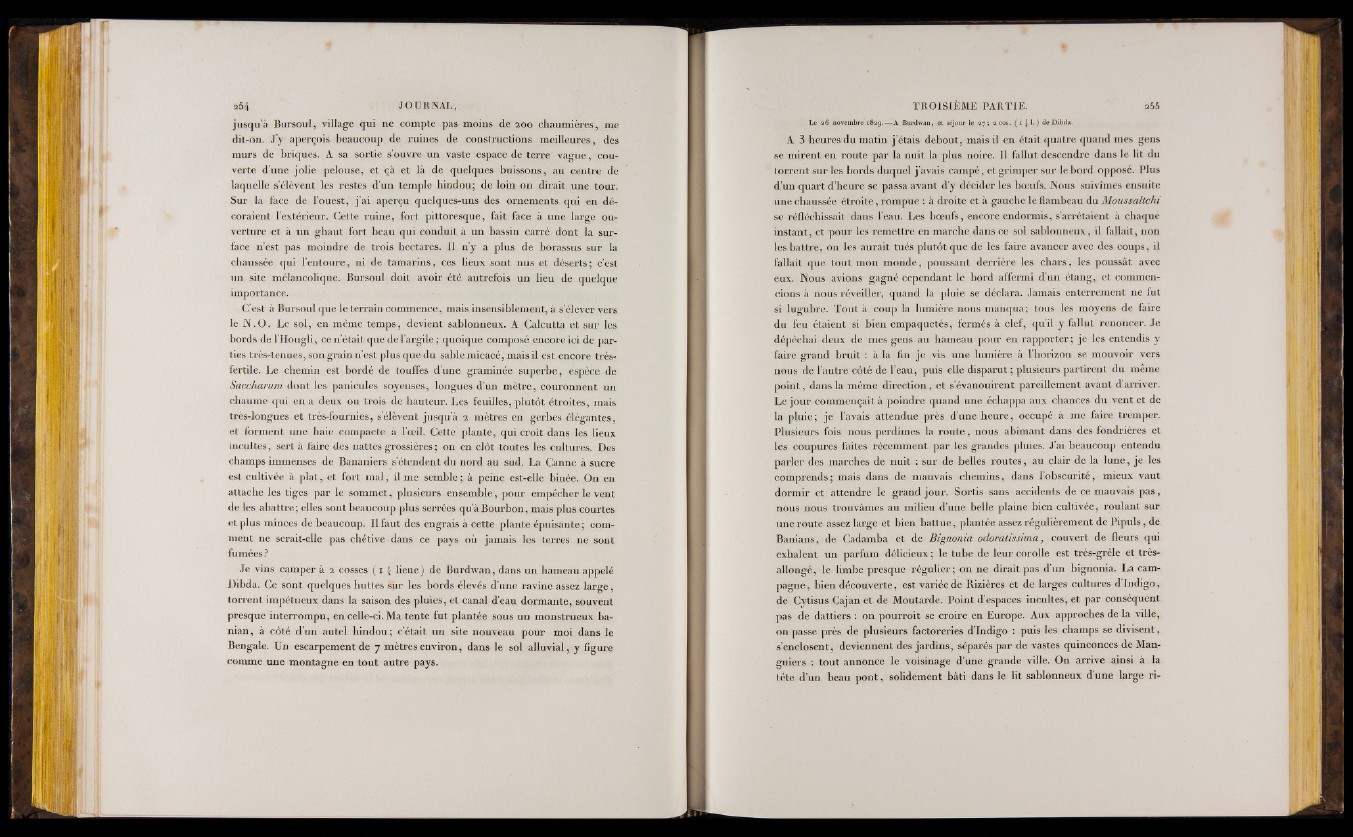
jusqu’à Bursoul, village qui ne compte pas moins de 200 chaumières, me
dit-on. J’y aperçois beaucoup de ruines de constructions meilleures, des
murs de briques. A sa sortie s’ouvre un vaste espace de terre vague, couverte
d’une jolie pelouse, et çà et là de quelques buissons, au centre de
laquelle s’élèvent les restes d’un temple hindou; de loin on dirait une tour.
Sur la face de l’ouest, j ’ai aperçu quelques-uns des ornements qui en décoraient
l’extérieur. Cette ruine, fort pittoresque, fait face à une large ouverture
et à un ghaut fort beau qui conduit à un bassin carré dont la surface
n’est pas moindre de trois hectares. Il n’y a plus de borassus sur la
chaussée qui l’entoure, ni de tamarins, ces lieux sont nus et déserts; c’est,
un site mélancolique. Bursoul doit avoir été autrefois un lieu de quelque
importance.
C’est à Bursoul que le terrain commence, mais insensiblement, à s’élever vers
le N . O . Le sol, en même temps, devient sablonneux. A Calcutta et sur les
bords de l’Hougli, ce n’était que de l’argile ; quoique composé encore ici de parties
très-tenues, son grain n’est plus que du sable micacé, mais il est encore très-
fertile. Le chemin est bordé de touffes d’une graminée superbe, espèce de
Saccharum dont les panicules soyeuses, longues d’un mètre, couronnent un
chaume qui en a deux ou trois de hauteur. Les feuilles, plutôt étroites, mais
très-longues et très-fournies, s’élèvent jusqu’à 2 mètres en gerbes élégantes,
et forment une haie compacte à l’oeil. Cette plante, qui croît dans les lieux
incultes, sert à faire des nattes grossières ; on en clôt toutes les cultures. Des
champs immenses de Bananiers s’étendent du nord au sud. La Canne à sucre
est cultivée à pla t, et fort mal, il me semble ; à peine est-elle binée. On en
attache les tiges par le sommet, plusieurs ensemble, pour empêcher le vent
de les abattre; elles sont beaucoup plus serrées qu’à Bourbon, mais plus courtes
et plus minces de beaucoup. Il faut des engrais à cette plante épuisante ; comment
ne serait-elle pas chétive dans ce pays où jamais les terres ne sont
fumées ?
Je vins camper à 2 cosses ( i l lieue) de Burdwan, dans un hameau appelé
Dibda. Ce sont quelques huttes sur les bords élevés d’une ravine assez la rg e ,
torrent impétueux dans la saison des pluies, et canal d’eau dormante, souvent
presque interrompu, en celle-ci. Ma tente fut plantée sous un monstrueux banian,
à côté d’un autel hindou; c’était un site nouveau pour moi dans le
Bengale. Un escarpement de 7 mètres environ, dans le sol alluvial, y figure
comme une montagne en tout autre pays.
TROISIÈME PARTIE. a55
Le 26 novembre 1829.— A Burdwan, et séjour le 27; 2 cos. ( 1 11. ) de Dibda.
A 3 heures du matin j ’étais debout, mais il en était quatre quand mes gens
se mirent en route par la nuit la plus noire. Il fallut descendre dans le lit du
torrent sur les bords duquel j ’avais campé, et grimper sur le bord opposé. Plus
d’un quart d ’heure se passa avant d’y décider les boeufs. Nous suivîmes ensuite
une chaussée étroite, rompue : à droite et à gauche le flambeau du Moussaltchi
se réfléchissait dans l’eau. Les boeufs, encore endormis, s’arrêtaient à chaque
instant, et pour les remettre en marche dans ce sol sablonneux, il fallait, non
les battre, on les aimait tués plutôt que de les faire avancer avec des coups, il
fallait que tout mon monde, poussant derrière les chars, les poussât avec
eux. Nous avions gagné cependant le bord affermi d’un étang, et commencions
à nous réveiller, quand la pluie se déclara. Jamais enterrement ne fut
si lugubre. Tout à coup la lumière nous manqua; tous les moyens de faire
du feu étaient si bien empaquetés, fermés à clef, qu’il y fallut renoncer. Je
dépêchai deux de mes gens au hameau pour en rapporter ; je les entendis y
faire grand bruit : à la fin je vis une lumière à l’horizon se mouvoir vers
nous de l’autre côté de l’eau, puis elle disparut; plusieurs partirent du même
point, dans la même direction, et s’évanouirent pareillement avant d’arriver.
Le jour commençait à poindre quand une échappa aux chances du vent et de
la pluie; je l’avais attendue près d’une heure, occupé à me faire tremper.
Plusieurs fois nous perdîmes la route, nous abîmant dans des fondrières et
les coupures faites récemment par les grandes pluies. J’ai beaucoup entendu
parler des marches de nuit : sur de belles routes, au clair de la lune, je les
comprends; mais dans de mauvais chemins, dans l’obscurité, mieux vaut
dormir et attendre le grand jour. Sortis sans accidents de ce mauvais p a s,
nous nous trouvâmes au milieu d’une belle plaine bien cultivée, roulant sur
une route assez large et bien battue, plantée assez régulièrement de Pipuls, de
Banians, de Cadamba et de Bignonia odoratissima, couvert de fleurs qui
exhalent un parfum délicieux; le tube de leur corolle est très-grêle et très-
allongé, le limbe presque régulier; on ne dirait pas d’un bignonia. La campagne,
bien découverte, est variée de Rizières et de larges cultures dlu digo,
de Cytisus Cajan et de Moutarde. Point d’espaces incultes, et par conséquent
pas de dattiers : on pourroit se croire en Europe. Aux approches de la ville,
on passe près de plusieurs factoreries d’indigo : puis les champs se divisent,
s’enclosent, deviennent des jardins, séparés par de vastes quinconces de Manguiers
: tout annonce le voisinage d’une grande ville. On arrive ainsi à la
tête d’un beau pont, solidement bâti dans le lit sablonneux d’une large ri