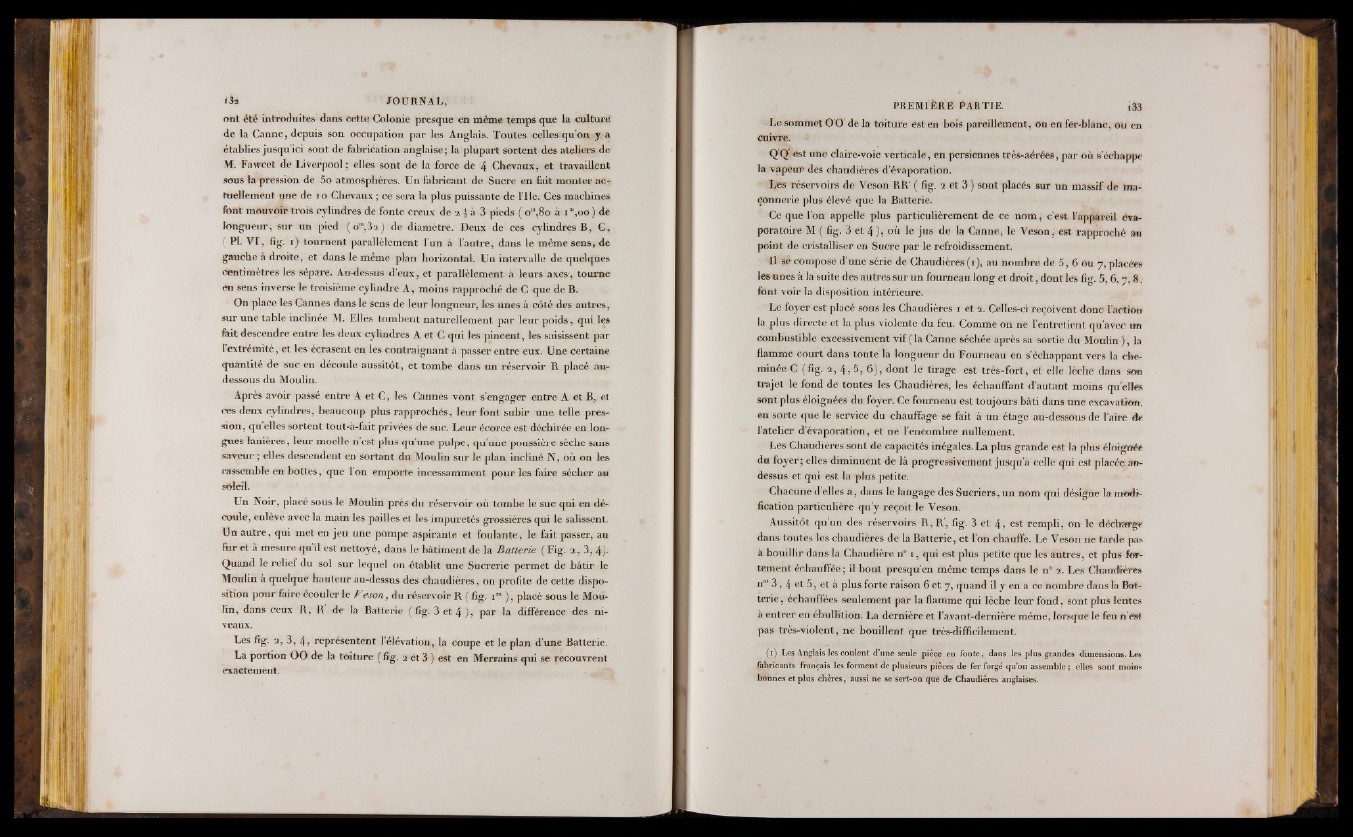
ont été introduites dans cette Colonie presque en même temps que la culture
de la Canne, depuis son occupation par les Anglais. Toutes celles qu’on y a
établies jusqu’ici sont de fabrication anglaise ; la plupart sortent des ateliers de
M. Fawcet de Liverpool; elles sont de la force de 4 Chevaux, et travaillent
sous la pression de 5o atmosphères. Un fabricant de Sucre en fait monter actuellement
une de 10 Chevaux ; ce sera la plus puissante de l'Ile. Ces machines
font mouvoir trois cylindres de fonte creux de 2 1 à 3 pieds ( o",8o à i",oo ) de
longueur, sur un pied (o " ,3a ) de diamètre. Deux de ces cylindres B , C ,
( Pl. V I , fig. i) tournent parallèlement l’un à l’autre, dans le même sens, de
gauche à droite, et dans le même plan horizontal. Un intervalle de quelques
centimètres les sépare. Au-dessus d'eux, et parallèlement à leurs axes*, tourne
en sens inverse le troisième cylindre A, moins rapproché de C que de B.
On place les Cannes dans le sens de leur longueur, les unes à côté des autres,
sur une table inchnée M. Elles tombent naturellement par leur poids, qui les
foit descendre entre les deux cylindres A et C qui les pincent, les saisissent par
lextrémité, et les écrasent en les contraignant à passer entre eux. Une certaine
quantité de suc en découle aussitôt, et tombe dans un réservoir R placé au-
dessous du Moulin.
Après avoir passé entre A et C, les Cannes vont s’engager entre A et B, et
ces deux cylindres, beaucoup plus rapprochés, leur font subir une telle pression,
quelles sortent tout-à-fait privées de suc. Leur ét'orce est déchirée en longues
lanières, leur moelle n ’est plus qu’une pulpe, qu’une poussière sèche sans
saveur ; elles descendent en sortant du Moulin sur le plan incliné N , où. on les
rassemble en bottes, que l’on emporte incessamment pour les faire sécher au
soleil.
Un Noir, placé sous le Moulin près du réservoir où tombe le suc qui en découle,
enlève avec la main les pailles et les impuretés grossières qui le salissent.
Un autre, qui met en jeu une pompe aspirante et foulante, le fait passer, au
fiir et à mesure q|u il est nettoyé, dans le bâtiment de la Batterie ( Fig. 2, 3, 4-4
Quand le relief du sol sur lequel on établit une Sucrerie permet de bâtir le
Moulin à quelque hauteur au-dessus des chaudières, on profite de cette disposition
pour faire écouler le V?son, du réservoir R ( fig. i " ) , placé sous le Moulin,
dans ceux R, R de la Ratterie (;fig. 3 et 4 ), par la différence des niveaux.
Les fig. 2, 3, 4 , représentent l’élévation, la coupe et le plan dirne Batterie.
La portion OO de la toiture (fig. 2 et 3 ) est en Merrains qui se recouvrent
exactement.
Le sommet O O de la toiture est en bois pareillement, ou en fer-blânc, ou en
cuivre.
Q’Q est une claire-voie verticale, en persiennes très-aérées, par ou s’échappe
la vapeur des chaudières d’évaporation.
Lés réservoirs de Veson RR’ ( fig. 2 et 3 ) sont placés sur un massif de maçonnerie
plus élevé que la Batterie.
Ce que l’on appelle plus particulièrement de ce nom, c’est l’appareil éva-
poratoire M ( fig. 3 et 4)5 où le jus de la Canne, le Veson, est rapproché an
point de cristalliser en Sucre par le refroidissement.
Il sè compose d’une série de Chaudières (t), au nombre de 5 , 6 ou 7, placées
les unes’à la suite des autres sur un fourneau long et d roit, dont les fig. 5 ,6 ,7 ,8 ,
font voir la disposition intérieure.
Le foyer est placé sous les Chaudières t et 2. Celles-ci reçoivent donc l’action
la plus directe et la plus violente du feu. Comme on ne l’entretient qu’avec an
combustible excessivement v if (la Canne séchéê après sa sortie du Moulin ) , la
flamme court dans tonte la longueur du Fourneau en s’échappant vers la cheminée
C (fig. 2, 4 , 5 , 6 ), dont le tirage est très-fort, et elle lèche dans son
trajet le fond de toutes les Chaudières, les échauffant d’autant moins quelles
sont plus-éloignées du foyer. Ce fourneau est toujours bâti dans une excavation,
en sorte que le service du chauffage se fait à un étage au-dessous de faire de
l’atelier d’évaporation, et ne l’encombre nullement.
Les Chaudières sont de capacités inégales. La plus grande est la plus éloignée
du foyer; elles diminuent de là progressivement jusqu’à celle qui est placée an-
dessus et qui est la pins petite.
Chacune d elles a , dans le langage des Sucriers, un nom qui désigne la modification
particulière qu’y reçoit le Yeson.
Aussitôt qu’un des réservoirs R, R’, fig. 3 et 4 , est rempli, on le décharge
dans toutes les chaudières de la Batterie, et l’on chauffe. Le Veson ne tarde pas
à bouillir dans la Chaudière n” r, qui est plus petite que les autres, et plus fortement
échauffée ; il bout presqu’en même temps dans le n" 2. Les Chaudières
n°* 3 , 4 et 5 , et à plus forte raison 6 et 7, quand il y en à Ce nombre dans la Batterie
, échauffées seulement par la flamme qui lèche leur fond, sont plus lentes
à entrer en ébullition. La dernière et l’avant-dernière même, lorsque le feu n’est
pas très-violent, ne bouillent que très-difficilement.
(1) Les Anglais les coulent d’une seule pièce en fonte, dans les plus grandes dimensions. Les
fabricants français les forment de plusieurs pièces de fer forgé qu’on assemble ; elles sont moins
bonnes et plus chères, süssi ne se sert-on que de Chaudières anglaises.