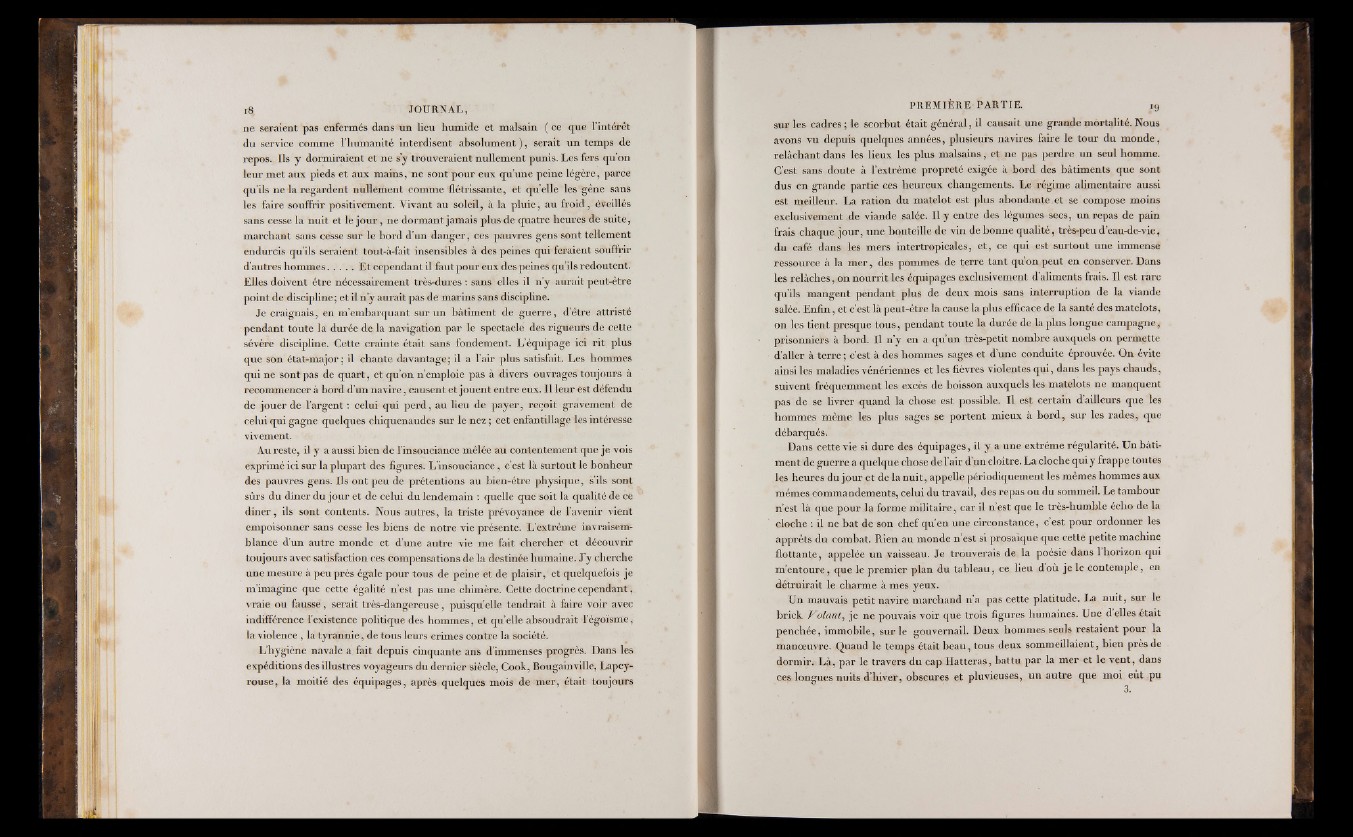
ne seraient pas enfermés dans un lieu humide et malsain (ce que l’intérét
du service comme lliumanité interdisent absolument), serait un temps de
repos. Us y dormiraient et ne s’y trouveraient nullement punis. Les fers qu’on
leur met aux pieds et aux mains, ne sont pour eux qu’une peine légère, parce
qu’ils ne la regardent nullement comme flétrissante, et qu elle les gêne sans
les faire souffrir positivement. Vivant au soleil, à la pluie, au froid, éveillés
sans cesse la nuit et le jour, ne dormant jamais plus de quatre heures de suite,
marchant sans cesse sur le bord d’un danger, ces pauvres gens sont tellement
endurcis qu’ils seraient tout-à-fait insensibles à des peines qui feraient souffrir
d’autres hommes Et cependant il faut pour eux des peines qu’ils redoutent.
Elles doivent être nécessairement très-dures : sans elles il n’y aurait peut-être
point de discipline; et il n’y aurait pas de marins sans discipline.
Je craignais, en m’embarquant sur un bâtiment de guerre, d’être attristé
pendant toute la durée de la navigation par le spectacle des rigueurs de cette
sévère discipline. Cette crainte était sans fondement. L’équipage ici rit plus
que son état-major; il chante davantage; il a l’air plus satisfait. Les hommes
qui ne sont pas de quart, et qu’on n’emploie pas à divers ouvrages toujours à
recommencer à bord d’un navire, causent et jouent entre eux. Il leur est défendu
de jouer de l’argent : celui qui perd, au lieu de payer, reçoit gravement de
celui qui gagne quelques chiquenaudes sur le nez ; cet enfantillage les intéresse
vivement.
Au reste, il y a aussi bien de l’insouciance mêlée au contentement que je vois
exprimé ici sur la plupart des figures. L’insouciance, c’est là surtout le bonheur
des pauvres gens. Ils ont peu de prétentions au bien-être physique, s’ils sont
sûrs du diner du jour et de celui du lendemain : quelle que soit la qualité de ce
dîner, ils sont contents. Nous autres, la triste prévoyance de l’avenir vient
empoisonner sans cesse les biens de notre vie présente. L’extrême invraisemblance
d’un autre monde et d’une autre vie me fait chercher et découvrir
toujours avec satisfaction ces compensations de la destinée humaine. J’y cherche
une mesure à peu près égale pour tous de peine et de plaisir, et quelquefois je
m’imagine que cette égalité n’est pas une chimère. Cette doctrine cependant
vraie ou fausse, serait très-dangereuse, puisqu’elle tendrait à faire voir avec
indifférence l’existence politique des hommes, et qu’elle absoudrait Tégoïsme,
la violence, la tyrannie, de tous leurs crimes contre la société.
L’hygiène navale a fait depuis cinquante ans d’immenses progrès. Dans les
expéditions des illustres voyageurs du dernier siècle, Cook, Bougainville, Lapey-
rouse, la moitié des équipages, après quelques mois de mer, était toujours
sur les cadres ; le scorbut était général, il causait une grande mortalité. Nous
avons vu depuis quelques années, plusieurs navires faire le tour du monde,
relâchant dans les lieux les plus malsains, et ne pas perdre un seul homme.
C’est sans doute à l’extrême propreté exigée à bord des bâtiments que sont
dus en grande partie ces heureux changements. Le régime alimentaire aussi
est meilleur. La ration du matelot est plus abondante et se compose moins
exclusivement de viande salée. Il y entre des légumes secs, un repas de pain
frais chaque jour, une bouteille de vin de bonne qualité, très-peu d’eau-de-vie,
du café dans les mers intertropicales, et, ce qui est surtout une immense
ressource à la mer, des pommes de terre tant qu’on peut en conserver. Dans
les relâches, on nourrit les équipages exclusivement d’aliments frais. Il est rare
qu’ils mangent pendant plus de deux mois sans interruption de la viande
salée. Enfin ? et c’est là peut-être la cause la plus efficace de la santé des matelots,
on les tient presque tous, pendant toute la durée de la plus longue campagne*
prisonniers à bord. Il n’y en a qu’un très-petit nombre auxquels on permette
d’aller à terre ; c’est à des hommes sages et d’une conduite éprouvée. On évite
ainsi les maladies vénériennes et les fièvres violentes qui, dans les pays chauds,
suivent fréquemment les excès de boisson auxquels les matelots ne manquent
pas de se livrer quand la chose est possible. Il est certain d ailleurs que les
hommes même les plus sages se portent mieux à bord, sur les rades, que
débarqués.
Dans cette vie si dure des équipages, il y a une extrême régularité. Un bâtiment
de guerre a quelque chose de l’air d’un cloître. La cloche qui y frappe toutes
les heures du jour et de la nuit, appelle périodiquement les mêmes hommes aux
mêmes commandements, celui du travail, des repas ou du sommeil. Le tambour
n’est là que pour la forme militaire, car il n’est que le très-humble écho de la
cloche : il ne bat de son chef qu’en une circonstance, c’est pour ordonner les
apprêts du combat. Rien au monde n’est si prosaïque que cette petite machine
flottante, appelée un vaisseau. Je trouverais de la poésie dans 1 horizon qui
m’entoure, que le premier plan du tableau, ce lieu doù je le contemple, en
détruirait le charme à mes yeux.
Un mauvais petit navire marchand n’a pas cette platitude. La nuit, sur le
brick Volant, je ne pouvais voir que trois figures humaines. Une d elles était
penchée, immobile, sur le gouvernail. Deux hommes seuls restaient pour la
manoeuvre. Quand le temps était beau, tous deux sommeillaient, bien près de
dormir. Là., par le travers du cap Hatteras, battu par la mer et le vent, dans
ces longues nuits d’hiver, obscures et pluvieuses, un autre que moi eut pu