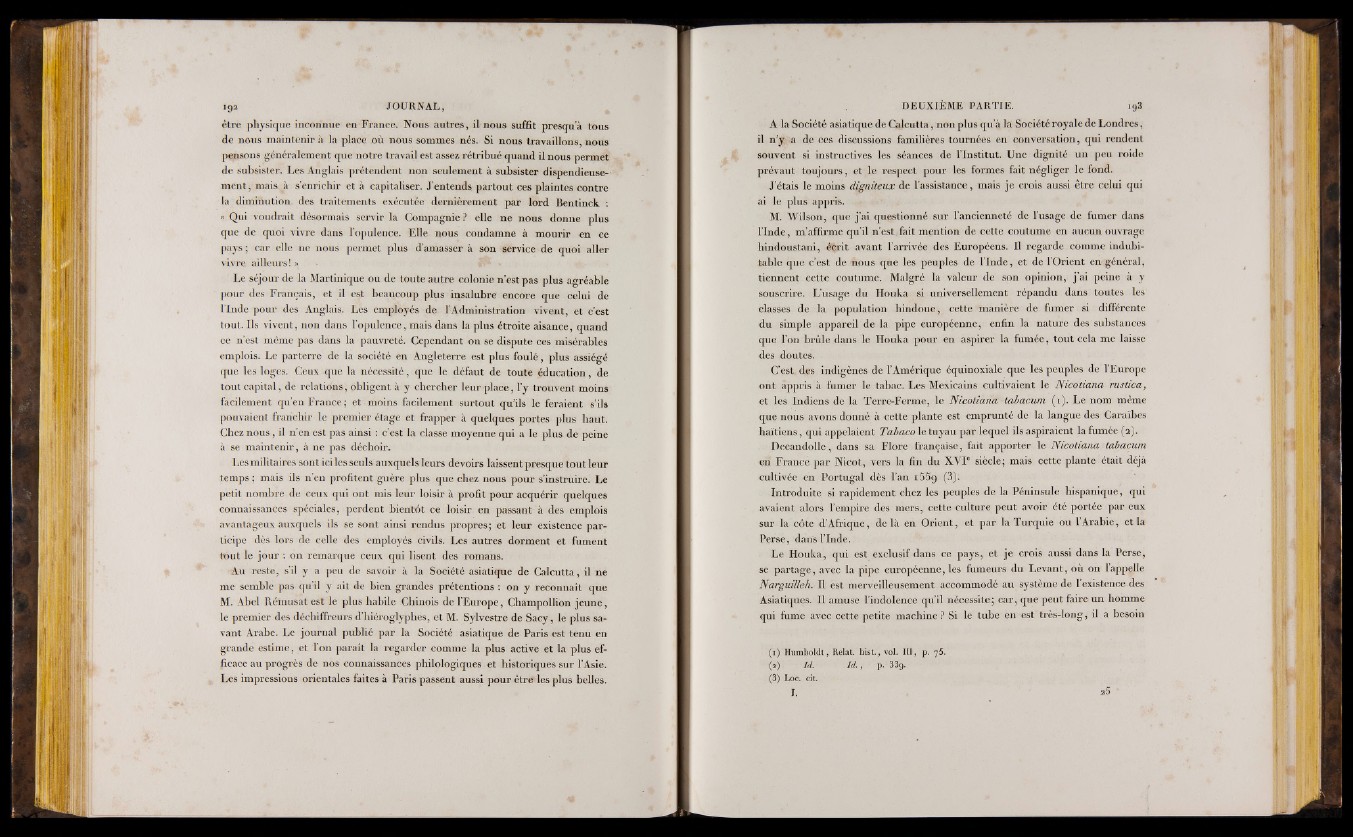
être physique inconnue en France» Nous autres, il nous suffit presqu’à tous
de nous maintenir à la place où nous sommes nés. Si nous travaillons, nous
pensons généralement que notre travail est assez rétribué quand il nous permet
de subsister. Les Anglais prétendent non seulement à subsister dispendieusement
, mais , à s’enrichir et à capitaliser. J’entends partout ces plaintes contre
la diminution des traitements exécutée dernièrement par lord Bentinck :
" Qui voudrait désormais servir la Compagnie ? elle ne nous donne plus
que de quoi vivre dans l’opulence. Elle nous condamne à mourir en ce
pays ; car elle ne nous permet plus d’amasser à son service de quoi aller
vivre ailleurs! »
Le séjour de la Martinique ou de toute autre colonie n’est pas plus agréable
pour des Français, et il est beaucoup plus insalubre encore que celui de
l'Inde pour des Anglais. Les employés de l’Administration vivent, et c’est
tout. Ils vivent, non dans l’opulence, mais dans la plus étroite aisance, quand
ce n’est même pas dans la pauvreté. Cependant on se dispute ces misérables
emplois. Le parterre de la société en Angleterre est plus fou lé , plus assiégé
que les loges. Ceux que la nécessité, que le défaut de toute éducation, de
tout capital, de relations, obligent à y chercher leur place, l’y trouvent moins
facilement qu’en France; et moins facilement surtout qu’ils le feraient s’ils
pouvaient franchir le premier étage et frapper à quelques portes plus haut.
Chez n ou s, il n’en est pas ainsi : c’est la classe moyenne qui a le plus de peine
à se maintenir, à ne pas déchoir.
Les militaires sont ici les seuls auxquels leurs devoirs laissent presque tout leur
temps ; mais ils n’en profitent guère plus que chez nous pour s'instruire. Le
petit nombre de ceux qui ont mis leur loisir à profit pour acquérir quelques
connaissances spéciales, perdent bientôt ce loisir en passant à des emplois
avantageux auxquels ils se sont ainsi rendus propres; et leur existence participe
dès lors de celle des employés civils. Les autres dorment et fument
tout le jour : on remarque ceux qui lisent des romans.
Au reste, s’il y a peu de savoir à la Société asiatique de Calcutta, il ne
me semble pas qu’il y ait de bien grandes prétentions : on y reconnaît que
M. Abel Rémusat est le plus habile Chinois de l’Europe, Champollion jeune,
le premier des déchiffreurs d’hiéroglyphes, et M. Sylvestre de Sacy, le plus savant
Arabe. Le journal publié par la Société asiatique de Paris est tenu en
grande estime, et l’on parait la regarder comme la plus active et la plus efficace
au progrès de nos connaissances philologiques et historiques sur l’Asie.
Les impressions orientales faites à Paris passent aussi pour être les plus belles.
A la Société asiatique de Calcutta, non plus qu’à la Société royale de Londres,
il n’y a de ces discussions familières tournées en conversation, qui rendent
souvent si instructives les séances de l’Institut. Une dignité un peu roide
prévaut toujours, et le respect pour les formes fait négliger le fond.
J’étais le moins digniteux de l’assistance, mais je crois aussi être celui qui
ai le plus appris.
M. Wilson, que j'ai questionné sur l’ancienneté de l’usage de fumer dans
l’Inde, m’affirme qu’il n’est fait mention de cette coutume en aucun ouvrage
hindoustani, écrit avant l’arrivée des Européens. Il regarde comme indubitable
que c’est de nous que les peuples de l’Inde, et de l’Orient en général,
tiennent cette coutume. Malgré la valeur de son opinion, j ’ai peine à y
souscrire. L ’usage du Ilouka si universellement répandu dans toutes les
classes de la population hindoue, cette manière de fumer si différente
du simple appareil de la pipe européenne, enfin la nature des substances
que l’on brûle dans le Houka pour en aspirer la fumée, tout cela me laisse
des doutes.
C’est, des indigènes de l’Amérique équinoxiale que les peuples de l’Europe
ont appris à fumer le tabac. Les Mexicains cultivaient le Nicotiana rustica,
et les Indiens de la Terre-Ferme, le Nicotiana tabacum (i). Le nom même
que nous avons donné à cette plante est emprunté de la langue des Caraïbes
haïtiens, qui appelaient Tabaco le tuyau par lequel ils aspiraient la fumée ;
Decandolle, dans sa Flore française, fait apporter le Nicotiana tabacum
en France par Nicot, vers la fin du X V Ie siècle; mais cette plante était déjà
cultivée en Portugal dès l’an i 5àq ’3).
Introduite si rapidement chez les peuples de la Péninsule hispanique, qui
avaient alors l’empire des mers, cette culture peut avoir été portée par eux
sur la côte d'Afrique, d e là en Orient, et par la Turquie ou 1 Arabie, et la
Perse, dans l’Inde.
Le Houka, qui est exclusif dans ce pays, et je crois aussi dans la Perse,
se partage, avec la pipe européenne, les fumeurs du Levant, où on l’appelle
Narguilleh. Il est merveilleusement accommodé au système de l’existence des
Asiatiques. Il amuse l’indolence qu’il nécessite; car, que peut faire un homme
qui fume avec cette petite machine ? Si le tube en est très-long, il a besoin
(i) Humboldt, Relat. hist., vol. III, p. 75.
: Id. Id ., p. 33g.
(3) Loc. cit.
I, a5 '