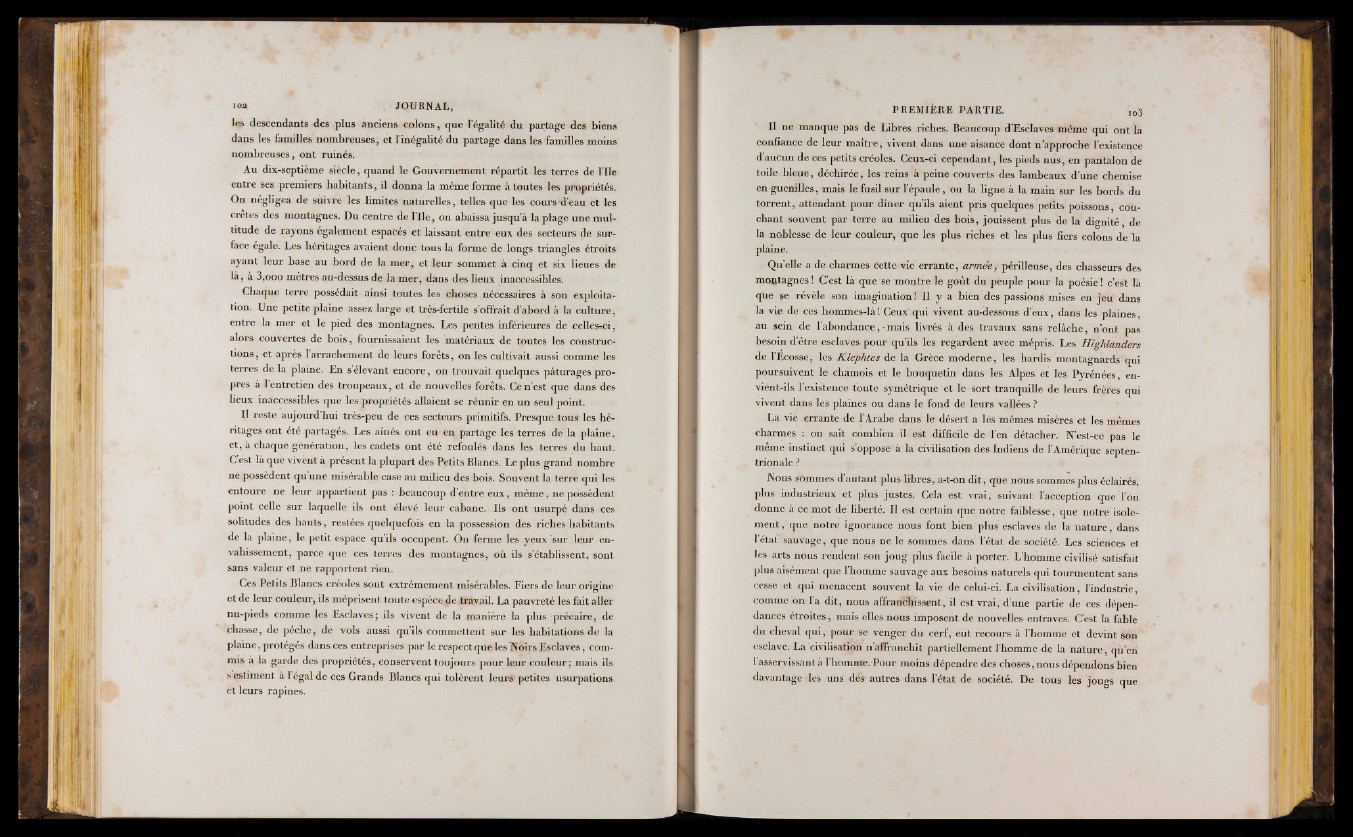
les descendants des plus anciens colons, que légalité du partage des biens
dans les familles nombreuses, et l’inégalité du partage dans les familles moins
nombreuses, ont ruinés.
Au dix-septième siècle, quand le Gouvernement répartit les terres de l’Ile
entre ses premiers habitants, il donna la même forme à toutes lés propriétés.
On négligea de suivre les limites naturelles, telles que les cours d’eau et les
cretes des montagnes. Du centre de l’I le , on abaissa jusqu’à la plage une multitude
de rayons également espacés et laissant entre eux des secteurs de surface
égale. Les héritages avaient donc tous la forme de longs triangles étroits
ayant leur base au bord de la mer, et leur sommet à cinq et six lieues de
là , à 3,ooo métrés au-dessus de la mer, dans des lieux inaccessibles.
Chaque terre possédait ainsi toutes les choses nécessaires à son exploitation.
Une petite plaine assez large et très-fertile s’offrait d’abord à la culture,
entre la mer et le pied des montagnes. Les pentes inférieures de celles-»ci,
alors couvertes de bois, fournissaient les matériaux de toutes les constructions
, et après 1 arrachement de leurs forêts, on les cultivait aussi comme les
terres de la plaine. En s elevant encore, on trouvait quelques pâturages propres
à l’entretien des troupeaux, et de nouvelles forêts. Ce n’est que dans des
lieux inaccessibles que les propriétés allaient se réunir en un seul point.
Il reste aujourdhui très-peu de ces secteurs primitifs. Presque tous les héritages
ont été partagés. Les aînés ont eu en partage les terres de la plaine,
et, à chaque génération, les cadets ont été refoulés dans les terres du haut.
C est là que vivent à présent la plupart des Petits Blancs. Le plus grand nombre
ne possèdent qu une misérable case au milieu des bois. Souvent la terre qui les
entoure ne leur appartient pas : beaucoup d’entre eux , même, ne possèdent
point celle sur laquelle ils ont élevé leur cabane. Ils ont usurpé dans ces
solitudes des hauts, restées quelquefois en la possession des riches habitants
de la plaine, le petit espace qu’ils occupent. On ferme les yeux sur leur envahissement,
parce que ces terres des montagnes, où ils s’établissent, sont
sans valeur et ne rapportent rien.
Ces Petits Blancs créoles sont extrêmement misérables. Fiers de leur origine
et de leur couleur, ils méprisent toute espèce de travail. La pauvreté les fait aller
nu-pieds comme les Esclaves; ils vivent de la manière la plus précaire, de
chasse, de pêche, de vols aussi qu’ils commettent sur les habitations de la
plaine, protégés dans ces entreprises par le respect que le s lf oirs Esclaves, commis
à la garde des propriétés, conservent toujours pour leur couleur; mais ils
s estiment à l égal de ces Grands Blancs qui tolèrent leurs petites usurpations
et leurs rapines.
Il ne manque pas de Libres riches. Beaucoup d’Esclaves même qui ont la
confiance de leur maître, vivent dans une aisance dont n’approche l’existence
d aucun dè ces petits créoles. Ceux-ci cependant, les pieds nus, en pantalon de
toile bleue, déchirée, les reins â peine couverts des lambeaux d’une chemise
en guenilles, mais le fusil sur l’épaule, ou la ligne à la main sur les bords du
torrent, attendant pour dîner qu’ils aient pris quelques petits poissons, couchant
souvent par terre au milieu des bois, jouissent plus de la dignité, de
la noblesse de leur couleur, que les plus riches et les plus fiers colons de la
plaine.
Qu’elle a de charmes cette vie errante, armée,- périlleuse, des chasseurs des
montagnes! C’est là que sémontre le goût du peuple pour la poésie! c’est là
que pe révèle son imagination! Il y a bien des passions mises en jeu dans
la vie de Ces hommes-là! Ceux qui vivent au-dessous d’eux, dans les plaines,
au sein de l’abondance, ■ mais livrés à des travaux sans relâche, n’ont pas
besoin d’être esclaves pour qu’ils les regardent avec mépris. Les Highlanders
de l’Ecosse, les Klephtes de la Grèce moderne, les hardis montagnards qui
poursuivent le chamois et le bouquetin dans les Alpes et les Pyrénées, envient
ils l’existence toute symétrique et le sort tranquille de leurs frères qui
vivent dans les plaines ou dans le fond de leurs vallées ?
La vie errante de l’Arabe dans le désert a lés mêmes misères et les mêmes
charmes. : on sait combien il est difficile de l’en détacher. N’est-ce pas le
meme instinct qui s’oppose- à la civilisation des Indiens de l’Amérique septentrionale
P
Nous sommes d’autant plus libres, a-t-on d it , que nous sommes plus éclairés,
plus industrieux et plus justes. Cela est vrai, suivant l’acception que l’on
donne à ce mot de liberté. Il est certain que notre faiblesse, que notre isolement,
que notre ignorance nous font bien plus esclaves de la nature, dans
l’état sauvage, que nous ne le sommes dans l’état de société. Les sciences et
les arts nous rendent son joug plus facile à porter. L’homme civilisé satisfait
plus aisément que l’homme sauvage aux besoins naturels qui tourmentent sans
cesse et qui menacent souvent la vie de celui-ci. La civilisation, l’industrie,
comme 'on l’a dit, nous affranchissent, il est vrai, d’une partie de ces dépendances
étroites, mais elles nous imposent de nouvelles entraves. C’est la fable
du cheval qu i, pour se venger du cerf, eut recours à l’homme et devint son
esclave. La civilisation n’affranchit partiellement l’homme de la nature, qu’en
l asservissant à l’homme. Pour moins dépendre des choses, nous dépendons bien
davantage des uns dés autres dans l’état de société. De tous les jougs que