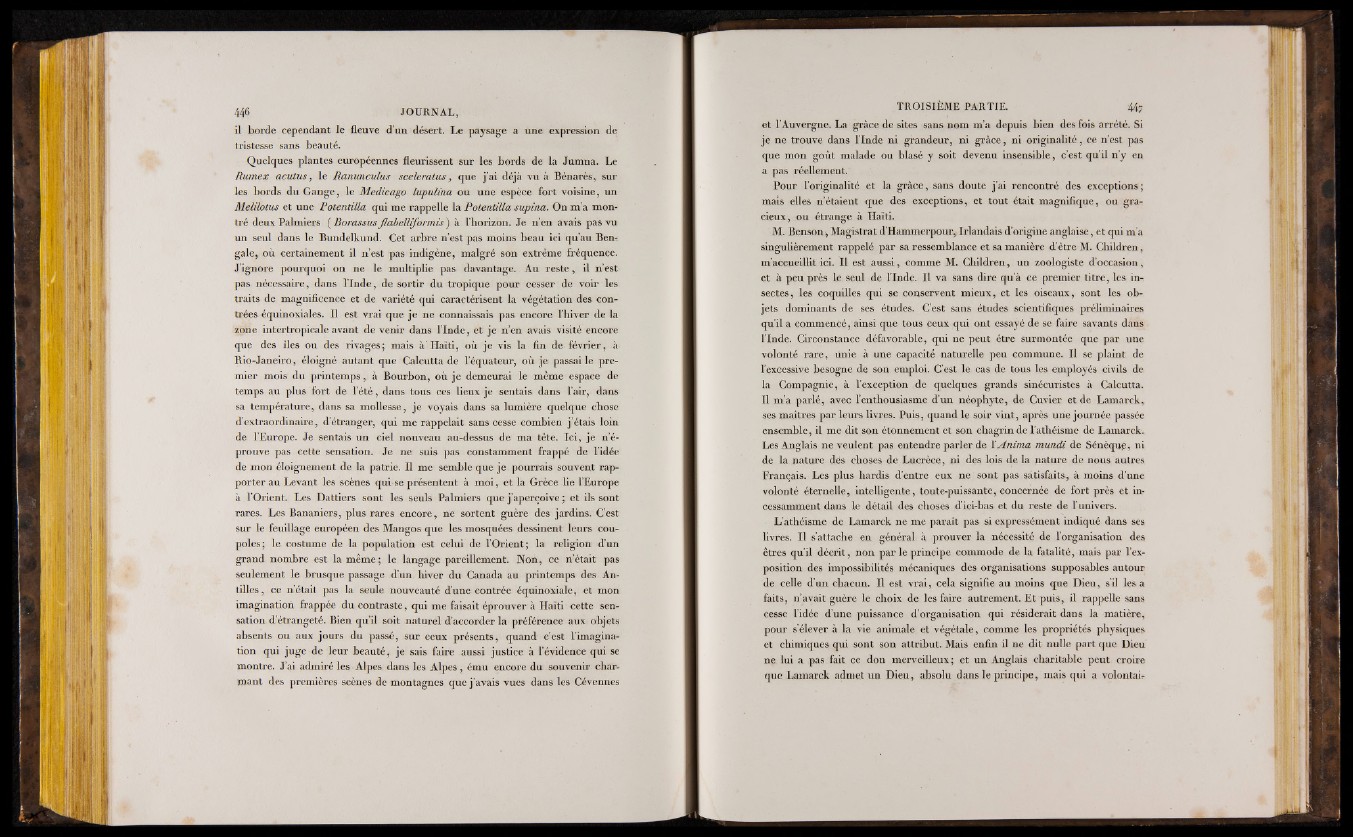
il borde cependant le fleuve d’un désert. Le paysage a une expression de
tristesse sans beauté.
Quelques plantes européennes fleurissent sur les bords de la Jumna. Le
Rumex acutus, le Ranunculus sceleratus, que j ’ai déjà vu à Bénarès, sur
les bords du Gange, le Medicago lupulina ou une espèce fort voisine, un
Melilotus et une Potentilla qui me rappelle la Potentilla supina. On m’a montré
deux Palmiers ( Borassusflabelliformis ) à l’horizon. Je n’en avais pas vu
un seul dans le Bundelkund. Cet arbre n’est pas moins beau ici qu’au Bem
gale, où certainement il n’est pas indigène, malgré son extrême fréquence.
J’ignore pourquoi on ne le multiplie pas davantage. Au re s te , il n’est
pas nécessaire, dans l’Inde, de sortir du tropique pour cesser de voir les
traits de magnificence et de variété qui caractérisent la végétation des contrées
équinoxiales. Il est vrai que je ne connaissais pas encore l’hiver de la
zone intertropicale avant de venir dans l’Inde, et je n’en avais visité encore
que des îles ou des riyages; mais à Haïti, où je vis la fin de février, à
Rio-Janeiro, éloigné autant que Calcutta de l’équateur, où je passai le premier
mois du printemps, à Bourbon, où je demeurai le même espace de
temps au plus fort de l’é té , dans tous ces lieux je sentais dans l’air, dans
sa température, dans sa mollesse, je voyais dans sa lumière quelque chose
d’extraordinaire, d’étranger, qui me rappelait sans cesse combien j ’étais loin
de l’Europe. Je sentais un ciel nouveau au-dessus de ma tête. Ici, je n’éprouve
pas cette sensation. Je ne suis pas constamment frappé de l’idée
de mon éloignement de la patrie. Il me semble que je pourrais souvent rapporter
au Levant les scènes qui se présentent à moi, et la Grèce lie l’Europe
à l’Orient. Les Dattiers sont les seuls Palmiers que j ’aperçoive ; et ils sont
rares. Les Bananiers, plus rares encore, ne sortent guère des jardins. C’est
sur le feuillage européen des Mangos que les mosquées dessinent leurs coupoles;
le costume de la population est celui de l’Orient; la religion d’un
grand nombre est la même; le langage pareillement. Non, ce n’était pas
seulement le brusque passage d’un hiver du Canada au printemps des Antilles
, ce n’était pas la seule nouveauté d’une contrée équinoxiale, et mon
imagination frappée du contraste, qui me faisait éprouver à Haïti cette sensation
d’étrangeté. Bien qu’il soit naturel d’accorder la préférence aux objets
absents ou aux jours du passé, sur ceux présents, quand c’est l’imagination
qui juge de leur beauté, je sais faire aussi justice à l’évidence qui se
montre. J’ai admiré les Alpes dans les Alpes, ému encore du souvenir charmant
des premières scènes de montagnes que j ’avais vues dans les Cévennes
TROISIÈME PARTIE. 447
et l’Auvergne. La grâce de sites sans nom m’a depuis bien des fois arrêté. Si
je ne trouve dans l’Inde ni grandeur, ni grâce, ni originalité, ce n’est pas
que mon goût malade ou blasé y soit devenu insensible, c’est qu’il n’y en
a pas réellement.
Pour l’originalîté et la grâce, sans doute j ’ai rencontré des exceptions;
mais elles n’étaient que des exceptions, et tout était magnifique, ou gracieux,
ou étrange à Haïti.
M. Benson, Magistrat d’Hammerpour, Irlandais d’origine anglaise, et qui m ’a
singulièrement rappelé par sa ressemblance et sa manière d’être M. Children,
m’accueillit ici. II est aussi, comme M. Children, un zoologiste d’occasion,
et à peu près le seul de l’Inde. Il va sans dire qu’à ce premier titre, les insectes,
les coquilles qui se conservent mieux, et les oiseaux, sont les objets
dominants de ses études. C’est sans études scientifiques préliminaires
qu’il a commencé, ainsi que tous Ceux qui ont essayé de se faire savants dans
l’Inde. Circonstance défavorable, qui ne peut être surmontée que par une
volonté rare, unie à une capacité naturelle peu commune. Il se plaint de
l’excessive besogne de son emploi. C’est le cas de tous les employés civils de
la Compagnie, à l’exception de quelques grands sinécuristes à Calcutta.
Il m’a parlé, avec l’enthousiasme d’un néophyte, de Cuvier et de Lamarck,
ses maîtres par leurs livres. Puis, quand le soir vint, après une journée passée
ensemble, il me dit son étonnement et son chagrin de l’athéisme de Lamarck.
Les Anglais ne veulent pas entendre parler de XAnima mundi de Sénèquç, ni
de la nature dés choses de Lucrèce, ni des lois de la nature de nous autres
Français. Les plus hardis d’entre eux ne sont pas satisfaits, à moins d’une
volonté éternelle, intelligente, toute-puissante, concernée de fort près et incessamment
dans le détail des choses d’içi-bas et du reste de l’univers.
L ’athéisme de Lamarck ne me parait pas si expressément indiqué dans ses
livres. Il s’attache en général à prouver la nécessité de l’organisation des
êtres qu’il décrit, non p a r le principe commode de la fatalité, mais par l ’exposition
des impossibilités mécaniques des organisations supposables autour
de celle d’un chacun. Il est vrai, cela signifie au moins que Dieu, s’il les a
faits, n’avait guère le choix de les faire autrement. Et puis, il rappelle sans
cesse l’idée d’une puissance d’organisation qui résiderait dans la matière,
pour s’élever à la vie animale et végétale, comme les propriétés physiques
et chimiques qui sont son attribut. Mais enfin il ne dit nulle part que Dieu
ne lui a pas fait ce don merveilleux; et un Anglais charitable peut croire
que Lamarck admet un Dieu, absolu dans le principe, mais qui a volontair