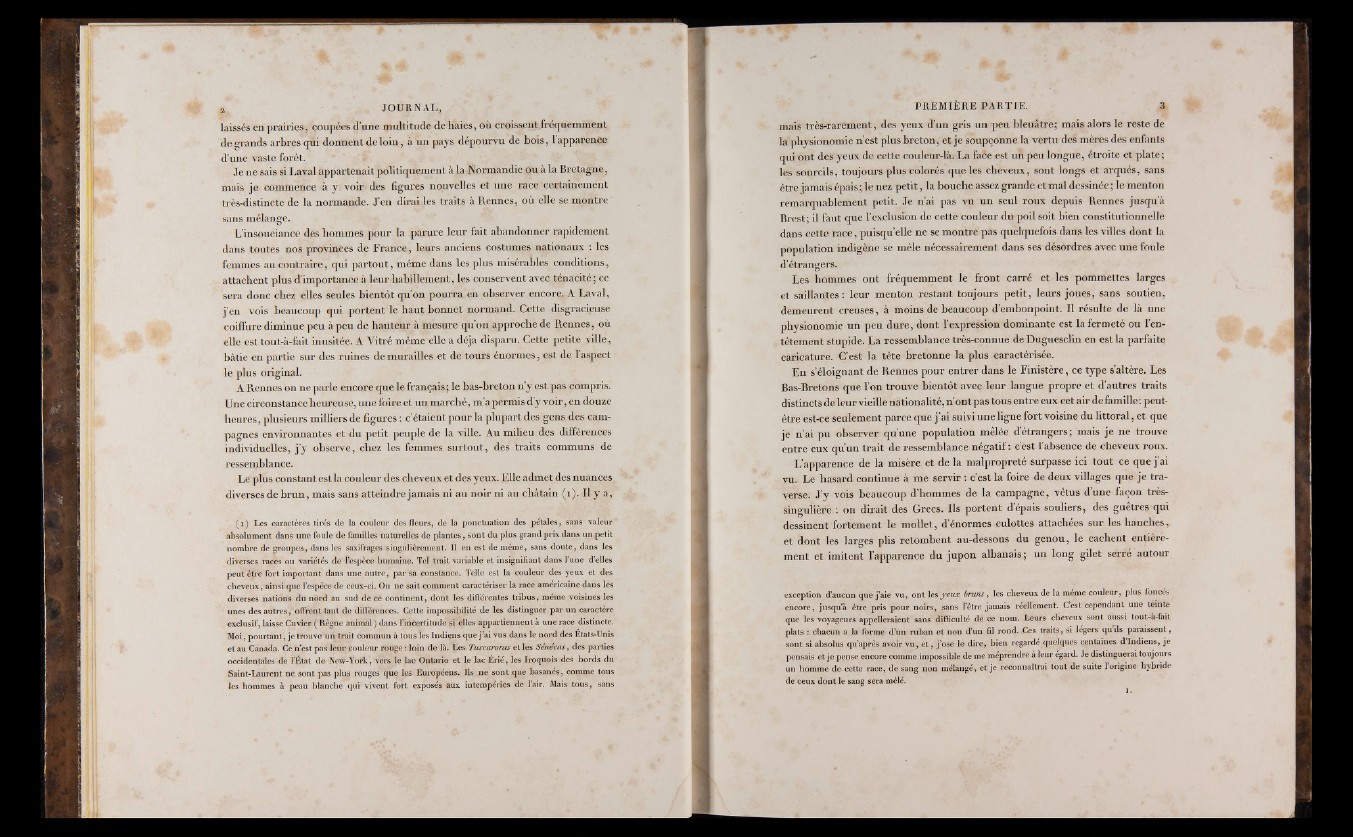
laissés en prairies, c o u p é e s d’une multitude de haies, où croissent fréquemment
de grands arbres qùi donnent de loin, à un pays dépourvu de bois, 1 apparence
d’une vaste forêt.
Je ne sais si Laval appartenait politiquement à la Normandie ou à la Bretagne,
mais je commence à y voir des figures nouvelles et une race'certainement
très-distincte de la normande. J’en dirai les traits à Rennes, où elle se montre
sans mélange.
L’insouciance des hommes pour la parure leur fait abandonner rapidement
dans toutes nos provinces de France, leurs anciens costumes nationaux : les
femmes au contraire, qui partout, même dans les plus misérables conditions,
attachent plus d’importance à leur habillement, les conservent avec ténacité ; ce
sera donc chez elles seules bientôt qu’on pourra en observer encore, A Laval,
j ’en vois beaucoup qui portent le haut bonnet normand. Cette disgracieuse
coiffure diminue peu à peu de hauteur à mesure qu’on approche de Rennes, où
elle est tout-à-fait inusitée. A Vitré même elle a déjà disparu. Cette petite ville,
bâtie en partie sur des ruines de murailles et de tours énormes, est de l’aspect
le plus original.
A Rennes on ne parle encore que le français; le bas-breton n’y est pas compris.
Une circonstance heureuse, nue foire et un marché, m’a permis d y voir, en douze
heures, plusieurs milliers de figures : c’étaient pour la plupart des gens des campagnes
environnantes et du petit peuple de la ville. Au milieu des différences
individuelles, j’y observe, chez les femmes surtout, des traits communs de
ressemblance.
Le plus constant est la couleur des cheveux et des yeux. Elle admet des nuances
diverses de brun, mais sans atteindre jamais ni au noir ni au châtain (1). Il y a,
( i ) Les caractères tirés de la couleur des fleurs, de la ponctuation des pétales, sans valeur
absolument dans une foule de familles naturelles de plantes, sont du plus grand prix dans un petit
nombre de groupes, dans les saxifrages singulièrement. 11 en est de même, sans doute, dans les
diverses.races ou variétés de l’espèce humaine. Tel trait variable et insignifiant dans l’une d’elles
peut être fort important dans une autre, par sa constance. Telle est la couleur des yeux et des
cheveux, ainsi que l’espèce de ceux-ci. On ne sait comment caractériser la race américaine dans lés
diverses nations du nord au sud de ce continent, dont les différentes tribus, même voisines les
unes des autres, offrent tant de différences. Cette impossibilité de les distinguer par un caractère
exclusif, laisse Cuvier ( Règne animal) dans l’incertitude si elles appartiennent à une race distincte.
Moi, pourtant, je trouve un trait commun à tous les Indiens que j ’ai vus dans le nord des États-Unis
et au Canada. Ce n’est pas leur couleur rouge : loin de là. Les Tuscaroras et les Sénécas, des parties
occidentales de l’État de New-York, vers le lac Ontario et le lac Érié, les Iroquois des bords du
Saint-Laurent ne sont pas plus rouges que les Européens. Ils ne sont que basanés, comme tous
les hommes à peau blanche qui vivent foît exposés aux intempéries de l’air. Mais tous, sans
mais très^rarement, des yeux d’un gris un peu bleuâtre; mais alors le reste de
la physionomie n’est plus breton, et je soupçonne la vertu des mères des enfants
qui ont des yeux de cette oouleur-là. La face est un peu longue, étroite et plate;
les sourcils, toujours plus colorés que les cheveux, sont longs et arqués, sans
être jamais épais ; le nez petit, la bouche assez grande et mal dessinée ; le menton
remarquablement petit. Je n’ai pas vu un seul roux depuis Rennes jusqu a
Brest; il faut que l’exclusion de cette couleur du poil soit bien constitutionnelle
dans cette race, puisqu’elle ne se montre pas quelquefois dans les villes dont la
population indigène se mêle nécessairement dans ses désordres avec une foule
d’étrangers.
Les hommes ont fréquemment le front carré et les pommettes larges
et saillantes: leur menton restant toujours petit, leurs joues, sans soutien,
demeurent creuses, à moins de beaucoup d’embonpoint. Il résulte de là une
physionomie un peu dure, dont l’expression dominante est la fermeté ou l’entêtement
stupide. La ressemblance très-connue de Duguesclin en est la parfaite
caricature. C’est la tête bretonne la plus caractérisée.
En s’éloignant de Rennes pour entrer dans le Finistère, ce type s’altère. Les
Bas-Bretons que l’on trouve bientôt avec leur langue propre et d’autres traits
distincts de leur vieille nationalité, n’ont pas tous entre eux cet air de famille : peut-
être est-ce seulement parce que j ’ai suivi une ligne fort voisine du littoral, et que
je n’ai pu observer qu’une population melée d étrangers; mais je ne trouve
entre eux qu’un trait de ressemblance négatif : c’est l’absence de cheveux roux.
L’apparence de la misère et de la malpropreté surpasse ici tout ce que j ’ai
vu. Le hasard continue à me servir : c’est la foire de deux villages que je traverse.
J’y vois beaucoup d’hommes de la campagne, vêtus d’une façon très-
singulière | on dirait des Grecs. Ils portent d’épais souliers, des guêtres qui
dessinent fortement le mollet, d’énormes culottes attachées sur les hanches,
et dont les larges plis retombent au-dessous du genou, le cachent entièrement
et imitent l’apparence du jupon albanais; un long gilet serre autour
exception d’aucun que j’aie vu, ont les yeux bruns, les cheveux de la même couleur, plus foncés
encore, jusqu’à être pris pour noirs, sans l’être jamais réellement. C’est cependant une téinte
que les voyageurs appelleraient sans difficulté de ce nom. Leurs cheveux sont aussi tout-a-fait
plats : chacun a la forme d’un ruban et non d’un fil rond. Ces traits, si légers quils paraissent,
sont si absolus qu’après avoir vu, e t , j ’ose le dire, bien regardé quelques centaines d Indiens, je
pensais et je pense encore comme impossible de me méprendre à leur égard. Je distinguerai toujours
un homme de cette race, de sang non mélangé, et je reconnaîtrai tout de suite 1 origine hybride
de ceux dont le sang sera mêlé.