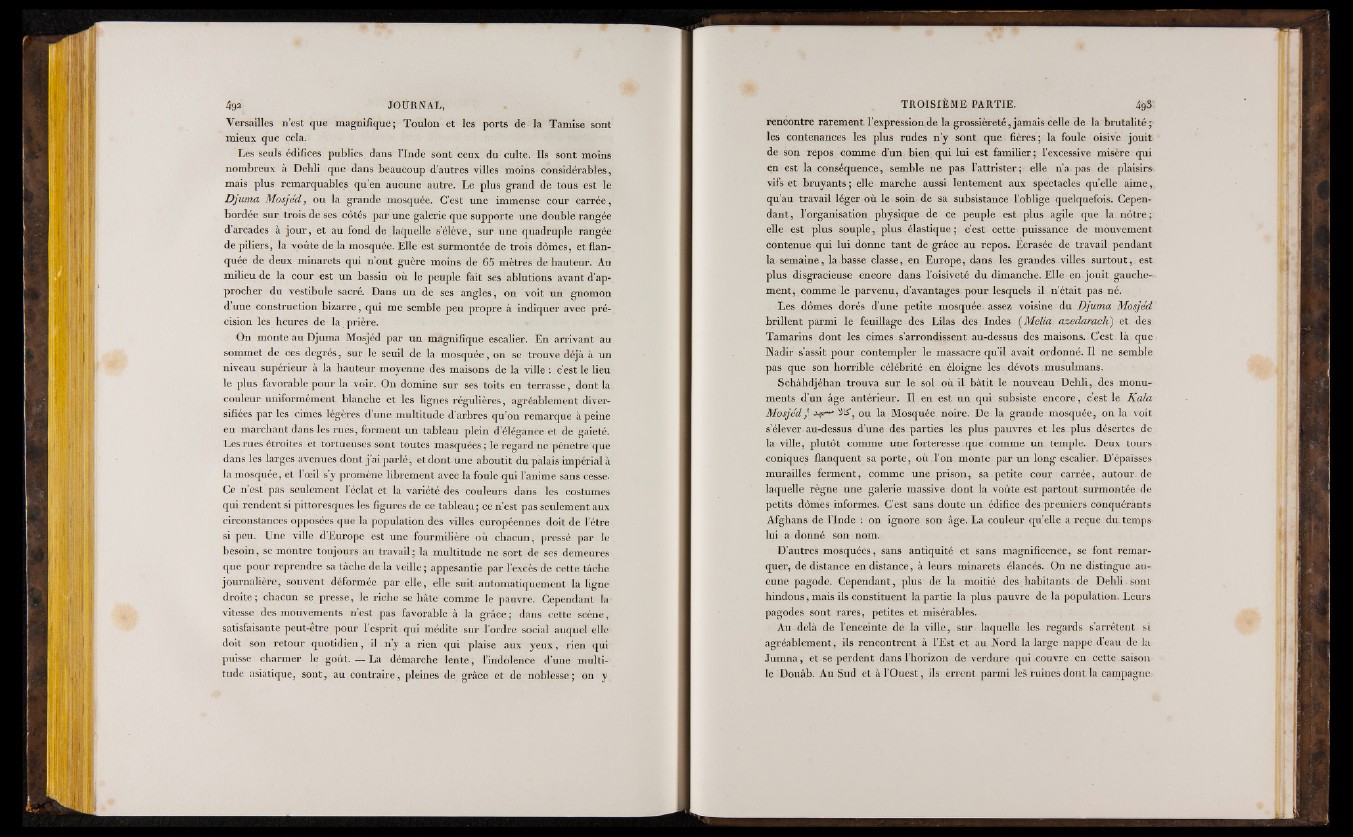
Versailles n’est que magnifique; Toulon et les ports de la Tamise sont
mieux que cela.
Les seuls édifices publics dans l’Inde sont ceux du culte. Ils sont moins
nombreux à Dehli que dans beaucoup d’autres villes moins considérables,
mais plus remarquables qu’en aucune autre. Le plus grand de tous est le
Djuma Mosjéd, ou la grande mosquée. C’est une immense cour carrée,
bordée sur trois de ses côtés par une galerie que supporte une double rangée
d’arcades à jou r, et au fond de laquelle s’élève, sur une quadruple rangée
de piliers, la voûte de la mosquée. Elle est surmontée de trois dômes, et flanquée
de deux minarets qui n’ont guère moins de 65 mètres de hauteur. Au
milieu de la cour est un bassin où le peuple fait ses ablutions avant d’approcher
du «vestibule sacré. Dans un de ses angles, on voit un gnomon
d une construction bizarre, qui me semble peu propre à indiquer avec précision
les heures de la prière.
On monte au Djuma Mosjéd par un magnifique escalier. En arrivant au
sommet de ces degrés, sur le seuil de la mosquée, on se trouve déjà à un
niveau supérieur à la hauteur moyenne des maisons de la ville : c’est le lieu
le plus favorable pour la voir. On domine sur ses toits en terrasse, dont la
couleur uniformément blanche et les lignes régulières, agréablement diversifiées
par les cimes légères d’une multitude d’arbres qu’on remarque à peine
en marchant dans les rues, forment un tableau plein d’élégance et de gaieté.
Les rues étroites et tortueùses sont toutes masquées; le regard ne pénètre que
dans les larges avenues dont j ’ai parlé , et dont une aboutit du palais impérial à
la mosquée, et 1 oeil s y promène librement avec la foule qui l’anime sans cesse.
Ce n est pas seulement l’éclat et la variété des couleurs dans les costumes
qui rendent si pittoresques les figures de ce tableau; ce n’est pas seulement aux
circonstances opposées que la population des villes européennes doit de l’être
si peu. Une ville d Europe est une fourmilière où chacun, pressé par le
besoin, se montre toujours au travail; la multitude ne sort de ses demeures
que pour reprendre sa tâche de la veille ; appesantie par l’excès de cette tâche
journalière, souvent déformée par elle, elle suit automatiquement la ligne
droite; chacun se presse, le riche se hâte comme le pauvre. Cependant la
vitesse des mouvements n’est pas favorable à la grâce; dans cette scène,
satisfaisante peut-etre pour l’esprit qui médite sur Tordre social auquel elle
doit son retour quotidien, il n’y a rien qui plaise aux y eu x , rien qui
puisse charmer le goû t.H -L a démarche lente, l’indolence d’une multitude
asiatique, sont, au contraire, pleines de grâce et de noblesse; on y.
rencontre rarement l'expression de la grossièreté, jamais celle de la brutalité;
les contenances les plus rudes n’y sont que fières ; la foule oisive jouit
de son repos comme d’un bien qui lui est familier; l’excessive misère qui
en est la conséquence, semble ne pas l’attrister; elle n’a-pas de plaisirs
vifs et bruyants; elle marche aussi lentement aux spectacles quelle aime,
qu’au travail léger où le soin de sa subsistance l’oblige quelquefois. Cependant,
l’organisation physique de ce peuple est plus agile que la. nôtre;
elle est plus souple, plus élastique ; c’est cette puissance de mouvement
contenue qui lui donne tant de grâce au repos. Ecrasée de travail pendant
la semaine, la basse classe, en Europe, dans les grandes villes surtout,. est
plus disgracieuse encore dans l’oisiveté du dimanche. Elle en jouit gauchement,
comme le parvenu, d’avantages pour lesquels il n’était pas né.
Les dômes dorés d’une petite mosquée, assez voisine du Djuma Mosjéd
brillent parmi le feuillage des Lilas des Indes (Melia azedaracK) et des
Tamarins dont les cimes s’arrondissent au-dessus des maisons. C’est là que
Nadir s’assit pour contempler le massacre qu’il avait ordonné. Il ne semble
pas que son horrible célébrité en éloigne les dévots , musulmans.
Schâhdjéhan trouva sur le sol où il bâtit le nouveau Dehli, des monuments
d’un âge antérieur. Il en est un qui subsiste encore, c’est le Kala
Mosjéd j ül/, ou la Mosquée noire. De la grande mosquée, on la voit
s’élever au-dessus d’une des parties les plus pauvres et les plus désertes de.
la ville, plutôt comme une. forteresse que comme un temple. Deux tours
coniques flanquent sa porte, où l’on monte par un long escalier. D’épaisses
murailles ferment, comme une prison, sa petite cour carrée, autour de
laquelle règne une galerie massive dont la voûte est partout surmontée de
petits dômes informes. C’est sans doute un édifice des premiers conquérants
Afghans de l’Inde : on ignore son âge. La couleur qu’elle a reçue du temps
lui a donné son nom.
D’autres mosquées, sans antiquité et sans magnificence, se font remarquer,
de distance en distance, à leurs minarets élancés. On ne distingue aucune
pagode. Cependant, plus de la moitié des habitants de Dehli. sont
hindous, mais ils constituent la partie la plus pauvre de la population. Leurs
pagodes sont rares, petites et misérables.
Au delà de l ’enceinte de la ville, sur laquelle les regards s’arrêtent si
agréablement, ils rencontrent à l’Est et au Nord la large nappe d’eau de la
Jumna, et se perdent dans l’horizon de verdure qui couvre en cette saison
le Douâb. Au Sud et à l’Ouest, ils errent parmi les ruines dont la campagne*