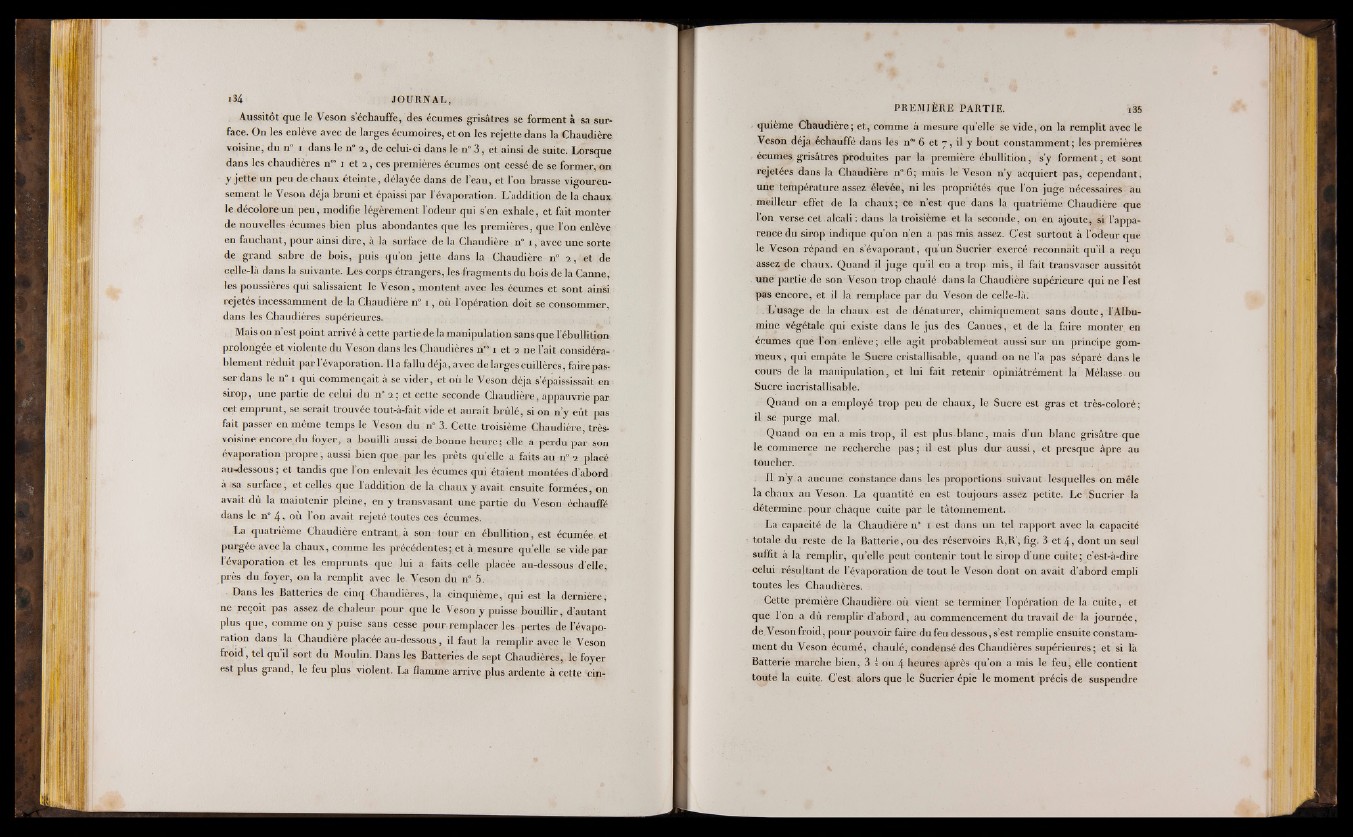
Aussitôt que le Veson s’échauffe, des écumes grisâtres se forment à sa surface.
On les enlève avec de larges écumoires, et on les rejette dans la Chaudière
voisine, du n” i dans le n° 2, de celui-ci dans le n" 3 , et ainsi de suite. Lorsque
dans les chaudières n“ 1 et 2, ces premières écumes ont cessé de se former, on
y jette un peu de chaux éteinte, délayée dans de l’eau, et l’on brasse vieoureu-
sement le Veson déjà bruni et épaissi par l’évaporation. L ’addition de la chaux
le décolore un peu, modifie légèrement l’odeur qui s’en exhale, et fait monter
de nouvelles écumes bien plus abondantes que les premières, que l’on enlève
en fauchant, pour ainsi dire, à la surface de la Chaudière n°. 1 ,'avec une sorte
de grand sabre de bois, puis qu’on jette dans la Chaudière n° 2, et de
celle-là dans la suivante: Les corps étrangers, les fragments du bois de la Canne,
les poussières qui salissaient le Veson, montent avec les écumes et sont ainsi
rejetés incessamment de la Chaudière n° 1 , où l’opération doit se consommer,
dans les Chaudières supérieures.
Mais on n’est point arrivé à cette partie de la manipulation sans que l’ébullition
prolongée et violente du Veson dans les Chaudières n“ 1 et 2 ne l’ait considérablement
réduit par l’évaporation. lia fallu déjà, avec de larges cuillères, faire passer
dans le u° I qui commençait à se vider, et où le Veson déjà s’épaississait en
sirop, une partie de celui du n° 2; et cette seconde Chaudière, appauvrie par
cet emprunt, se serait trouvée tout-à-fait vide et aurait brûlé, si on n’y eût pas
fait passer en même temps le Veson du n° 3. Cette troisième Chaudière, très-
voisine encore du foyer, a bouilli aussi.de bonne heure; elle a perdu par son
évaporation propre , aussi bien que par les prêts qu’elle a faits au 11“ 2 placé
au-dessous; et tandis que l’on enlevait les écumes qui étaient montées d’abord
à sa surface, et celles que 1 addition de la chaux y avait ensuite formées, on
avait dù la maintenir pleine, en y transvasant une partie du Veson échauffé
dans le n° 4 , où l’on avait rejeté toutes ces écumes.
L a quatrième Chaudière entrant, à son tour en ébullition, est écumée, et
purgée avec la chaux, comme les précédentes ; et à mesure quelle se vide par
l’évaporation-et les emprunts que lui a faits celle placée au-dessous d’elle,
près du foyer, on la remplit avec le. Veson du n° 5. .
Dans les Batteries de cinq Chaudières, la cinquième, qui est la dernière,
ne reçoit pas assez de chaleur pour que le Veson y puisse bouillir, d’autant
plus que, comme on y puise sans cesse pour.remplacer les pertes de l’évaporation
dans la Chaudière placée au-dessous, il faut la remplir avec le Veson
froid, tel qu’il sort, du Moulin. Dans les Batteries de sept Chaudières, le foyer
est plus grand, le feu plus violent. La flamme arrive plus ardente à cette c in quième
Chaudière; et, comme à mesure quelle se vide, on la remplit avec le
Veson déjà échauffé dans les n“ 6 et 7 , il y bout constamment; les premières
écumes grisâtres produites par la première ébullition, s’y forment, et sont
rejetées dans la Chaudière n"-6; mais le Veson n’y acquiert pas, cependant,
une température assez élevée, ni les propriétés que l’on juge nécessaires- au
meilleur effet de la chaux; ce n’est que dans la quatrième Chaudière que
l’on verse cet alcali : dans la troisième et la seconde, on en ajoute, si l’apparence
du sirop indique qu’on n’en a pas mis assez. C’est surtout à l’odeur que
le Veson répand en s’évaporant , qu’un Sucrier exercé reconnaît qu’il a reçu
assez de chaux. Quand il juge qu’il en a trop mis, il fait transvaser aussitôt
une partie de son Veson trop chaulé dans la Chaudière supérieure qui ne l’est
pas encore, et il la remplace par du Veson de celle-là:
. L’usage de la chaux, est de dénaturer, chimiquement sans doute, l’Albumine
végétale qui existe dans le jus des Canues , et de la faire monter en
écumes que l’on enlève ; elle agit probablement aussi sur un principe gommeux,
qui empâte le Sucre cristallisable, quand on ne l’a pas séparé dans le
cours de la manipulation, et lui fait retenir opiniâtrement la Mélasse ou
Sucre incristallisable.
Quand on a employé trop peu de chaux, le Sucre est gras et très-coloré;
il se purge mal.
Quand ou en a mis trop, il est plus blanc, mais d’un blanc grisâtre que
le commerce ne recherche pas; .il est plus dur aussi, et presque âpre au
toucher. ■ , .
Il n’y.a aucune constance dans les proportions suivant lesquelles on mêle
la chaux au Veson. La quantité en est toujours assez petite. Le Sucrier la
détermine. pour chaque cuite par le tâtonnement.
La capacité de la Chaudière n" 1 est dans un tel rapport avec la capacité
totale du reste de la Batterie,»ou des réservoirs R,K’, fig. 3 et 4, dont un seul
suffit à la remplir, qu’elle peut contenir tout le sirop d’une cuite; c’est-à-dire
celui résultant de l’évaporation de tout le Veson dont on avait d’abord empli
toutes les Chaudières. .
Cette première Chaudière.où vient se terminer l’opération de la. cuite, et
que Ion. a dù remplir d’abord, au commencement du travail de la journée,
de.Veson froid, pour pouvoir faire du feu dessous, s’est remplie ensuite constamment
du Veson écumé, chaulé; condensé des Chaudières supérieures; et si là
Batterie marche bien, 3 é ou 4 heures après qu’on a mis le feu, elle contient
toute la cuite. C’est alors que le Sucrier épie le moment précis de suspendre