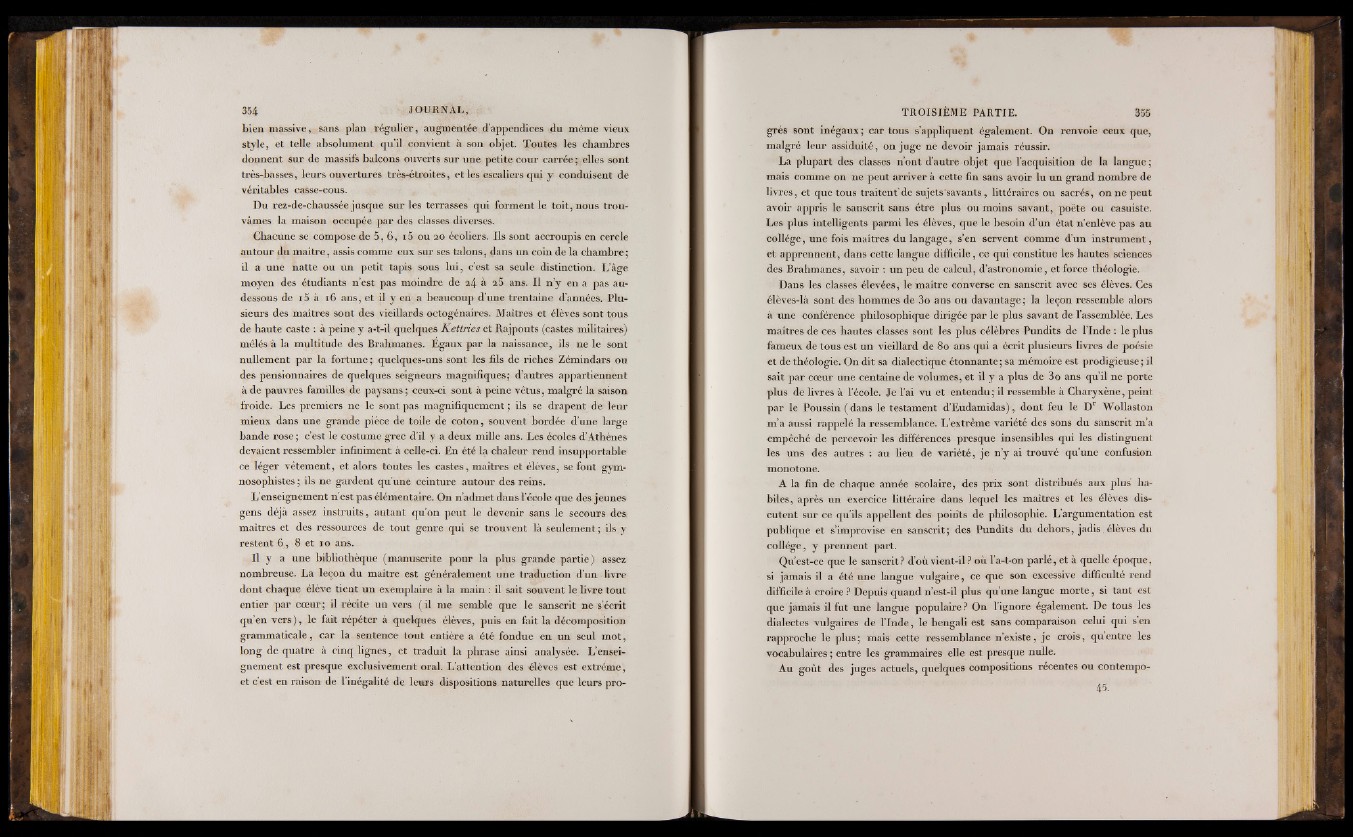
bien massive, sans plan régulier, augmentée d’appendices du même vieux
style, et telle absolument qu’il convient à son objet. Toutes les chambres
donnent sur de massifs balcons ouverts sur une petite cour carrée ; elles sont
très-basses, leurs ouvertures très-étroites, et les escaliers qui y conduisent de
véritables casse-cous.
Du rez-de-chaussée jusque sur les terrasses qui forment le toit, nous trouvâmes
la maison occupée par des classes diverses.
Chacune se compose de 5 , 6, 15 ou 20 écoliers. Ils sont accroupis en cercle
autour du maître, assis comme eux sur ses talons, dans un coin de la chambre ;
il a une natte ou un petit tapis sous lui, c’est sa seule distinction. L ’âge
moyen des étudiants n’est pas moindre de 24 à 25 ans. Il n’y en a pas au-
dessous de i 5 à 16 ans, et il y en a beaucoup d’une trentaine d’années. Plusieurs
des maîtres sont des vieillards octogénaires. Maîtres et élèves sont tous
de haute caste : à peine y a-t-il quelques Kettries et Rajpouts (castes militaires)
mêlés à la multitude des Brahmanes. Egaux par la naissance, ils ne le sont
nullement par la fortune ; quelques-uns sont les fils de riches Zémindars ou
des pensionnaires de quelques seigneurs magnifiques; d’autres appartiennent
à de pauvres familles de paysans; ceux-ci sont à peine vêtus, malgré la saison
froide. Les premiers ne le sont pas magnifiquement ; ils se drapent de leur
mieux dans une grande pièce de toile de coton, souvent bordée d’une large
bande rose ; c’èst le costume grec d’il y a deux mille ans. Les écoles d’Athènes
devaient ressembler infiniment à celle-ci. En été la chaleur rend insupportable
ce léger vêtement, et alors toutes les castes, maîtres et élèves, se font gym-
nosophistes ; ils ne gardent qu’une ceinture autour des reins.
L ’enseignement n’est pas élémentaire. On n’admet dans l’école que des jeunes
gens déjà assez instruits, autant qu’on peut le devenir sans le secours des
maîtres et des ressources de tout genre qui se trouvent là seulement; ils y
restent 6 , 8 et 10 ans.
Il y a une bibliothèque (manuscrite pour la plus grande partie) assez
nombreuse. La leçon du maître est généralement une traduction d’un livre
dont chaque élève tient un exemplaire à la main : il sait souvent le livre tout
entier par coeur; il récite un vers ( il me semble que le sanscrit ne s’écrit
qu’en v ers), le fait répéter à quelques élèves, puis en fait la décomposition
grammaticale, car la sentence tout entière a été fondue en un seul m o t,
long de quatre à cinq lignes, et traduit la phrase ainsi analysée. L’enseignement
est presque exclusivement oral. L’attention des élèves est extrême,
et c’est en raison de l’inégalité de leurs dispositions naturelles que leurs progrès
sont inégaux ; car tous s’appliquent également. On renvoie ceux que,
malgré leur assiduité, on juge ne devoir jamais réussir.
La plupart des classes n’ont d’autre objet que l’acquisition de la langue ;
mais comme on ne peut arriver à cette fin sans avoir lu un grand nombre de
livres, et que tous traitent'de sujets'savants, littéraires ou sacrés, on ne peut
avoir appris le sanscrit sans être plus ou moins savant, poète ou casuiste.
Les plus intelligents parmi les élèves, que le besoin d’un état n’enlève pas au
collège, une fois maîtres du langage, s’en servent comme d’un instrument,
et apprennent , dans cette langue difficile, ce qui constitue les hautes sciences
des Brahmanes, savoir : un peu de calcul, d’astronomie, et force théologie.
Dans les classes élevées, le maître converse en sanscrit avec ses élèves. Ces
élèves-là sont des hommes de 3o ans ou davantage ; la leçon ressemble alors
à une conférence philosophique dirigée par le plus savant de l’assemblée. Les
maîtres de ces hautes classes sont les plus célèbres Pundits de l’Inde : le plus
fameux de tous est un vieillard de 80 ans qui a écrit plusieurs livres de poésie
et de théologie. On dit sa dialectique étonnante ; sa mémoire est prodigieuse ; il
sait par coeur une centaine de volumes, et il y a plus de 3o ans qu’il ne porte
plus de livres à l’école. Je l’ai vu et entendu; il ressemble à Charyxène, peint
par le Poussin (dans le testament d’Eudamidas), dont feu le Dr Wollaston
m’a aussi rappelé la ressemblance. L’extrême variété des sons du sanscrit m’a
empêché de percevoir les différences presque insensibles qui les distinguent
les uns des autres : au lieu de variété, je n’y ai trouvé qu’une confusion
monotone.
A la fin de chaque année Scolaire, des prix sont distribués aux plus habiles,
après un exercice littéraire dans lequel les maîtres et les élèves discutent
sur ce qu’ils appellent des points de philosophie. L ’argumentation est
publique et s’improvise en sanscrit; des Pundits du dehors, jadis élèves du
collège, y prennent part.
Qu’est-ce que le sanscrit? d’où vient-il ? où l’a-t-on parlé, et à quelle époque,
si jamais il a été une langue vulgaire, ce que son excessive difficulté rend
difficile à croire ? Depuis quand n’est-il plus qu’une langue morte, si tant est
que jamais il fut une langue populaire? On l’ignore également. De tous les
dialectes vulgaires de l’Inde, le bengali est sans comparaison celui qui s’en
rapproche le plus; mais cette ressemblance n’existe, je crois, qu’entre les
vocabulaires ; entre les grammaires elle est presque nulle.
Au goût des juges actuels, quelques compositions récentes ou contempo