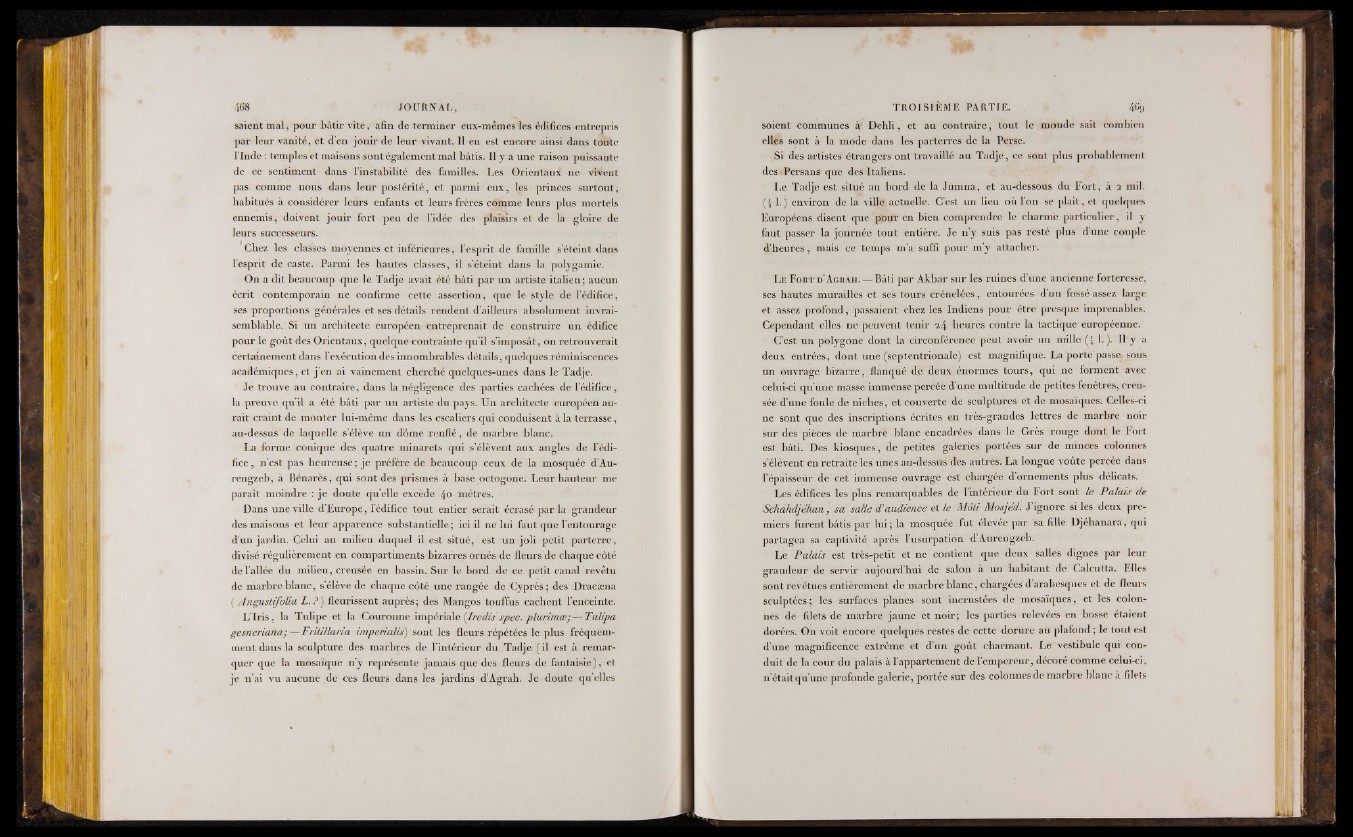
saient mal, pour bâtir vite, afin de terminer eux-mêmes les édifices entrepris
par leur vanité, et d’en jouir de leur vivant. Il en est encore ainsi dans toute
l’Inde : temples et maisons sont également mal bâtis. Il y a une raison puissante
de ce sentiment dans l’instabilité des familles. Les Orientaux ne vivent
pas comme nous dans leur postérité, et parmi eux, les princes surtout,
habitués à considérer leurs enfants et leurs frères comme leurs plus mortels
ennemis, doivent jouir fort peu de l’idée des plaisirs et de la gloire de
leurs successeurs.
Chez les classes moyennes et inférieures, l’esprit de famille s’éteint dans
l’esprit de caste. Parmi les hautes classes, il s’éteint dans la polygamie.
On a dit beaucoup que le Tadje avait été bâti par un artiste italien; aucun
écrit contemporain ne confirme cette assertion, que le style de l’édifice,
ses proportions générales et ses détails rendent d’ailleurs absolument invraisemblable.
Si un architecte européen entreprenait de construire un édifice
pour le goût des Orientaux, quelque contrainte qu’il s’imposât, on retrouverait
certainement dans l’exécution des innombrables détails, quelques réminiscences
académiques, et j ’en ai vainement cherché quelques-unes dans le Tadje.
Je trouve au contraire, dans la négligence des parties cachées de l’édifice,
la preuve qu’il a été bâti par un artiste du pays. Un architecte européen aurait
craint de monter lui-même dans les escaliers qui conduisent à la terrasse,
au-dessus de laquelle s’élève un dôme renflé, de marbre blanc.
La forme conique des quatre minarets qui s’élèvent aux angles de l’édifice,
n’est pas heureuse; je préfère de beaucoup ceux de la mosquée d’Aurengzeb,
à Bénarès, qui sont des prismes à base octogone. Leur hauteur me
parait moindre : je doute qu elle excède 40 mètres.
Dans une ville d’Europe, l’édifice tout entier serait écrasé par la grandeur
des maisons et leur apparence substantielle ; ici il ne lui faut que l ’entourage
d’un jardin. Celui au milieu duquel il est situé, est un joli petit parterre,
divisé régulièrement en compartiments bizarres ornés de fleurs de chaque côté
de l’allée du milieu, creusée en bassin. Sur le bord de ce petit canal revêtu
de marbre blanc, s’élève de chaque côté une rangée de Cyprès ; des Dracæna
( Angustifolia L . ?) fleurissent auprès; des Mangos touffus cachent l’enceinte.
L ’Iris, la Tulipe et la Couronne impériale [Iredisspec. plurimoe;— Talipa
gesneriana; — Fritillaria imperialis) sont les fleurs répétées le plus fréquemment
dans la sculpture des marbres de l’intérieur du Tadje ( i l est à remarquer
que la mosaïque 11’y représente jamais que des fleurs de fantaisie), et
je n’ai vu aucune de ces fleurs dans les jardins d’Agrah. Je doute qu’elles
soient communes à Dehli, et au contraire, tout le monde sait combien
elles sont à la mode dans les parterres de la Perse.
Si des artistes étrangers ont travaillé au Tadje, ce sont plus probablement
deslPersans que des Italiens.
Le Tadje est situé au bord de la Jumna, et au-dessous du Fort, à 2 mil.
(11.) environ de la ville actuelle. C’est un lieu où l’on se plaît, et quelques
Européens disent que pour en bien comprendre le charme particulier, il y
faut passer la journée tout entière. Je n’y suis pas resté plus d’une couple
d’heures, mais ce temps m’a suffi pour m’y attacher.
L e F o r t d ’A g r a h . — Bâti par Akbar sur les ruines d’une ancienne forteresse1,
ses hautes murailles et ses tours crénelées, entourées d’un fossé assez large
et assez profond, passaient chez les Indiens pour être presque imprenables.
Cependant elles ne peuvent tenir a4 heures contre la tactique européenne.
C’est un polygone dont la circonférence peut avoir un mille ( i 1.). Il y a
deux entrées, dont une (septentrionale) est magnifique. La porte passe- sous
un ouvrage bicarré, flanqué de deux énormes tours, qui ne formënt avec
celui-ci qu’une masse immense percée d’une multitude de petites fenêtres, creusée
d’une foule de niches, et couverte de sculptures et de mosaïques; Celles-ci
ne sont que des inscriptions écrites en très-grandes lettres de marbre noir
sur des pièces de marbre blanc encadrées dans le Grès rouge dont le Fort
est bâti. Des kiosques, de petites galeries portées sur de minces colonnes
s’élèvent en retraite les unes au-dessus des autres. La longue voûte percée dans
l’épaisseur de cet immense ouvrage est chargée d’ornements plus délicats.
Les édifices les plus remarquables de l’intérieur du Fort sont le Palais de
Schahdjéhan, sa salle d’audience et le Môti Mosjéd. J’ignore si les deux premiers
furent bâtis par lui ; la mosquée fut élevée par sa fille Djéhanara, qui
partagea sa captivité après l’usurpation d’Aurengzeb.
Le Palais est très-petit et ne contient que deux salles dignes par leur
grandeur de servir aujourd’hui de salon à un habitant de Calcutta. Elles
sont revêtues entièrement de marbre blanc, chargées d arabesques et de fleurs
sculptées; les surfaces planes sont incrustées de mosaïques, et lès colonnes
de filets de marbré jaune et noir; les parties relevées en bosse étaient
dorées. On voit encore quelques restés de cette dorure au plafond ; le tout est
d’une magnificence extrême et d’un goût charmant. L e vestibule qui conduit
de la cour du palais à l’appartement de l’empereur, décoré comme celui-ci,
n’était qu’une profonde galerie, portée sur des colonnes de marbre blanc a filets