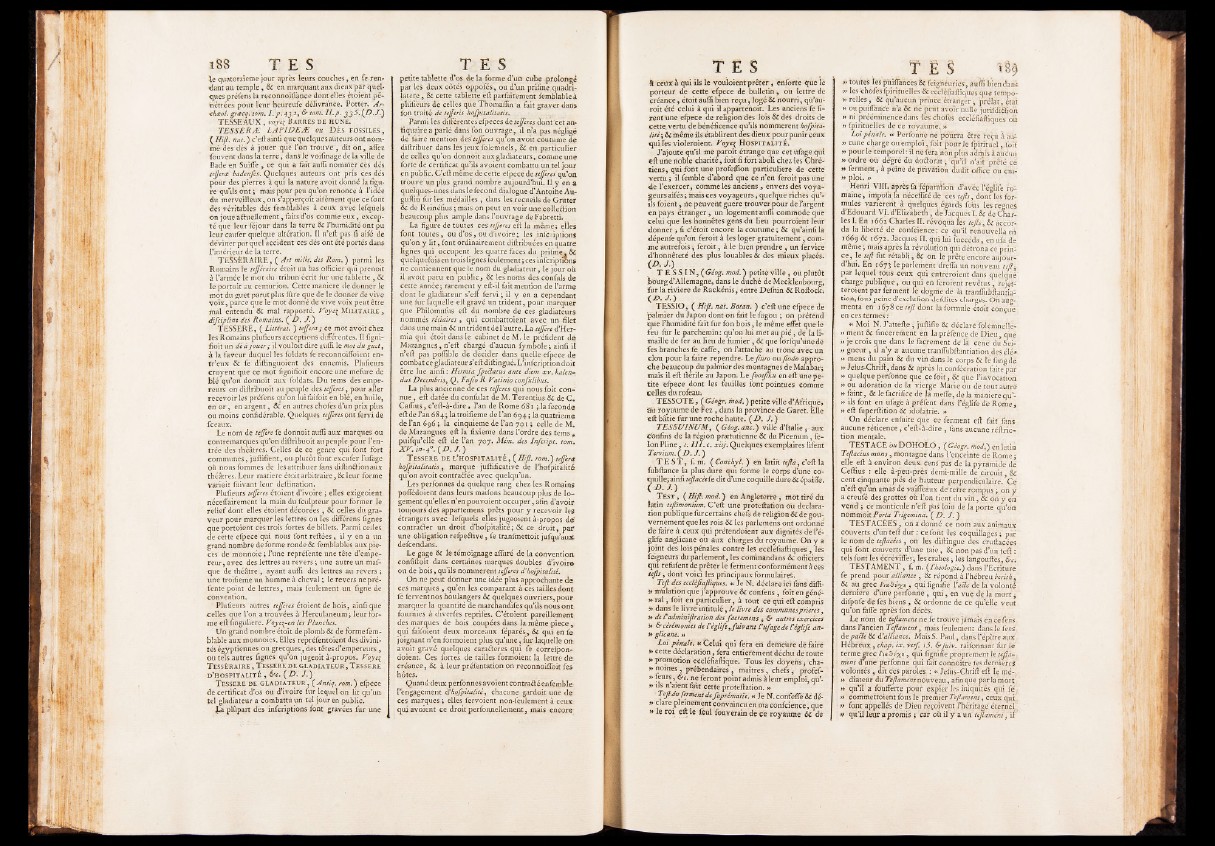
î88 TES
le quatorzième jour après leurs couches, en fe*rendant
au temple, & en marquant aux dieux par quelques
préfens la reconnoifl'aoce dont elles étoient pénétrées.
pour leur fieureufe délivrance. Potfêr. Ar-
chccol. greeçq.to'm. I .p : 43,2, &'tom. I l.p . fD .J .)
TESSEAUX, voyii Barres de Hune.
TESSERÆ LA P ID EÆ ou DÉS fossiles,
( Hift. nat. ) c’eft ainfi que quelque? atiteurs ont nommé
des dés à jouer que fon trouve“ , dit o h , allez
fouventdans la terre, danslë voifinagè de là ville de
Bade en Suifle , ce qui a fait auffi nomirièr çès dés
ujferoe badenfes. Quelques auteurs ont pris ces dés
pour des pierres à qui la nature avoit donné là figure
qu’ils ont ; mais pour peu qu’on renonce à l’idée
du merveilleux, on s’apperçoit ailément que ce font
des véritables dés f'emblables à ceux avec lefquels
on joue aftuellement, faits d’os comme eux, excepté
que leur féjour dans la terre & l’humidité ont pu
leur caufer quelque altération. Il n’ eft pas fi aifé de
deviner par quel accident ces dés ont été portés dans
l’intérieur de la terre.
TÉMÉRAIRE, ( An milit. dès Rom. ) parmi les
Romains le teféraire étoit un bas officier qui prenoit
à l’armée le mot du tribun écrit fur une tablette , &
le portoit au centurion. Cette maniéré de donner le
mot du guet partit plus fûre que de le donner de vive
voix, parce que le mot donné de vive voix peut être
mal entendu & mal rapporté. Foye^ Militaire ,
difcipline des Romains. ( jD. J. )
TESSERE, ( Littérat. ) tejfera; ce mot avoit chez
les Romains plufieurs acceptions différentes. Il figni-
fioit un dé à jouer; il vouloit dire aitffi le mot du guet,
à la faveur duquel les foldats fe reconnoiflbient en-
tr’eux & fe diftinguoient des ennemis. Plufieurs
croyent que ce mot fignifioit encore une mefure de
blé qu’on donnoit aux foldats. Du tems des empereurs
on diftribuoit au peuple des tejferes, pour aller
recevoir les préfens qu’on luifaifoit en blé, en huile,
en o r , en argent, & en autres chofes d’un prix plus
ou moins confidérable. Quelques tejferes ont fervi de
fceâux.
Le nom de tejfere fe donnoit auffi aux marques ou
contremarques qu’on diftribuoit au peuple pour l’entrée
des théâtres. Celles de ce genre qui font fort
communes, j.uftifient, ou plutôt font excufer l'ufage
oit nous fommes de les attribuer fans diftinûion aux
théâtres. Leur matière étoit arbitraire, & leur forme
varioit fuivant leur deftioation.
Plufieurs tejferes étoient d’ivoire ; elles exigeoient
néceflairement la main du fculpteur pour former le
relief dont elles étoient décorées , & celles du graveur
pour marquer les lettres ou les différens fignes
que portoient ces trois fortes de billets. Parmi celles
de cette efpece qui nous font reftées, il y en a un
grand nombre déformé ronde & femblables aux pièces
de monhoie ; l’une repréfente une tête d’empereur,
avec des lettres au revers ; une autre un maf-
que de théâtre , ayant auffi des lettres au revers ;
une troifieme un homme à cheval ; le revers ne préfente
point de lettres, mais feulement un figne de
convention.
' PluffeU-rs' autres tejferes étoient de bois, ainfi que
celles que l’on a.trouvées à Herculaneum; leur forme
eft finguliere. Foyeç-en lés Planches.
Un grand nombre étoit de plomb & de forme fém-
blable aux monnoies. Elles repréfentoient des divinités
égyptiennes ou grecques, des têtes d’empereurs ,
ou tels autres fignes qu’on jugeoit à-propos. Voye^
T esséràire, T essere de g ladiateu r, T essere '
D’H05PITALITÉ , 6rc. ( D. J.)
T essere de.g lad ia teu r, ( Antiq. rom. ) efpece
dé certificat d’os ou d’ivoire fiir lequel on lit qu’un
tel gladiateur a combattü un tel joiirén public.
J*a plupart des infcriptions font gravées fur une
T ES
petite tablette d’os de la forme d’un cube prolongé
par les deux côtés ôppofés , ou d’un prifme quadrilatère.,
& cette tablette eft parfaitement iemblableà
plufieurs dé celles que Thomaffin a fait graver dans
ion traité de tejferis hofpitalitatis.
Parmi les différentes elpeces de iejferès dont cet antiquaire
a parlé dans fon ouvrage, il n’a pas négligé
de faire mention dès tejferes qu’on avoit côutume de
diftribuer dans les jeux folemnels, & en particulier
de celles qu’on donnoit aux gladiateurs, comme une
forte de certificat qu’ils avpient combattu un tel jour
en public. C ’eft même de cette efpece de iéjftres qu’ort
trouve un plus grand nombre aujourd’hui. Il y en a
quelques-unes dans le fécond dialogue d’Antoihe Au-
guftih fur lès médailles , dans les recueils de Grüter
& de Reinéfius ; mais on peut en voir une colleâiont
bçâucbup plus ample dans l’ouvrage dé Fabretti.
La figure de toutes ces tejferes eft îa même; èiles
font toutes , ou d’o s , ou d’ivoire; les ,infCriptionj
qu’on y lit , font ordinairement diftribuees en quatre
lignes qui occupent les quatre faces du priime*
quelquefois en trois lignes feulement ; ces inferiptiona
ne contiennent que le nom du gladiateur, le jour où
il avoit paru en public, & les noms des confuls de
cette année; rarement y eft-il fait mention de l’arme
dont le gladiateur s’eft fervi ; il y en a Cependant
une fur laquelle eft gravé un trident, pour marquer
que Philomufus eft du nombre de ces gladiateurs
nommés rétiaires , qui combattoient avec un filet
dans une main & un trident de l’autre. La tejfere d’Her-
mia qui étoit dans le cabinet de M. le préfrdent de
Mazangues, n’eft chargé d’aucun fymbole ; ainfi il
n’eft pas poffible de décider dans quelle efpece de
combat ce gladiateur s’eft: diftingué. L’infcription doit
être lue ainfi: Hermiafpeclatus ante diem xv.kalen-
dus Decembris, Q. Fujio R Fatinio confulibus.
La plus ancienne de ces tejferes qui nous foit con*
nue, eft datée du confulat de M. Terentius & de C .
Caffius, c’eft-à-dire, l’an de Rome 681 ;da fécondé
eft de l’an 684; la troifieme de l ’an 694 ; la quatrième
de l’an 69.6 ; la cinquième de l’an 701 ; celle de M.
de Mazangues eft la fixieme dans l’ordre des tems -
puifqu’elle eft de l’an 707. Mém. des Infcript. tom.
X F . in-40. (D . J .)
T essere de l’h o spita lit é , (Hîjl. rom.) tejfera
hofpitalitatis, marque juftificative de l’hofpitaiité
qu’on avoit contractée avec quelqu’un.
. Les perfonnes de quelque rang chez les Romains
poffédoieht dans leurs maifons beaucoup plus de logement
qu’elles n’en pouvoient occuper, afin d’avoir
toujours des appartemens prêts pour y recevoir les
étrangers avec lefquels elles jugeoient à-propos de’
contracter un droit d’hofpitalité; &c ce droit, par
Une obligation refpeCtive, 1e tranlinettoit jufqu’auac
defeendans.
Le gage & le témoignage affuré de la convention,
confiftoit dans certaines marques doubles d’ivoire
ou de bois, qu’ils nommèrent tejferes d'hofpitalité.
On ne peut donner une idée plus approchante de
ces marques , qu’en les comparant à ces tailles dont
fè fervent nos boulangers & quelques ouvriers, pour
marquer la quantité de marchandifes qu’ils nous ont
fournies à diverfes reprifes. C ’étoient pareillement
des marques de bois coupées dans la même piece ,
qui faifôient deux morceaux féparés , & qui en fe
joignant n’en formoient plus qu’une, fur laquelle on
avoit gravé quelques caraCteres qui fe correfpon-
doient. Ces fortes de tailles formoient la lettre de
créance, & à leur préfentation oh reconnoiffoit fes
hôtes.
Quand'deux perfonnes avoient contracté enfemble
Rengagement d'hofpitalitè, chacune gardait une de
ces marques ; elles fervoient non-feulement à ceux-
qui avoient ce droit perfonnellement, mais encore
TES
à ceux à qui ils le vouloiènt prêter, ènforte que le
porteur de cette efpece de bulletin, ou lettre de
créance, étoit auffi bien reçu, logé & nourri, qù’àu-
roit été celui à qui il appartenait. Les anciens fé firent
une efpece de religion des fois & dès droits dé
cette, vertu de bénéficenee qu’ils nommèrent hofpita-
lité ; & même ils établirent des dieux pour punir cèüx
qui les violeroient. Foye^ Ho sp it a l ité .
J’ajoute qu’il me jparoît étrange que cet üfâge qui
eft une noble charité, foit.fi fort àboli chez les Chré-
îiens, qui font une profeffion particulière de ce'tté
vertu ; il femble d’abord que ce n’en feroit pas une
de l’exetcer, comme lés anciens, envers des voyageurs
aifés ; mais ces voyageurs j quelque riches qu’ils
foient i rte péuveht guere trouver poiir de l’argent
en pays étranger ; un logement auffi commode que
celui qüe les honnêtes gens du lieu pourroient leur
donner > fi c’étoit encore la coutume; & qu’airtfila
dépenfe qu’on feroit à les loger gratuitement, comme
autrefois*; feroit, à le bien prendre , un fervice
d’honnêteté des plus louables & des mieux placés.
( A J )
T E S S I N , ( Qéog. mod. ) petite ville $ OU plutôt
bourg d’Allemagne, dans le duché de Mecklenbourg,
fur là riviere de Rackénis, entre Defnin & Roftock; ....
TESSIO, ( Hift. nat. Bôtdti. ) c’eft une efpece de
palmier du Japon dont on fait le fagou ; on prétend
que l’humidité fait fur fon bois, le même effet que le
feu fur le parchemin: qu’on lui met au pié , dé la limaille
de fer au lieu de fumier, & que forfqu’ürte dé
fes branches fe caffe, on l’attache au trône avec un
clou pour la faire rependre. LeJiûro ou jiodo approche
beaucoup du palmier des montagnes de Malabar;
mais il eft fterile au Japon. Le footfikù en eft Une petite
efpece dont les feuilles font pointues Comme
celles du rofeau.
. TESSOTE , fGéogr. fnod. ) petite ville d’Afrique;
au royaume de Fez, dans la province de Garet. Elle
eft bâtie fur une roche haute. ( D . J. )
TESSU IN FM , ( Géog. anc.) ville d’Italie ^ aux
côhfins de la région prætutienne & du Picenum, félon
Pline, t. I I I . c. xiiji Quelques exemplaires lifent
Tervium.( D . J .)
T E S T , fi m; ( Corïchyl. ) en latin tejlà, e’eft la
fubftance la plus dure qui forme lé corps d’une co-
quille; ainfi tcjlacét fe dit d’une coquille dure iképaiffe.
i o . j . )
T est , ( Hijh mod. ) en Ànglëtërfé, mot tiré dit
latin tejtimonium. C ’eft une proteftation ou déclaration
publique fur certains chefs de religion è i de gouvernement
que les rois & les parlemens ont ordonné
'défaire à ceux qui prétendoient aux dignités del’é-
glâfe anglicane ou aux charges du royaume. On y a
joint des fois pénales contre les eeeléfiaftiques , les
feigneurs du parlement, les coihmandans & officiers
qui refufent de prêter le ferment conformément à cés
tejls ; dont voici les principaux formulaires.
■ Tejl des eccléjiajhques. m Je N; déclare ici fans diffi-
i> mülatiort que j’approuve & eonfens , foit en géné-
->>'ral, foit ert particulier, à tout ce qui eft compris
»dans le livre intitule, le livre des commîmes prières,
» de PadmbiijtratioTï des facremens ; <S* autres exercices
G cérémonies de PégUjc^ fuivant Cufagede Üéglife an-
to glicant. H
Loi pénale. « Celui qui fera en dénieiirè dé faire
i> cette déclaration, fera entièrement déchu de toute
» promotion eedéfiaftique; Tous les doyefis; cha-
» noines , prébendaires , maîtres , chefs i profef-
>>.feurs, 6*c. ne feront point admis à leur emploi, qu’-
^> ils n’aiëntfait cetfè proteftation. »
Tejl du jet ment de fuprématie. « Je N. Confefle&C dé-
» ciare -pleinement convaincu en ma cônfcience, que
» le roi eft le feul fouverain de ce royaume ôc de
T Ê 5
» toutes les puilfancès & feignéuries, auffi bien danfe
» les chofes fpirifuélles & eeeléfiaftiques que tempo-
» reliés-, & qu’aucun prince étranger ; prélat , état
» ou puiflaricë n’â Sc ne peut avoir nulle jurifdiéfioh
» ni prééminence dans les chofes eeeléfiaftiques oii
» fpirituelles de ce royaume.. »
Loi pénale. « Perfonhe ne pourra être reÇù à ait
» cune charge ou emploi;, foit pour le fpirituel ,.foïf
» 'pour le'temporel: il né fera îfon plus admis à aucun
» ordre où défg:ré du doftorat ; qu’il n’ait prêté cé
» fermëiitj-à peiné dè privation dudit officé Ou cm-
» ploi. >>
Henri VHÎ. après fa féparatiori d’avec féglife romaine;
impofa la nécefljtéde ces tejls, dont les formules
varièrent à quelquëS(.égards fous les regnei
d’Edouard VI. d’Elizabeth, de Jacques I. & de Charles
I. En 1662 Charles II. révôqùà lés tejlsr & açcôr-
dà la liberté de conféiéhçe: ce qu’il rettôü'veïîâ eii
1669 & 1672. Jacques II. qui lui fuccéda , en ufa de
même ; mais après la révolution qui détroriâcé prince
, le tefl fut rétabli, &c on le prête encore aujourd’hui.
En 1673 le parlement dreffa un nouveau ûfl^
par lequel fôus-cetix qui entreroient dans queiqiié'
charge publique ; ou qui en fer Oient revêtus., rejét-
teroient pàf fefmerit le dogmë de la tranfliibftahtia-
tion,fous peine d’exclufiqn defdités chargeL5nàü^-
mentâ en 167$ ce tejl dont la formule eto'it conçuë
en ces termes:
« Moi N. J’attéft.e ; juftifi'e & déclaré folemnellë-
» ment & fincerement en la préfènee de Dieü , qiië
» je crois que dans le façrement de 1k cenë dii Sei-
» gneur ; il n’y a àucune.tranffubftantiation.des élé-»
» mens du pain & du vin dans lé corps & Té farig elé
>> Jefus-Chrift, dans & après la.confécratipn faite par
» quelque perfonne que c e foit; & qùe l’invocation
» ou adoration de la viefge Marie ou dë tout autre'
» faint, & le facrificë de la meffe, de la maniéré qu-
» ils font en ufagë à préfent dans l’é'glife de Rome;
>> eft fuperftition &c idOlâtrié. » ■
On déclare enfuite que ce ferment eft fait'fans
aucune réticence, e’eft-à-dire , fans aucune rëftric-
tion mentale.
TESTACE ou DOH O LO, ( Géogr. mod.) en latin
Tejlacius morts, montagne dans l’enceinte dé Rome ;
elle eft à environ deux, cens pas ae la pyramide dé
Ceftius : elle à-peu-prés demi-mille de circuit, &C
cent cinquante pies de lïatiteur perpendiculaire. Ce
n’eft qu’un aihàs dë vâiffeaux de'terie rompus on y
a çreufé des grottes oh l’on, tient du vi'ïi, éç on y en
vend ; çe monticule n’eft pai loin de la porte qii’On
nommoit Porta Trigtminà. ^ D . J. )
TESTACÉES’y on i donné ce nom aux ànimaux
couyerts d’tin teft dur : cé; font les coquillages ; par
le nom de tejtacées ; on lës diftingué des cruftaçées
qui font, couverts d’une taie, & non paS d’un teft :
tels font les écréviffes; les crabes ; les iangouftes, 6v:
TESTAMENT, fi in. f Théologie.) dans l’Ecriture
fe prend pouralliance ^ & répond.àl’hébreubèrith j
& au grec S'/etSfa» ; qui fignifiè Y acte de la volonté
dernière d’une perfonitè ; q ïii, en vue de la mort ;
difpofe'de fes biens , & ordonne de ce qu’elle veut
qu’on fafle après fon décès;
Le nom de tejlameht ne/ë trOüvë jamais en ce fens,
dans l’ancien Tejlàment, mais feulement daps le fens,
de pacte & d'alliance. Mais S. Paul, darts l’épître aux
Hébreux ; diap. ix.yerf. iS.bjiÙY.. tmfohnant.fiir le'
terme grec/<*ôil%y, qui fignifiè proprement le tejla-,
ment d’une perfonne qui fait côiinoîtrè fes dernières
volontés ; dît ces paroles : « jefüs^Ghrift eft Te mé-;.
» diateùr du Tïflamént nouveau, a fin que par la mort
» qii’il a foufferte pour expier les iniquités qui fé,
» commettoient fous lé' premier Tefldmeht, ceux qui
» font appellés de Dieu reçoivent l’héritage' éterneL
» qu’il leur a promis ; car ofi il y a un tejlomehtj il