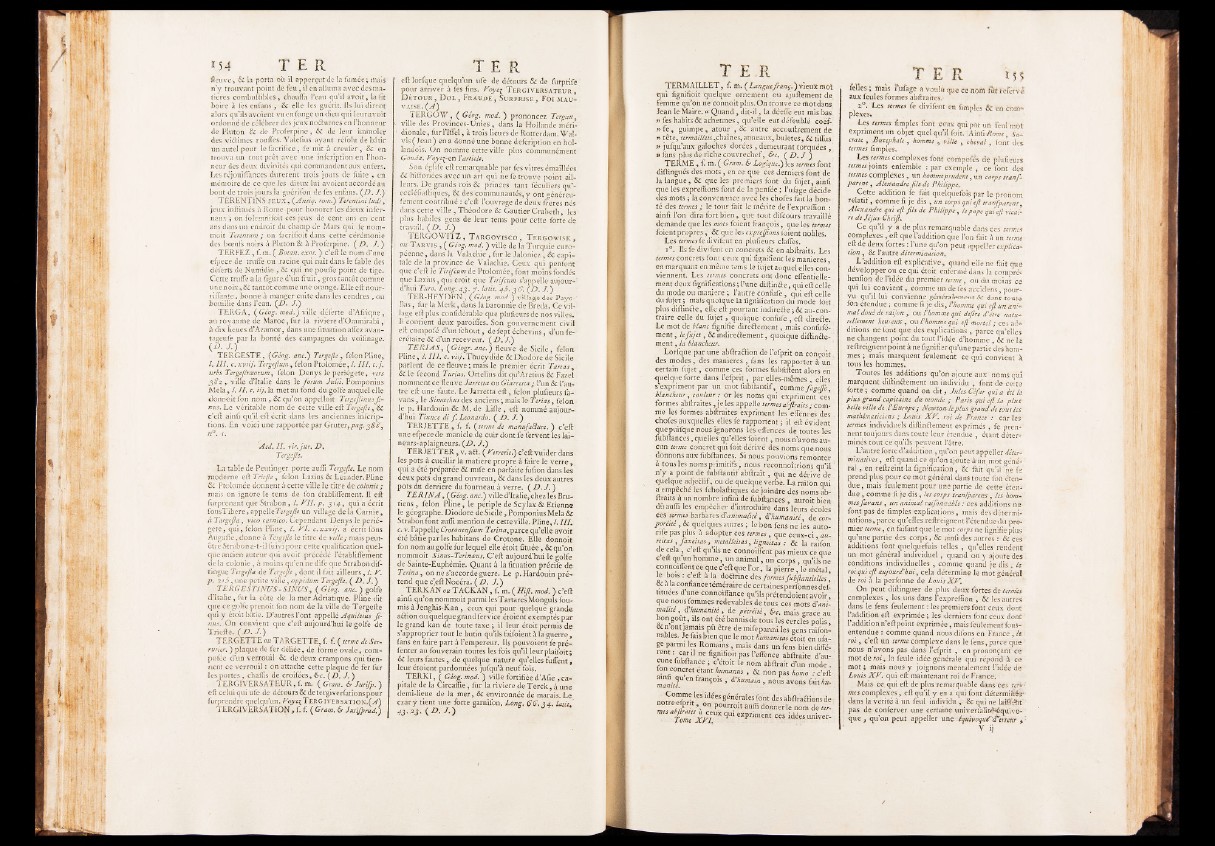
fleuve^ & la porta oh il apperçutde la fumée; mais
n’y trouvant point de feu , il en alluma avec des matières
combuftibles, chauffa l’eau qu’il avoit, la fit
boire à fes enfans , & elle les guérit. Ils lui dirent
alors qu’ils avoient vu cnfonge un dieu qui leur avoit
ordonné de célébrer des jeux no&urnes en l’honneur
de Pluton 6c de Proferpine, 6c de leur immoler
des viâimcs roufles. Valefius ayant réfolu de bâtir
un autel pour le facrifice, fe' mit à creufer, 6c en
trouva un tout prêt avec une infcription en l’honneur
des deux divinités qui commandent aux enfers*
Les réjouiffances durèrent trois jours de fuite , en
mémoire de ce que les dieux lui avoient accordé au
bout de trois jours la guérifon de fes enfans. {D . J.)
TÉRENTINS JEUX, (Antiq. rom.') Terentini ludi,
jeux inftitués à Rome pour honorer les dieux infernaux
'; on folemnifoit ces jeux de cent ans en cent
ans dans un endroit du champ de Mars qui fe nom-
moit Terentum ; on facrifioit dans cette cérémonie
des boeufs noirs à Pluton & à Proferpine. ( D. J .)
TERFEZ, f. m. ( Botan. exot. ) c’eft le nom d’une
efpeee de truffe ou racine qui naît dans le fable des
déferts de Numidie , 6c qui ne pouffe point de tige.
Cette truffe a la figure d’un fruit, gros tantôt comme
une noix, 6c tantôt comme une orange. Elle eft nour-
riiTante, bonne à manger cuite dans les cendres , ou
bouillie dans l’eau. {D. J.)
TERG A , {Géog. mod.) ville déferte d’Afrique,
au royaume de Maroc, fur la riviere d’Ommirabi,
à dix lieues d’Azamor, dans une fituation affez avan-
tageufe par la bonté des campagnes du voifinage.
{ o . j . ) .
TERGESTE, (Géog. anc.) Tergejle, félon Pline,
/. III. c. xviij. TergeJIum, félon Ptolomée, /. III. c. j.
nrbs Tergejïroeorum, félon Denys le periégete, vers
382,. ville d’Italie dans le forum Julii. Pomponius
Mêla, l. IL c. iij. la met au fond du golfe auquel elle
donnoit fon nom , 6c qu’on appelloit TergejïmusJi-
nus. Le véritable nom de cette ville eft Tergejle, 6c
c’eft ainli qu’il eft écrit dans les anciennes infcrip-
tions. En voici une rapportée par Gruter, pag. gS8,
n°... •/. ; .
Aed. II. vir.jur. D .
Tergejle.
La table de Peutinger porte aufti Tergejle. Le nom
moderne eft Triefle, félon Lazius & Léander. Pline
6c Ptolomée donnent à cette ville le titre de colonie ;
mais on ignore le tems de fon établiffement. Il eft
furprenant que Strabon, l. VII. p. 3 /4 , qui a écrit
fousTibere, appelle 7Vge/?e un village de la Carnie,
àTargefia, vico carnico. Cependant Denys le periégete,
qui, félon Pline, l. VI. c.xxvij. a écrit fous
Aiigufte, donne à Tergejle le titre de ville; mais peut-
être Strabon a-t-il fuivi pour cette qualification quelque
ancien auteur qui avoit précédé l’établiflement
de la colonie, à moins qu’en ne dife que Strabon dif-
tingue Tergejla de Tergejle , dont il fait ailleurs, l. V.
p. 215 , une petite ville, oppidum Tergejle. ( D . J. )
TERGEST1NUS-SIN US, ( Géog. anc. ) golfe
d’Italie, fur la côte de la mer Adriatique. Pline.dit
que ce golfe prenoit fon nom de la ville de Tergefte
qui y étoit bâtie. D’autres l’ont appellé Aquileius Jî-
nus. On convient que c’ eft aujourd’hui le golfe de
Triefte. (D . J.)
TERGETTE ou TARGETTE, f. f. ( terme de Serrurier.
) plaque de fer déliée, de forme ovale, com-
pofée d’un verrouil 6c de deux crampons qui tiennent
ce verrouil : on attache cette plaque de fer fur
les portes , chaflis de croifées, 6-c. (D . J .)
. TERGIVERSATEUR, f. m. ( Gram. & Jurifp. )
eft celui qui ufe de détours & de tergiverfations pour
furprendre quelqu’un. ^qyeçTERGiVERSATiON.(^) ,
TERGIVERSATION , f. f. ( Gram. 6* Jurfprud.)
eft lorfque quelqu’un ufe de détours & de ftirprife
pour arriver à les fins. Voye{ T erg iv ersa teu r,
D é t o u r , D o l , Fr a u d e , Su rpr ise, Foi mauvaise.
(A )
T E R G OW , ( Géog. mod. ) prononcez Ter gau 7
• ville des Provinces-Unies , dans la Hollande méri-
• dionale, fur l’Iffel, à trois lieues de Rotterdam."Wal-
vis ( Jean ) en a donné une bonne defcription en hol-
landois. On nomme cette ville plus communément
Gouda. Vyyeç-en l’article.
Son églife eft remarquable par fes vitres émaillées
& hiftoriées avec un art qui ne fe trouve point ailleurs.
De grands rois 6c princes tant féculiers qu’ -
eccléfiaftiques, 6c des communautés, y ont «énéreu-
: fement contribué : c’eft l’ouvrage de deux freres nés
dans cette ville , Théodore 6c Gautier Crabeth, les
plus habiles gens de leur tems pour cette forte de
travail. {D , J.)
T E R G O V IT Z , T arg ov isco , T e r g ow isk ,
ou T arvis , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie européenne,
dans la Valachie , fur le Jalonicz , 6c capitale
de la province de Valachie. Ceux qui penfent
que c’eft le Tirifcumde Ptolomée , font moins fondés
que Lazius, qui croit que Tirifcum s’appelle aujour--
d’hui Turo. Long. 43. y. latit. 4J .'3G. (D . J.)
TER-HEYDEN , ( Géog. mod. ) village des Pays--
Bas, fur la Merk, dans la baronnie de Breda. Ce village
eft plus confidérable que plufieurs de nos villes.
Il contient deux paroiflés. Son gouvernement civil
eft compofé d’un fchout, de fept échevins, d’un fe-
crétaire 6c d’un receveur. ( D . J.)
, . T E R IA S , ( Gèogr.anc.) fleuve de Sicile, félon
Pline, l. I lI . c. viij. Thucydide 6c Diodôre de Sicile
parlent de ce fleuve ; mais le premier écrit Tareas ,
6c le fécond Turias. Orteliüs dit qu’Aretius 6c Fazel
nomment ce fleuve Jarrctta ou Giarretta ; l’un 6c l’autre
eft une faute. Le Jarretta e ft , félon plufieurs fa-
vans , le Simoethusdes anciens; mais le Terias, félon
le p. Hardouin & M. de Lifle , eft nommé aujourd’hui
Tiunce di f . Leonardo. ( D . J. )
TERJETTE , f. f. ( terme de manufacture. ) c’eft:
une efpeee de manicle de cuir dont fe fervent les lai—
neurs-aplaigneurs. (D . J.)
TERJETTER, v. a£t. ( Virrerie.) c’ eft vuider dans
les pots à cueillir la matière propre à faire le verre ,
qui a été préparée 6c mife en parfaite fufion dans les
deux pots du grand ouvreau, 6c dans les deux autres
pots dtl derrière du fourneau à verre, {D . J .)
T E R IN A , {Géog. anc.) ville d’Italie, chez les Bru-
tiens , félon Pline, le périple de Scylax & Etienne
le géographe. D iodore de Sicile , Pomponius Mêla &
Strabon font aufli mention de cette ville. Pline, l. III.
c. v. l’appelle Crotonenjium Teri/zû, parce qu’elle avoit
été bâtie par les habitans de Crotone. Elle donnoit
fon nom au golfe fur lequel elle étoit fituée, & qu’on
nommoit Sinus-Terinæus. C ’eft aujourd’hui le golfe
de Sainte-Euphémie. Quant à la fituation précife de
Terina, on ne s’accorde guere. Le p. Hardouin prétend
que c’eftNocéra. (Z). J .)
TERKAN ou T A C K A N , f. m. ( Hijl. mod. ) c’eft
ainfi qu’on nommoit parmi les Tartares Monguls fournis
à Jenghis-Kan, ceux qui pour quelque grande
aétion ou quelque grand fervice étoient exemptés par
le grand kan de toute taxe ; il leur étoit permis de
s’approprier fout le butin qu’ils faifoient à la guerre ,
fans en faire part à l’empereur. Ils pouvoient fe pré-:
lenter au fouverain toutes les fois qu’il leur plaifôit;
6c leurs fautes, de quelque nature qu’elles fuflent,
leur étoient pardonnées jufqu’à neuf fois.
T ER K I, ( Géog. mod. ) ville fortifiéed’Afie , capitale
de la Circaflie, fur la riviere de Terck , à une
demi-lieue de la mer, 6c environnée de marais. Le
czarÿ tient une forte garnifon. Long, 6 G. 34. Latit.
TERMAILLËT, f. m. ( Langue franç. ) vieux mot
qui fignifioit quelque ornement ou ajuftement de
femme qu’on ne connoit plus. On trouve ce mot dans
Jean le Maire. « Quand , d it-il, la déefle eut mis bas
» fes habits & achetmes, qu’elle eut défeublé coëf-
n f e , guimpe, atour , 6c autre accouftrement de
» tête, termaillets,chaînes, anneaux, buletes, 6c tifliis
» jufqu’aux galoches dorées , demeurant torquées ,
» fans plus de riche couvrechef, &c. {D . J.S
TERME , f. m. ( Gram. & Logique.) les termes font
diftingués des mots , en ce que ce$ derniers font de
la langue, 6t que les premiers font du fujet, ainfi
que les expreffions font de la penfée ; l’ufage décide
des mots ; la convenance avec les chofes fait la bonté
des termes ; le' tour fait le mérité de l’expreflion :
ainfi l’on dira fort b ien, que tout diféours travaillé
demande que les mots foient françois, que les termes
foient propres, 6c que les expreffions foient nobles.
Les termes fe divifent en plufieurs claffes.
i° . Ils fe divifent en concrets 6c en abftraits. Les
termes concrets font ceux qui lignifient les maniérés
en marquant en même tems le fujet auquel elles conviennent.
Les termes concrets ont donc eflentielle-
ment deux lignifications ; Fune diftin&e, qui eft celle
du mode ou maniéré ; l’autre confufe, qui eft celle
du fujet ; mais quoique la lignification du mode foit
plus diftin&e, elle eft pourtant indire&e ; 6c au-côn-
traire celle du fujet, quoique confufe , eft direûe.
Le mot de blanc lignifie directement, mais c o n f ir ment
, le fu je t, 6c indirectement, quoique diftinCte-
ment, la blancheur.
Lorfque par une abftraCtion de l’efprit on conçoit,
des modes , des maniérés , fans les rapporter à un
certain fujet, comme ces formes fubfiftent alors en
quelque forte dans l’efprit, par elles-mêmes , elles
s’expriment par un mot fubftantif, comme fagejfe,
blancheur, couleur : or les noms qui expriment ces
formes abftraites, je.les appelle termesabjlraits; Comme
les formes abftraites expriment les eflences des
chofes auxquelles elles fe rapportent ; il eft évident
quepùifque nous ignorons les eflences de toutes les
lubftances, quelles qu’elles foient, nous n’avons aucun
terme concret qui foit dérivé dés noms que.nous
donnons aux fubftances. Si nous pouvions remonter
à^tous les noms primitifs \ nous reconnoîtrioris qu’i l 1
n’y a point de lubftantif abftfait, qui ne dérive de
quelque adjeCtif, ou de quelque verbe. La raifon qui
a‘ empêché les fçholaftiques de joindre des noms abftraits
à un nombre infini de fubftances , auroit bien
dû aufli les empêcher d’introduire dans leurs écoles
cés termes barbares d’animalité, d'humanité, de cor-
poréitè , & quelques autres ; le bon fens ne les auto-
nfe pas plus à adopter ces termes , que ceux-ci, aü-
reitas , faxeitas , metalleitas, ligneitas : 6c la raifon
de cela ? c’eft qu’ils ne connoiffent pas mieux ce que
c eft qu’un homme, un animal, un corps, qu’ils ne
' connoiflentee que c’eft que l’o r, la p ierre, le métal,
lé bots : c’eft à la doftrine des formes fubjlantielles t
cc à la confiance téméraire de certaines perfonnes del-
tituees dune connoiflance qu’ilsprétendoientavoir,
que nous fommes redevables de tous ces mots d'animalité
v d'humanité, de pétrêité ,■ &c. mais grâce au
bon goût, ils ont été bannis de tous les cercles polis
& n ont jamais pû être de mifeparmiles gens raifon-
nables. Je fais bien que le mot humanitas étoit en ufa-
ge parmi les Romains, mais dans un fens biendiffé-
rent : car il ne fignifioit pas l’effence abftraite d’aucune
iubftance ; c’étoit le nom abftrait d’un mode .
ion concret étant humanus , 6c non pas homo : c’eft
ain 1 qu en françois , d'humain, nous avons fait humanité.
idé“ 8énérales f°'nt abftraflionsde
■ H H m pourrait auffidûrinerle nom de H
m e s qui expriment: ces idées univerieïles
; mais IVifage a vonlâ que ce ftôm firt rèfcrvé
aux feules formes abftraites.'
. Les termes fe divifent e n fimples & en tom«
: plexes.
Les tennis fimples font te\ix qui par un feul mbt
expriment un objet quel qu’il foit. Ainfi -Rome, So*
creue , Buccpkale , homme , ville , thtval, font des
termes fimples.
Les ternies complexes fofif côrtlpbfés dé plufieurs
termes joints enfemble : par exemple > cè font des
termes complexes > un hommeprudtm, un corps eranf1
parent, Alexandre fils de Philippe.
Cette addition fe fait quelquefois par leqjronom
relatif, comme fi je dis , un corps qiiitfi ttmijvarcnt.
Alexandre qui eft fils de Philippe. le pape qui ifl vient,
re de Jéfus-ChriJL
Ce qu’il f à de plus remarquable dans tes termes
complexes , eft que l’addition que l’on fait à un terme-
eft de deux fortes : l'une qu’on peut appeller explica.
tion, 6c l’autre détermination.
L ’addition èft explicative > quand elle né fait qué
développer ou ce qui étoit enfermé dans la compré*
henfion de l’idée du premier terme oit du moins cô
qui lui convient, comme un de fes accidens, pourvu
qu’il lui convienne généralement 6c dans toute
fon etendue ; comme fi je dis, P homme qui ejl un uni*
mal doué de raijon , ou L'homme qui defire d'être naturellement
heureux , ou C homme qui ejl mortel ; ces ad*
dirions ne font que des explications , parce qu’elles
ne changent point du tout l’idée d’homme 6c ne la
rèftreignent point à ne lignifier qu’une partie dés hommes
; mais marquent feulement ce qui convient à
tous les hommes.
Toutes les additions qu’on ajouté aux nomsqùï
marquent diftin&ement un individu , font de cette
forte ; comme quand on dit, Jules Géfar qui a été U
plus grand capitaine du monde ; Paris qui ejl,la plus
belle ville de. C Europe; Newton le plus grand de tout les
mathématiciens ; Louis XV. roi de France *' car les
termes individuels diftin&ement exprimés , fe prennent
toujours dans toute leur étendue , étant déterminés
tout ce qu’ils peuvent l’être.
L’autre forte d’addition, qu’on petit appellér déterminatives
, eft. quand ce qu’on ajoute mot général
, en reftreint la fignification, 6c fait qu’il ne fe
prend plus pour ce mot général dans toute fon èten*
due, mais feulement pour une partie de cette étendue
, comme fi je dis, les corps tranfparens, les hôm- ’
mesfavans , un animal raifonnable : ces additions ne
font pas de fimples explications, mais des déterminations
, parce qu’elles reftreigrrent l’étendue du premier
terme, en faifant que le mot corps ne fignifie plus
qu’une partie des corps, 6c ainfi des autres : 6c ces '
additions font quelquefois telles , qu’elles rendent
un mot général individuel, quand on y ajoute des
conditions individuelles , comme quand je dis , le
roi qui ejl aujourd'hui, cela détermine le mot général
de roi a la perfonne de Louis XV.
On peut diftinguer de plus deü'X fortes de ternîtes
complexes , les uns dans l’expreffion , 6c les autres
. dans le fens feulement : les premiers font Ceux dont
l’addition eft exprimée ; les derniers font ceux dont
l’addition n’eft point exprimée, mais feulement fous*
entendue : comme quand nous difons èn France , lt
; roi, c’eft un terme complexe dans le fens , parce que
nous n’avons pas dans l’efprit , en prononçant et:
mot de roi *Ja feule idée generale qui répond à ce
mot ; mais nous y joignons mentalement l’idée de
Louis X V . qui eft maintenant roi de Frarice,
Mais, ce, qui eft de pins remarquable dans ces UftH
mes complexes , eft qu’il y en a qui font détermiîtéi*
' dans la vérité à un feul individu , 6c qui ne lalfi'éht
i pas de conferver «une certaine univerlalité^équivo-
que , qu’on peut appeller une èquivoquf'eFerretir %
y ij