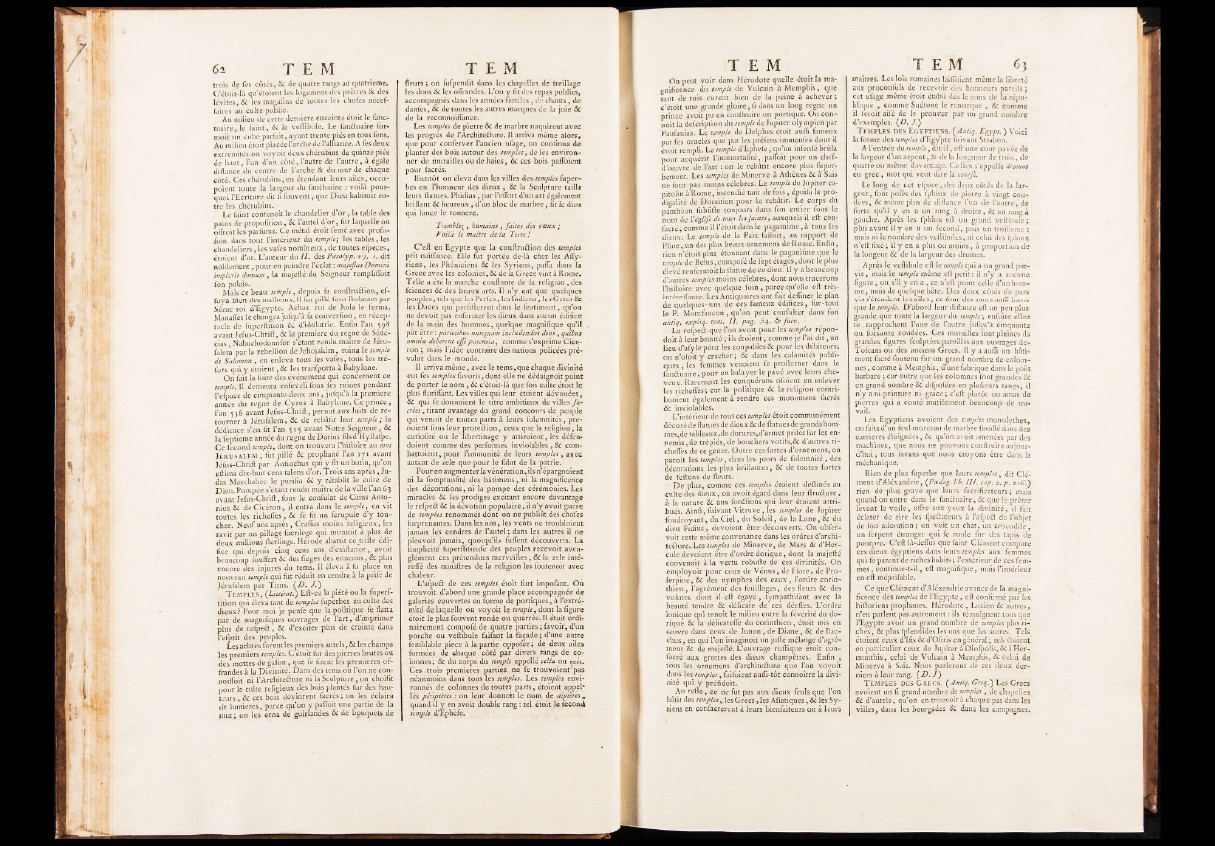
trois de fes côtés, & de quatre rangs aü quatrième*
G’étoit-là qu’étoient les logemens des prêtres & des
lévites, 6c les magafins de toutes les chofes nécef-
faires au culte public.
Au milieu de cette derniere enceinte étoit le fanc-
tuaire, le faint, 6c le veflibule. Le fanûuaire for*
moit un cube parfait, ayant trente pies en tous fens.
Au milieu étoit placée l’arche de l’alliance. A fes deux
extrémités on voyoit deux chérubins de quinze piés
de haut, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, à égale
diflance du centre de l’arche & du mur de chaque
côté. Ces chérubins, en étendant leurs aîles, occu-
poient toute la largeur du fanftuaire : voilà pourquoi
l’Ecriture dit fi fouvent, que Dieu habitoit entre
les chérubins.
Le faint contenoit le chandelier d’o r , la table des
pains de propofition, 6c l’autel d’o r, fur laquelle on
offroit les parfums. Ce métal étoit femé avec profusion
dans tout l'intérieur du temple; les tables, les
chandeliers, les vafes nombreux, de toutes efpeces,
étoient d’or. L’auteur du I I . des Paralyp. vij. /. dit
noblement, pour en peindre l’éclat : majefias Domini
impàvit domum , la majefté du Seigneur remplifloit
fon palais.
Mais ce beau' temple, depuis fa conftru&ion, ef-
fuya bien des malheurs. 11 fut pillé fous Roboam par
Sézac roi d’Egypte. Achaz roi de Juda le ferma.
Manaffès le changea jufqu’à fa converfion, en réceptacle
de fuperftition 6c d’idolâtrie. Enfin l’an 598
avant JefUs-Chrift, 6c la première du régné de Sédé-
cias, Nabuchodonofor s’étant rendu maître de Jéru-
falem par la rébellion de Jehojakim, ruina le temple
de Salomon, en enleva tous les vafes, tous les tré-
fors qui y étoient, 6c les tranfporta à Babylçne.
On fait la fuite des événemens qui concernent ce
temple. Il demeura enfeveli fous fes ruines pendant
J’efpace de cinquante-deux ans, jufqu’à la preiniere
année du régné de Cyrus à Babylone. Ce prince,
fan 536 avant Jefus-Chrift, permit aux Juifs de retourner
à Jérufalem, 6c de rebâtir leur temple ; la
dédicace s’en fit l’an 515 avant Notre-Seigneur, 6c
la feptieme année du régné de Darius fils d’Hyftafpe.
Ce fécond temple, dont on trouvera l’hiftoire au mot
Jérusalem , fut pillé 6c prophané l’an 171 avant
Jéfus-Chrifl par Antiochus qui y fit un butin, qu’on
eftima dix-huit cens talens d’or. Trois ans après, Judas
Macchabée le purifia & y rétablit le culte de
Dieu. Pompée s’étant rendu maître de la ville l’an 63
avant Jefus-Chrift, fous Le confulat de Càïus Anto-
nius 6c de Cicéron, il entra dans le temple, en vit
toutes les richeffes, & ,fe fit un fcrupule d’y toucher.
Neuf ans après, Craflus moins religieux, les
ravit par un pillage facrilege qui montait à plitf de
deux millions fterlings. Hérode abattit ce trifle édifice
qui depuis cinq cens ans d’exiftance, avoit
beaucoup fouffert 6c des fieges des ennemis, & plus
encore des injures du tems. Il eleva à fa place un
nouveau temple qui fut réduit en cendre a la prife de
Jérufalem par Titus. ( D . / . )
T emples, (Littérat.) Eft-ce la piété ou la fuperftition
qui éleva tant de temples fuperbes au culte des
dieux? Pour moi je penfe que la politique fe flatta
par de magnifiques ouvrages de l’a rt, d’imprimer
plus de relpeét, 6c d’exciter plus de crainte dans
l’efprit des peuples. ^ #
Les arbres furent les premiers autels, & les champs
les premiers temples. C’étoit fur des pierres brutes ou
des mottes de gafon, que fe firent lés premières offrandes
à la Divinité. Dans des tems où l’on ne con-
noifloit ni l’Architeéture ni la Sculpture, on choifit
pour le culte religieux des bois plantes fur des hauteurs
6c ces bois devinrent facrés; on les éclaira
de lumières, parce qu’on y paffoit une partie de la
nuit; on les orna de guirlandes 6c de bouquets de
fleurs ; on fufpendit dans les chapelles de treillage
les dons 6c les offrandes. L’on y fit des repas publics,
accompagnés dans les années fertiles , de chants, de
danfes, 6c de toutes les autres marques de la joie 6c
de la reconnoiffance.
Les temples de pierre & de marbre naquirent avec
les progrès de l’Architecture. Il arriva même alors,
que pour conferver l’ancien ufage, on continua de
planter des bois autour des .temples, de les environner
de murailles ou de haies, 6c ces bois paffoient
pour facrés.
Bientôt on éleva dans les villes des temples fuperbes
en l’honneur des dieux , 6c la Sculpture tailla
leurs ftatues. Phidias , par l’effort d’un art également
brillant 6c heureux, d’un bloc de marbre, fit le dieu
qui lance le tpnnere.
Tremble^, humains, faites des ■ ÿceux ;
Voilà le maître delà Tefre ! ‘
C ’efl en Égypte que la conftruétion des temples
prit naiffance. Elle fut portée de-là chez les Afly-
riens, les Phéniciens 6c les Syriens, paffa dans la
Grece avec les colonies, & de la Grece vint à Rome*
Telle a été la marche confiante de la religion,des
fciences 6c des beaux arts. Il n’y eut que quelques
peuples, tels que les Perfes, les Indiens, les Getes 6c
lesDaces qui perfiflerent dans le fentiment, qu’on
ne de voit pas enfermer les dieux dans aucun édifice
de la main des hommes, quelque magnifique qu’ il
put etre : par'utibus nunquam includendos deos, qui bus
omnia deberent ejfe paienâa, comme s’exprime C icéron
; mais l’idée contraire des nations policées prévalut
dans le monde.
Il arriva même, avec -le tems, que chaque divinité
eut fes temples favoris, dopt elle ne dédaignoit point
de porter le nom , 6c c’étoit-là que fon culte étoit Iç
plus floriffant. Les villes qui leur étoient dévouées ,
6c qui fe donnoient le titre ambitieux de villes fa-
crées, tirant avantage du grand concours de peuple
qui venoit de toutes parts à leurs folemnités, pre-
noient fous leur protection, ceux que la religion, la
curiofité ou le* libertinage y attiroient, les défen-
doient comme des perfonnes inviolables , 6c combattaient,
pour l’immunité de leurs temples, ayec
autant de zele que pour le falut de la patrie.
Pour en augmenter la vénération, ils n’épargnoient
ni la fomptuofité des bâtimens, ni la magnificence
des décorations, ni la pompe des cérémonies. Les
miracles 6c les prodiges excitant encore davantage
lé refpeét 6c la dévotion populaire, il n’y avoit guere
de temples renommés dont on ne publiât des chofes
furprenantes. Dans les uns, les vents ne troubloient
jamais les cendres de l’autel; dans les autres il ne
pleuvoit jamais, quoiqu’ils fuffent découverts. La
fimplicité fuperflitieufe des peuples recevoit aveuglément
ces prétendues merveilles , 6c le zele inté-
reffé des miniflres de la religion les foutenoit avec
chaleur.
L’afpeCt de ces temples étoit fort impofant. On
trouvoit d’abord une grande place accompagnée de
galeries couvertes en forme de portiques, à l’extrémité
de laquelle on voyoit le temple, dont la figure
étoit le plus fouvent ronde ou quarrée. Il étoit ordinairement
compofé de quatre parties ; favoir, d’un
porche ou veflibule faifant la façade ; d’une autre
femblable piece à la partie oppofée ; de deux aîles
formées de chaque côté par divers rangs de colonnes
; & du corps du temple appelle. cella ou vais.
Ces trois premières parties ne fe trou voient* pas
néanmoins dans tous les temples. Les temples environnés
de colonnes de toutes parts, étoient appel*
lés périptlres : on leur donnoit le nom de diptères,
quand il y en avoit double rang : tel étoit le fécond
temple d’Ephèfe,
On peut voir dans Hérodote quelle étoit la magnificence
du ttmple de Vulcain à Memphis, que
tant de rois eurent bien de la peine à achever;
c’étoit une grande gloire, fl dans un long régné un
prince avoit pu en conftruire un portique. On con-
noît la defeription du temple de Jupiter olympien par
Paufanias. Le temple de Delphes étoit aufli fameux
par fes oracles que par les préfens immenfes dont il
étoit rempli. Le temple d’Ephefe, qu’un infenlé*brûla
pour acquérir l’immortalité, paffoit pour un chef-
d’oeuvre de l’art. :.on le rebâtit encore plus fuper.-
bement. Les temples de Minerve à Athènes 6c à Sais
ne font pas moins célébrés. L e temple de Jupiter capitolin
à Rome, incendié tant de fois, épuila la prodigalité
de Domitien pour le'rebâtir. Le Corps dti
panthéon fubfifte toujours dans fon entier fous- lê
nom de Véglife de. tous les faints ; auxquels il eft- corn
facré comme il l’étoit dans le pâganifme, à toits lès
dieux. Le temple de la Paix: failoit, au rapport dé
Pline, un des plus beauxornemens deRome. Enfin,
rien n’étoit plus étonnant dans le paganilme que le
temple de Bélus, compofé de fept étages, dont le plus
élevé renfermoit la fiatue de c é ’dieu. Il y a beaucoup
d’autres temples moins célébrés, dont nous tracerons
l’hiftoire avec quelque foin, parce qu'elle eft très-
intéreffante. Les Antiquaires ont fait deffmer le plan
de quelques-uns de ces fameux édifices-? fur-tout
le P. Montfaucon , qu’on p:eut confulter ‘dans' fon
antiq. expliq. tom. I I . pag. 64.- & fü iv . !
- Le refpeû que l’on avoit pour les temples répbh-
doit à leur beauté^; ils étoient, comme je l?ai d it, un
lieu d’afyle pour les coupables & pour les débiteurs;
on n’ofoit y cracher ; & dans les calamités publiques
, les femmes venôienf fe proflerner dans lp
fanétuaire, pour en balayer le pavé avec' leurs cheveux.
Rarement les cônquérans ofoient en enlever
les richeffes-; car la politique & la religion contri-
buoient également à rendre ces monumens facrés
6c inviolables. •' -
. L’intérieur de tous ces temples étoit communément
décoré de ftatues de dieux 6c de ftatues de grands hommes,
dé tableaux,de dorures,d’armes prifes fur les ennemis,
de trépiés, de boucliers votifs,& d’autres richeffes
de ce gènre. Outre ces fortes d’ornemens, on
paroit les temples, dans les: jours de folemnité, des
décorations les plus brillantes* 6c de toutes fortes
de feftons de fleurs.
- De plus, comme ces temples étoient deftinés au
culte des dieux, on avoit égard dans leur ftruéture,
à la nature 6c aux fondions qui leur étoient attribués.
Ainfi, fuivant Vitruve, les temples de Jupiter
foudroyant, du Ciel, du Soleil, de la Lune, 6c du
dieu Fidius, dévoient être découverts. On obfër*
voit cette même convenance dans les ordres d’archi-
te&ure. Les temples de Minerve, de. Mars & d’Her-
cule dévoient être d’ordre dorique, dont la majefté
convenoit à la vertu robufle de ces divinités. On
èmployoit pour ceux de Vénus, de Flore, de Pro-
ferpine, 6c des nymphes des e aux, l’ordre corinthien
, l’agrément des feuillages, dès fleurs 6c des
volutes dont il eft égayé , fympàthifant avec la
beauté tendre 6c délicate de ces déeffes. L’ordre
ionique qui tenoit le milieu entre la févérité du dorique
6c la délicateffe du corinthien, étoit mis en
oeuvre dans ceux de Junon, de D iane, 6c de Bàc-
chus , en qui l’on imaginoit un jufte mélange d’agrément
6c de majefté. L’ouvrage ruftique étoit Con-
facré aux grottes des dieux champêtres. Enfin ,
tous les ornemens d’archite&ure que l’on voyoit
dans les temples, faifoient aufli-tôt connoître la divi-.
nité qui y préfidoit.
• Au relie, ce' fie fut pas aux dieux feuls que l’on
Bâtit des temples, l e s G r e c s , les Afiatiques, & lès Sy_-
Bens en confacrerent à leurs bienfaiteurs ou à leurs
maîtres. Les lois romaines laiffoient même la liberté
aux proconfuls de recevoir des honneurs pareils ;
cet ufage même étoit établi dès le tems de la république
, comme Suétone le remarque , 6c comme
il feroit aifé de le prouver par un grand nombre
d’exemples. (D. ƒ.)
T emples des Eg ypt iens. (Antiq. Egypt. ) Voici
la forme des temples d’Egypte fuivant Strabon.
A l’entrée du temple, dit-il, eft une cour pavée de
la largeur d’un arpent, & de la longueur de trois, dé
quatrè ou même davantage. Ce lieu s’appelle dromos
en grec , mot qui veut dire la courfe.
Le long de cet efpace , des deux côtés de la largeur,
font ppfés.des fphinx de pierre à vingt coudées,
6c meme plus de diflance l’un de l’autre, de
forte qu’il y en a un rang à droite ,6 c un rang à
gauche. Après lès fphinx eft un grand veflibule ;
plus avant il y en a un fécond, puis un troifieme :
mais ni |enombre des veftibules, ni celui des fphinx
n’eft fixé; il y en a plus où moins, à proportion de
la longeur & de la largeur des dromes.
Après le veftibule eft le temple qui a un grand parvis
, mais le temple même eft petit : il n’y a aucune
figure, ou s’il y en a , ce n’eft point celle d’un homme,
mais de quelque bête. Des deux côtés du pars
vis s’étendent les aîles, ce font des murs aufli hauts,
que \e temple. D ’abord leur diflance eft un peu plus
grande, ;que toute la largeur du temple ; enfuite ellee
le , rapprochent l’une de. l’autre jufqu’à cinquante
ou- foixante coudées. Ces murailles font pleines ds
grandes figures fculptées pareillès aux ouvrages de-
Tofeans ou des anciens Grecs. Il y a aufli un bâtiment
facré foutenu fur un grand nombre de colom-
nes, comme, à Memphis, d’une fabrique dans le goût
barbare ; car outre que les, eolomnes font grandes 6c
en grand nombre & difpofées en plufieurs rangs, il
n’y a ni peinture ni grâce ; c’eft plutôt un amas de
pierres qui a coûté inutilement beaucoup de travail.
J
Les Egyptiens avoient des temples monolythes,
ou faits d’ un feul morceau de marbre fouillé dans des
carrières éloignées, 6c qu’Pn avoit amenées par des
machines, que nous ne pouvons conftruire aujourd’hui,
tous favans que nous croyons être dans la
méchanique.
Rien de plus fuperbe que leurs temples, dit Clément
d’Aléxandrie, ( Padag.lib. III. cap. 2. p. 2/(T.)
rien de plus grave que leurs facrificateurs ; mais
quand on entre dans le: fanétuaire, 6c que le prêtre'
levant le voile , offre aux yeux la divinité, il fait
éclater de rire les fpeétateurs à l’àfpeét de l’objet
de fon> adoration ; on voit un chat, un crocodile,'
un ferpent étranger qui fe roule fur des tapis de
pourpre. C’eft là-deffus que faint Clément-compare
ces dieux égyptiens dans leurs temples aux femmes
qui fe parent de riches habits ; l’extérieur de ces femmes,
continue-t-il, eft magnifique, mais l’intérieur
en eft méprifable.
Ce que Clément d’Aléxandrie avance de la magnificence
des temples de l’Egypte, eft confirmé par les.
hiftoriens prophanes. Hérodote, Lucien 6c autres,
n’en parlent pas autrement : ils témoignent tous que
l’Egypte avoit un grand nombre de temples plus riches,
6c plus fplendides les uns que les autres. Tels
étoient Ceux d’Ilis 6c d’Ofiris en général ; tels étoient
en particulier ceux de Jupiter àDiofpolis, & à Her-
munthis, celui de Vulcain à Memphis, & celui de
Minerve à Sais. Nous parlerons de ces deux der-'
. niers à leur rang. (Z ) ./ )
T emples des G recs. (Antiq. Gnql) Les Grecs
aVoient un fi grand nombre de temples , de chapelles
6c d’autels , qu’on en trouvoit à chaque pas dans lés
, villes, dans les bourgades 6c dans les campagnes.