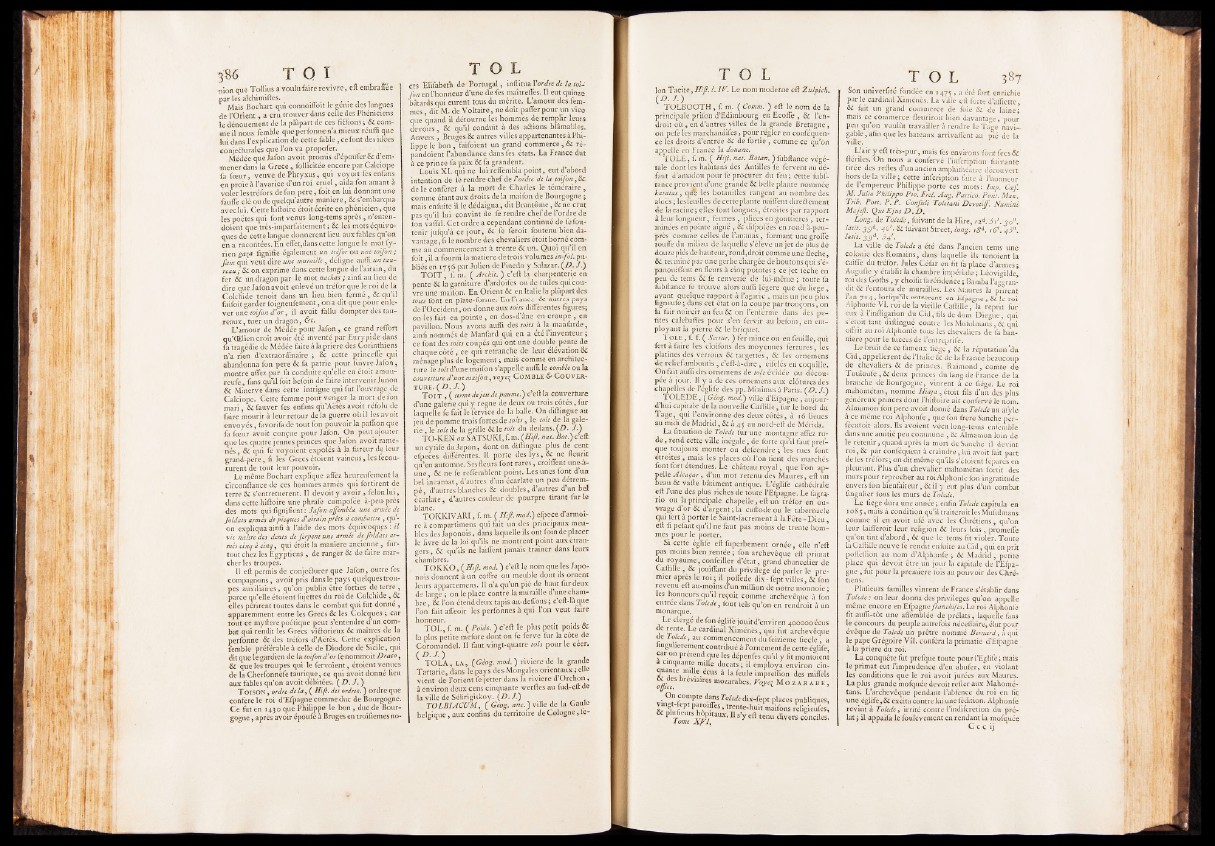
'îiion que T ollius a voulu faire re v iv r e , eil embraSee
.par les alchimiftes.
Mais Bochart qui connoiffoit le génie des langues
de l’O r ie n t , a cru trouver dans celle des Phéniciens
le dénouement de la plupart de ces fiûions ; & comme
il nous femble que.perfonne n’a m ieux réufli que
lui dans l’explication de cette fa b le , ce font des idées
conjecturales que l’on v a propofer.
Médée que Jafon avo it promis d’époùfer & d’ emmener
dans la G r e c e , follicitée encore pa rCa lciop e
fa foe u r , v eu v e de P h ry xu s , qui v o y o it fes enfans
en proie à l’ avarice d’un ro i c ru e l, aida fon amant à
v o le r lestréfors de fon p e re , foit en lui donnant une
fauffe clé ou de quelqu’autre maniéré, 6 c s’embarqua
a v e c lui. Cette hilloire étoit écrite en phénicien, que
les poètes qui font venus long-tems ap rè s , n’enten-
doient que très-imparfaitement ; & les mots équivoques
de cette langue donnèrent lieu aux fables qu’on
en a racontées. E n effet,dans cette langue le mot fy -
rien g a ^ a lignifie également u n t r i f o r ou u n e t o i f o n ;
f a m qui v eu t dire u n e m u r a i l l e , defigne aufli u n t a u r
e a u ; 6 c on exprime dans cette langue de l’airain, du
fe r & un dragon par le mot n a c h a s ; ainfi au lieu de
dire que Jafon avo it enlevé un tréfor que le roi de la
Colchide tenoit dans un lieu bien fermé , & qu’il
faifoit garder foigneufement, on a dit que pour enlev
e r une t o i f o n d ' o r , il avo it fallu dompter des taureaux
, tuer un dragon, & c .
L ’amour de Médée pour Jafon , ce grand reffort
qu’CElien croit avoir été inventé par Eurypide dans
la tragédie de Médée faite à lap rie re des Corinthiens
n’a rien d’extraordinaire ; 6 c cette princefle qui
abandonna fon pere 6 c fa patrie pour fuivre Jafon,
montre allez par fa conduite qu’elle eh étoit amou-
r eu fe , fans qu’ il foit befoin de faire intervenir Junon
& Minerve dans cette intrigue qui fut l’ouvrage de
Calciope. Cette femme pour venger la mort de fon
m a r i, 6 c fauver fes enfans qü’A ëtès avo it réfolu de
faire mourir à leur retour de la guerre où il les avoit
e n v o y é s , favorifa de tout fon pouvoir la paflion que
fa foeur avoit conçue pour Jafon. On peut ajouter
que les quatre jeunes princes que Jafon avo it ramenés
, 6 c qui fe voy oien t expolés à la fureur de leur
grand-pere, li les Grecs étoient vaincus, les fecou-
rurent de tout leur pouvoir.
L e même Bochart explique aflez heureufement la
circonllance de ces hommes armés qui fortirent de
terre 6 c s’entretuerent. Il devoit y avo ir , félon lu i ,
dans cette hilloire une phrafe compofée à-peu- près
des mots qui lignifient: J a f o n a f f e m b l a u n e a rm é e d e
f o l d a t s a rm e s d e p i c q u e s tC a i r a i n p r ê t s à c o m b a t t r e , qu’on
expliqua ainfi à l ’aide des mots équivoques : i l
v i t n a î t r e d e s d e n t s d e f e r p e n t u n e a rm é e d e f o l d a t s a r m
é s c i n q à c i n q , qui étoit la maniéré ancienne, fur-
tout chez les Egyptiens , de ranger 6 c de faire marcher
les troupes.
Il elt permis de conjedurer que Jafon, outre fes
compagnons, avoit pris dans le pays quelques troupes
auxiliaires, qu’on publia être forties de terre ,
parce qu’elle étoient fuiettes du roi de C o lch id e , 6 c
elles périrent toutes dans le combat qui fut donne ,
apparemment entre les Grecs 6 c les Colcques ; car
to ut ce myllere poétique peut s’entendre d’un combat
qui rendit les Grecs viélorieux 6 c maîtres de la
perfonne 6 c des tréfors d’Aëtès. Cette explication
femble préférable à celle de Diodore de S ic ile , qui
dit que le gardien de la t o i f o n d ' o r fe nommoit D r a c o ,
& que les troupes qui le fe rvo ient, étoient venues
de la Cherfonnèfe taurique, ce qui avo it donné lieu
aux fables qu’on avo it débitées. (Z ) . / . )
T OISON, o r d r e d e l à , ( H i ß . d e s o r d r e s . ) ordre que
conféré le roi d’Efpagne comme duc de Bourgogne.
C e fut en 1430 que Philippe le b o n , duc de Bourgogne
, après avoir époufé à Bruges en troifiemes noces
Ëlifabeth de P o r tu g a l, inflitua l' o r d r e d e l a t o i -
f o n en l’honneur d’une de fes maîtreffes. Il eut quinze
bâtards qui eurent tous du mérite. L’amour des femmes
dit M. de V o lta ire , ne doit paffer pour un v ice
que quand il détourne les hommes de remplir leurs
d e v o ir s , & qu’il conduit à des aérions blâmables.
Anvers , Bruges & autres v illes appartenantes à Phi7
lippe le b o n , faifoient un grand commerce , 6 c ré-
pandoient l’abondance dans fes états. L a France dut
à ce prince fa paix 6 c fa grandeur.
Louis X I . qui ne lui reffembla po in t, eut d’abord
intention de le rendre ch e f de ü o r d r e d e l a t o i f o n , &C
■ de le conférer à la mort de Charles le tém é ra ire ,
comme étant aux droits de la maifon de Bourgogne ;
mais enfuite il le dédaigna, dit Brantôme, & ne crut
pas qu’il lui convînt de fe rendre ch e f de l’ordre de
fon vafîàl. C e t ordre a cependant continué de fefou-
tenir jufqu’à ce jo u r , & fe feroit fouténu bien davantage,
fi le nombre des chevaliers étoit borné comme
au commencement à trente 6 c un. Q u oi qu’ il en
fo i t , il a fourni la matière de trois volumes i n - f o l . publiés
en 1756 par Julien de Pinedo y Salazar. { D . J . )
T O IT f. m. ( A r c h i t . ) c’eft la charpenterie en
pente & la garniture d’ardoifes ou de tuiles qui couv
re une maifon. En Orient 6 c en Italie la plupart des
t o i t s font en plate-forme. En France 6 c autres pays
de l’O c c id en t , on donne aux t o i t s différentes figures;
on les fait en pointe , en dos-d’âne en croupe , en
pavillon. Nous avons aulîi des t o i t s à la manfarde,
ainfi nommés de Manfard qui en a ete 1 inventeur ;
ce font des t o i t s coupés qui ont une double pente de
chaque c ô t é , ce qui retranche de leur élévation &
ménage plus de logement ; mais comme en architecture
le t o i t d’une maifon s’appelle aulîi le c o m b le ou la
c o u v e r t u r e d ' u n e m a i f o n 9 v o y e { COMBLE 6* COUVERTURE.
( D . J . )
T o it , ( te rm e d e j e u d e p a u m e . j c’e ll la couverture
d’une galerie qui y regne de deux ou trois c o te s , fur
laquelle fe fait le fervice de la balle. On ƒ illingue au
jeu de pomme trois fortes de t o i t s , le t o i t de la galerie
, le t o î t de la grille 6 c le t o i t du dedans. (Z>. J . )
T O -K E N ou SA T SU K I , f. m. { H i ß . n a t . B o t . ) c’eft
un cytife du Japon, dont on dillingue plus de cent
efpeces différentes. Il porte des l y s , 6 c ne fleurit
qu’en automne. Ses fleurs font ra re s , croiffent une-à-
u n e , & ne fe reffemblent point. Les unes font d’un
bel incarnat, d’autres d’un écarlate un peu détremp
é , d’autres blanches 6 c doubles, d’autres d’un bel
I e ca rla te , d’autres couleur de pourpre tirant fur le
; blanc.
T O K K IV A R l , f. m. ( H i ß . m o d . ) efpece d armoire
à compartimens qui fait un des principaux meubles
des Japonois, dans laquelle ils ont foin de placer
le livre de la loi qu’ils ne montrent point aux étrangers
, 6 c qu’ils ne laiffent jamais traîner dans leurs
chambres.
T O K K .O , ( H i ß . m o d . ) c’eft le nom que les Japonois
donnent à un coffre ou meuble dont ils ornent
leurs appartemens. Il n’a qu’un pié de haut fur deux
de large ; on le place contre la muraille d’une chambre
, 6 c l ’on étend deux tapis au-deffous ; c’eft-làque
l’on fait affeoir les perfonnes à qui l’on veut faire
honneur.
T O L , f. m. ( P o i d s . ) c’ eft le plus petit poids &
la plus petite mefure dont on fe fe rve fur la côte de
Coromandel. Il faut vingt-quatre t o l s pour le céer.
w m m J Ê Ê
T O L A , l a , ( G é o g .m o d . ) riviere de la grande
T artarie, dans le pays des Mongales orientaux ; elle
v ien t de l’orient fe jetter dans la riviere d’O r ch o n ,
à environ deux cens cinquante werftes au fud-eft de
la ville de Sélirigiskoy. ( D . J . )
T O L B I A C U M , ( G é o g . «ne.) v ille de la Gaule
b e lgiqu e , aux confins du territoire de C o lo gn e , fe-
Ion Tacite, IIî(l. I. IP. Le nom moderne eft Zulpich. mBBÊ TOLBOOTH, f. m. ( Comm.) eft le nom de la
principale, prifon d’Edimbourg en Ecoffe , 6c l’endroit
où , en d’autres villes de la grande Bretagne,
on pefeles marchandifes, pour régler en conféquen-
ce les droits d’entrée 6c de fortie , comme ce qu’on
appelle en France la douane.
TO L E , f. m. ( Hijl. nat. Botan. ) fubftance végétale
dont les habitans des Antilles fe fervent au défaut
d’amadou pour fe procurer du feu ; cette fubftance
provient d’une grande 6c belle plante nommée
karatas, que les botaniftes rangent au nombre des
aloës ; les feuilles de cette plante naiffent direélement
de la racine; elles font longues, étroites par rapport
à leur longueur, fermes , pliées en gouttières, terminées
en pointe aiguë , 6c difpofées en rond à-peu-
près comme celles de l’ananas, formant une groffe
touffe du milieu de laquelle s’élève un jet de plus de
douze piés de hauteur, rond,droit comme une fléché,
& terminé par une gerbe chargée de boutons qui s’é-
panouiffent en fleurs à cinq pointes ; ce jet feche en
peu de tems 6c fe renverfé de lui-même ; toute fa
fubftance fe trouve alors aufli légère que du liege ,
ayant quelque rapport à l’agaric , mais un peu plus
ligneufe; dans cet état on la coupe par tronçons , on
la fair noircir au feu 6c on l’enferme dans des petites
calebaffes pour s’en fervir au befoin, en employant
la pierre 6c le briquet.
T ôle , f. f. ( Sentir. ) fer mince ou en feuille, qui
fert à faire les cloifons des.moyennes ferrures, les
platines des verroux 6c targettes, 6c les ornemens
de relief amboutis , c’eft-à-dire, cifelés en coquille.
On fait aufli des ornemens de tôle évidée ou découpée
à jour. Il y a de ces ornemens aux clôtures des
chapelles de l’églife des pp. Minimes à Paris. CD. J.)
I TOLEDE, ( Géog. mod.) ville d’Efj )agne, aujourd’hui
capitale de la nouvelle Caftille, fur le bord du
Tage, qui l’environne des deux côtés, à 16 lieues
au midi de Madrid, 6c à 45 au nord-eft de Mérida.
La fituation de Tolede fur une montagne aflez rude
, rend cette ville inégale, de forte qu’il faut pref-
que toujours monter ou defeeridre ; les rues font
étroites, mais les places où l’on tient des marchés
font fort étendues. Le château ro y al, que l’on appelle
Alcaçar, d’un mot retenu des Maures, eft un
beau 6c vafte bâtiment antique. L’églife cathédrale
eft l’une des plus riches de toute l’Eipagne. Le fagra-
rio ou la principale chapelle, eft un tréfor en ouvrage
d’or 6c d’argent ; la euftode ou le tabernacle
qui fert à porter le Saint-facrement à la Fête - Dieu,
eft fi pefant qu’il ne faut pas moins de trente hommes
pour le porter.
Si cette églife eft Superbement ornée, elle n’eft
pas moins bien rentée ; fon archevêque eft primat
du royaume, çonfeiller d’état, grand chancelier de
Caftille, & jouiffant du privilège de parler le premier
après le roi ; il :poffede dix - fept v illes, 6c fon
revenu eft au-moins d’un million de notre monnoie ;
les honneurs qu’il reçoit comme archevêque à fon
entrée dans Tolede, lônt tels qu’on en rendroit à un
monarque.
Le cierge de fon églife jouit d’envireiï 400000 écus
de rente. Le cardinal Ximénès, qui fut archevêque
de Tolede, au commencement du feizieme fiecle , a
inguUerement contribué à l’ornement de cette églife,
car on prétend que les dépenfes qu’il y fit montoient
a cinquante milfe ducats; il employa environ cin-
quante mflle écus à la feule impreflion des miffels
ù c o ç s bréviaires mozarabes. Foyer M o z a r a b e ,
office. x 9
vmgt-fept paroiffes, trente-huit maifons religieufei p tîm u s’y eft tenu H mm
Son univerfité fondée en 1475 » a été fort enrichie
par le cardinal-Ximénès. La ville eft forte d’afliette
6 c fait un grand commerce de foie 6 c de lain e;
mais ce commerce fleuriroit bien davantage, pour
peu qu’on voulût travailler à rendre le Tage navigable
, afin que les bateaux arrivaffent au pié de la
ville.
L air y eft tres-pur, mais fes environs font fecs 6 c
fteriles. O n nous a conferve l’mfcription Suivante
tirée des reftes d’un ancien amphithéâtre découvert
hors de la v ille ; cette infeription faite à l’honneur
de l’empereur Philippe porte ces mots: lm p . C oe f .
M . J u l i o P h i l i p p o P 1 0 . F r e l . A u g . 'P a r t i c o . P o n t . M a x .
T r i b . P o t t . P . P . C o n f u U T o ie t a n t D e v o t i f f . N u m i n i
M a j e f l . Q u e E j u s D . D .
L o n g , de T o l e d e , fuivant de la Hire, /zd. 5/L 3 0 " .
l a t t e , j e ) * . 4 6 * . 6 c lùivantStreet, l o n g . i S d . t 6 ‘ . 4 6 “ .
l a t i t . 3 c > d . 6 4 ! .
La v ille de T o l e d e a été dans l’ancien tems une
colpnie des Romains, dans laquelle ils tenoient la
caille du tréfor. Jules Céfar en fit fa place d ’armes;
Augufte y établit la chambre impériale ; Léovigilde,
ro i des G o th s , y choilitfaréfidence ; Bamba l’aggran-
dit 6 c l’entoura de murailles. Les Maures la prirent
l’an 7 1 4 , lorfqu’ils entrèrent en Efpa gne, 6 c le roi
Alphonle VI. roi de la vieille C a ftille , la reprit fur
eux à 1 inftigation du C id , fils de dom D ie g u e , qui
s etoit. tant dillingue contre les Mufulmans, 6 c qui
offrit au roi Alphonfe tous les chevaliers de fa bannière
pour le Succès de l’entreprife.
Le bruit de ce fameux liège , 6 c la réputation’du
C id , ap pe lè rent de l’ Italie 6 c de la France beaucoup
de chevaliers & de princes. Ra imond, comte de
T ouloufe , 6 c deux princes du fang de France de la
branche de Bourgogne, vinrent à ce fiége. Le roi
mahométan, nommé H i a j a , étoit fils d’un des plus
généreux princes dont l’hiftoire ait confervé le nom.
Almamon fon pere avo it donné dans T o l e d e un afyle
à ce même ro i A lp hon fe , que fon frere Sanche per-
fecutoit alors. Ils avoient v écu long-tems enfemble
dans une amitié peu commune , 6 c Almamon loin de
le retenir, quand après la mort de Sanche il devint
r o i , 6 c par conféquent à craindre, lui avoit fait part
de fes tréfors; on dit même qu’ils s’étoient Séparés en
pleurant. Plus d’un chevalier mahométan Sortit des
murs pour reprocher au roi Alphonfe fon ingratitude
envers fon bienfaiteur , & il y eut plus d’un combat
Singulier lions les murs de T o le d e .
L e liege dura une année ; enfin T o le d e capitula en
1085, mais à condition qu’il traiteroit les Mufulmans
comme il en avoit ufé avec les C hrétien s, qu’ on
leur laifferoit leur religion 6 c leurs lo i s , promeffe
qu’on tint d’a b ord , 6 c que le tems fit vio le r. T ou te
la Caftille neuve fe rendit enfuite au C id , qui en prit
poflèflîon au nom d’Alphonfe ; 6 c Madrid , petite
place qui devoit être un jour la capitale de l’Efpa-
gne , fut pour la première fois au pouvo ir des Chrétiens.
Plufieurs familles vinrent de France s’établir dans
T o l e d e : on leur donna des privilèges qu’on appelle
même encore en Efpagne f r a n c h i f e s . Le ro i Alphonfe
fit aufli-tôt une affemblée de prélats , laquelle fans
le concours du peuple autrefois néceffaire, élut pour
évêque de T o l e d e un prêtre nommé B e r n a r d , à qui
le pape Grégoire V IL conféra la primatie d’Efpagne
à la priere du roi.
La conquête fut prefque toute pour l’Eglife ; mais
le primat eut l’imprudence d’en abufer, en violant
les conditions que le ro i avoit jurées aux Maures.
La plus grande mofquée devoit refter aux Mahomé-
tans. L ’archevêque pendant l’abfence du roi en fit
une é glife , 6 c excita contre lui une fédition. A lphonfe
rev in t à T o l e d e , irrité contre l’indiferetion du prélat
; il appaifa le foulevement en rendant la mofquée