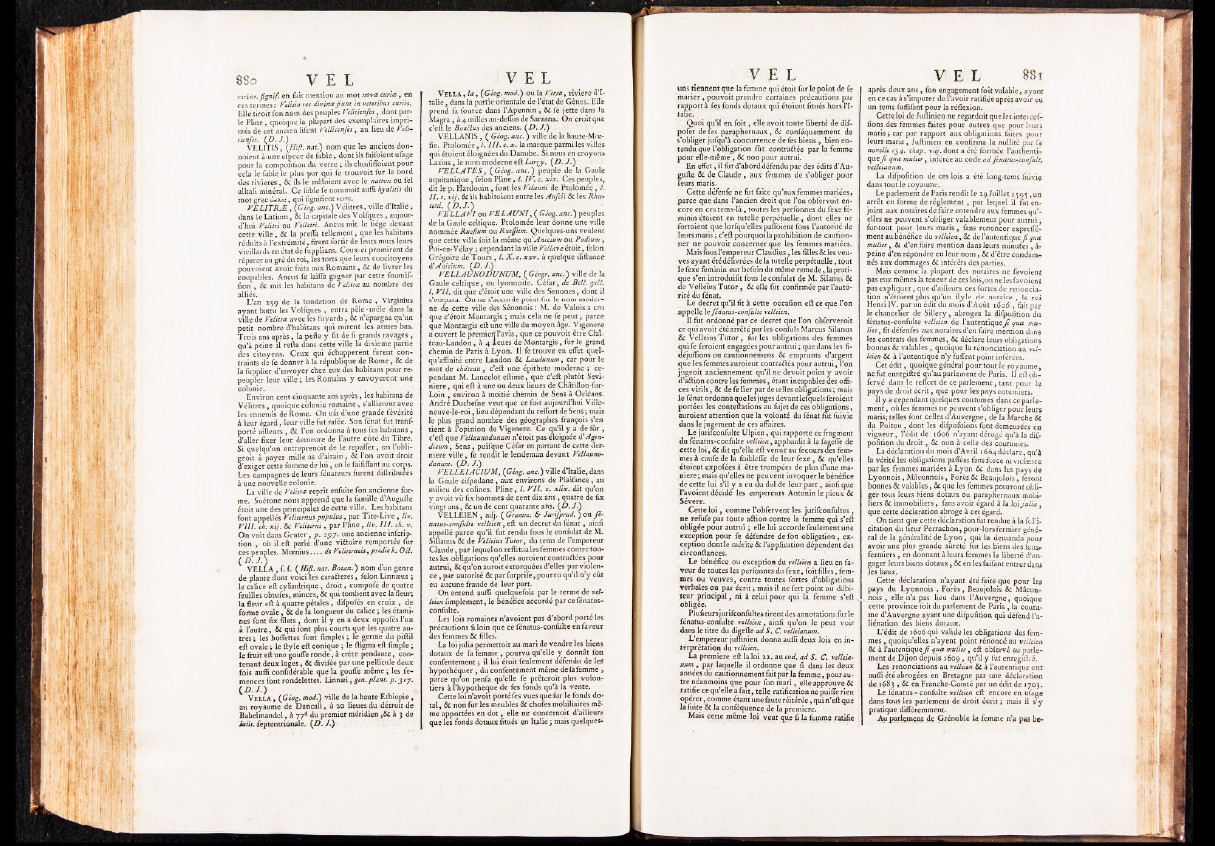
vtrbor.fignif. en fait mention au mot nova curia, en
ces termes : Vditia res divince fiunt in vetcribus curas.
Elle tiroit fon nom des peuples Vüitienfes| dont parle
Pline, quoique la plupart des exemplaires imprimés
de cet ancien lifent Vellicenfts , au lieu de Veli—
tienfes. (D . J.)
VELITIS, (Hift. nat.) nom que les anciens don-
noient à une efpece de fable, dont ils faifoient ufage
pour la compofition du verre ; ils choiliffoient pour
cela le fable le plus pur qui fe trouvoit fur le bord
des rivières, & ils le méloient avec le natron ou fel
alkali minéral. Ce fable 1e nommoit aufli hyalitis du
mot grec J*Xoç, qui lignifient verre.
V E L IT RÆ , (Géog. une.) Vélitres, ville d’Italie,
dans le Latium, & la capitale des Volfques , aujourd'hui
Velitri ou Velletri. Ancus mit le fiége devant
cette v ille , & la preffa tellement, que les habitans
réduits l’extrémité, firent fortir de leurs murs leurs
vieillards en état de fupplians. Ceux- ci promirent de
réparer au gré du roi, les torts que leurs concitoyens
pouvoient avoir faits aux Romains, & de livrer les
coupables. Ancus fe laiffa gagner par cette foumif-
fion , & mit les habitans de Velitra au nombre des
alliés.
L’an 159 de la fondation de Rome , Virginius
ayant battu les Volfques , entra pele-mele dans la
ville de Velitra avec les fuyards, & n’épargna qu’un
petit nombre d’habitans qui mirent les armes bas.
Trois ans après, la pefte y fit de fi grands ravages ,
qu’à peine il refta dans cette ville la dixième partie
des citoyens. Ceux qui échappèrent furent contraints
de fe donner à la république de Rome, & de
la fupplier d’envoyer chez eux des habitans pour repeupler
leur ville ; les Romains y envoyèrent une
colonie. ^
Environ cent cinquante ans apres, les habitans de
Vélitres, quoique colonie romaine, s allièrent avec
les ennemis de Rome. On ufa d’une grande févérité
à leur égard, leur ville fut rafee. Son fenat fut tranf-
porté ailleurs , & l’on ordonna à tous fes habitans ,
d’aller fixer leur demeure de l’autre côté du Tibre.
Si quelqu’un entreprenoit de le repaffer, on l’obli-
geoit à payer mille as d’airain, & 1 on avoit droit
d’exiger cette fomme de lui, en le fiufiflant au corps.
Les campagnes de leurs fénateurs furent diftribuees
à une nouvelle colonie.
La ville de Velitra reprit enfuite fon ancienne forme.
Suétone nous apprend que la famille d’Augufte
étoit une des principales de cette ville. Les habitans
font appellés Velitemus populus, par Tite-Live, liv.
VIII. ch. xij. & Veliterni, par Pline, liv. I I I . ch. v.
On voit dans Gruter, p. 297. une ancienne inferip-
tion , où il eft parlé d’une victoire remportée fur
ces peuples. Moenius. . . . de Vilitcrneis, préditk. Ocl.
( D . J . )
VELLA , f. f. ( Hifl. nat. Botan. ) nom d’un genre
de plante dont voici les cara&eres, félon Linnæus ;
le calice eft cylindrique, droit, compofé de quatre
feuilles obtufes, minces, & qui tombent avec la fleur;
la fleur eft à quatre pétales, difpofés en croix , de
forme o vale, & de la longueur du calice ; les étamines
font fix filets, dont il y en a deux oppofés l’un
à l’autre, & qui font plus courts que les quatre autres;
les boffettes font Amples; le germe du piftil
eft ovale ; le ftyle eft conique ; le ftigma eft fimple ;
le fruit eft une goufle ronde, à crête pendante, contenant
deux loges, & divifée par une pellicule deux
fois aufli confidérable que la goufle même ; les fe-
mences font rondelettes. Linnaei, gen. plant, p. 31 y.
m Ê m
V ellà , ( Géog. mod.) ville de la haute Ethiopie,
au royaume de Dancali, à 10 lieues du détroit de
Babelmandel, à 77«* du premier méridien ,& à 3 de
iatit. feptentrionale. (D . J.)
V e l l a , la , (Géog. mod.") ou la Verra, riviere d’Italie
, dans la partie orientale de l’état dé Gènes. EUè
prend fa fource dans l’Apennin , & fe jette dans la
Magra , à 4 milles au-defliis de Sarzana. On croit que
c’eft le B ou cl us des. anciens. (D . J.)
VELLANIS , ( Géog. anc. ) ville de la haute-Moe-
fie. Ptolomée, l. I I I . c. x. la marque parmi les villes
qui étoient éloignées du Danube. Si nous en croyons
Lazius, le nom moderne eft Larçy. (D . J.')
VE L IA T E S y (Géog. anc.') peuple de la Gaule
àquitanique, félon Pline , /. IV. c. xix. Ces peuples,
dit le p. Hardouin, font les Velauni de Ptolomée, /.
II. c. vij. & ils habitoient entre 1 es Aufcii & les Rhu-
teni. (D .J . )
V E L L A V I ou VELAU N I y ( Géog. anc.) peuples
de la Gaule celtique. Ptolomée leur donne une ville
nommée Ruefium ou Ruefium. Quelques-uns veulent
que cette ville foit la même qu’’Anicium ou Podium,
Pui-en-Vélay ; cependant la ville Vdlava étoit, félon
Grégoire de Tours , /. X . c. xxv. à quelque diftance
Anicium. (D. J.)
VE LL A UNO D UNUM, (Glogr. anc.) ville de là
Gaule celtique, ou lyonnoile. Céfar, de Bell. gall.
l. VII. dit que c’étoit une ville des Senones, dont il
s’empara. On ne s’accorde point fur le nom moderne
de cette ville desSénonois : M. de Valois a cru
que c’étoit Montargis ; mais cela ne fe peut, parce
que Montargis eft une ville du moyen âge. Vigenere
a ouvert le premier! l’avis, que ce pouvoit être Châ-
teau-Landon, à 4 Jieues de Montargis, fur le grand
chemin de Paris à Lyon. Il fe trouve en effet quel-
qu’affinité entre Landon & Laudanum, car pour le
mot de château, c’eft une épithete moderne ; cependant
M. Lancelot eftime, que c’eft plutôt Sevi-
niere, qui eft à une ou deux lieues de Châtillon-fur-
Loin , environ à moitié chemin de Sens à Orléans.
André Dttchefne veut que ce foit aujourd’hui Ville-
neuve-le-roi, lieu dépendant du reflort de Sens; mais
le plus grand nombre des géographes françois s’ en
tient à l’opinion de Vigenere. Ce cju’il y a de fûr ,
c’eft que Vellaunodunum n’étoit pas éloignée d'Agen-
dicum, Sens , puifque Céfar en partant de cette dernière
v ille , fe rendit le lendeman devant Vellaunodunum.
(D . J.)
VELLEIACIUM, (Géog. anc.) ville d’Italie, dans
la Gaule cifpadane, aux environs de Plaifance, au
milieu des colines. Pline, l. VII. c. xlix. dit qu’on
y avoit vû fix hommes de cent dix ans , quatre de fix
vingt ans, & un de cent quarante ans. (D . J.)
VELLEÏEN , adj. ( Gramm. & Jurifprud. ) ou fe-
natus-confulte velleïen, eft un decret du fénat, ainû
appellé parce qu’il fut rendu fous le confulat de M.
Sillanus & de Velleius Tutor, du tems de l’empereur
Claude, par lequel on reftitua les femmes contre toutes
les obligations qu’elles auroient contrariées pour
autrui, & qu’on auroit extorquées d’elles par violence
, par autorité & par furprife, pourvu qu’il n’y eût
eu aucune fraude de leur part.
On entend aufli quelquefois par le terme de vel-
lèïen Amplement, le bénéfice accordé par ce fénatus-
confulte.
Les lois romaines n’avoient pas d’abord porté les
précautions fi loin que ce fénatus-confulte en faveur
des femmes & filles.
La loi julia permettoit au mari de vendre les biens
dotaux de fa femme , pourvu qu’elle y donnât fon
confentement ; il lui étoit feulement défendu de les
hypothéquer , du confentement même de fa femme ,
parce quon penfa qu’elle fe prêteroit plus volontiers
à l’hypotheque de fes fonds qu’à la vente.
Cette loi n’avoit porté fes vues que fur le fonds do*
tal, & non fur les meubles & choies mobiliaires même
apportées en dot, elle ne concernoit d’ailleurs
que les fonds dotaux fitués en Italie ; mais quelquesuns
tiennent que la femme qui étoit fur le point de fe
marier, pouvoit prendre certaines précautions par
rapport à fes fonds dotaux qui étoient fitués hors l’Italie.
Quoi qu’il en fo it , elle avoit toute liberté de dif-
pofer de fes parçphernaux, & conféquemment de
s’obliger jufqu’à concurrence de fes biens , bien entendu
que l’obligation fut contrariée par la femme
pour elle-même, & non pour autrui.
En effet, il fut d’abord défendu par des édits d’Au-
gufte & de Claude , aux femmes de s’obliger pour
Teurs maris.
Cette défenfe ne fut faite qu’aux femmes mariées»
parce que dans l’ancien droit que l’on obfervoit encore
en ces tems-là, toutes les perfonnes du fexe féminin
étoient en tutelle perpétuelle, dont elles ne
fortoient que lorfqu’elles pafloient fous l’autorité de
leurs maris ; c’eft pourquoi la prohibition de cautionner
ne pouvoit concerner que les femmes mariées.
Mais fous l’empereur Claudius, les filles & les veuves
ayant été délivrées delà tutelle perpétuelle, tput
le fexe féminin eut befoin du même remede, la pratique
s’en introduifit fous le confulat de M. Silanus &
de Velleius Tu to r , & elle fut confirmée par l’autorité
du fénat.
Le decret qu’il fit à cette occafion eft ce que l’on
appelle le fénatus-confulte velleïen.
Il fut ordonné par ce decret que l’on obferveroit
ce qui avoit été arrêté par les confuls Marcus Silanus
& VelleïusTutor, furies obligations des femmes
quife feroient engagées pour autrui ; que dans les fi-
déjuflions ou cautionnemens & emprunts d’argent
que les femmes auroient contrariés pour autrui, l’on
jugeoit anciennement qu’il ne devoit point y avoir
d’aâion contre les femmes, étant incapables des offices
virils, & de fe lier par de telles obligations ; mais
le fénat ordonna que les juges devant lefquels feroient
portées les contestations au fu jet de ces obligations,
auroient attention que la volonté du fénat fût fuivie
.dans le jugement de ces affaires.
Le jurilconfulte Ulpien, qui rapporte ce fragment
du fénatus-confulte velleïen, applaudit à la fagefle de
cette loi, & dit qu’elle eft venue au fecours des femmes
à caufe de la foiblefîe de leur fexe, & qu’elles
étoiept expofées à être trompées de plus d’une maniéré;
mais qu’elles ne peuvent invoquer le bénéfice
de cette loi s’il y a eu du dol de leur p art, ainfi que
l’avoient décide les empereurs Antonin le pieux &
Sévere.
Cette lo i , comme l’obfervent les jurifeonfuites ,
ne refufe pas toute aftion contre la femme qui s’eft
obligée pour autrui ; elle lui accorde feulement une
exception pour fe défendre de fon obligation, exception
dont le mécite & l’application dépendent des
circonftances.
Lé bénéfice ou exception du velleïen a lieu en faveur
de toutes les perfonnes du fexe, foit filles, femmes
ou veuves, contre toutes fortes d’obligations
verbales ou par écrit ; mais il ne fert point au débiteur
principal, ni à celui pour qui la femme s’eft
obligée.
Plufieurs jurifeonfuites tirent des annotations fur le
fénatus-confulte velleïen, ainfi qu’on le peut voir
dans le titre du digefte ad S. C. velleianum.
L’empereur juftinien donna aufli deux lois en interprétation
àwvelleïcn.
La première eft la loi i%. au cod. ad S. C. velleianum
y paj laquelle il ordonne que fi dans les deux
années du cautionnement fait par la femme, pourau-
tre néanmoins que pour fon mari, elle approuve &
ratifie ce qu’elle a fait, telle ratification ne puiffe rien
operer, comme étant une faute réitérée, qui n’eft que
la fuite & la confequence de la première.
Mais cette même loi veut que fi la femme ratifie
après deux ans, fon engagement foit valable, ayant
en ce cas à s’imputer de l’avoir ratifiée après avoir eu
un tems fuififant pour la réflexion.
Cette loi de Juftinien ne regardent que les intercef-
fions.des femmes fhites pour autres que pour leurs
maris ; car par rapport aux obligations faites pour
leurs maris , Juftinien en confirma la nullité par f^
novelle 13 4. chap. viij. dont a été formée l’authentique
f i qua mu lier, inférée au code ad fenatw-cpnfult,
velleianum.
La difpofition de ces lois a été long-tems fuivie
dans tout le royaume.
Le parlement de Paris rendit le 19 Juillet 1595 ,up
arrêt en forme de réglement , par lequel il fut enjoint
aux polaires dé faire entendre aux femmes qu’elles
ne peuvent s’obliger valablement pour autrui,
fur-tout pour leurs maris, fans renoncer expreffér
ment au bénéfice du velleïen, & de l’autentique f i qua
mulier, & d’en faire mention dans leurs minutes , à-
peine d’en répondre en leur nom, & d’être condamnés
aux dommages & intérêts des parties.
Mais comme la plupart des notaires ne favoient
pas eux mêmes la teneur de ces lois,ou ne les favoient
pas expliquer, que d’aill,eur$ ces fortes de renonciar
tiçn n’étoient plus qu’un ftyle de notaire , le roi
Henri IV. par un édit du mois d’Âoût 1606 , fait par
le chancelier de Sillery, abrogea la difpofition du
fénatus-confulte velleïen de l’autentique f i qua mulier
, fit défenfes aux notaires d’en faire mention dans
les contrats des femmes, & déclare leurs obligations
bonnes & valables , quoique la rénonciation au vd-r
Iden à l’autentique n’y fuffent point inférées.
Cet édit, quoique général pour tout le royaume,
ne fut enregiftré qu’au parlement de Paris. Il eft ob-
fervé dans le reflort de ce parlement, tant pour le
p^ys de droit écrit, que pour les pays cotumiers.
Il y a cependant quelques coutumes dans ce parler
ment, où les femmes ne peuvent s’obliger pour leurs
maris; telles font celles d’Auvergne, de la Marche &
du Poitou , dont les difpofitions font demeurées ei>
vigueur, l’édit de 1606 n’ayant dérogé qu’à la dilr
pofition du droit, & non à-celle des coutumes.
La déclaration du mois d’Avril 1664déclare, qu’à
la vérité les obligations paffées fans force ni violence
par les femmes mariées à Lyon & dans les pays de
Lyonnois, Mâconnois, Forés & Beaujolois, feront
bonnes & valables, & que les femmes pourront obliger
tous leurs biens dotaux ou paraphernaux mobiliers
& immobiliers, fans avoir égard à la loi ju lia ,
que cette déclaration abroge à cet égard.
On tient que cette déclaration fut rendue à la fol'i-
citation du fieur Perrachon, pour-lors fermier général
de la généralité de L y o n , qui la demanda pour
avoir une plus grande sûreté fur les biens des lousr
fermiers, en donnant à leurs femmes la liberté d’engager
leurs biens dotaux, & en les faifant entrer dans
les baux,
Cette déclaration n’ayant été faite que pour les
pays du Lyonnois , Forés, Beaujolois & Mâconnois
, elle n’a pas lieu dans l’Auvergne, quoique
cette province foit du parlement de Paris, la coutume
d’Auvergne ayant une difpofition qui défend l’aliénation
des biens dotaux.
L’édit de 1606 qui valide les obligations des femmes
, quoiqu’elles n’ayent point rénoncé au velleïen
& à l’autentique f i qua mulier, eft obfervé au parlement
de Dijon depuis 1609 , qti’il y fut enregiftré.
Les renonciations au velleïen & à l’autentique ont
aufli été abrogées en Bretagne par une déclaration
de 1683 , & en Franche-Comté par un édit de 1703.
Le fénàtus - confulte velleïen eft encore en ufage
dans tous les parlemens de droit écrit ; mais il s’y
pratique différemment.
Au parlç/p$nt de Grenoble la femme n’a pas be