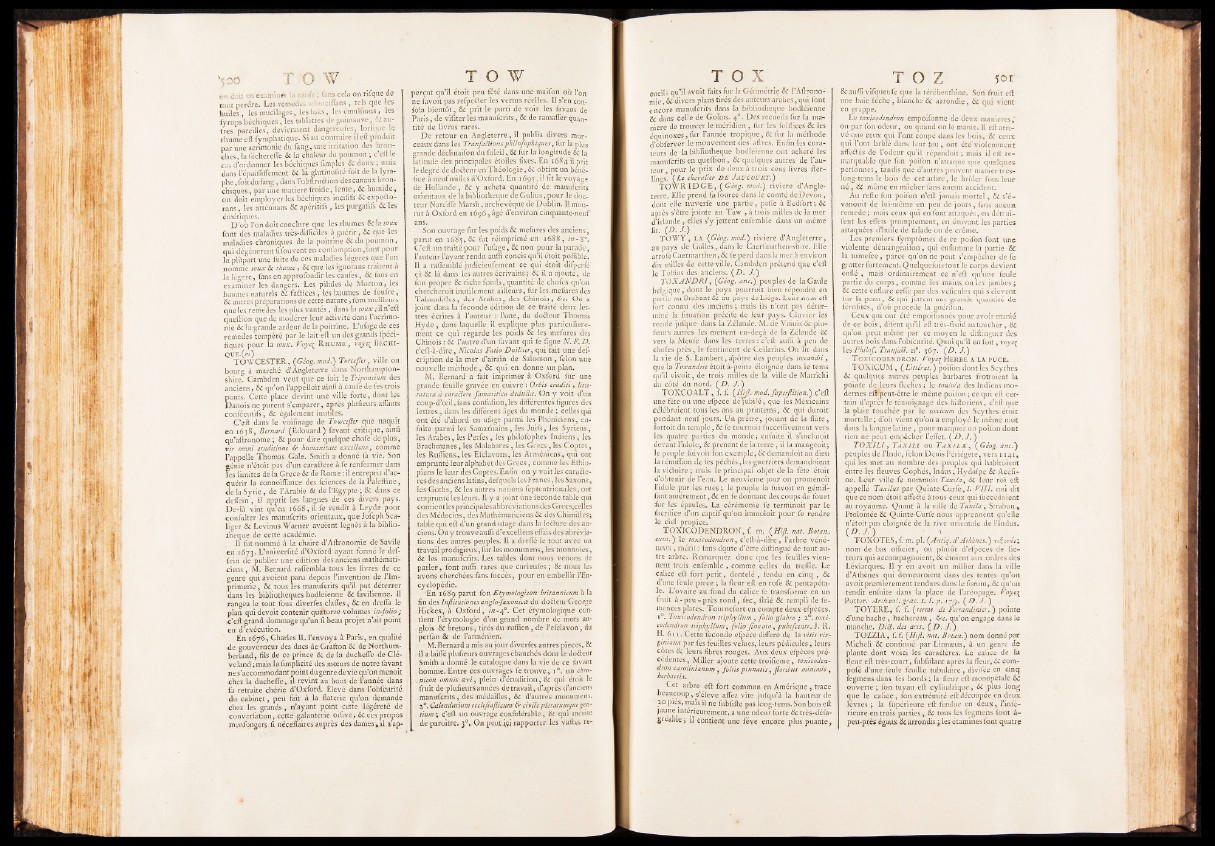
on doit en examiné»- la caufe ; fans cela on rifque de
tout perdre. Les remedes adouciflans , tels que les
huiles, les mucilages, les loks, les émulfions, les
fyrops béchiques, les tablettes de guimauve, 8c autres
pareilles, deviennent dangereuses, lorfque le
rhume eft fymphatique. Si au contraire il eft produit
par une acrimonie du fang, une irritation des bronches,
la féchereffe & la chaleur du poumon ; c’eft le
cas d’ordonner les béchiques Amples & doux ; mais
dans l’épaiffiffement 8c la glutinofité foit de la lymphe,
foit du fang , dans l’obftruftion des canaux bronchiques
, par une matière froide, lente, 8c humide,
on doit employer les béchiques incififs 8c expeftô-
rans, les atténuans 8c apéritifs, les purgatifs 8c les
émétiques. ' ■
D ’où l’on doit conclure que les rhumes 8c la toux
font des maladies très-difficiles à guérir, 6c que les
maladies chroniques de la poitrine 6c du poumon,
qui dégénèrent fifouvent en confomption, lotit pour
la plûpart une fuite de ces maladies légères que l?on
nomme toux 8c rhume » 6c que les ignorans traitent à
la légère, fans en approfondir les caufes, 6c fans en
examiner les dangers. Les pilules de Morton, les
baumes naturels 6c faûices, les baumes de foufre,
6c autres préparations de cette nature , font meilleurs
que les .remedes les plus vantés, dans la toux; il n’eft
queftion que. de modérer leur aâûvite dans l’acrimonie
6c la grande ardeur de la poitrine. L’ufage de ces
remedes tempéré par le lait eft un des grands fpeci-
fiquès pour la toux. Foye^ R hume , voyei Béçhi-
QVE.Çm)
• TQWCESTER, (Géog. moi.) Torcepr, ville ou
bourg à marché d’Angleterre dans Northampton-
shire. Cambden veut que ce foit le Tripontium des
anciens, 6c qu’on l’appelloit ainfi à caufe de fes trois
ponts. Cette place devint une ville forte, dont les
Danois ne purent s’emparer, après plufieurs aflauts
confécutifs, 6c également inutiles.
C’eft dans le voifinage de Towcepr que naquit
en 163B, Bernard (Édouard) favant critique* ainfi
qu’aftronome ; 6c pour dire quelque chofe de plus,
vir omni eruditione & humanitate zxcelLtns, comme
l ’appelle Thomas Gale. Smith a donné fa vie. Son
génie n’étoit pas d’un caraftere à fe renfermer dans
les limites de la Grece 6c de Rome : il entreprit d’acquérir
la connoifîance des fciences de la Paleftine,
de la Syrie, de l’Arabie 6c de l’Égypte ; 6c dans ce
deffein , il apprit les langues de ces divers pays.
De-là vint qu’en 16 68 ,il fe rendit à Leyde pour
confulter les manufcrits Orientaux, que Jofeph Sca-
liger 6c Levinus ’Warner avoient légués à la bibliothèque
de cette académie.
Il fut nommé à la chaire d’Aftronomie de Savile
en 1673. L’univerfité d’Oxford ayant formé le deffein
de publier une édition des anciens mathématiciens
, M. Bernard raffembla tous les livres de ce
genre qui avoient paru depuis l’invention de l’Imprimerie
, 6c tous les manufcrits qu’il put déterrer
dans les bibliothèques bodleïenne 6c favilienne. Il
rangea le. tout fous diverfes clafles, 6c en drefla le
plan qui devoit contenir quatorze volumes in-foLio ;
c’ eft grand dommage qu’un li beau projet n’ait point
eu d’exécution.
En 1676, Charles II. l’envoya à Paris, en qualité
de gouverneur des ducs de Grafton 6c de Northum-
berland, fils de ce prince ôc de la duchefîe de Clé-
veland ;mais la fimplicité des moeurs de notre favant
ne s’accommodant point du genre de vie qu’on menoit
chez la duchefîe, il revint au bout de l’année,dans
fa retraite chérie d’Oxford. Élevé dans l’obfcurité
du cabinet , peu fait à la flalerie qu’on demande
chez les grands, n’ayant point cette légéreté de
converfation, cette galanterie oifive , 6c ces propos
menfongers fi néceflaires auprès des dames * il a’appèrçut
qu’il étoit peu fêté dans une maifon où l’on
ne favoit pas refpeâer les vertus réelles. Il s’en con-
fola bientôt, 6c prit le parti de voir les favans de
Paris, de vifiter les manufcrits, 6c de ramafler quantité
de livres rares.
De retour en Angleterre., il publia divers morceaux
dans les Tranfaclionsphilojbphiques, fur la plus
grande déelinaifon du foleil, 6c fur la longitude 8c la
latitude des principales étoiles fixes. En 1684 il prit
le degré de doôeur en Théologie, 6c obtint un bénéfice
à neuf milles d’Oxford. En 1695, il fit le voyage
de Hollande , 6c y acheta quantité de manufcrits
orientaux de la bibliothèque de Golius, pour le docteur
Narcifîe Marsh, archevêque de Dublin. Il mourut
à Oxford en 1696, âgé d’environ cinquante-neuf
ans;
Son ouvrage fur les poids 8c mefures des anciens,
parut en i68ÿ, 6c fut réimprimé en 1688 , in -8®.
C’eft un traite pour l’ufage, 6C non pour la parade,
l’auteur l’ayant rendu auffi concis qu’il étoit poffible.
Il a raffemblé judicieufement ce qui étoit difperfé
çà 6c là dans les autres écrivains ; 6c il a ajoute, de
fon propre 6c riche fonds, quantité de chôfes qu’on
chercheroitinutilement ailleurs, fur lesjnefures des
Talmudiftes, des Arabes, des Chinois, &c. On a
joint dans la fécondé édition de ce traité deux lettres
écrites à l’auteur : l’une, du doûeur Thomas
Hyde, dans laquelle il explique plus particulièrement
ce qui regarde les poids Ôc lès mefures des
Chinois : 8c l’autre d’un favant qui fe figne N. F. D.
c’eft-à-dire Nicolas Fatio Duillier, qui fait une def-
cription de la mer d’airain de Salomon , félon une
nouvelle méthode , 6c qui en donne un plan.
M. Bernard a fait imprimer à Oxford fur une
grande feuille gravée en cuivre : Orbis eruditi, litte-
ratura à caractère famaritico deducta. On y voit d’un
coup-d’oeil,fans confufion, les différentes figures des
lettres, dans les différens âges du monde ; celles qui
ont été d’abord en ufage parmi les Phéniciens, en-
fuite parmi les Samaritains, les Juifs, les Syriens,
les Arabes, les Perfes, les philofophes Indiens, les
Brachmanes, les Malabares, les Grecs, les Coptes,
les Rufîiens., les Efclavons, les Arméniens, qui ont
emprunté leur alphabet des Grecs, comme les Ethiopiens
le leur des Coptes. Enfin on y voit les cara&e-
res des anciens latins, defquels les Francs, les Saxons,
les Goths, 6c les autres nations feptentrionales, ont
I emprunté les leurs. Il y a joint une fécondé table qui
contientles principales abbréviations des Grecs,celles
des Médecins, des Mathématiciens 6c desChimiftes;
table qui eft d’un grand ulage dans la leéhire des anciens.
On y trouve auffi d’excellens effais des abréviations
des autres peuples. Il a drelfé le tout avec un
travail prodigieux, fur lesmonumens,, les monnoies,
6c les manufcrits. Les tables dont nous venons de
parler, font auffi rares que curieufes ; 6c nous les
avons cherchées fans fuccès, pour en embellir l’Encyclopédie.
‘En 1689 parut fon Etymologicon britannicum à la
fin des Inflitudones anglo-faxonicoe du dofteur George
Hickes, à Oxford , i/z-40. Cet étymologique contient
l’étymologie d’un grand nombre de mots an-
. glois 6c bretons, tirés du ruffien, de l’efclaVon, du
perfan 8c de l’arménien.
M. Bernard a mis au jour diverfes autres pièces, 6c
; i l a laifle plufieurs ouvrages ébauchés dont le doéleùr
Smith a donné le catalogue dans la vie de ce favant
. homme. Entre ces ouvrages fe trouve, r°. un chro-
. nicon omnis envi, plein d’érudition, 8c qui étoit le
fruit de plufieurs années de travail, d’après d’anciens
manufcrits, des médailles, 6c d’autres monumens.
1°. Calendarium ecclefiafticum G civile plerarumque gen-
tium ; c’eft un ouvrage confidérable, 6c qui mérite
de paroître. 30. On peut \çi rapporter les vaftes recueits
qu’il avoit faits fur la Géométrie 6c l’Aftrono-
mie 6c divers plans tirés des auteurs arabes, qui font
encore manufcrits dans la bibliothèque bodléïenne
& dans celle de Golius. 40. Des recueils fur la maniéré
de trouver leméridien , fur les.folftices 6c les
équinoxes, fur l’année tropique, 6c fur la méthode
d’obferver le mouvement des aftres. Enfin les curateurs
de la bibliothèque bodléïenne ont acheté les
manufcrits en queftion, 6c quelques autres de l’auteur
, pour le prix de deux à trois cens livres fter-
lings. (Le chevalier D E J A U COURT.')
T O W R ID G E , ( Géog. mod.) riviere d’Angleterre.
Elle prend fa fource dans le comté de Devôn,
dont elle traverfe une partie, paffe à Bedfort; 6c
après s’être jointe au Taw , à trois milles de la mer
d’ Irlande, elles s’y jettent enfemble dans un même
lit. CD. /.)
TOW Y , la (Géog. mod.) riviere d’Angleterre,
au pays de Galles, dans le Caerfmathen-snire. Elle
arrofeCaermarthen, 8c fe perd dans la mer à environ
dix milles de cette ville. Cambden prétend que c’eft
le Tobîus des anciens. ( D . J.)
TO X AN D R I, (Géog. anc.)^ peuples de la Gaule
belgique, dont le pays pourroit bien répondre en
partie au Brabant 8c au pays de Liège. Leur nom eft
fort connu des anciens ; mais ils n’ont pas déterminé
la fituation précife de leur pays. Cluvier les
recule jufque dans la Zélande. M. de Valois 6c plu- 1
fieurs autres les mettent en-deçà de la Zélande 6c
vers la Meufe dans les terres : c’eft auffi à peu de
chofeS près, le fentiment de Ceilarius. On lit dans
la vie de S. Lambert, apôtre des peuples toxandri,
que la Toxandrie étoit à-peine éloignée dans le tems
qu’il vivoit, de trois milles de la ville de Matrichi
du côté du nord. (D . J.)
T O X C O A L T , f. f. (Hiß- mod. fuperßition.) c’eft
une fête ou une efpece de)ubilé, que les Méxicains
célébroient tous les ans au printems, 6c qui duroit
pendant neuf jours. Un prêtre, jouant de la flûte ,
fortoit du temple, 6c fe tournoit fucceffivement vers
les quatre parties du monde; enfuite il s’inclinoit
devant l’idole, 6c prenant de la terre, il la mangeoit;
le peuple fui voit fon exemple, 6c demandoit au dieu
la rémiffion de fes péchés, les guerriers demandoient
la vi&oire ; mais le principaLobjet de la fête étoit
d’obtenir de l’eau. Le neuvième jour on promenoit
l’idole par les rues ; le peuple la fuivoit en gémif-
fant amèrement, 6c en fe donnant des coups de fouet
fur les épaules. La cérémonie fe terminoit par le
facrifice d’un captif qu’on immoloit pour fe rendre
le ciel propice. ■
TOXICODENDRON, f. m. (Hiß. nat. Botan.
exot.) le toxicodendron, c’eft-à-dfre, l’arbre vénéneux
, mérite fans doute d’ être diftingué de tout autre
arbre. Remarquez donc que les feuilles vien-r
nent trois enfemble, comme celles du trefïlë. Le
calice eft fort petit, dentelé , fendu en cinq , 6c
d’une feule piece ; la fleur eft en rofe 6c pentapéta-
le. L’ovaire au fond du calice fe transforme en un
fruit à-peu-près rond, fec, ftrié 6c rempli de fe-
mences plates. Tournefort en compte deux efpèces.
1°. Toxicodendron triphyllum , folio glabro ; z°. toxicodendron
iriphyllum, folioßnuato, pubefeente. J. R.
H. 611. Cette fécondé efpèce différé de la vitis vir-
giniana par fes feuilles velues, leurs pédicules, leurs
cotes 6c leurs fibres rouges. Aux deux efpèces précédentes,
Miller ajoute cette troifieme, toxicodendron
carolinianum , foliis pinnatis, floribus ■ minimis,
■ herbaceis,. ,
Cet arbre eft fort commun en Amérique, trace
beaucoup, s’élève affez vite jufqu’à la hauteur de
20 pies, mais il ne fubfifte pas long-tems. Son bois eft
jaune intérieurement, a une odeur forte 6ctrès-défa-
greable ; il contient une fève encore plus puante,
8cauffi vifqiieiife que la térébenthine. Son fruit eft
une baie feche, blanche 6c arrondie, 6c qui vient
en grappe.
Le toxicodendron empoifonne de deux maniérés,-
ou par fon odeur, ou quand on le manie. Il eft arriv
é que ceux qui l’ont coupé dans les bois, 6c ceux
qui l’ont brûlé dans leur teu , ont été violemment
affe&és de l’odeur qu’il répandoit ; mais il eft remarquable
que fon poifon n’attaque que quelques
perfonnes, tandis que d’autres peuvent manier très-
long-tems le bois de cet arbre, le brûler fous leur
né , 6c même en mâcher fans aucun accident.
Au r'efte fon poifon n’eft jamais mortel, 6c s’é vanouit
de lui-même en peu de jours, fans aucun
remede ; mais ceux qui en font attaqués, en détrui-
fent les effets promptement, en étuvant les parties
attaquées d’huile de falade ou de crème.
Les premiers fymptômes de ce poifon font une
violente démangeaifon, qui enflamme la partie 6c
la tumefee, parce qu’on ne peut s’empêcher de fe
gratter fortement. Quelquefois tout le corps devient
enflé , mais ordinairement ce n’eft qu’une feule
partie du corps, comme les main§ ou les jambes ;
6c cette enflure ceffe par des.véficuies qui s'élèvent
fur la peau , ôc qui jettent une grande quantité de
férofités, d’où procédé la guérifon.
Ceux qui ont été empoilonnés pour avoir manié
de ce bois, difent qu’il eft très-froid au tou cher, 6c
qu’on peut même par ce moyen le diftinguer des
autres bois dans l’obfcurité. Quoi qu’il en foit, voye^
les Phitof. TranJ'act. n°. 367. (D. J.)
T oxicodendron. Toye^ Herbe a la puce.
TOXICUM , (Littéral.) poifon dont les Scythes
6c quelques autres peuples barbares frottoient la
pointe de.,leurs fléchés ; le toulola des Indiens modernes
eftrpeut-être le même poifon ; ce qui eft certain
d’après le témoignage des hiftoriens, c’eft que
la plaie touchée par le toxicum des Scythes étoit
mortelle ; d’où vient qu’on a employé le même mot
dans la langue latine , pour marquer un poifon dont
rien ne peut empêcher l’effet. (D . J .)
TO X ILI y Ta x i l i o u Ta xi læ , (Géog. anc.)
peuples de l’Inde, félon Denis Périégete, vers 1141,
qui les met au nombre des peuples qui habitoient
entre les fleuves Cophés, Indus, Hydafpe 6c Acéfi-
ne. Leur ville fe nommoit Taxila, 6c leur roi eft
appellé Taxilus par Quinte-Curfe,/. FIII. qui dit
que ce nom étoit affeéié à tous ceux qui fuccédoient
au royaume. Quant à la ville de Taxila , Srrabon ,
Ptolomée 6c Quinte-Curfe nous apprennent qu’elle
n’étoit pas éloignée de la rive orientale de l’indus.
TOXOTES, f. m. pl. (Aniiq. d’Jthlms.) t*™ '/ ;
nom de bas officier, ou plutôt d’efpèces de licteurs
qui accompagnoient, 6c étoient aux ordres des
Léxiarques. Il y en avoit un millier dans la ville
d’Athènes qui demeuroient dans des tentes qu’on
avoit premièrement tendues dans le forum, 6c qu’on
tendit enfuite dans la place de raréopage. Foyeç
Potter. Archozol. greec. t. /. p. i jg . ( D. J. )
TOYERE , f. f. (terme de Ferrand\nier. ) pointe
d’une hache , hachereau , &c. qu’on engage dans le
manche. Dict. des arcs. (D . J .)
TO Z Z IA , f. f. (Hifi. nat. Botan.) nom donné par
Micheli 6c continué par Linnæus, à un genre de
1 plante dont voici les caraûères. Le calice de la
i fleur eft très-court, fubfiftant après la fleur, 8c com-
pofé d’une feule feuille tubulaire, divifée en cinq
legmens dans fes bords ; la fleur eft monopétale 6c
ouverte; fon tuyau eft cylindrique, 8c plus long
que le calice, fon extrémité eft découpée en deux
lèvres ; la ftipérieure eft fendue en deux, l’inférieure
en trois parties, 8c tous les fegmens font à-
peu-près égaux ôc arrondis ; les étamines font quatre