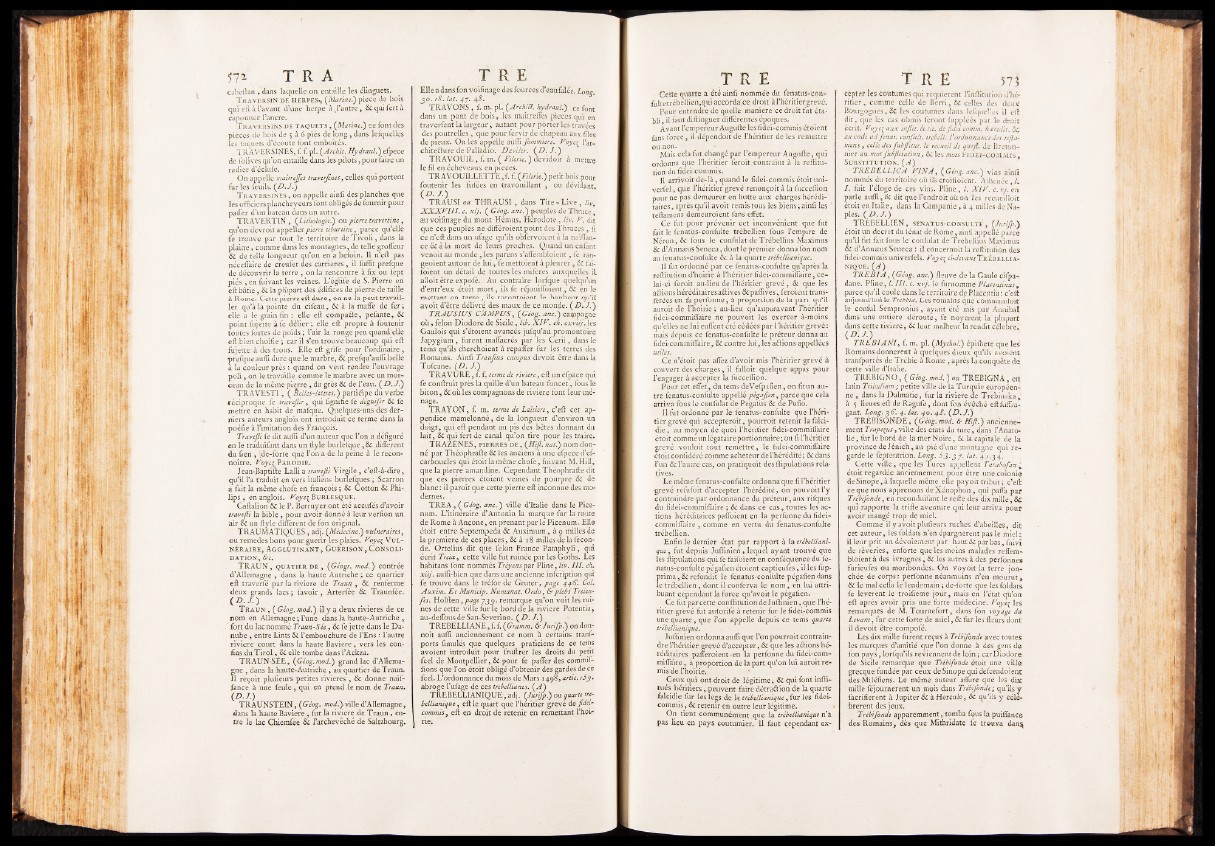
cabeftan » dans laquelle on entaille les élinguets.
T raversin de herpes., (Marine.') piece de bois
qui eft à l’avant d’une herpe à d’autre, &quifertà.
caponner l’ancre.
T raversins de taquets , (Marine.) ce font des
pièces de bois de 5 à 6 pies de long, dans lefquelles
les taquets d’écoute font emboîtés.
TRAVERSINES, f. f.’pl. (Archit. Hydraul.) efpece
de folives qu’on entaille dans les pilots, pour faire un .
radier d’éclufe.
On appelle maîtrejfes traverjînes, celles qui portent
furies feuils. (D.J .)
T raversines , on appelle ainfi des planches que
les officiers planchey eurs font obligés de fournir pour
paffer d’un bateau dans un autre.
TRAVERTIN , ( Lithologie.) ou pierre travertine ,
qu’on devroit appeller pierre tiburtine, parce qu’elle
fe trouve par tout, le territoire de T iv o li, dans la
plaine, comme dans les montagnes, de telle groffeur
& de telle longueur qu’on en a b.efoin. 11 n’eft pas
néceffaire de creufer des carrières , il fuffit prefque
de découvrir la terre , on la rencontre à fix ou fept
pies , enfuivant les veines. L’églife de S. Pierre en
eft bâtie, & la plupart des édifices de pierre de taille .
à Rome. Cette pierre eft dure, on ne la peut travailler
qu’à la pointe du cifeau, & à là maffe de fer;
elle a le grain fin : elle eft compare, pefante, &
point Tu jette à fe délier ; elle eft propre à foutenir
toutes fortes de poids ; l’air la ronge peu quand-elle
eftsbien choifie ; car il s’en trouve beaucoup qui eft
fujette à des trous. Elle eft grife pour l’ordinaire,
prefque aufli dure que le marbre, & prefqu’aulïi belle
à la couleur près : quand on veut rendre l’ouvrage
p o li, on le travaille comme le marbre avec un morceau
de la même pierre , du grès & de l’eau. ( D. J.)
T R A V E ST I , ( belles-lettres. ) participe du verbe
réciproque fe traveflir, qui fignifie le déguifer & fe
mettre en habit de mafque. Quelques-uns des derniers
auteurs anglois ont introduit ce terme dans la
poéfie à l’imitation des François'.
Travejli fe dit aufli d’un auteur que l’on a défiguré
en le traduifant dans u n ftyle b u rlefque, &: different
du lien , [de-forte que l’on a de la peine à le recon-
n o ître . Voye{ Pa rodie.
Jean-Baptifte Lalli a travejli Virgile, c’ eft-à-dire,
qu’il l’a traduit en vers italiens burlefques ; Scarron
a fait la même chofe en françois ; Cotton & Philips
, en anglois. Voye{ Burl e sq u e .
Caftalion & le P. Berruyer ont été accufés d’avoir
travejli la bible , pour avoir donné à leur verfion un
air &.un ftyle différent de fon original.
TRAUMATIQUES, adj. (Médecine?) vulnéraires,
ou remedes bons pour guérir les plaies. Voye^ Vuln
é r a ir e , Ag g lu t in a n t , Guér iso n , C o n so l id
a t io n , &c.
TR AU N , q u atier de , (Géogr. mod.) contrée
d’Allemagne , dans la haute Autriche ; ce quartier
eft traverfé par la riviere de Traun , & renferme
deux grands lacs; favoir, Arterfée & Traunfée.
Cn - i . )
T ra u n , (Géog. mod.) il y a deux rivières de ce
nom en Allemagne ; l’une dans la haute-Autriche ,
. fort du lac nommé Traun-Sée, & fe jette dans le Danube
, entre Lints & l’embouchure de l’Ens : l’autre
riviere court dans la haute Bavière, vers les confins
du T ir o l, & elle tombe dans l’Ackza.
TRAUN-SÉE, (Géog.mod.) grand lac d’Allemagne
, dans la haute-Autriche , au quartier de Traun.
Il reçoit plufieurs petites rivières , & donne naif-
fance à une feule, qui en prend le nom de Traun.
(D .J .)
TRÀUNSTEIN, (Géog. mod.JviWt d’Allemagne,
dans la haute Bavière, fur la riviere de Traun, entre
le lac Çhiemfée Si l’archevêché de Saltzbourg.
Elle a dans fon voifinage des foùrces d’eaufalée. Long,
30. 18. lat. 47. 48.
TR AVONS , f. m. pl. (A relu cl. hydraül.) ce font
dans un pont de bois, les maîtrefîes pièces qui en
traverfent la largeur, autant pour porter les travées
des poutrelles, que pour fervir de chapeau aux files
de pieux. On les appelle aufli fommiers. Voye£ l’ar-
chitefture de Palladio. Daviler. (D . J. )
TR A VOU IL, f. m. ( Filerie. ) dévidoir à mettre
le fil en écheveaux en pièces.
TRAVOUILLETTE,f. f. (Filerie.) petit bois pour
foutenir les fufées en travouillant , ou dévidant.
( « • / . ) m m
TRAUSI ou THRÂUSI , dans Tite - L ive , livl
XXXVILI. c. xlj. ( Géog. anc.) peuples de Thrace,
au voifinage du mont Hémiis. Hérodote, liv. V. dit
que ces peuples ne différoient point des Thraces , fi
ce n’eft dans un ufage qu’ils obfervoient à la naiffan-
ce Si à la mort de leurs proches. Quand un enfant
venoit au monde , les parens s’affembloient, fe ran-
geoient autour de lui, fe mettoient à pleurer, & fai-
loient un détail de toutes les miferes auxquelles iL
alloit être expofé. Au contraire lorfque quelqu’un
d’entr’ eux étoit mort, ils fe réjouiffoient, & en le
mettant en terre, ils racontoient le bonheur qu’il
avoit d’être délivré des maux de ce monde. ( D. J . )
TRAUSIUS CAMPUS, (Géog. anc.) campagne
o ii, félon Diodore de Sicile, Lib. X IV . ch. cxviij, les
Gaulois qui s’étoient avancés jufqu’au promontoire
Japygium, furent maffacrés par les Ce r ii, dans le
tems qu’ils cherchoient à repaffer fur les terres des
Romains. Ainfi Traujîus campus devoit .être dans la
Tofcane. (D . J.)
TRAVUR E, f. f. terme de riviere, eft un efpace qui
fe conftruit près la quille d’un bateau foncet, fous le
biton, & où les compagnons de riviere font leur ménage.
T R A YO N , f. m. terme de Laitière, c’eft cet appendice
mamelonné, de -la longueur d’environ un
doigt, qui eft pendant au pis des bêtes donnant du
lait, & qui fert de canal qu’on tire pour lés traire.
TRAZÉNES, pierr es de , (Hijl. nat.) nom donné
par Théophrafte & les anciens à une efpece d’ef-
carboucles qui étoit la même chofe, fuivant M. Hill,
que la pierre amandine. Cependant Théophrafte dit
que ces pierres étoient veines de pourpre & de
blanc: il paroîtque cette pierre eft inconnue des mo-
dèrnes.
T R E A , ( Géog. anc. ) ville d’Italie dans le Pice-
num. L’itinéraire d’Antonin la marque fur la route
de Rome à Ancône, en prenant parle Picenum. Elle
étoit entre Septempeda & Auximum, à 9 milles de
la première de ces places, & à 18 milles de la fécondé.
Ortelius dit que félon France Pamphyli, qui
écrit Treia, cette ville fut ruinée par les Goths. Les
habitans font nommés Tréyens par Pline, liv. III. ch.
xiij. auffi-bien que dansune ancienne infeription qui
fe trouve dans le tréfor de Gruter, page 446'. Col.
Auxim. E t Municip. Numanat. Ordo, & plebs Treienfes.
Holften, page 73 c>. remarque qu’on voit les ruines
de cette ville fur le bord de la riviere Potentia,
au-deffousdeSan-Severino. (D. J . )
TREBELLIANE, f. f. (Grarnm, & Jurifp.) on don-
noit aufli anciennement ce nom à certains tranf-
ports fimulés que quelques praticiens de ce tems
avoient introduit pour fruftrer les droits du petit
feel de Montpellier, & pour fe paffer des commif-
fions que l’on étoit obligé d’obtenir des gardes de ce
feel. L’ordonnance du mois de Mars 1498, artic. i5y.
abroge l’ufage de ces trebellianes. (A )
TREBELLIANIQUE, adj. (Jurifp.) ou quarte tre-
bellianique, eft le quart que l’heritier grevé de Jîdei-
commis, eft en droit de retenir en remettant l’hoirie.
Cette quarte a été ainfi nommée du tenatus-con*
fultetrébellien,qui accordance droit àl’héritiergrevé.
Pour entendre de quelle maniéré ce droit fut é ta bli
il faut diftinguer différentes époques.
Avant l’empereur Augufte les fidei-commis étoient
fans fo rc e , il dépendoit de l’héritier d e les remettre
ou non.
Mais cela fut changé par l’empereur Augufte, qui
ordonna que l’héritier lèroitxcontraint à la reftitu-
tion du fidei- commis.
Il arrivoit de-là, quand le fidei-commis étoit uni-
verfel, que l’héritier grevé renônçoit à la fucceflion
pour ne pas demeurer en butte aux charges héréditaires
, après qu’il avoit remis tous les biens ; ainfi les 1
teftamens demeuroient fans effet.
Ce fut pour prévenir cet inconvénient que fut
fait le fenatiis-consulte trébellien fous l’empire de
Néron, & fous le confulat de Trébellitis Maximus
& d’Annæus Seneca, dont Je premier donna fon nom
au fenatus-confulte &. à la quarte trébellianique.
Il fut ordonné par ce fenatus-cpnfulte qu’après la
reftitution d’hoirie à l’héritier fidei-commiffaire, ce*
lui-ci feroit au-lieu de l’héritier grevé, & que les
a Étions héréditaires actives & paflives, feroient transférées
en fa perfonne, à proportion de la part qu’il
auroit de l’hoirie ; au-lieu qu’auparavant l’héritier
fidei-commiffaire ne pouvoit les exercer à-moins
qu’elles ne lui euffent été cédées par l ’héritier grevé:
mais depuis ce fenatus-confulte le préteur donna au
fidei-commiffaire, ÔC contre lui,les actions appellées
utiles.
Ce n’étoit pas affez d’avoir mis l’héritier grevé à
couvert des charges, il falloit quelque appas pour
l’engager à accepter la fucceflion.
Pour cet effet, du tems deVefpafien, on fit un autre
fenatus-confulte appellé pégafien, parce que cela
arriva fous le confulat de Pegalùs & de Pufiô.
Il fi.it ordonné par le fenatus-confulte que l’héritier
grevé qui accepteroit, pourroit retenir la falci*
d ie, au moyen de quoi l’héritier fidei-commiffaire
étoit comme un légataire portionnaire; ou fi l’héritier
grevé vouloit tout remettre, le fidei-commiffaire
étoit confidéré comme acheteur de l’hérédité; & dans
l’un & l’autre cas, on pratiquoit des ftipulations relatives.
,
Le même fenatus-confulte ordonna que fi l’héritier
grevé refufoit d’accepter l’hérédité, on pouvoit l’y
contraindre par ordonnance du préteur,aux rifques
du fidei-commiffaire ; & dans ce cas, toutes les actions
héréditaires paffoient en la perfonne du fidei*
commiflaire, comme en vertu du fenatus-confulte
trébellien.
Enfin le dernier état par rapport à la trébellianique
, fut depuis Juftiniert, lequel ayant trouvé que
les ftipulations qui fe faifoient en conféquence du-fenatus
confulte pégafien étoient captieufes, il les fup-
prima, &: refondit le fenatus-confulte pégafien dans
le trébellien, dont il conferva le nom, en lui attribuant
cependant la force qu’avoit le pégafien.
Ce fut par cette conftitution de Juftinien, que l’hé-
ritier.grevé fut autorifé à retenir fur le fidei-commis
une quarte, que l’on appelle depuis ce tems quarte
trebellianique.
Juftinien ordonna aufli que l’on pourroit contraindre
l’héritier grevé d’accepter, & que les a «fiions héréditaires
pafleroient*en la perfonne du fidei-com-
miflkire, à proportion de la part qu’on lui auroit rends
de l’hoirie.
Ceux qui ont droit de légitime, & qui font infti*
tués héritiers, peuvent faire détrafiion de la quarte
falcidie fur les legs de la trébellianique, fur les fidei-
commis, & retenir en outre leur légitime.
On tient communément que-la trébellianique riz.
pas lieu en pays coutumier. 11 faut çependanf exeepter
les coutumes qui rèquierent l’inftitiition d’héritier
, comme celle de Berri, & celles des deux
Bourgognes, & les coutumes dans lefquelles il eft
dit, que les cas obmis feront fuppléés par le droit
écrit. Voyeç aux inflit. le tit. de fidei-co'nlrrt-, hceredit. &£
au code ad fenat. confult. tfèbell. V ordonnance des te fia-
Utens, celle des fubftitut. le recueil de quefl. de Breton*
nier au mot fubfiitution, ôi les mots Fidëi-COMmis ,
Su bstitut ion. (A )
TREBELLICA VIN À , (Géog. an c .)y ins ainfi
nommés du territoire où ils croifioieht. Athenée, L
I. fait l’éloge de ces vins. Pline, l. X IV . c. vj. en
parle aufli, & dit que l’endroit où ori les recueilloit
étoit en Italie, dans la Campanie, à 4 milles de Na*
plesi ( D . J. )
TRÉBELLIEN, senatus-consUlté , (Jurifp.)
étoit un decret du fénat de Rome, ainfi appellé parce
qu’il fut fait fous le Confulat de Trebellius Maximus
8>c d’Annæus Seneca : il concernoit la reftitutiôn des
fidei-commis univerfels. Voye^ ci-devant T rébellian
iq u e . (A )
TREB1A , (Géog. anc.) fleuve de la Gaule cifpa*.
dane. Pline,, l. III. c. xvj, le furnommë Placenùnus
parce qu’il coule dans le territoire de PlaCentia: c’eft
aujourd’hui le Trebbia. Les romains que cömmandoit
le conful Sempronius, ayant été mis pài1 Annibal
dans une entière déroute, fe noyèrent là' plupart
dans cette riviere, & leur malheur la rendit célébré*’ WM I I WM, ; v TREBIANI , f. m. pl. (Mythoï.) épithète que les
Romains donnèrent à quelques dieux, qu’ils avoient
tranfportés de Trébie à Rome, après la conquête de
Cette ville d’Italie.
TREBIGNO, ( Géog. mod. ) ou TREBÎGNA, en
latin Tribulium; petite ville de la Turquie européenne
, dans la Dalmatie, fur la riviere de Trebinska %
à 5 lieues eft de Ragufe, dont fon évêché eft fuffra*
gant. Long. 3 S. 4. Lat. 40. 48. (D . J.) 1
TRÉBISONDE, (Géog.mod. & Hiß.) anciennement
Trape^us, ville des états du turc, dans l’Anato*
lie , fur le bord de la mer Noire, & la capitale dé la
province deJénich,au pié d’une montagne qui regarde
le feptentrion. Long. 3 J . 3 7. lat. 40.3 4.
Cêtte v ille , que les Turcs appellent Tarabofan,
étoit regardée anciennement pour être une colonie
de Sinope, à laquelle même elle payoit tribut ; c’eft
ce que nous apprenons de Xénophon, qui pafla par
Trébifonde, en reconduifant le refte des dix mille, Sc
qui rapporte la trifte aventure qui leur arriva pour
avoir mangé trop de miel.
Comme il y avoit plufieurs ruches d’abeilles, dit
cet auteur, les foldats n’en épargnèrent pas le miel :
il leur prit un dévoiement par haut &c par bas, fuivi
de rêveries, enforte que.les moins malades reffem*
bloient à des ivrognes, & les autres à des perfonnes
furieufes ou moribondes. On voyoit la terre jonchée
de corps : perfonne néanmoins n’én mourut,
& le mal cefla le lendemain ; de-forte que les foldats
fe levèrent le troifieme joür, mais en l’état qu’on
eft après avoir pris une forte médecine. V6ye[ leâ
remarques de M. Tournefbrt, dans fon voyage du
Levant, fur cette forte de miel, & lur les fleurs dont
il devoit être compofé.
Les dix mille furent reçus à Trébifonde avec toutes
les marques d’amitié que l’on donne à des gens dè
fon p ays, lorfqu’ils reviennent de loin ; car Diodore
de Sicile remarque que Trébifonde étoit une ville
grecque fondée par ceux de Sinope qui defeendoient
des Miléfiens. Le même, auteur affure que les dix
mille féjournerent un mois dans Trébifonde; qu’ils y
facrifîerent à Jupiter te à Hercule, & qu’ils y célébrèrent
des jeux.
Trébifonde apparemment, tomba fous la puiffance
des Romains, dès que Mithridate fe trouva dan$