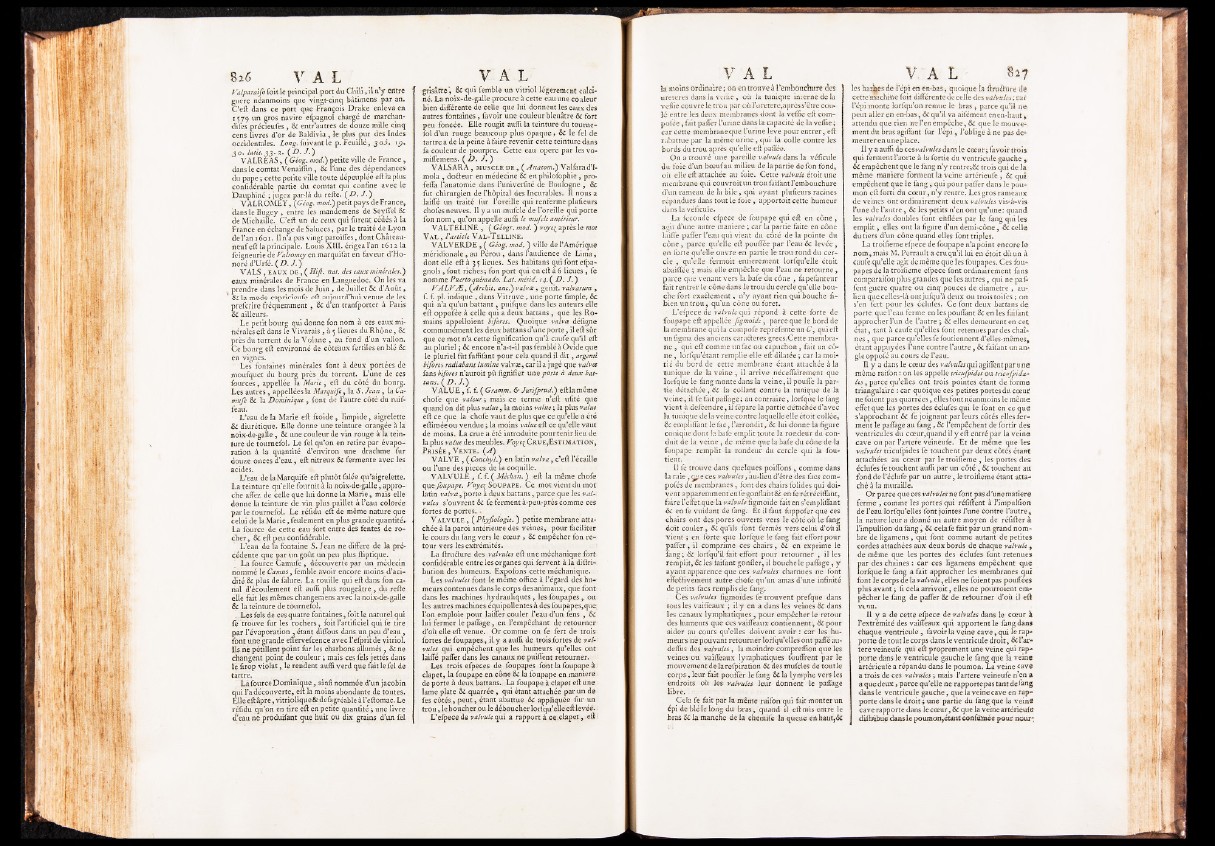
Valparaiso foit le principal port du Chili , il n’y entre
guere néanmoins que vingt-cinq bâtimens par an.
C ’eft dans ce port que François Drake enleva en
1579 un gros navire efpagnol chargé de marchan-
tlifes précieufes , 8c entr’autres de douze mille cinq
cens livres d’or de Baldivia , le plus pur des Indes
occidentales. Long, fuivant le p. Feuille, 3 oJ. 1$.
30 . laeit.33.2. (D . J .)
VALRÈAS, ( Géog. mod.) petite ville de France,
dans le comtat Venaiffin , 8c l’une des dépendances
du pape ; cette petite ville toute dépeuplée eft la plus
confidérable partie du comtat qui confine avec le
Dauphiné ; jugez par-là du refte. (D . J.')
VALROMEY, (Géog. mod.) petit pays de France,
dans le Bugey , entre les mandemens de SeyfTel 8c
de Michaille. C ’eft un de ceux qui furent cédés à la
France en échange de Saluces, par le traité de Lyon
de l’an 1601. Il n’a pas vingt paroiffes, dont Château-
neuf eft la principale. Louis XIII. érigea Fan 161 z la
feigneurie de Valromey en marquifat en faveur d’Ho-
noré d’Urfé. ( D. J. ) ^
VALS , EAUX DE, ( Hiß. nai. des eaux minérales.)
eaux minérales de France en Languedoc. On les va
prendre dans les mois de Juin , de Juillet 8c d’Août,
8c la mode capricieufe eft aujourd’hui venue de les
preferire fréquemment, 8c d’en tranfporter à Paris
8c ailleurs.
Le petit bourg qui donne fon nom à ces eaux minérales
eft dans le V ivarais, à 5 lieues du Rhône, 8c
près du torrent de la Volane , au fond d’un vallon.
Ce bourg eft environné de coteaux fertiles en blé &c
en vignes.
Les fontaines minérales font à deux portées de
moufquet du bourg près du torrent. L’une de ces
fources, appellée la Marie, eft du côté du bourg.
Les autres , appelléesla Marquife,.la S. Jean, la Ca-
mufe 8c la Dominique , font de l’autre côté du ruif-
feau.
L’eau de la Marie eft fro id e lim p id e , aigrelette
8c diurétique. Elle donne une teinture orangée à la
noix-de-galle, 8c une couleur de vin rouge à la teinture
de tournefol. Le fel qu’on en retire par évaporation
à la quantité d’environ une drachme fur
douze onces d’eau, eft nitreux 8c fermente avec les
acides. y-
L’eau de laMarquife eft plutôt falée qu’aigrelette.
La teinture qu’elle fournit à la noix-de-galle, approche
affez de celle que lui donne la Marie, mais elle
donne la teinture de vin plus paillet à l’eau colorée
par le tournefol. Le réfidu eft de même nature que
celui de la Marie, feulement en plus grande quantité.
La fourçe de cette eau fort entre des fentes de rocher
, & eft peu confidérable.
L ’eau de la fontaine S. Jean ne différé de la précédente
que par un goût un peu plus ftiptique.
? La fourcé Camufe , découverte par un médecin
nommé le Camus, femble avoir encore moins d’acidité
8c plus de falure. La rouille qui eft dans fon canal
d’écoulement eft auffi plus rougeâtre , du refte
elle fait les mêmes changemens avec la noix-de-galle
8c la teinture de tournefol.
., Les fels de ces quatre fontaines, foit le naturel qui
fé trouve fur les rochers, foit l’artificiel qui fe tire
par l’évaporation , étant diffous dans un peu d’eau,
font une grande effervefcence avec l’efpritde vitriol.
Ils né pétillent point fur les charbons allumés , & n e
changent point de couleur ; mais ces fels jettes dans
le firop v io lâ t l e rendent auffi verd que fait le fel de
tartre.
La fource Dominique, ainfi nommée d’un jacobin
qui l’a découverte, eft la moins abondante de toutes.
Elle eft âpre, vitriolique &defagréable à l’eftomac. Le
réfidu qu’on en tire eft en petite quantité ; une livre
d’eau ne produisant que huit ou dix grains d’un fel
grisâtre’, & q u i femble un vitriol légèrement calciné.
La noix-de-galle procure à cette eau une co uleur
bien différente de celle que lui donnent les eaux des
autres fontaines , lavoir une couleur bleuâtre 8c fort
peu foncée. Elle rougit auffi la teinture du tourne-
lol d’un rouge beaucoup plus opaque, 8c le fel de
tartre a de la peine à faire revenir cette teinture dans
fa couleur de pourpre. Cette eau opéré par les vo-
miffemens. (D . J . )
VALSARA, muscle de , ( Anatom.) Valfarad’I-
mola , dofteur en médecine 8c en philofophie, pro-
feffa l'anatomie dans l’univerfité de Boulogne , &
fut chirurgien de l’hôpital des Incurables. Il nous a
iaiffé un traité fur l’oreille qui renferme plufieurs
chofes neuves. Il y a un mufcle de l’oreille qui porte
fon nom, qu’on appelle auffi le mufcle antérieur.
VALTELINE , ( Géogr. mod. ) voye^ après le mot
V al , l'article Vàl-T elline.
VA LV ERD E, ( Géog. mod. ) ville de l’Amérique
méridionale, au Pérou, dans l’audience de Lima,
dont elle eft à 3 5 lieues. Ses habitans qui font efpa-
gnols, font riches ; fon port qui en eft à 6 lieues, fe
nomme Puertoquémado. Lut. mérid. 14f D . J .)
V A LVÆ , (Archit. anc.) valvce, genit. valvarum ,
f. f. pl. indique , dans Vitruve , une porte fimple, 8c
qui n’a qu’un battant, puifque dans les auteurs elle
eft oppofée à celle qui a deux battans, que les Romains
appelloient bifores. Quoique valvce défigne
communément les deux battans d’une porte, il eft sûr
que ce mot n’a cette lignification qu’à caufe qu’il eft
au pluriel ; 8c encore n’a-t-il pas femblé à Ovide que
le pluriel fût fuffifant pour cela quand il d i t , argenti
bifores radiabant lumine valvæ, car il a jugé que valvce
fans bifores n’auroit pû lignifier une porte à deux battans.
( D . J.)
V A LU E , f. f. ( Gramm. & Jurifprud.') eft la même
chofe que valeur ; mais ,ce terme n’eft ufité que
quand on dit plus value, la moins value ; la plus value
eft ce que la chofe vaut de plus que ce qu’elle a été
eftiméeou vendue ; la moins value eft ce qu’elle vaut
de moins. La crue a été introduite, pour tenir lieu de
la plus value des meubles. Vrye{ Crue,Est im a t io n ,
Prisée , V ente. (A )
VALVE , ( Conchyl.) en latin valva, c’eft l’écaille
ou l’une des pièces de la coquille.
V A LVUL E , f. f. ( Méckan. ) eft la même chofe
qutfoiipape. Voye^ SOUPAPE. Ce mot vient du mot
latin valvce, porte à deux battans, parce que les val-:
vules s’ouvrent 8c fe ferment à-pemprès comme ces
fortes de portes..
Va lv u l e , ( Phyfiologie. ) petite membrane'attachée
à la paroi intérieure des veines, pour faciliter
le cours du.fang vers le coeur , 8c empêcher fon retour
vers les extrémités.
La ftruûure des .valvules eft une méchanique fort
confidérable entre les organes qui fervent à la diftri-
bution des humeurs. Expofons cette méchanique. •
"Les valvules font le meme office à l’égard des humeurs
contenues dans le corps des animaux, que font
dans les machines hydrauliques, les. foupapes, ou
les autres machines equipollentes à des foupapes,qiie:
Fon emploie pour Jaiffer couler l’eau d’un fens , 8c
lui fermer le paffage, en l’empêchant de retourner-
d’oii elle eft venue. Or comme on fe fert de trois
fortes de foupapes, il y a auffi de trois fortes de val- :
vules qui empêchent que les humeurs qu’elles ont
Iaiffé paffer dans les canaux ne puiffent retourner.
Les trois efpeces de foupapes font la fou pape à
clapet, la foupape en cône 8c la foupape en maniéré
de porte à deux battans. La foupape à clapet eft une
lame plate 8c quarrée , qui étant attachée par un de
fes côtés., peut, étant abattue,.& appliquée fur un
trou, leboucher ou le déboucher lçvrfqu’ elle eft levée..
L’eipecede valvule qui a rapport à ce.clapet, eft :
la moins ordinaire ; on en trouve à l’embouchure des
ureteres dans la vdiie , oii la tunique interne de la
veffie couvre le trou par où l’uretere,après s’être coulé
entre les deux membranes dont la veffie eft com-
polée, fait paffer l’urine dans la capacité de la veffie ;
car cette membrane que l’urine leve pour entrer, eft
rabattue par la même urine , qui .la colle contre les
bords du trou après qu’elle eft paffée.
On a trouvé une pareille valvule dans la véficule
du foie d’un boeuf au milieu de la partie de fon fond,
ç>ù elle eft attachée au foie. Cette valvule t toit une
membrane qui couvroitun trou faifant l’embouchure
d’un rameau de la bile, qni ayant plufieurs racines
répandues dans tout le foie , apportoit cette humeur
dans la véficule.
La fécondé efpece de foupape qui eft en cône ,
agit d’une autre maniéré ; car la partie faite en cône
laiflè paft’er l’eau qui vient du côté de la pointe du
cône, parce qu’elle eft pouffée par l’eau 8c lev ée,
en forte qu’elle ouvre en partie le trou rond du cercle
, qu’elle fermoit entièrement lorfqu’elle étoit
abaiffée ; mais elle empêche que l’eau ne retourne,
parce que venant vers la bafe du cône , fapefanteur
fait rentrer le cône dans le trou du cercle qu’elle bouche
fort exactement, n’y ayant rien qui bouche fi-
bien untrou, qu’un cône ou foret..
L’efpece de valvule qui répond à cette forte de
foupape eft appellée fgmotde, parce que le bord de
la membrane qui la compofe repréfente un C , qui eft
un figma des anciens caractères grecs.Cette membrane
, qui eft comme unfac ou capuchon, fait un cône
, lorfqu’étant remplie elle eft dilatée ; car la moi*
tié du bord de cette membrane étant attachée à la
tunique de la veine ; il arrive néceffairement que
lorfque le fang monte dans la veine, il pouffe la partie
d é ta ch é e8c la collant contre la tunique de la
veine, il fe fait paffage; au contraire, lorfque le fang
vient à defeendre, il fépare la partie détachée d’avec
la tunique de la veine contre laquelle elle étoit collée,
8c empliffant le fa c , l’arrondit, & lui donne la figure
conique dont la bafe emplit jpute la rondeur du conduit
de la veine , de même que la bafe du cône de la
foupape remplit la rondeur du cercle qui la- fou-
tient.
11 fe trouve dans quelques poiffons, comme dans
la raie , jp e ces valvules, au-lieu d’être des lacs com-
pofés de membranes , font des chairs foiides qui doivent
apparemment en fe gonflant & en fe rétréciffant,
faire l’effet.quela valvule ûgmoide fait en s’empliffant
8c en fe vuidant de fang. Et il faut fuppofer que ces
chairs ont des pores ouverts vers le coté où le fang
doit couler, & .qu’ils font fermés vers celui d’où il
vient '; en forte que lorfque le fang fait effort pour
paffer ; il comprime ces chairs, 8c en exprime le
fang; & lorfqu’il fait effort pour retourner , il les
remplit, 8c les faifant gonfler, il bouche le paffage, y
ayant apparence que ces valvules charnues ne font
effectivement autre chofe qu’un amas d’une infinité
de petits facs remplis de fang.
Ces valvules figmoïdes fe trouvent prefque dans
tous les vaiffeaux ; il y en a dans les veines &: dans
les canaux lymphatiques , pour empêcher le retour
des humeurs que ces vaiffeaux .contiennent -, 8c pour
aider au cours qu’elles doivent avoir : car les humeurs
ne pouvant retourner lorsqu’elles ont pafféau-
deffus des valvules, la moindre compreffion que les
veines ou vaiffeaux lymphatiques louffrent par le
mouvement de la refpiration 8c des mufcles de tout le
corps, leur fait pouffer le fang 8c la lymphe vers les
endroits où les valvules leur donnent le paffage
libre. .
Cela fe fait par la même raifon qui fait monter un
épi de blé le long du bras , quand il eft mis entre le
bras 8c la manche de la chemife la queue en haut,8c
les barhes de l’épi en en-bas -, quoique la ftruChlré de
cette machine foit différente de celle des valvules ; car
l’épi monte lorfqu’on remue le bras ^ parce qu’il ne-
peut aller en en-bas, 8c qu’il va aifément en en-haut »
attendu que rien ne l’en empêche, 8c que le mouvement
du bras agiffant fur l’ép i, l’obligé à ne pas demeurer
en une place-.
Il y a auffi de ces valvules dans le coeur ; favoir trois
qui ferment l’aorte à la fortie du ventricule gauche ,
8c empêchent que le fang n’y rentre;& trois qui de la
même maniéré forment la veine artérieufe , 8c qui
empêchent que le fang, qui pour paffer dans le pou*
mon eft forti du coeur, n’y rentre. Les gros rameaux
de veines Ont ordinairement deux valvules vis-à-vis
l’une de l’autre, 8c les petits n’en ont qu’une: quand
les valvules doubles font ehflées par le fang qui les
emplit, elles ont la figure d’un demi-cône, 8c celle
du tiers d’un cône quand elles font triples.
La troifieme efpece de foupape n’a point encore le
nom, mais M. Perrault a cruqü’il lui en étoit dû un à
câufe.qu’elle agit de même que les foupapes. Ces fou*
papes de la troifieme efpece font ordinairement fans
comparaifon plus grandes que les autres, qui ne paf*
fent guere quatre ou cinq pouces de diamètre , au-
lieu que celles-là ont jufqu’à deux ou trois toifes ; on
s’en fer.t pour les éclufes. Ce font deux battans de
porte que l’eau ferme en les pouffant & en les faifant
approcher l’un de l’autre ; 8c elles demeurent en cet
état, tant à caufe qu’ elles font retenues par des chaînes
, que parce qu’elles fefoutiennent d’elles-mêmes*
étant appuyées l’une contre l’autre, 8c faifant un angle
oppofé au cours de l’eau.
Il y a dans le coeur des valvules qui agiffentpar une
même raifon : on les appelle tricufpides ou tricufpida-
les, parce qu’elles ont trois pointes étant de forma
triangulaire : car quoique ces petites portes du coeut
ne foient pas quarrées, elles font néanmoins le même
effet que les portes des éclufes qui le font en çe que
s’approchant 8c fe joignant par leurs côtés elles ferment
le paffage au fang, 8c l’empêchent de fortir des
ventricules du coeur,quand il y eft entré par la veina
cave ou par l’artere veineufe. Et de même que les
valvules tricufpides fe touchent par deux côtés étant
attachées au coeur par le troifieme , les portes des
éclufes fe touchent auffi par un coté , 8c touchent au
fond de l’éclufe par un autre, le troifieme étant attaché
à la muraille.
Or parce que ces valvules ne font pas d’une mariera
ferme , comme les portes qui réfiftent à l’impulfion
de l’eau.lorfqu’elles font jointes l’une contre l’autre ,
la nature leur a donné un autre moyen de réfifter à
l’impulfion du fang, 8c celafe fait par un grand nombre
de ligamens , qui font comme autant de petites
cordes attachées aux deux bords de chaque valvule ,
demême que les portes des éclufes font retenues
par des chaînes : car ces ligamens empêchent que
lorfque le fang a fait approcher les membranes cjui
; font le corps de la valvule, elles ne foient pas pouffees
plus avant ; fi cela arrivoit, elles ne pourraient empêcher
le fang de paffer 8c de retourner d’où il eft
venu.
Il y a de cette efpece de valvules dans le coeur à
l’extrémité des vaiffeaux qui apportent le fang dans
chaque ventricule , favoir la veine ca ve, qui le rapporte
de tout le corps dans le ventricule droit, & l’artere
veineufe qui eft proprement une veine qui rapporte
dans le ventricule gauche le fang que la veine
artérieufe a répandu dans le poumon. La veine cav$
a trois de ces valvules ; mais l’artere veineufe n’en a
a que deux, parce qu’elle ne rapportepas tant defang
dans le ventricule gauche, que la veine cave en rapporte
dans le droit ; une partie du fang que la veinô
cave rapporte dans le coeur, 8c que la veine artérieule
difbibue dans le poumon,étant confümée pour nour*