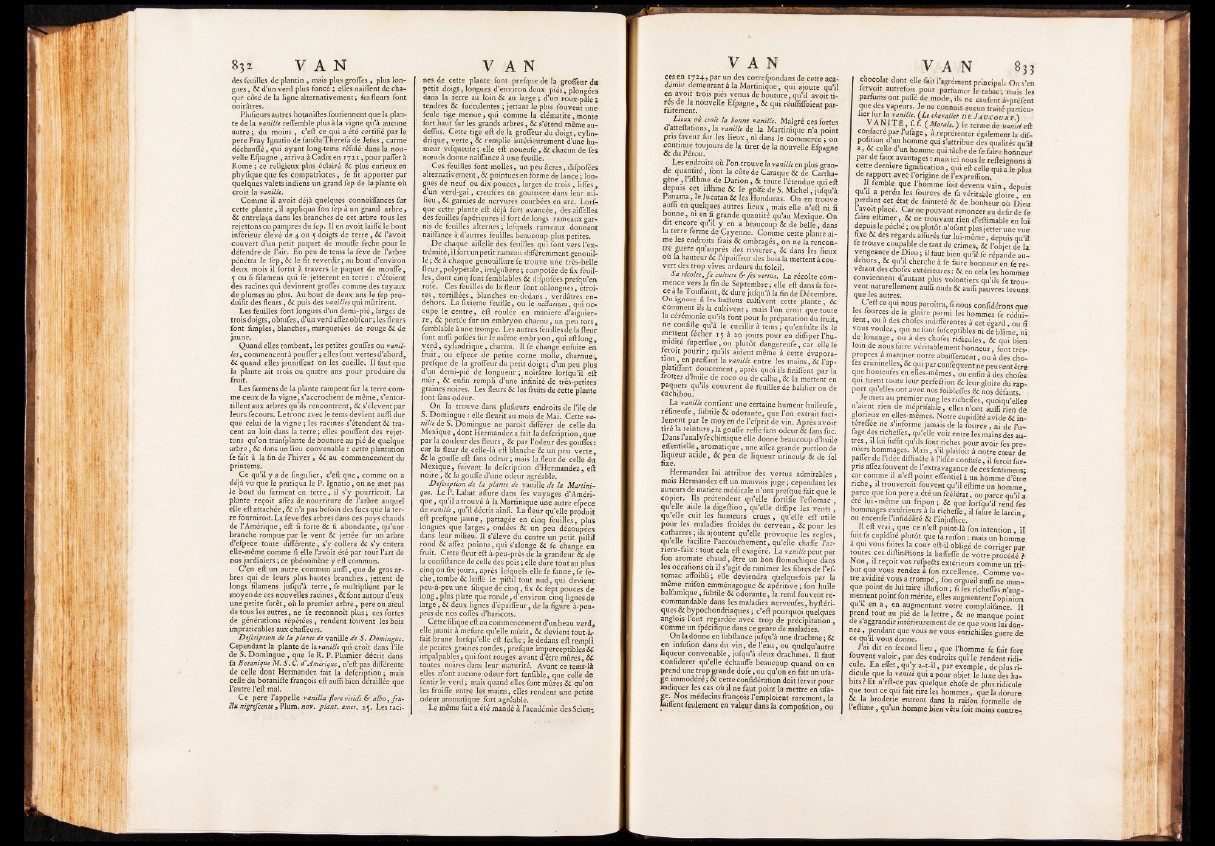
des feuilles de plantin , mais plus groffes -, plus longues
, & d’un verd plus foncé ; elles naiffent de chaque
côté de la ligne alternativement; fesfleurs font
noirâtres.
Plufieurs autres botaniftes foirtiennent que la plante
de la vanille reffemble plus à la vigne qu’à aucune
autre; du moins , c’eft ce qui a été certifié par le
pere Fray Ignatio de fanftaTherefa de Jefus , carme
déchauffé, qui ayant long-tems réfidé dans la nouvelle
Efpagne , arriva à Cadix en 17 1 1 , pour paffer à
Rome ; ce religieux plus éclairé & plus curieux en
phyfique que fes compatriotes, fe fit apporter par
quelques valets indiens un grand fep de la plante où
croit la vanille.
Comme il avoit déjà quelques connoiffances fur
cette plante, il appliqua fon fep à un grand arbre ,
6c entrelaça dans les branches de cet arbre tous les
rejettons ou pampres du fep. Il en avoit laiffé le bout
inférieur élevé de 4 ou 5 doigts de terre , & l’avoit
couvert d’un petit paquet de moufle feche pour le
défendre de l’air. En peu de tems la feve de l’arbre
pénétra le fep, 6c le fit reverdir; au bout d’environ
deux mois il fortit à travers le paquet de mouffe,
5 ou 6 filamens qui fe jetterent en terre : c’étoient
des racines qui devinrent groffes comme des tuyaux
de plumes au plus. Au bout de deux ans le fep pro-
duifit des fleurs, & puis des vanilles qui mûrirent.
Les feuilles font longues d’un demi-pié, larges de
trois doigts, obtufes, d’un verd affez obfcur ; les fleurs
font Amples, blanches, marquetées de rouge & de
jaune.
Quand elles tombent, les petites gouffes ou vanilles
, commencent à pouffer ; elles font vertes d’abord,
6c quand elles jauniffeat on les cueille. Il faut que
la plante ait trois ou quatre ans pour produire du
fruit.
Les farmens de la plante rampent fur la terre comme
ceux de la vigne, s’accrochent de même, s’entortillent
aux arbres qu’ils rencontrent, & s’élèvent par
leurs fecours. Le tronc avec le tems devient aulîi dur
que celui de la vigne ; les racines s’étendent & tracent
au loin dans la terre ; elles pouffent des rejet-
tons qu’on tranfplante de bouture au pié de quelque
arbre, & dans un lieu convenable : cette plantation
fe fait à la fin de l’hiver , &c au commencement du
printems.
Ce qu’il y a de fingulier, c’eft que, comme on a
déjà vu que le pratiqua le P. Ignatio, on ne met pas
le bout du farment en terre, il s’y pouftiroit. La
plante reçoit affez de nourriture de l’arbre auquel
elle eft attachée, & n’a pas befoin des fucs que la terre
fourniroit. La feve des arbres dans ces pays chauds
de l’Amérique, eft li forte & fi abondante, qu’une •
branche rompue par le vent & jettée fur un arbre
d’efpece toute différente, s’y collera & s’y entera
elle-même comme fi elle l’avoit été par tout l’art de
nos jardiniers ; ce phénomène y eft commun.
C’en eft un autre commun aulîi, que de gros arbres
qui de leurs plus hautes branches , jettent de
longs filamens jufqu’à terre, fe multiplient par le
moyen de ces nouvelles racines, &font autour d’eux
une petite forêt, où le premier arbre, pere ou aïeul
de tous les aütfes, ne fe reconnoît plus ; ces fortes
de générations répétées, rendent louvent les bois
impraticables aux chaffeurs.
Defcription de la plante de vanille de S. Domingue.
Cependant la plante de hvanille qui croît dans l’île
de S. Domingue , que le R. P. Plumier décrit dans
fa Botanique M. S . C. d’Amérique, n’eft pas différente
de celle dont Hermandez fait la defcription ; mais
celle du botanifte françois eft auflibien détaillée que
l ’autre l’eft mal.
Ce pere l’appelle vanilla flore viridi & albo, fru-
Bu nigrefeentt, Plum. nov. plant, amer. 15. Les racines
de cette plante, font prefque de la groffeur du
petit doigt, longues d’environ deux piés, plongées
dans la terre au loin & au large ; d’un roux-pâle ;
tendres & fucculentes ; jettant le plus Louvent une
feule tige menue, qui comme la clématite, monte
fort haut fur les grands arbres, & s’étend même âu-
deffus. Cette tige eft de la groffeur du doigt, cylindrique,
verte, 6c remplie intérieurement a’une humeur
yifqueufe ; elle eft noueufe, 6c chacun de fes
noeuds donne naiffance à une feuille.
; Ç es feuilles font molles, un peu âcres, difpofées
alternativement, 6c pointues en forme de lance ; longues
de neuf ou dix pouces, larges de trois , liffes ,
d’un verd-gai, creufees en gouttière dans leur milieu
, 6c garnies de nervures courbées en arc. Lorf-
aue cette plante eft déjà foit avancée, desaiffelles
des feuilles fupérieures il fort de longs rameaux garnis
de feuilles alternes; lefquels rameaux donnent
naiffance à d’autres feuilles beaucoup plus petites.
De chaque aiffelle des feuilles qui font,vers l’ëx-»
trémité, il lort un petit rameau différemment genouil-
lé ; & à chaque genouillurefe trouve une tics-belle
fleur, polypétale, irrégulière ; compofée de fix feuilles
, dont cinq font femblables &c difpofées prefqu’en
rofe. Ces feuilles de la fleur font oblongues, étroites,
tortillées, blanches en- dedans , verdâtres en-
dehors. La fixieme feuille, ou le neclarium, qui occupe
le centre, eft roulée en maniéré d’aiguier-
re , 6c portée fur un embryon charnu, un peu tors,
femblable à une trompe. Les autres feuilles de la fleur
font auflîpofées fur le même embryon, qui eft long,
verd, cylindrique, charnu. Il fe change enfuite en
fruit, ou efpece de petite corne molle, charnue*,
prefque de la groffeur du petit doigt ; d’un peu plus
d’un demi-pié de longueur; noirâtre lorfqu’il eft
mûr, 6c enfin rempli d’une infinité de très-petites
graines noires. Les fleurs &c les fruits de cette plante
font fans odeur.
On la trouve dans plufieurs endroits de l’île de
S. Domingue : elle fleurit au mois de Mai. Cette vanille
de S. Domingue ne paroit différer de celle du
Mexique, dont Hermandez a fait la defcription, que
par la couleur des fleurs, & par l’odeur des gouffes:
car la fleur de celle-là eft blanche 6c un peu verte ,
& la gouffe eft fans odeur ; mais la fleur, de celle du
Mexique, fuivant la defcription d’Hermandez, eft
noire, & la gouffe d’une odeur agréable.
Defcription de la plante de vanille de la Martinique.
Le P. Labat affure dans fes voyages d’Amérique
, qu’il a trouvé à la Martinique une autre efpece
de vanille, qu’il décrit ainfi. La fleur qu’elle produit
eft prefque jaune, partagée en cinq feuilles, plus
longues que larges, ondées & un peu découpées
dans leur milieu. Il s’élève du centre un petit piftil
rond & affez pointu, qui s’alonge & fe change en
fruit. Cette fleur eft à-peu-près de la grandeur & de
la confiftance de celle des pois ; elle dure tout au plus
cinq ou fix jours, après lefquels elle fe fanne, fe femelle,
tombe & laiffe le piftil tout nud, qui devient
peu-à-peu une fifique de cinq, fix & fept pouces dé
.long ? plus plate que ronde, d’environ cinq lignes de
large, 6c deux lignes d’épaiffeur, de la figure à-peu-
près de nos coffes d’haricots.
Cette filique eft au commencement d’un beau verd,,'
elle jaunit à mefure qu’elle mûrit, 6c devient tout-à*-
fait brune lorsqu’elle eft feche ; le dedans eft rempli
de petites graines rondes, prefque imperceptibles
impalpables, qui font rouges avant d’être mûres, Sç
toutes noires dans leur maturité. Avant ce tems-là
elles n’ont aucune odeur fort fenfible, que celle de
fentir le verd ; mais quand elles font mûres & qu’on
les froiffe entre les mains, elles rendent une petite
j odeur aromatique fort agréable.
Le même fait a été mandé à l’académie des Scient
ces en 1724, par un des correfpondans de cette academie
demeurant à la Martinique, qui ajoute qu’il
en avoit trois piés venus de bouture, qu’il avoit tires
de la nouvelle Efpagne, & qui réuffiffoient parfaitement.
Lieux ou croit la bonne vanille. Malgré ces fortes
d’atteftations, la vanille de la Martinique n’a point
pris faveur fiir les lieux, ni dans le commerce ; on
continue toujours de la tirer de la nouvelle Efpagne
& du Pérou. * °
Les endroits ou 1 on trouve la vanille en plus grande
quantité, font la côte de Caraque 6c de Carthag
e 6 , 1 ifthme de Darion, & toute l’étendue qui eft
depuis cet ifthme & le golfe de S. Michel, jufqu’à
Panama, le Jucafan & les Honduras. On en trouve
auffi en quelques autres lieu x, mais elle n’eft ni fi
bonne, ni en fi grande quantité qu’au Mexique. On
dit encore qu’il y en a beaucoup & de belle , dans
la terre ferme de Cayenne. Comme cette plante aime
les endroits frais & ombragés, on ne la rencontre
guere qu’auprès des rivières, & dans les lieux
où la hauteur 6c l’épaiffeur des bois la mettent à couvert
des trop vives ardeurs du foleil.
Sa récolte, fa culture & fes vertus. La récolte commence
vers la fin de Septembre ; elle eft dans fa force
a la Touffaint,& dure jufqu’à la fin de Décembre.
On ignore fi les Indiens cultivent cette plante, &
comment ils la cultivent ; mais l’on croit que toute
la cérémonie qu’ils font pour la préparation du fruit,
ne confifte qu’à le cueillir à tems ; qu’enfuite ils le
mettent fécher 15 à .20 jours pour en difliper l’hu-
midite fuperflue, ou plutôt dangereufe, car elle le
feroit pourir ; qu’ils aident même à cette évapora-
t i° n > en preffant la vanille entre les mains, 6c l’ap-
platiffant doucement, après quoi ils finiflènt par la
frotter d’huile de coco ou de calba, & la mettent en
paquets qu’ils couvrent de feuilles de balifier ou de
cachibou.
j vanille contient une certaine humeur huileufe,
refineufe, fubtile 6c odorante, que l’on extrait facilement
par le moyen de l’efprit de vin. Après avoir
tiré la teinture, la gouffe refte fans odeur & fans fuc.
Dans l’analyfe chimique elle donne beaucoup d’huile
effentielle, aromatique, une affez grande portion de
liqueur acide, & peu de liqueur urineufe & de fel
fixe.
Hermandez lui attribue des vertus admirables,
mais Hermandez eft un mauvais juge ; cependant les
auteurs de matière médicale n’ont prefque fait que le
copier. Ils prétendent qu’elle fortifie l’eftomac-,
qu’elle aide la digeftion, qu’elle diffipe les vents ,
qu’elle cuit les humeurs crues , qu’elle eft utile
pour les maladies froides du cerveau, & pour les
catharres ; ils ajoutent qu’elle provoque les réglés,
qu’elle facilite l’accouchement, qu’elle chaffe l’ar-
riere-faix : tout cela eft exagéré. La vanille peut par
fon aromate chaud, être un bon ftomachique dans
les occafions où il s’agit de ranimer les fibres de l’eftomac
affoibli; elle deviendra quelquefois par la
même raifon emménagogue 6c apéritive ; fon huile
balfamique, fubtile & odorante, la rend fouvent recommandable
dans les maladies nerveufes, hyftéri-
ques & hypoçhondriaques ; c’eft pourquoi quelques
anglois l’ont regardée avec trop de précipitation,
comme un fpécifique dans ce genre de maladies.
On la donne en fubftance jufqu’à une drachme ; &
en infufion dans du vin, de l’eau, ou quelqu’autre
liqueur convenable, jufqu’à deux drachmes. Il faut
confiderer qu’elle échauffe beaucoup quand on en
prend une trop grande dofe, ou qu’on en fait un ufa-
ge immodéré ; & cette confidération doit fervir pour
indiquer les cas où il ne faut point la mettre en ufaÊ
e. Nos médecins françois l’emploient rarement, la
. iffent feulement en valeur dans la compofition, ou
chocolat .dont elle foit i’agrcment principal;, On s’en
iervoit autrefois pour parfumer létabac; mais les
parfums ont paffé de mode , ils ne éaufent.à-préfent
que des vapeurs. Je ne connais aucun traité patticu-
lier lur la vanille. (Le chevalict d e JAUCOURt.')
V A NI T É , f. £ ( Mp/aU. ) le terme d eManiti eft
confacrepar l’ufage, àreprélenter également la dif-
polition d un homme qui s^attribue des qualités qu’il
a , ôc celle d un homme qui tâche de fefrire horineur
par de faux avantages : mais ici nous le refteignons à
cette dermere fignïficati&n, qui eft celle qui a le plus
de rapport avec l’origine de l’expreflioir.
Il femble que l’homme foit devenu vain, depuis
quil a perdu les fources de. fa véritable gloire en
perdant cet état de fainteté & de bonheur oh Dieu
havoit placé. Car qe.pou.vant renoncer au défié de le
faire efomer, & ne tropvant rien d’eftimable en lui,
depuis le peche ; ounhitôt n’ofant plus.jetter une vue.
fixe & des regards allurés fur lui-même, depuis qu’il
le trouve coupable de tant de crimes, & l'objet de la
vengeance de Dieu ; il fout bien qu’il fe répande au-
dehors, & qu il cherche à fe faire honneur en fe revêtant
des chofes extérieures : & en cela les hommes
conviennent d autant plus volontiers qu’ils fe trouvent
naturellement aulîi nuds & aulîi pauvres lésons
que les autres.
C eft ce qui nous paraîtra, fi nous confidérons que
les fources de la gloire, parmi les hommes fe rédui-
lent, ou.â des chofes indifférentes à cet égard, ou iî
vous voulez, qui ne font fufceptibles ni de blâme hfa
de louange, ou à des chofes ridicules-, & qui bien'
loin de nous faire .véritablement honneur font très-'
propres à marquer notre abattement, .o u i des chofes
criminelles, & qni par confcquent ne peuvent être
que honreufes en elles-même?, ou enfin à des chofes
qui tirent toute.leur perfeftion & leur,gloire du rapport
qu elles,ont;avec nos fo.ibleffes,&,nos défeuts. r
^ Je mets au premier rang les richeffes , quoiqu’elles
n aient rien de méprifable , elles n’ont auffi rien de
S r ! ? ] 1* en elles-mêmes. Notre cupidité avide & in-
tereffée ne,s’informe jamais de la fource, ni de l’u^
fage des richeffes,.quelle voit entre les mains des au-
très, il lui fuffit qu ils font riches pour avoir fes premiers
hommages. Mais, s’il plaifoit à notre coeur de
paffer de l’idée diftinfte à l’idée confufe, il feroit fur-
pris affez fouvent de l’extravagance de Ces fentimens;
car comme il n’eft point effentiel à un homme d’être
riche, il trouverait fouyem qu’il eftime un homme
parce que fon pere a été un fcélérat, ou parce qu’il â
ete lui-même un fripon ; & que lorfqu’il rend fes
hommages extérieurs à la richeffe, il falue le larcin '
ou encenfe l’infidélité & i’injuftice.
Il eft vrai, <jue ce n’eft point-là fon intention , il
fuit fa cupidité plutôt que là raifon, t mais un homme
à qui vous faites la cour eft-il obligé de corriger par
toutes ces diftinftions la baffeffe de votre procède f
Non, il reçoit vos refpeûs extérieurs comme un tribut
que vous rendez à fon excellence. Comme votre
avidité vous a trompé, fon orgueil aulîi ne manque
point de lui foire illufion ; fi fes richeffes n’aue-
mentent point fon mérite, elles augmentent l’opinion,
qu it en a , en augmentant votre cbipplaifance II
prend tout au pié de la lettre, & ne manque point
des aggrandir intérieurement de ce que vous lui don-
nez ,, pendant que vous ne vous enriçhiffez guere de
ce qu’il vous donne.
J’ai dît en fécond lieu , que l’homme fe fait fore
fouvent valoir, par des endroits qui le rendent ridicule.
En effet, qu’y a -t-il, par exemple, de plus ridicule
que la vanité qui a pour objet le luxe des habits
? Et n eft-ce pas quelque chofe de plus ridicule
que tout ce qui foit rire les hommes, que la .dorure
& la broderie entrent dans la raifon formelle de
l’eftime, qu’un homme bien vêtu foit moins contre