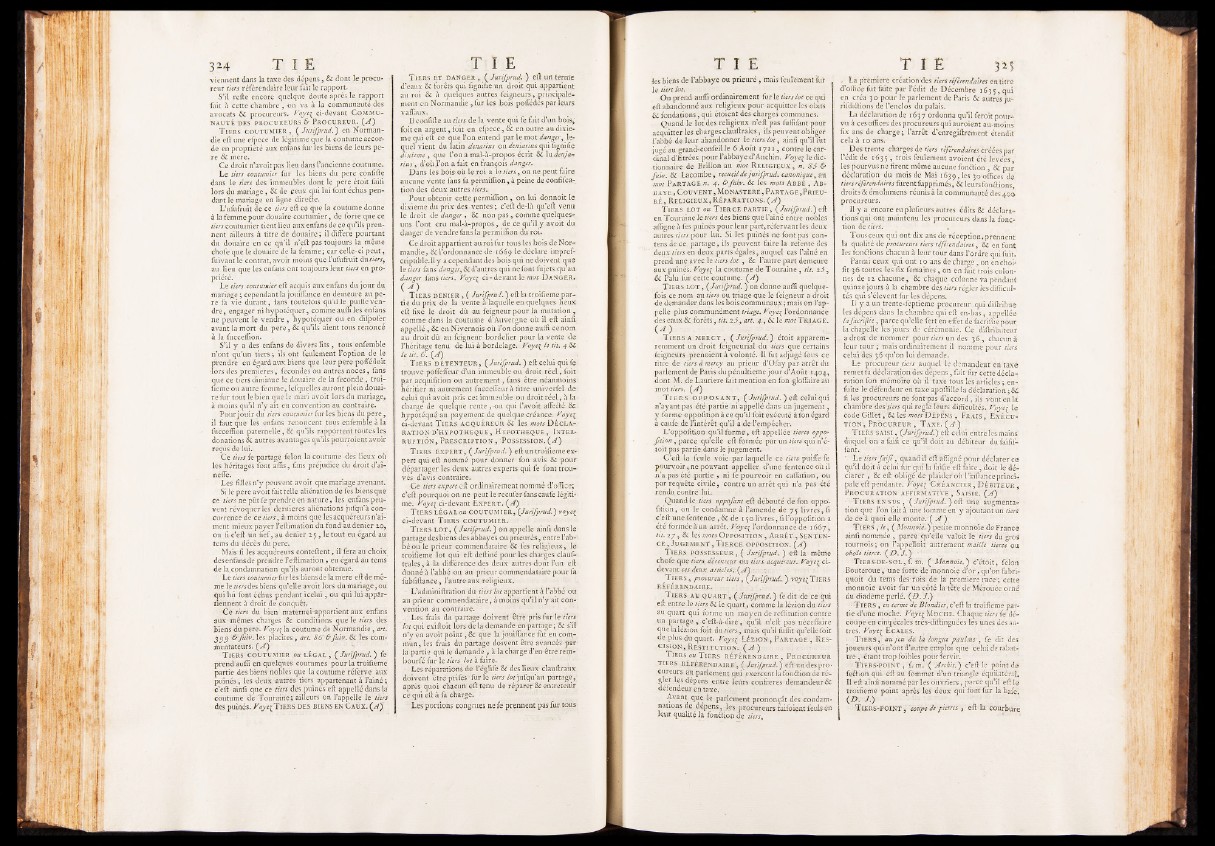
m T i e
viennent dans la taxe des dépens, & dont le procu- ■
reur tiers référendaire leur fait le rapport.
S’il relie encore quelque doute après le rapport
fait à cette chambre , On va à la communauté des
avocats & procureurs. Foye^ ci-devant C ommun
au té DES PROCUREURS & PROCUREUR. {A )
T iers coutumier , ( Jurifprud.) en Normandie
eft une efpece de légitime que la coutume accor*
de en propriété aux enfans fur les biens de leurs pe-
re & mere.
Ce droit n’avoit pas lieu dans ^ancienne coutume.
Le tiers coutumier fur les biens du pere confifte
dans le tiers des immeubles dont le pere étoit faili
lors du mariage , & de ceux qui lui font échus pendant
le mariage en ligne direéte.
L’ufufruit de ce tiers elt ce que la coutume donne
à la femme pour douaire coutumier, de forte que ce
tiers coutumier tient lieu aux enfans de ce qu’ils prennent
ailleurs à titre de douaire ; il différé pourtant
du douaire en ce qu’il n’eft pas toujours la même
chofe que le douaire de la femme; car celle-ci peut,
fuivant le contrat, avoir moins que l’ufufruit du tiers,
au lieu que les enfans ont toujours leur tiers en propriété.
Le tiers coutumier eft acquis aux enfans du jour du
mariage ; cependant la jouiflance en demeure au pere
fa vie durant, fans toutefois qu’il le puifle vendre,
engager ni hypotéquer, comme aufli les enfans
ne peuvent le vendre , hypotéquer ou en difpofer
avant la mort du pere, & qu’ils aient tous renoncé
à la fucceflion.
S’il y a des enfans de divers lits , tous enfemble
n’ont qu’un tiers ; ils ont feulement l’option de le
prendre eu égard aux bieris que leur pere poffédoit
•lors des premières, fécondés du autres noces, fans
que ce tiers diminue le douaire de la fécondé , troi-
fieme ou autre femme , lefquelles auront plein douaire
fur tout le bien que le mari avoit lors du mariage,
à moins qu’il n’y ait eu convention au contraire.
Pour jouir du tiers coutumier fur les biens du pere,
il faut que les enfans renoncent tous enfemble à la
fucceflion paternelle , & qu’ils rapportent toutes les
donations 6c autres avantages qu’ils ppurrôient avoir
reçus de lui.
Ce tiers fe partage félon la coutume des lieux où
les héritages font afîis, fans préjudice du droit d’aî-
nefle.
Les filles n’y peuvent avoir que mariage avenant.
Si le pere avoit fait telle aliénation de fes biens que
ce tiers ne pût-fe prendre en nature, les enfans peuvent
révoquer les dernieres aliénations jufqu’à concurrence
de ce tiers , à moins que les acquéreurs n’aiment
mieux payer l’eftimation du fond ait denier 20,
ou fi. c’eft un fief, au denier 25 , le tout eu égard au
tems du décès du pere.
Mais fi les acquéreurs conteftent, il fera au choix
des enfans de prendre l’eftimation, eu égard au tems
de la,condamnatjon qu’ils auront obtenue.
Le tiers coutumier fur les biens de la mere eft de même
le tiersdesbiens qu’elle avoit lors du mariage,ou
qui lui font échus pendant icelui, ou qui lui appartiennent
à droit de conquêt.
Ce tiers du bien maternel appartient aux enfans
aux mêmes charges & conditions que le tiers des
biens du pere. Foye\ la coutume de Normandie, art.
3$9 WÊlÊK' les placites, art. 8 GG fuiv. & les commentateurs.
(A )
T iers coutumier ou légal , ( Jurifprud. ) fe
prend aufli en quelques coutumes pour la troifieme
partie des biens nobles que la coutume réferve aux
puînés -, les deux autres tiers appartenant à l’ainé ;
c’ eft ainfi que ce tiers des puînés eft appelle dans la
coutume de Touraine; ailleurs oh l’appelle le tiers
des puînés. Voye{ T iers des biens en Caùx. {a )
T I E
T iers et danger , ( Jurifprud. ) eft un terme
d’eaux & forêts qui fignifie un droit qui appartient
au roi & à quelques autres feigneurs, principalement
en Normandie, fur les bois pofledés par leurs
vaflaux-.
Il confifte au tiers de la vente qui fe fait d’un bois,'
foiten argent, foit en efpece, Si en outre au dixième
qui eft ce que l’on entend par le mot danger, 1er
quel vient du latin denarius ou deniarius qui fignifie
dixième , que l’on a mal-à-propos écrit &C lu denja-
riusy d ’^ii j.’on a fait en françois danger.
Dans les bôis>où. le roi a le tiers, on ne peut faire
aucune vente fans fa permiflion, à peine de confifca-
tion des deux autres tiers.
Pour,obtenir cette permiflion , on lui donnoit le
dixième du prix des . ventes ; c’ eft de-là qu’eft venu
le droit de danger , 6c non pas, comme quelques-
uns l’ont cru mal-à-propos , de ce qu’il y avoit du
danger de vendre fans la permiflion du roi.
Ce droit appartient au roi fur tous les bois de Nor-<
mandie, & l’ordonnance de 1669 le déclare impref-
criptible.il y a cependant des bois qui ne doivent que
le tiers fans danger, 6c d’autres qui ne font fujets qu’au
danger fan s tiers. Foye* ci-devant le mot D anger.:
( A ) - I ;
T iers denier , ( Jurifprud. ) eft la troifieme partie
du prix de la vente à laquelle en. quelques lieux
eft fixé le droit dû au feigneur pour la mutation ,
comme dans la coutume d’Auvergne oii il eft ainfi
appellé , & en Nivernois où l’on donne aufli ce nom
au droit dû au feigneur bordelier pour la vente de
l’héritage tenu de lui à bordelage. Foye{ le tit. 4 6c
le tit. G. (A')
. T iers d ét ent eu r, ( Jurifprud. ) eft celui quife
trouve pofleffeur d’un immeuble ou droit réel., foit
par acquifition ou autrement, fans être néanmoins
héritier ni autrement fuccefleur à titre univerfel de.
celui qui avoit pris cet immeuble ou droit réel, à la
charge de quelque rente,-ou qui l’avoit affeélé ôe.
hypotéqué au payement de quelque créance. Voye^
ci-devant T iers acquéreur 6c les mots D éclaration
d’h y po th eq u e , Hypo théq u é, Interru
pt io n , Prescription , Possession. (A)
T iers ex pert, ( Jurifprud. ) eft un troifieme expert
qui eft nommé pour donner' fon avis 6c pour
départager les deux autres experts qui fe font trou-;
vés d’avis contraire.
Ce tiers expert eft ordinairement nommé d’office;
c’eft pourquoi on ne peut le reeuferfans caufe légiti-■
me. Voye^ ci-devant Expert. ( A)
T iers LÉGAL 0« COUTUMIER, (Jurifprud.) voye^
ci-deVant T iers coutumier.
T iers l o t , ( Jurifprud. ) on appelle ainfi dans le
partage dès biens des abbayes ou prieurés, entre l’ab-:
bé ou le prieur commendataire 6c fes religieux, le
troifieme lot qui eft deftiné pour les charges clauf-
t_ral.es, à la différence des deux autres dont l’un eft
donné à l’abbé ou au prieur commendataire pour fa
fubfiftance, l’autre aux religieux.
L’adminiftration du tiers lot appartient à l’abbé ou
au prieur commendataire, à moins qu’il n’y ait convention
au contraire.
.. Les frais du partage doivent être pris fur le tiers
' lot qui exiftoit lors de la demande én partage ; & S’il
n’y en avoit point, que la jouiflance fût en coin-,
immoles frais du partage doivent être avancés' parla
partie qui le demande , à la charge d’en-être rem-
bourfe fur le tiers lot à faire.
. Lès réparations dé- l’églife & des liëux clauftraüx
doivent être prifés 'fur le tiers lot jufqu’au partage,;
après quoi chacun eft tenu de réparer 6c entretenir
ce*qui eft à fa chargé; •
Les portions congrues ne fe prennent pas fur tous
T I E
les biens de l’abbaye ou prieuré, mais feulement fut
le tiertlot...
On prend aufli ordinairement fur le tiers lot ce qui
eft abandonné aux religieux pour acquitter les obits
Sc fondations, qui étoient des charges communes.
Quand le lot des religieux n’eft pas fuffifant pour
acquitter les charges clauftraies, ils peuvent obliger
l’abhé de leur abandonner le tiers lot, ainfi qu’il fut
jugé au grand-confeille 6 Août 1 7 1 1 , contre le cardinal
d’Etrées pour l’abbaye d’Anchin. Foye^ le dictionnaire
de Brillon au mot R e l i g i e u x , n. 85 &
fuiv. & Lacombe, recueil de jurifprud. canonique, au
mot P a r t a g e n. 4. & fuiv. 6c les mots A b b é , A b b
a y e , C o u v e n t , M o n a s t è r e , P a r t a g e , P r i e u r
é , R e l i g i e u x , R é p a r a t i o n s . ( A )
T ie r s l o t ou T i e r c e p a r t i e , (Jurifprud.') eft
en Touraine le tiers des biens que l’aîné entre nobles
afligne à fes puînés pour leur part, réfervant les deux
autres tiers pour lui. Si les puînés ne font pas con-
tens de ce, partage, ils peuvent faire la refente des
dt\xx tiers en deux parts égales, auquel cas l’aîné en
prend mie avec le tiers, lot , & l’autre part demeure
aux puînés. Foye^ la coutume de Touraine , tit. z 5 ,
& Palu fur cette coutume. (A)
T i e r s l o t , {Jurifprud,. ) on donne aufli quelquefois
ce.nom au tiers ou triage que le feigneur a droit
de demander dans les bois communaux ; mais on l’appelle
plus communément triage. Foyeç l’ordonnance
des eaux 6c forêts, tit. z 5 , art. 4 , 6c le mot T r i a g e . ■ ■ H H ■ • T i e r s a m e r c y , ( Jurifprud:!) etoit apparem-
remment un droit feigneurial du tiers que certains
feigneurs prenoiènt à volonté. Il fut adjugé fous ce
titre de tiers à mercy au prieur d’Ofay par- arrêt du
parlement de Paris du pénultième jour d’Août 1404,
dont M. de Lauriere fait mention en fon gloflaire au
mot tiers. (A)
T l e RS O P E O S A N T, ( Jurifprud. ) eft celui qui
n’âyànt pas été partie ni appellé dans un jugement.
y formé oppofition à ce qu’il foit exécuté à ion égard
à caufe de l’intérêt qu’il a 'de l’empêcher.
L’oppofition qu’il forme, eft ap-pellée tierce oppo-
Jition ,• parce qii’elle eft formée par un tiers qui n’é-
toit pas partie;dans le jugement.
C ’eft la .feule voie par laquelle ce tiers puifle fe
pourvoir., ne pouvant appeller. d’une fenten'ce où il
n’a pas été partie , ni fe pourvoir en caflation, ou
par requête civile, contre un arrêt qui n’a pas été
rendu, contre lui.'
Quand le rie« oppofajit eft débouté de fon oppofition,
on le condamne à l’amende de 75 livres , fi
c’eft une-fentence ,6c de 150 livrés, fi l’oppofition a
été form.ée à' un- arrêt. Foye^ l’ordonnance de 1667,
tit. z y , & les' mots O p p o s i t i o n , A r r ê t ., S e n t e n c
e , Ju g e m e n t , T i e r c e o p p o s i t i o n , {a )
T iers possesseur, .([ Jurifprud..) eft la même
chofe que tiers; détenteur Ou tiers acquéreur. Foyeç ci-
devant ces deux, articles ..(A)
TÏERS, procureur tiers, ( Jurifprud.: \ voye? TIERS
. RÉFÉRENDAIRE. ' -
T i e r s a u q u a r t :, ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui
eft entre le tiers &c le quart., comme la lézion du tièrs
au quart qui forme un moyen de reftitution contre
un partage;,:.c’eft-à-dire ,'q u ’il n’eft pas; néceflaire
que la lézion. foit du -tiers-.,: mais qu’il fuffit qu’elle foit
de plus du quart-. Foyei Lézion , P a r t a g e , R e s c
i s i o n , R e s t i t u t i o n ; ( A )
T iers ou T iers référendaire , Procureur
tiers Référendaire', { Jurifprud.) éft'im des procureurs
au parlement qui exercent la fo’n&ion de ré-
gler les dépens .entre leurs confrères demandeur &
defendeur en taxe.
■ ^vant le parlement prononçât des condamnations
ae dépens , les -proçureurs faifoient feuls en
leur qualité la fonaion de tiers.
T I E 315
. Là pr èniiere création des tiers référendaires én titré
d’office fut faite par l’édit de Décembre 1635, qui
en créa 30 pour le parlement de Paris & autres ju-
rifdiaions de l’enclos du palais.
La déclaration de 1637 ordonna qu’il feroit pourvu
à ces offices des procureurs qui auroient aü-moins
fix ans de charge; l’arrêt d’enregiftrement étendit
cela à 10 ans.
Des trente charges de tiers référendaires èréées paf
l’édit de 11535 , trois feulement avoient été levées
les pourvus ne firent même aucune fonaion , & par
déclaration du mois de Mai 1639, les 30 offices dé
tiers référendaires furent fupprimés, & leurs fônaions,
droits & ëmolumens réunis à là communauté des 400
procureurs.
Il y a encore eu plufieurs autres édits & déclarations
qui ont maintenu les procureurs dans la fonction
de tiers. .
Tous ceux qui ont dix ans de réception, prennent
la qualité de procureurs tiers référendaires & en font
les fonaions chacun à leur tour dans l’ordre qui fuit.
Parmi ceux qui ont 10 ans de charge, on èn choi*
fit 3 6 toutes les fix femàines, on en fait trois colonnes
de 12 chacune, & chaque colonne Va pendant
quinze jours à.la chambre de^ tiers régler les difficultés
qui s’élèvent fur les dépens.
Il y a un trente-feptieme procureur,qui diftribue
les dépens dans la chambre qui eft en-bas, appellée
lafacrifiie, parce qu’elle fert en effet dé facriftie pour
la chapelle les jours de cérémonie. Ce diftributeur
n a droit de nommer pour tiers un des 3 6 , chacun â
leur tour ; mais ordinairement il nommé pour tiers
celui des 36 qu’on lui demande.
. Le procureur tiers auquel 4e demandë.ûf en taxé
remet là déclaration des dépens, fait fur cette déclaration
fon mémoire où il taxe tous les articles ; en-
fuite le défendeur en taxe apbftille la déclaration ; &C
fi lès procureurs ne fonrpas d’accord, ils vont en là
chambre desfiers qui réglé leurs difficultés. Foye[ le
code Gillet, & l,es mots D épens , Frais , Ex é cu t
io n , Pr o cu reur, T axe. ( ^ )
T IEÉS saisi , (Jurifprud,) eft celui entré les mains
duquel bn a.faifi ce qu’il doit au débiteur dufaifif-
fant.;
L e tiers fa j i , quand il eft affigné pouf déclafer ce
qu’il doit à celui fur qui' la faifie eft Faite, doit 4 e déclarer
, & eft obligé dé plaider'où l ’irfftahcëprincipale
eft pendante. Foye^ C réancier, D ébiteur ,
Procuration affirmative , Saisie, ( à ) \
• T iers en sus , ( Jurifprud. ) eft une âiigmënta-
tion que l’on fait à une forrime en y ajoutant un tiers
de ce à quoi elle monte/( A )\
T IERS , l e , ( Monnaie'. ) petite monnOie de France
ainfi nommée , parce, qu’elle 'valoit le tiers du gros
tournois ; on l’appelloit autrement maille tierce ou
obole tiercé. (D . J .) ■
T iers-de-s o l , f. m. {Monnaie.) c’étoit, félon
• Bôutéroue, une forte île monnoie d’o r, qu’on fabri-
quoit du tems dès-rois-de là première race'; cette
monnoië avoit fur un côté la tête deMérouée orné
I du diadème perlé. (D . J.)
•Tiers , en terme dé Blondier, c’eft la troifieme partie
d?ivne moche. Foyé{ MOCHE. Chaque tiersTe découpe
en cinq éeales très-drftinguées les unes des autres.
Foye^ Eçales.
T iÉRS ,' au jeu de. la longue paulmf, fe dit des
joueurs qui n’ont d’autre emploi que celui de rabattre
, • étant trop foiblès pour fervir.
T iers-point , f.-m. ( A relût. ) c’eft le point de
feôiori qui eft au fommet d’un triangle équilatéral.
Il eft ainfi nommé par les ouvriers, parce qu’il eft lé
troifieme point après' lès deux qui font fur la bafe. HH I mmm T iers-p o i n t , coupe de pierres, elt la courbure