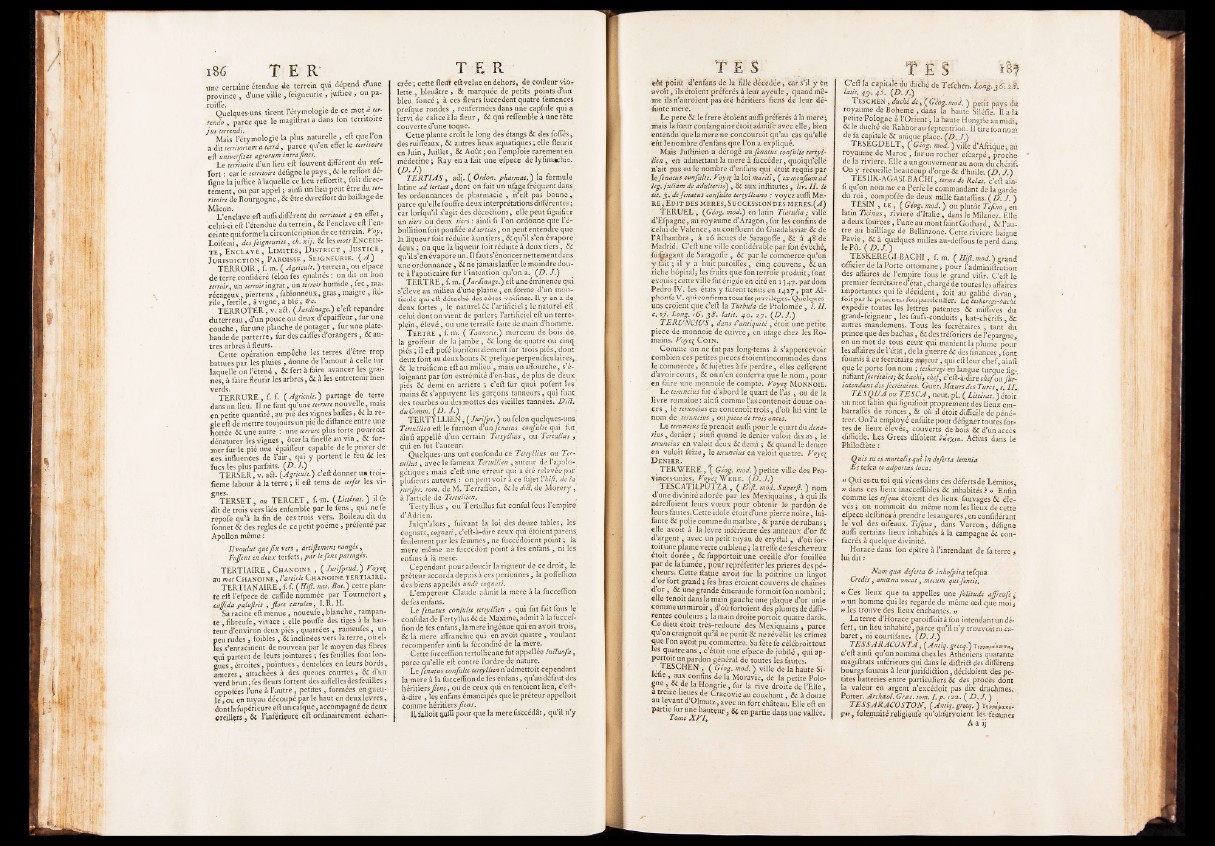
i86 T E R
une certaine étendue de térrein qui dépend d*une
province , d’une ville , feigneurie , juftice , ou paroiffe.
, . i x <
Quelques-uns tirent l’étymologie de ce mot a ter-
rendo , parce que le magiftrat a dans fon territoire
jusitrrtndï. „ a «
Mais l’étymologie la plus naturelle , eft que Ion
a dit ttrritorium cl tirrd, ^ parce qu’en efFet le territoire
eft unjverfitas agrorurhintrafinis. -
Le tirriioin d’un lieu eft foùvent différent du rel-
Lort : car le territoire défigne le pa ys, &c le reffort de-
ligne la juftice à laquelle ce lieu reffortit, foit directement,
ou par appel ; ainfi un lieu peut etre du territoire
de Bourgogne, & être du reffort du baillàge de
Mâcon. .
L’enclave eft auffi différent du territoire ; en ettet,
celui-ci eft l’étendue du terrein, & 1 enclave eft 1 enceinte
qui forme la circonfcription de ce terrein. Foy.
Loifeau, des feigneuries, ch.xij. & \esmots Encein-
t e , En c l a v e , Lim ite s , D istrict , Ju s t ic e ,
Jurisdiction , Paroisse , Seigneurie. ( ^ )
TERROIR, f. m. ( Agricult. ) terrem, ou eipace
de terre confidéré félon fes qualités : on dit un bon
terroir) un terroir ingrat, un terroir humide , fe c , marécageux
, pierreux , fablonneux, gras, maigre , fte-
rile, fertile, à vigne, à blé, &c. ■
TERROTER, v . aft. (Jardinage.) c eft répandre
du terreau, d’un pouce ou deux d’épaiffeur, fur une
couche, fur une planche de potager , fur une plate-
bande de parterre, fur des caiffes d’orangers, oc autres
arbres à fleurs.
Cette opération empêche les terres d etre trop
battues par les pluies , donne de l’amour à celle fur
laquelle on l’étend , & fert à faire avancer les graines,
à faire fleurir les arbres, & à les entretenir bien
verds. _ .
TERRURE, f. f. (Agricult.) partage de terre
dans un lieu. Il ne faut qu’une terrure nouvelle, mais
en petite quantité, au pié des vignes baffes, & la réglé
eft de mettre toujours un pié aediftance entre une
hottée & une autre : une terrure plus forte pourroit
dénaturer les vignes , ôter la fineffe au vin , & former
fur le pié une épaiffeur capable de le priver de
ces influences de l’air, qui y portent le feu & les
lues les plus parfaits. (D. J.)
TERSER, v. aGt. (Agricult.) c’eft donner un troi-
fieme labour à la terre ; il eft tems de terfer les vi-
^ T E R S E T , ou TER C ET , f.-m. (Littéral.) ilfe
dit de trois vers liés enfemble par le fens, qui nefe
repofe qu’à la fin de ces trois vers. Boileau dit du
fonnet & des réglés de ce petit poëme, préfenté par
Apollon même :
I l voulut que Jîx vers , artiftement ranges,
Fuffent en deux terfets, par le fens partages.
TERTIAIRE, C hanoine , ( Jurifprud. ) Foyeç
au mot C hanoine , ! article Chanoine te rtiair e.
TERTIANAIRE, f. f. (Hift. nos. Bot.) cette plante
eft l’efpece de caflide nommee par Tournefort ,
cafjida palujlris , flore caeruleo, I. R. H.
Sa racine eft menue, noueufe, blanche, rampante
, fibreufe, vivace ; elle pouffe des tiges à la hauteur
d’environ deux pies , quàrrées , rameufes, un
peu rudes , foibles , & inclinées vers la terre, oii elles
s’enracinent de nouveau par le moyen des fibres
qui partent de leurs jointures ; fes feuilles font longues
, étroites, pointues , dentelées en leurs bords,
ameres , attachées à des queues courtes, &C d’un
verd brun ; fes fleurs fortent des aiffelles des feuilles,
oppofées l’une à l’autre, petites, formées en gueule
, ou en tuyau découpé par le haut en deuxlevres,
dont la fupérieure eft un cafque, accompagné de deux
oreillers, & Finférieurç eft ordinairement échan-
T ER
crée ; cette fleift eft velue en dehors, de couleur vio?
lette , bleuâtre , & marquée de petits points d’un
bleu foncé ; à ces fleurs fuccedent quatre femences
prefque rondes , renfermées dans une capfule qui a
fervi de calice à la fleur, & qui reffemble à une tête
couverte d’une toque.
Cette plante croît le long des étangs & des foffés,
des ruiffeaux, & autres lieux aquatiques ; elle fleurit
en Juin, Juillet, & Août ; on remploie rarement eu.
médecine ; Ray en a fait une efpece de lyfimachie.,
w m m
TERTIAS , adj. ( Ordon. pharmac. ) la formule
latine ad tertias, dont on fait un ufage fréquent dans(
les ordonnances de pharmacie , n’eft pas bonne,
parce qu’elle fouffre deux interprétations différentes;
car lorfqu’il s’agit des décodions, elle peut fignifier
un tiers ou deux tiers : ainfi fi l’on ordonne que l’ébullition
foit pouffée ad tertias, on peut entendre que;
la liqueur foit réduite à un tiers, & qu’il s’en évapore"
deux ; ou que la liqueur foit réduite à deux tiers, &
qu’il s’en évapore un. Il faut s’énoncer nettement dans
une ordonnance, & ne jamais laiffer le moindre doute
à l’apoticaire fur l ’intention qu’on a. (D. J.)
TER TR E , f. m. (Jardinage.) eft une éminence qui.
s’élève au milieu d’une plaine, en forme d’un mon-'
ficule qui eft détaché des côtes voifines. Il y en a de.
deux fortes , le naturel & l’artificiel ; le naturel eft
celui dont on vient de parler; l’artificiel eft un terre-,
plein, élev é, ou une terraffe faite de main d’homm'e.
T ertre , f. m. ( Tannerie.) morceau de bois de,
la groffeur de la jambe , & long de quatre ou cinq,
piés ; il eft pofé horifontalement fur trois piés, dont
deux font au deux bouts & prefque perpendiculaires,.
Sc le troifieme eft au milieu , mais en affourché, s’éloignant
par fon extrémitéd’en-bas, déplus de deux'
piés & demi en arriéré ; c’eft fur quoi pofent les ’^
mains & s’appuyent les garçons tanneurs , qui font.
des tourbes ou des mottes des vieilles tannées. Dicl.
duComm. (D . J.)
TERTYLLIEN, ( Jurifpr. ) ou félon quelques-uns ’
Tertullien eft le furnom d’un fenatus confulte qui fut
ainfi appellé d’un certain Tertyllius , ou Tertullus ,
qui en fut l’auteur.
Quelques-uns ont confondu ceTertyllius ou Tertullus
, avec le fameux Tertullien , auteur de l’apolo.-i
gétique ; mais c’eft une erreur qui a été relevée par
plufieurs auteurs : on peut voir à ce fujet Vkifl. de la^
jurifpr. rom. de M. Terraffon, & le dicl. de Morery /
à l’article de Tertullien.
Tertyllius , ou Tertullus fut confulfoûs l’empire
d’Adrien.
Jufqu’alors, fuivant la loi des douze tables, les'
cognats,c0o-/zÆ/i, c’eft-à-dire ceux qui étoient parens.
feulement par les femmes, ne fuccedoient point ; la
mere même ne fuccédoit point à fes enfans , ni les
enfans à là mere.
Cependant pour adoucir la rigueur de ce droit, le
préteur accorda depuis à ces peri'onnes,' la poffeffion
des biens appellés undh cognati.
L’empereur Claude admit la mere à la fucceffion
defesenfans.
Le fenatus confulte tertyllien , qui fut fait fous le
confulat deTertyllus & de Maxime, admit à la fucceffion
de fes enfans, la mere ingénue qui en avoit trois,
& la mere affranchie qui en avoit quatre , voulant
recompenfer ainfi la fécondité de la mere.
Cette fucceffion tertullienne Ait appellée lucluofa,
parce qu’elle eft contre l’ordre de nature.
Le fenatus confulte tertyllien n’admettoiteependant
la mere à la fucceffion de fes enfans, qu’au defaut des
héritiers fe n s , ou de ceux qui entenomnt lieu, c’eft-
à-dire , les enfans émancipes que le préteur appelloit
comme héritiers fiens.
Il falloit auffi pour que la mere fûccédât, qu’il n’y
T Ë S
eût pôiht d’énïàns de la fille ‘décédée-, câ?. s’il y fen
ia voit f ils étoient préférés à leur ayeule, quand même
ils n’auroient pas été héritiers fiens de leur défunte
mere.
Le pere & le frere étoient auffi préférés à là mërë;
mais lafoeu'rconfanguine étoitadmife avec elle; bien
lentèhdu que la mere ne concoiiroit qu’au cas qu’elle
eût le nombre d’enfans qüe l ’on a expliqué.
Mais Juftinien a dérogé ali fenatus confulte ter 'tyl-
lien , en admettant la mere à fuccéder, quoiqu’elle
n’ait pas eu le nombre d’enfans qui étoit requis par
le fenatus confulte. Foye{ la loi mariti, (exnienfiuni ad
leg. juliàm de adulteriis), & aux inftitutes, ûv. II. U
tic. y . de fenatus confulto tertylliano : voyez auffi Me-
&e , Edit des meres, Succession des meres.(^ )
TERUEL , (Géog. mod.) en latin Tiarulia ; ville
(d’Efpagne, ail royaume d’Aragon, fur les confins dé
celui de Valence, au confluent du Guadalaviar & de
l’Alhambra, à 26 lieues de Sàragoffe , & à 48 de
Madrid-. C’eft une ville confidéràbië pat fort évêché,
fuffiagant de Saragoffe , & par le commercé qu’on
y fait ; il y a huit paroiffes, cinq couvens, & un
riche hôpital; les fruits que fon terroir produit, font
exquis ; cëtte ville fut érigée én cité en 13 47. pat dom
Pedro IV. les états y furent tenus en 1427, par Al-
phonfe V . qui confirma tous fes privilèges. Quelques-
Uns croient que c’eft la Turbula de Ptolomée , l. II.
c. vj. Long. 16. J 8. latit. 40. zÿ. (D .J .)
TERUNCIUS, dans Cantiquité , étoit une petite
piece de monnoie de cuivre * en ufage chez les Romains.
Voye{ CoiNj
• Comme on ne fut pas long-tems à s’appercevoir
tombien ces petites pièces étoient incommodes dans
le commerce, & fujettes à fe perdre, elles çefferent
d’avoir cours ; Si on n’en conferva que le nom, pour
en faire une monnoie de compte. Voye[ MôNnoié.
Le teruncius fin d’abord le quart de Vas , ou de la
livre romaine : ainfi comme l’as contenoit douze onces
, le teruncius en contenoit trois ; d’où lui vint le
nom de teruncius , ou piece de trois onces.
Le teruncius fe prenoit auffi pour le quart du dend-
rius, denier ; ainfi quand le denier valoit dix as , le
teruncius en valoit deux & demi ; & quand le denier
en valoit feize, le teruncius en valoit quatre* Voye^
D enier.
B TERWERE , ^ Géog. ftiod. ) petite ville des Pro-
vinces-unies. Foye^Were. (D .J .)
TESCATÎLPUTZA, ( Hiß. möd. Super/l. ) nom
d’une divinité adorée par les Mexiquains , à qui ils
adreffoient leurs voeux pour obtenir le pardon de
leurs fautes* Cette idole étoit d’une pierre noire * lui-
fante & polie comme du marbre, & parée de rubans;
elle avoit à la lèvre inférieure des anneaux d’or &
d’argent, avec un petit tuyau de eryftal , d’où for*
toit une plume verte ou bleue} la treffe de fes cheveux
étoit dorée , & fupportoit une oreille d’or fouillée
par de la fumée, pour repréfenter les prières des pécheurs.
Cette ftatue avoit fur la poitrine un lingot
d or fort grand ; fés bras étoient couverts de chaînes.
d’o r , & une grande émeraude formoit fon nombril;
elle tenoit dans la main gauche une plaque d’or unie
comme un miroir, d’où fortoient des plumes de différentes
couleurs ; la main droite portoit quatre dards.
Ce dieu etoit très-redouté des Mexiquains , parce
qu’on craignoit qu’il ne punît & ne révélât les crimes
que 1 on ayoit pu commettre. Sa fête fe célébroittout
les quatre ans , c’étoit une efpece de jubilé , qui ap-
H g l un pardon général de toutes les fautes.
TESCHEN, ( Géog. mod, ) ville de la häute Si-
iehe » aux confins de la Moravie, de la petite Polo-
gn e , & de la Hongrie, fur la rive droite de l’Elfe ,
a treize «eues de Cracovie au couchant, & à douze
au levant d Olnuitz, avec un fort château. Elle eft en
partie fur une hauteur 3 U en partie dans une vallée.-
Tome X F I ,
T Ë S ïSf
C ’eft la capitale du duché de Tefchen. Long. 3 G. zS'.
latit, 4$. 4S. (D .J .) ,
T eschen , duché di-r Geàg.mod. ) petit pays dû
royaume de Boheme , dans la haute Siléfîe. Il a là
petit eTolqgnë à I Orient ; la haute Hongrie au midi;
& le duché de Raliborau feptentriort. Il tire fon noni
de fa capitale & unique place; (D . J.)
TESÉGDELT; ( Géog. mod. ) ville d’Afrique; au
royaume de Maroc , fur un rocher efearpé, proche
de là riviere. Elle a un gouverneur au nom du chérifv
On y recueille beaucoup d’orge & ffhuile; (D . J.)
TES IIK-AGASI-BACHI, terme de Relat. c’eft ain-
fi qu’on nomme en Perfe le commandant de la garde
du ro i, compofée de deux mille fantaffins. ( D . J . )
TESIN , l e , ( Géog. mod. ) ou plutôt Teféno, eri
latin Ticinus * riviere d’Italie, dans le Milanez. Elle
a deux fources, l’une au montfaintGothardj & l’autre
au bailliage de Bellinzone* Cette riviere baigné
Pavie, & à quelques milles au-deffous fe perd dans
le Pô; ( D . J . )
TESKEREGI-BACHI, f. m. ( Hift.mad.) grand
officier dé la Porte ottomane, pour l’adminiftration
des affaires de l’empire fous le grand vifir; C ’eft le
premier fecrétaire d’état, chargé de toutes les affaires
importantes qui fé décident * foit au galibé divan ,
foit par le prince en fon particulier. Le teskeregi-bachi
expédie toutes les lettres patentes & miffives du
grand-feigneur, les faufs-conduits ; kat-chérifs , &
autres mandemens* Tous les fecrétaires , tant du
prince que des bachas, & des tréforiers de l’épargne,-
en un mot de tous ceux qui manient la plume pour
les affaires de l ’état, de la guerre & des finances, font
fournis à ce fecrétaire mpjeur, qui eft leur chef, ainfi
que le porte fon nom ; teskeregi en langue turque fig-
x\.\Ivà.v\ffterctaireî & bachi, chef, c’eft-à-dire chef ou fur-
intendant des fecrétaires. Guer . Moeurs des Turcs t. I I .
T E S Q U A OU' TE SC A , neut; pl. ( Littéral. ) étoit
urt mot fabin qui fignifioit proprement des lieux em-
barraffés de ronces , & où il étoit difficile de pénétrer.
On l’à employé enfuite pour défigner toutes fortes
de lieux éleves; couverts de bois & d’un accès
difficile. Les Grecs difoiént S'd^xict. Aftius dans lé
Philo&ète :
Quis tu es mortalis qui in deferta lemnia
E t tefca te adportas loca.
» Qui es-tu toi qui viens dans ces défertsde Lémriôs;
» dans ces lieux inaccèffibles & inhabités ? » Enfin
comme les tefqua étoient des lieux fauvages & élevés
; on nommoit du même nom les lieux de cette
efpece deftinés à prendre les augures, en confidérant
le vol des oifeaux. Tefqua, dans Varron, défigne
auffi certains lieux inhabités à la campagne & con-
facrés à quelque divinité*
Horace dans fon épître à l’intendant de fa terre ;
lui dit :
Nam qud deferta & inkofpita tefquâ
Credis, amoena vocat, mecum qui fentit.
« Ces lieux que tu appelles une foliiudê àffreufé 1
» un homme qui les regarde de même oeil que moi *
>> les trouve des lieux enchantés. »
La terre d’Horace paroiffoitàfon intendant un dé-
fert, un lieu inhabité, parce qu’il n’y trouvoitni cabaret,
ni courtifane. (D .J .)
^ TESSARACONTA, (Antiq. grecq.) T^apdnovTct9
c’eft ainfi qu’on nomma chez les Athéniens quarante
màgiftrats inférieurs qui dans le diftriâ dès différens
bourgs fournis à leur jurifdi&ion, décidôient des petites
batteries entre particuliers & des procès dont
la valeur en argent n’excédoit pas dix drachmes.
Potter. Archoeol. Grcec. tom. I.p. iz z . ( D . J .)
TESSARACOSTON} (Antiq. grecq. )
ç-*v y folemnité religieufe qu’obfervoient les-femmes
A a ij