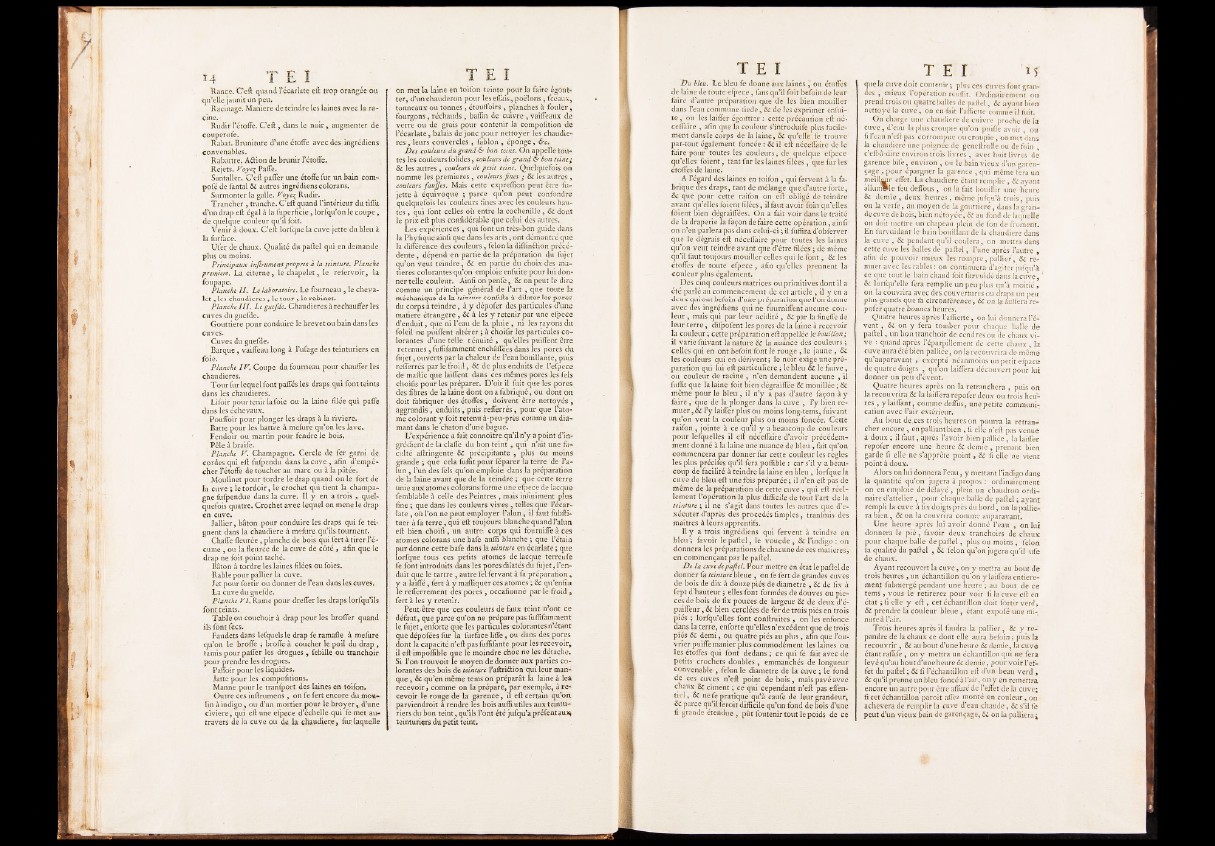
Rance. C’eft quand f écarlate eft trop orangée ou
'qu’elle jaunit un peu.
Racinage. Maniéré de teindre les laines avec la racine,
Rudir l’étoffe. C ’e ft , dans le noir, augmenter de
couperofe.
Rabat. Bruniture d’une étoffe avec des ingrédiens
convenables.
Rabattre. Aftion de brunir l’étoffe.
Rejets. Voye{ Paffe.
Santaller. C ’eft paffer une étoffe fur un bain com-
pofé de fantal & autres ingrédiens colorans.
Surmonter la galle. Voye^ Rudir.
Trancher , tranche. C’eft quand l’intérieur du tiffu
d’un drap eft égal à la fuperficie, lorfqu’on le coupe,
de quelque couleur qu’il foit.
Venir à doux. C’eft lorfquela cuve jette du bleu à
la furface.
UCer de chaux. Qualité du paftel qui en demande
plus ou moins.
Principaux infirumens propres à la teinture. Planche
première. La citerne, le chapelet, le refervoir, la
foupape.
Planche II. Le laboratoire. Le fourneau, le chevalet
, les chaudières, le tour , le robinet.
Planche III. Le guefde. Chaudières à rechauffer les
cuves du guefde.
Gouttière pour conduire le brevet ou bain dans les
cuves..
Cuves du guefde.
Barque, vaiffeau long à ,1’ufage des teinturiers en
foie.
Planche IV. Coupe du fourneau pour chauffer les
chaudières.
Tour fur lequel font paffés les draps qui font teints
dans les chaudières.
Lifôir pour tenir la foie ou la laine filée qui paffe
dans les échevaux.
Pouffoir pour plonger les draps à la riviere.
Batte pour les battre à. mefure qu’on les lave.
Fendoir ou martin pour fendre le bois.
Pèle à braife.
Planche V. Champagne. Cercle de fer garni de
cordes qui eft fufpendu dans la cuve , afin d’empêcher
l’étoffe de toucher au marc ou à la pâtée.
Moulinet pour tordre le drap quand on le fort de
la cuve ; le tordoir, le crochet qui tient la champagne
fufpendue dans la cuve. Il y en a trois , quelquefois
quatre. Crochet avec lequel on mene le drap
en cuve.
Jallier, bâton pour conduire les. draps qui fe teignent
dans la chaudière à mefure qu’ils tournent.
Chaffe fleurée, planche de bois, qui fert à tirer l’écume
, ou la fleurée de la cuve de côté , afin que le
drap ne foit point taché.
Bâton à tordre les laines filées ou foies.
Rable pour pallier la cuve.
Jet pour fortir ou. donner de l’eau dans, lçs cuves.
La cuve du guefde.
Planche VI. Rame pour dreffer les draps lorfqu’ils
font teints. . . /
Table ou cou choir à drap pour les broffer quand
ils font fecs.
Faudets dans lefquels le drap fe ramafle à mefure
qu’on le broffe ; broffe à coucher le poil du drap ,
tamis pour paffer les drogues , febilie ou tranchoir
pour prendre les drogues.
Paffoir pour les liquides.
Jatte pour les compofitions.
Manne pour le tranfport des laines en toifon.
Outre ces inftrumens , on fe fert encore du moulin
à indigo, ou d’un mortier pour le broyer , d’une
civiere, qui eft une efpece d’échelle qui femet au--
travers de la cuve ou de. la chaudière, fur laquelle
on met la laine en toifon teinte pour la faire égoutter,
d’unchauderon pour leseffais* poêlons , fceaux,
tonneaux ou tonnes, étouffoirs -, planches à fouler ,
fourgons, réchauds , baflin de cuivre , vaiffeaux de
verre ou de grais pour contenir la compofition de
l’écarlate, balais de jonc pour nettoyer les chaudie*-
re s , leurs couvercles , fablon , éponge, &c.
Iles couleurs du grand & bon teint. On appelle tou*
tes les couleurs folides, couleurs de grand & bon teint}
& les autres , couleurs de petit teint. Quelquefois on
nomme les premières, couleurs fines ; & les autres,
couleurs faujjes. Mais cette expreflion peut être fu-
jette à équivoque ; parce qu’on peut confondre
quelquefois les couleurs fines avec les couleurs hautes
, qui font celles oii entre la cochenille , & dont
le prix eft plus confidérable que celui des autres.
Les expériences , qui font un très-bon guide dans
la Phyfique ainfi que dans les arts, ont démontré que
la différence des couleurs, félon la diftinttion précédente
, dépend en partie de la préparation du fujet
qu’on veut teindre, & en partie au choix des matières
colorantes qu’on emploie enfuite pour lui donner
telle couleur. Ainfi on penfe, & on peut le dire
comme un principe général de l’art , que toute la
méchanique de la teinture confifte à dilater les pores
du corps à teindre, à y dépofer des particules d’une
matière étrangère, & à les y retenir par une efpece
d’enduit, que ni l ’eau de la pluie , ni les rayons du
foleil ne puiffent altérer ; à choifir les particules C0r
forantes d’une telle ténuité , qu’elles puiffent être
retenues , fuffifamrtient enchâffées dans les pores du
fujet, ouverts par la chaleur de Peau bouillante, puis
refferrés parle froid, & de plus enduits de l’efpece
de maftic que laiffent dans ces mêmes pores les fels
choifis pour les préparer. D’oii il fuit que les pores
des fibres de la laine dont on a fabriqué, ou dont on
doit fabriquer des étoffes, doivent être nettoyés ,
aggrandis, enduits, puis refferrés, pour que l’atome
colorant y foit retenu à-peu-près comme un diamant
dans le chaton d’une bague.
L’expérience a fait connoître qu’il n’y a point d’ingrédient
de la claffe du bon teint , qui n’ait une faculté
aftringente & précipitante , plus ou moins
grande ; que cela fuffit pour féparer la terre de l’alun
, l’un des fels qu’on emploie dans la préparation
de la laine avant que de la teindre ; que cette terre
unie aux atomes colorans forme une efpece de lacque
femblable à celle des Peintres , mais infiniment plus
fine y que dans les couleurs vives , telles que Fécar-
late , où l’on ne peut employer l’alun, il faut fübfti-
tuer à fa terre, qui eft toujours blanche quand l’alun
eft bien choifi , un autre: corps qui fourniffe à ces
atomes colorans une baie aufli blanche ; que l’étain
pur donne cette bafe dans là teinture en écarlate ; que
lorfque tous ces petits atomes de lacque terreufe
fe font introduits dans les pores dilatés du fujet * l’enduit
que le tartre, autre felfervant à fa préparation,
y a laiffé,. fert à y maftiquer ces atomes ; & qu’enfiii
le refferrement des pores , occafionné par le froid ,
fert à les y retenir»
Peut-être que ces couleurs dé faux teint, n’ont ce
défaut, que parce qu’on ne prépare pas fuffifamment
le fujet,enîorte que les particules colorantes n’étant
que dépofées fur là furface liffe, ou- dans des pores
dont la capacité n’ eft pas fuffifante pour les recevoir,
il eft impoflible que le moindre choc ne les détache.
Si l’on trouvoit le moyen de donner aux parties colorantes
des bois de teinture Faftriââon qui leur manque
, & qu’en même tems on préparât la laine à les
recevoir, comme on la prépare, par exemple, à re*>
cevoir le rouge de la garence, il eft certain qu’on
parviendroit a rendre les bois aufli*utiles aux teinturiers
du bon teint, qu’ils l’ont été jufqu’a préfentauj^
teinturiers du petit teint.
Du bleu. L e bleu fe donne aux laines \ ou étoffes
de laine de toute efpece, fans qu’il foit befoin de leur
faire d’autre préparation que de les bien mouiller
dans l’eau commune tiede, & de les exprimer enfuite
, ou les laiffer égoittter : cette précaution eft né-
ceffaire , afin que la couleur s’introduife plus facilement
dans le corps de la laine, & qu’elle , fe trouve
par-tout également foncée : & il eft néceffaire de le
faire pour toutes les couleurs, de quelque efpece
qu’elles foient, tant fur les laines filées , que fur les
étoffés de laine.
A l’égard des laines en toifon, qui fervent à la fabrique
aes draps, tant de mélange que d’autre forte,
& que pour cette raifon on eft obligé de teindre-
avant qu’elles foient filées, il faut avoir foin qu’elles
foient bien dégraiffées. On a fait voir dans le traité
de la draperie la façon de faire cette opération, ainfi
on n’en parlera pas dans celui-ci ; il fuffira d’obferver
que le dégrais eft néceffaire pour toutes les laines
qu’on veut teindre avant que d’être filées ; de même
qu’il faut toujours mouiller celles qui le fon t, & les
étoffés de toute efpece, afin qu’elles prennent la
couleur plus également.
Des cinq couleurs matrices ou primitives dont il a
été parlé au commencement de cet article , il y en a
deux qui ont befoin d’une préparation que l’on donne
avec des ingrédiens qui ne fourniffent aucune couleur
, mais qui par leur acidité , & par la fineffe de
leur terre, aifpofent les pores de la laine à recevoir
la Couleur ; cette préparation eftappellée le bouillon;
il varie fùivant la nature & la nuance des couleurs ;
celles qui en ont befoin font le rouge , le jaune , &
les couleurs qui en dérivent; le noir exige une préparation
qui lui eft particulière ; le bleu & le fauve,
ou couleur de racine , n’en demandent aucune , il
fuffit que la laine foit bien dégraiffée & mouillée ; &
même pour le bleu , il n’y a pas d’autre façon à y
faire, que de la plonger dans la cuve , l’y bien remuer
, & l’y laiffer plus ou moins long-tems, fuivant
qu’on veut la couleur plus ou moins foncée. Cette
raifon , jointe à ce qu’il y a beaucoup de couleurs
pour lefquelles il eft néceffaire d’avoir précédemment
donné à la laine une nuance de bleu, fait qu’on
commencera par donner fur cette couleur les réglés
les plus précifes qu’il fera polfible : car s’il y a beaucoup
de facilité à teindre la laine en bleu, lorfque la
cuve de bleu eft une fois préparée ; il n’en eft pas de
même de la préparation de cette cuve , qui eft réellement
l’operation la plus difficile de tout l’art de la
teinture ; il ne s’agit dans toutes les autres que d’exécuter
d’après des procédés fimples, tranfmis des
maîtres à leurs apprentifs.
Il y a trois ingrédiens qui fervent à teindre en
bleu favoir le paftel, le vouede , & l’indigo : on
donnera les préparations de chacune de ces matières,
en commençant par le paftel.
De la cuvedepafiel. Pour mettre en état le paftel de
donner fa teinture bleue , on fe fert de grandes cuves
de bois de dix à douze pies de diamètre , & de fix à
fept d’hauteur ; elles font formées de douves ou pièces
de bois de fix pouces de largeur & de deux d’é-
paiffeur, & bien cerclées de fer de trois piés en trois
piés ; lorfqu’elles font conftruites , on les enfonce
dans la terre, enforte qu’elles n’excédent que de trois
piés & demi, ou quatre piés au p lus, afin que l’ouvrier
puiffe manier plus commodément les laines ou
les étoffes qui font dedans ; ce qui fe fait avec de
petits crochets doubles , emmanchés de longueur
convenable , félon le diamètre de la cuve ; le fond
de ces cuves n’eft point de bois, mais pavé avec
chaux & ciment ; ce qui cependant n’eft pas effen-
t ie l, & ne fe pratique qu’à caufe de leur grandeur,
& parce qu’il leroit difficile qu’un fond de bois d’une
fi grande etendue, pût foutenir tout le poids de ce
que la cuve doit contenir ; plus ces cuves font grandes
, mieux l’operation reuflit. Ordinairement on
prend trois ou quatre balles de paftel, & ayant bien
nettoyé la cuve , on en-fait l’afliette comme il fuit.
On charge une chaudière de cuivre proche de la
cu ve, d’eau la plus croupie qu’on puiffe avoir , ou
fi l’eau n’eft pas corrompue ou croupie, on met dans
la chaudière une poignée de geneftrolle ou de foin ,
c’eft-à-dire environ trois livres , avec huit livres de
garence bife, environ , ou le bain vieux d’un garèn-
çage , pour épargner la garence , qui même fera un
meilhup- effet. La chaudière étant remplie, & ayant
àllumWe feu deffous , on la fait bouillir une heure
& demie , deux heures , même jufqu’à trois, puis
on la verfe, au moyen de la gouttière, dans la grande
cuve de bois, bien nétoyée, & au fond de laquelle
on doit mettre un chapeau plein de fon de froment.
En furvuidant le bain bouillant de la chaudière dans
la cuve , & pendant qu’il coulera, on mettra dans
cette cuve les balles de paftel, l’une après l’autre ,
afin de pouvoir mieux les rompre, pallier, & remuer
avec les râbles : on continuera d’agiter jufqu’à
ce que tout le bain chaud foit furvuidé dans la cuve,
& lorfqu’elle fera remplie un peu plus qu’à moitié ,
on la couvrira avec des couvertures ou draps un peu
plus grands que fa circonférence, & on ht laiffera re-
pofer quatre bonnes heures.
Quatre heures après l’afliette , on lui donnera l’évent
, & on y fera tomber pour chaque balle de
paftel, un bon tranchoir de cendres ou de chaux vive
: quand après l’éparpillement de cette chaux , la
cuve aura ete bien palliee, onia recouvrira de même
qu’aupara-vant , excepté néanmoins un petit efpace
de quatre doigts , qu’on laiffera découvert pour lui
donner un peu d’évent.
Quatre heures après on la retranchera , puis on
la recouvrira .& la laiffera repofer deux ou trois heu-
res , y laiflant, comme deffus, une petite communication
avec l’air extérieur.
Au bout de,ces trois heures on pourra la retran-'
cher encore , en palliant bien , fi elle n’eft pas venue
à doux ; il faut, après l’avoir bien palliée, la laiffer
repofer encore une heure & demie , prenant bien
garde fi elle ne s’apprête point, & fi elle ne vient
point à doux.
Alors on lui donnera l’eau, y mettant l’indigo dans
la quantité qu’on jugera à'propos : ordinairement
on en emploie de délayé , plein un chaudron ordinaire
d’atteiier, pour chaque balle de paftel ; ayànt
rempli la cuve à fix doigts près du bord, on la pallie-,
ra bien, & on la couvrira comme auparavant.
Une heure après lui avoir donné l’eau , on lui
donnera le p ié , favoir deux tranchoirs de chaux
pour chaque balle de paftel, plus ou moins , félon
la qualité du paftel , & félon qu’on jugera qu’il ufe
de chaux.
Ayant recouvert la cuve, on y mettra au bout de
trois heures , un échantillon qu’on y laiffera entièrement
fubmergé pendant une heure ; au bout de ce
tems , vous le retirerez pour voir fi la cuve eft en
état ; fi elle y eft , Cet échantillon doit fortir verd,
& prendre la couleur bleue , étant expofé une minute
à l’air.
Trois heures après il faudra la pallier, & y répandre
de la chaux ce dont elle aura befoin ; puis la
recouvrir , & au bout d’une heure & demie, la cuve
étant rafllfe , on y mettra un échantillon qui ne fera
leyé qu’au bout d’une heure & demie, pour voir l’effet
du paftel ; & fi l’échantillon eft d’un beau verd ,
& qu’il prenne un bleu foncé à l’air, on y en remettra
encore un autre pour être affuré de l’effet de la cuve;
fi cet échantillon paroît affez monté en couleur, on -
achèvera de remplir la cuve d’eau chaude, & s’il fe
peut d’un vieux bain de garençage, 6c on la palliera j