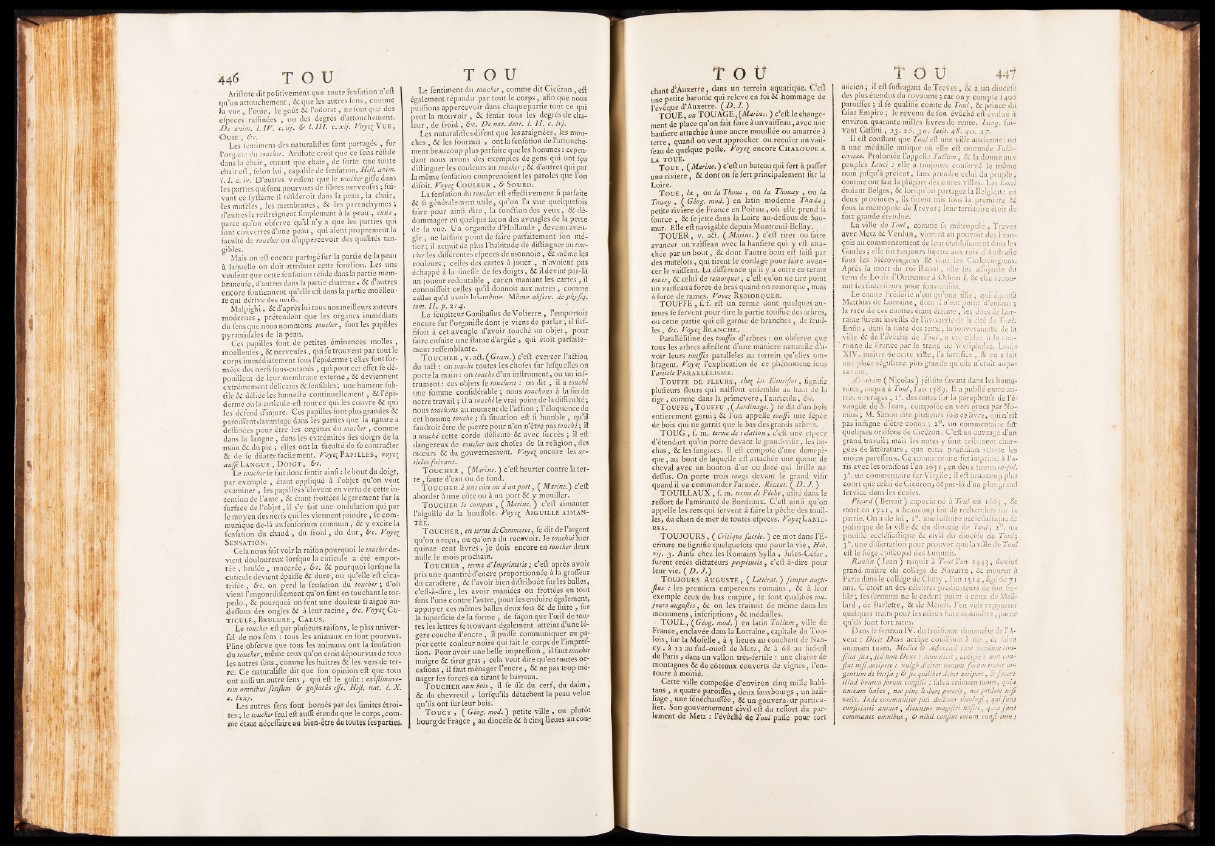
Ariftote dît pofitivement que toute fenfation n’ eft
qu’un attouchement, 6c que les autres fens, comme
la vue , Fouie, le goût 6c l’odorat, ne font que des
«fpeces raffinées , ou des degrés d’attouchement.
De anim. l.IF . c.iij. & LU I . c. xij. Voye{ VUE,
O uïe , &c. ,
Les lentimens des naturaliftes font partages , fur
l ’organe du toucher. Ariftote croit que ce fens réfide
dans la chair, entant que chair, de forte que toute
chair eft, félon lu i, capable de fenfation. Uifi: anim.
i. I. c. iv. D’autres veulent que le toucher gifle dans
les parties qui font pourvues de fibres nerveufes ; fui-
vant ce fyftème il réfideroit dans la peau, la chair,
lesmufcles, les membranes, 6c les parenchymes;
d’autres le reftreignent Amplement à la peau , cutis ,
parce qu’on obferve qu’il n’y a que les parties qui
Sont couvertes d’une peau, qui aient proprement la
faculté de toucher ou d’appercevoir des qualités tangibles.
Mais on eft encore partagé fur la partie de la peau
à laquelle on doit attribuer cette fonélion. Les uns
■ veulent que cette fenfation refide dans la partie mem-
braneufe, d’autres dans la partie charnue, & d’autres
encore foutiennent qu’elle eft dans la partie moëlleu-
fe qui dérive des nerls.
Malpighi, &.d’après lui tous nos meilleurs auteurs
modernes , prétendent que les organes immédiats
du fens que nous nommons toucher, font les papilles
pyramidales de la peau. ^ v
Ces papilles font de petites éminences molles ,
•moelleufes , 6c nerveufes, qui fe trouvent par tout le
corps immédiatement fous l’épiderme ; elles font formées
des nerfs idus-cutanés , qui pour cet effet fe dépouillent
de leur membrane externe, & deviennent
extrêmement délicates &fenfibles; une humeur fub-
tile & déliée les hume&e continuellement, 6c l’épi-,
derme ou la cuticule eft tout ce qui les couvre & qui
les défend d’injure. Ces papilles font plus grandes &
paroiffent davantage dans les parties que la nature a
deftinées pour être les organes du toucher , comme
dans la langue , dans les extrémités des doigts de la
main 6c du pié ; elles ont la faculté de fe eontra&er
& de fe dilater facilement. Foyei Papilles-, voyei
a u f f iL a n g u e ,D o ig t , & c.
Le toucher te fait donc fentir ainfi : le bout du doigt, .
par exemple , étant applique à l’objet qu’on veut
examiner , les papilles s’élèvent en vertu de cette intention
de l ’ame , 6c étant frottées légèrement fur la
furface de l’objet, il s’y fait une ondulation qui par
le moyen des nerfs qui les viennent joindre , fe corn- .
munique de-là aufenforium commun, 6c y excite la
fenfation du chaud, du froid, du dur, &c. Foyei
S ensation.
Cela nous fait voir la raifon pourquoi le toucher devient
douloureux lorfque la cuticule a été emportée
, brûlée , macerée, &c. 6c pourquoi lorfque la
cuticule devient épàiffe 6c dure, ou qu’elle eft cica-
trifée, &c. on perd la fenfation du toucher ; d’où
vient l’engourdiffement qu’on fent en touchant le torpédo
, 6c pourquoi on fent une douleur fi aiguë au-
4 effous des ongles 6c à leur racine, &c. F>yè{ C ut
ic u l e , BRULURE, CALUS.
Le toucher eft par plufieursraifons, le plus univer-
fel de nos fens : tous les animaux en font pourvus.
Pline obferve que tous les animaux ont la fenfation
du toucher, même ceux qu’on croit dépourvus de tous
les autres fens, comme les huitres 6c les vers de terre.
Ce naturalifte dit que fon opinion eft que tous
ont auffi un autre fens , qui eft le goût : exiflimave-
rim omnibus fenfum & gufiatus effe. Hifi. nat. I. X .
■c. Ixxj.
Les autres fens font bornés par des limites étroites
; le toucher texù. eft auffi étendu que le corps, comme
étaaî ijéçeflau-eau bien-être de toutes fes parties.
Le fentiment du toucher, comme dit Cicéron, eft
également répandu par tout le corps, afin que nous
puiffions appercevoir dans chaque partie tout ce qui
peut la mouvoir , 6c fentir tous les degrés de chaleur,
de froid , &c. De nat. deor. 1. 11. c . Ivj.
Les naturaliftes difent que les araignées, les mouches
, 6c les fourmis , ont la fenfation de l’attouchement
beaucoup plus parfaite que les hommes i cependant
nous avons des exemples de gens qui ont fçu
diftinguer les couleurs au toucher ; 6c d’autres qui par
la même fenfation comprenoient les paroles que l’on
difoit. Foye^ Couleur , & Souhü.
La fenfation dû toucher eft effectivement fi parfaite
& fi généralement utile, qu’on l’a vue quelquefois
faire pour ainfi dire , la fonction des yeu x , 6c dé*
dommager en quelque façon des aveugles de la perte
de la vue. Un organifte d’Hollande , devenu aveu-
gle , ne laiffoit point de faire parfaitement fon métier;
il acquit de plus l’habitude de diftinguer au toucher
les différentes efpeces de monnoie, 6c même les
couleurs ; celles des cartes à jouer', n’avoient pas
échappé à la fineffe de fes doigts, 6c il devint par-là
un joueur redoutable , car en maniant les cartes , il
connoiffoit celles qu’il donnoit aux autres , comme
celles qu’il avoit lui-même. Même obferv. de phyfiq.
tom. I I . p. 214.
Le fcuplteur Ganibafius de Volt erre , l’emportoit
encore fur l’organifte dont je viens de parler ; il fuf-
fifoit à cet aveugle d’avoir touché un objet, - pour
faire enfuite une ftatue d’argile , qui étoit parfaitement
reffemblante.
T o u ch er , v. a£t. (Gram.') c’eft exercer l’aélion
du taft : on touche toutes les chofes fur lefquelles on
porte la main : on touche d’un infiniment, ou un inf-
trument : ces objets fe touchent : on dit , il a touché
une fomme confidérable ; nous touchons à la fin de
notre travail ; il a touché le vrai point de la difficulté;
nous touchons au moment de Faftion ; l’ éloquence de
cet homme touche ; fafituation eft fi humble , qu’il
faudroit être de pierre pour n’en n’être pas touché ; il
a touché cette corde délicate 6c avec fuccès ; il eft
dangereux de toucher aux chofes de la religion, des
moeurs 6c du gouvernement. Foye{ encore les articles
fuiv ans.
T o u ch er , (Marine. ) c’eft heurter contre la ter-
te , faute d’eau ou de fond. ,
T O U C H E R à une côte ou à un port, ( Marine.') c’eft
aborder à une côté ou à un port 6c y mouiller.
T o u cher le compas , ( Marine. ) c’eft aimanter
l’aiguille de la bouffole. Foye^ Aig u il l e AIMANTÉE.
I H H ■
T o u ch er , en terme de Commerce,■ fe dit de l’argent
qu’on a reçu, ou qu’on a du recevoir. Je touchai hier
quinze cent livres , je dois encore en toucher deux
mille le mois prochain. ■ ^
T o u ch er , terme d?Imprimerie ; c’eft après avoir
pris une quantité d’encre proportionnée à la groffeur
du caraftere, 6c l’avoir bien diftribuée furies balles,
c’ eft-à-dire, les avoir maniées ou frottées en tout
fens l’une contre l’autre, pour les enduire également,
appuyer ces mêmes balles deux fois 6c de fuite , fur
la fuperficie de la forme , de façon que l’oeil de tour
tes les lettres fe trouvant également atteint d’une légère
couche d’encre , il puiffe communiquer au papier
cette couleur noire qui fait le corps de l’impref-
fion. Pour avoir une belle impreffion, il faut toucher
maigre 6c tirer gras , cela veut dire qu’en toutes oc-
cafions , il faut ménager l’encre, 6c ne pas trop ménager
fes forces en tirant le barreau.
T o ucher aux bois, il fe dit du cerf, du daim,
6c du chevreuil, lorfqu’ils détachent la peau velue
qu’ils ont fur leur bois.’ . A
Toucy , ( Géog. mod. ) petite ville , ou plutôt
bourg de France 3 au diocèfe 6c à cinq lieues au cour
chant dJÂuxerfe , dans un terrein aquatique; C ’eft
tme petite baronie qui releve en foi 6c hommage de
l’évêque d’Auxerre. (Z > ./ .)
TO U E , ou TOUAGE, {Marina ) c’eft le change*
ment de place qu’on fait faire à un vaiffeau, avec une
haufiere attachée à une ancre mouillée ou amarrée à
terre, quand on veut approcher ou reculer un vaif-
feau de quelque pofte. Foye^ encore Chaloupe a
LA TOUE. .
T oue , ( Marine. ) e’eft un bateau qui fert à paffer
une riviere, 6c dont on fe fert principalement fur la
Loire.
TOUE, la , ou la Thoïte , OU la Thouay , ou là
Touày , ( Géog. mod. ) en latin moderne Thotda ;
petite riviere de France en Poitou, où elle prend fa
fource , & f e jette dans la Loire au-deffous. de Sau-
mur. Elle eft navigâble depuis Montreuil-Bellay.
TOUER* v. ad. {Marine.) c’eft tirer ou faire
avancer un vaiffeau avec la hanfiere qui y eft attachée
par un bout, 6c dont l’autre bout eft faifi par
des matelots, qui tirent le cordage pour faire avancer
le vaiffeau. La différence qu’il y a entre ce terme
touer, 6c celui de remorquer, c ’eft qu’on ne tire point
un vaiffeau à force de bras quand on remorque, mais
à force de rames. Foye[ Remorquer.
TOUFFE , f. f. eft un terme dont quelques auteurs
fe fervent pour dire la partie touffue des arbres,
ou cette partie qui eft garnie de branches, de feuilles,
de. Foye^ Branche.
Parallélifme des touffes d’arbres : on obferve que
tous les arbres affedent d’une maniéré naturelle d’avoir
leurs touffes parallèles au terrein qu’elles ombragent.
Foye[ l’explication de ce phénomène fous
Yarticle PARAL LÉLISM E.
T ouffe de fleurs, che^ les Fleurijles, fignifie
plufieurs fleurs qui naïffent enfemble au haut de la
tige , comme dans la primevere, Faurieula, &c.
T ouffe , T ouffu , ( Jardinage. ) fe dit d’un bois
entièrement garni ; 6c l ’on appelle touffe une fépée
de bois qui ne garnit que le bas des grands arbres.
TOUG , f. m. terme de relation , c’eft une efpece
d’étendart qu’on porte devant le grand-vifir, les ba*
chas, 6c les fangiacs. Il eft compofé d’une demi-pique
, au bout de laquelle eft attachée une queue de
cheval avec un bouton d’or ou doré qui brille au-
deffus. On porte trois tougs devant le grand vifir
quand il va commander l’armée. Ricaut. {D . J .)
TOUILLAUX , f. m. terme de Pêche, ufité dans le
reffort de l’amirauté de Bordeaux. C ’eft ainfi qu’on
appelle les rets qui fervent à faire la pêche des touilles,
du chien de mer de toutes efpeces. Foye(LkmERES.
TOUJOURS, ( Critique facrée. ) ce mot dans l’Ecriture
ne fignifie quelquefois que pour la v ie , Héb.
vij. 3 . Ainfi chez les Romains S ylla , Jules-Céfar ,
furent créés diélateurs perpétuels, c’eft- à-dire pour
leur vie. (Z ). / .)
T oujours A u g u s t e , {Littlrat.') femperaugu-
fius : les premiers empereurs romains , 6c à leur
exemple ceux du bas empire, fe font qualifiés toujours
augufies, 6c on les traitoit de même dans les
monumens, inferiptions, 6c médailles.
■ T O U L , {Géog. mod.) en latin Tullum, ville de
France, enclavée dans la Lorraine, capitale du Tou-
lois, fur la Mofelle , à 5 lieues au couchant de'Nan-
c y , à 12 au fud-oueft de Metz, & à 68 au fud-eft
de Paris, dans un vallon très-fertile : une chaîne de
montagnes & de coteaux couverts de vignes, l’entoure
à moitié.
Cette ville compofée d’environ cinq mille habi-
tans , a quatre paroiffes, deux fauxbourgs , un bail—
liage, une fénéchauffée, & un gouverneur particulier.
Son gouvernement c iv il eft du reffort du parlement
de Metz : l’évêçné de T oui paffe pour fort
àhcieii; il eft fuffragant deT rev es, 6c à lin diocèfe
des plus étendus du royaume ; car on y compté 1400
paroiffes ; il fe qualifie comte de Toul, 6c prince dit
laint Empire ; le revenu de fon évêché eft évalué à
environ quarante milles livres de rente. Long, fui-
Vant Çalïini, 2.3. iô . 30. Iqtit. 4#. 40. z j .
Il eft confiant que Toul eft une ville ancienne : oii
à une médaille antique où elle eft nommée Tullo-
civitas. Ptolomée l’appelle Tullum $ 6c la donne aux
peuplés Leuci : elle a toujours confervé le même
nom jufqu’à préfent, fans prendre celui du peupTe^
comme ont fait la plûpart des autres villes. Les Leuci
étoient Belges, 6c lorfqu’on partagea la Belgique eii
deux provinces, ils furent mis fous la première 6c
fous la métropole deTreves ; leur territoire étoit de
fort grande étendue. 1
La ville de Toul, comme fa métropole , TreveS
avec Metz 6c Verdun, vinrent au pouvoir des François
au commencement de leur établiffement dans les
Gaules ; elle fut toujours fujette aux rois d’Auftrafié
fous les Mérovingiens 6c fous les Carlovingiens;
Après la mort du roi Raoul, elle fut affujettie du
tems de Louis d’Outremer à Othon I. 6c elle recon*
nut fes fucceffeurs pour fouverains.
Le comte Frédéric n’eut qu’une filié, qui époùfà
Matthias de Lorraine, dont il n’eut point d’enfans ;
la race de ces comtes étant éteinte, les ducs de Lorraine
furent inveftis de l’avouerie de la cité de Toul:
Enfin, dans la fuite des tems, la fouveraineté de là
ville 6c de l’éVêché de Toul, a été cédée à la cou*
’’ ronne de France par le traité de Weflphalie. Louis
XIV. maître de cette ville, Fa fortifiée, & en a fait
une place régulière plus grande qu’elle n’étoit aupa*
ravant.
Abraham ( Nicolas ) jéfitite favant dans les humanités,
naquit à Toul, l’an 15-8.9. H a publié entré autres
ouvrages , i°. des notes fur la pàraphrâfe de l’évangile
de S. Jean, compofée en vers grecs par No*
mius ; M. Simon cite plufieurs fois ce livre , qui n’efl:
pas indigne d’être connu ; 20. un commentaire fuï
quelques oraifons de Cicéron. C ’eft un ouvrage d’urt
grand travail ; mais les notes y font tellement chargées
de littérature, que cette profufion rebute les
moins pareffeux. Ce commentaire fut imprimé à Paris
avec les oraifons Fan 16 31 , en deux tomes in- fol.
30. un commentaire fur Virgile ; il eft beaucoup plus
court que celui de Cicéron, 6c par-là d’un plus grand
fervice dans les écoles.
Picard f Benoît ) capucin né à Toul eh 1 6 6 3 ,6c
mort en 1 7 1 1 , a beaucoup fait de recherches fur fa
patrie. On a de lu i, 1 °. une hiftoire eccléfiaftique 6c
polirique de la ville 6c du diocèfe de Toul’, z°. un
pouillé eccléfiaftique 6c civil du diocèfe de TW ;
30, une differtation pour prouver que la ville de Toul
eft le fiége épifcopal des Luquois.
Raulin (Je an) naquit à Toul Fan 1443, devint
grand-maître du collège de Navarre, 6c mourut à
Paris dans le collège de Cluny, Fan 15x4, âgé de 71
ans. C’étoit un des célébrés prédicateurs de fon fie-
b le; fes fermons ne le cedent point à ceux de Maillard
, de Barlette, & de Meno't. J’en vais rapporter
quelques traits pour les mieux faire cônnoîîre, parce:
qu’ils font fort rares.
Dans lefermonIV. dütrcifieme dimanche dé FA-
vent : Dicit Deus accipe eônfilium à me , 6c iiiva
animam tuam. Medici & Advocad carê vendant con-
Jilia j'ua, fednon Deus : nam dicit, accipe : non confiât
nifi accipere : vulgà dicitur bonum forum trahit ar-
gentum de burfa j & fie qüilibet débet accipere, & f acéré
illud bonum forum confilii : falva animam tuam, quia
unicam habes , nec plus habere poteris, ncc perdere nifi
velis. Inde communtter joli doctores theologi , qui f in i
confiliarii anima, dicuntur magiftri nofirt, quia f in i
communes omnibus , & nihil confiât eorum confiùum :