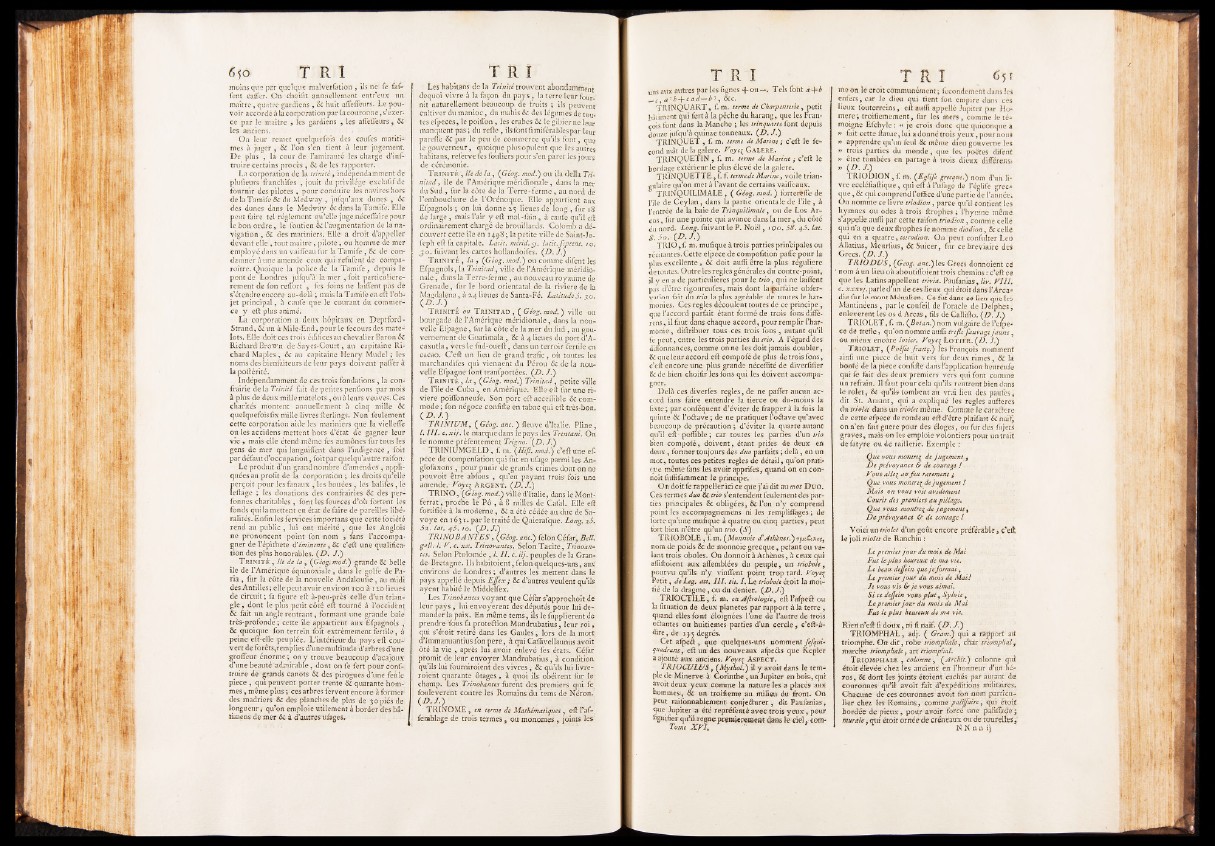
moins que par quelque malverfation , ils ne fe fafV
font caffer. On choiiit annuellement entr’eux un
maître , quatre gardiens , 8c huit affeffeurs. Le pouvoir
accordé à la corporation par la couronne »s’exerce
par le maître j les gardiens , les afleffeurs, 8c
les anciens.
On leur remet quelquefois des caufes maritimes
à juger , 8c l’on s’en tient à leur jugement.
De plus , là cour de l’amirauté les charge d’inf-
truire certains procès , 8c de les rapporter.
La corporation de la trinité, indépendamment de
plufieurs franchifes , jouit du privilège exclufif de
fournir des pilotes , pour conduire les navires hors
delaTamife 8c du Medway, jufqu’aux dunes , 8c
des dunes dans le Medway 8c dans la Tamife. Elle
peut faire tel réglement qu’elle jugenéceffaire pour
le bon o rdre, le foutien 8c l’augmentation de la navigation
, 8c des mariniers. Elle a droit d’appeller
devant e lle, tout maître , p ilote, ou homme de mer
employé dans un vaiffeau fur la Tamife , 8c de condamner
à une amende ceux qui refiifent de compa-
roître. (Quoique la police de la Tamife , depuis le
pont dé Londres jiffqu’à' la mer , foit particuliere-
rement de fon reffort , fes foins ne laiffent pas de
s’étendre encore au-delà ; mais la Tamife en eu l’objet
principal, à caufe que le courant du commerce
y eft plus animé.
La corporation a deux hôpitaux en Deptford-
Strand, 8c un à Mile-End, pour le feeours des mateJ
lots. Elle doit ces trois édifices au chevalier Baron 8c
Richard Brown de Sayes-Court, au capitaine Richard
Maples, 8c au capitaine Henry Mudel ; les
noms des bienfaiteurs de leur pays doivent pafler à
la poftérité. .
Indépendamment de ces trois fondations, là con-
frairie de la Trinité fait de petites penfions par mois
à plus de deux mille matelots , ou à leurs veuves. Ces
charités montent annuellement à cinq mille 8c
quelquefoisfix mille livres fterlings. Non feulement
cette corporation aide les mariniers que la vielleffe
ou les accidens mettent hors d’état de gagner leur
vie , mais elle étend.même fes aumônes fur tous les
gens de mer qui languiflént dans l’indigence , foit
par défaut d’occupation, foit par quelqu’autre raifqn:
Le produit d’un grand nombre d’amendes', appliquées
au profit de la corporation ; les droits qu’elle
perçoit pour les fanaux , les bouées , lés baliles , le
eftage ; les donations des confrairies 8c des per-
fonnés charitables , font les fources d’où fortent les
fonds qui la mettent en état de faire de pareilles libéralités.
Enfin les fervices importans que cette fotiété
rend au public , lui ont mérité , que les Anglois
ne prononcent point fon nom , fans l’accompagner
de l’épithete d’éminente , 8c c’eft une qualification
des plus honorables. (D . J .)
T rin ité , île de la , (Géog: mod.) grande 8c belle
île de l’Amérique équinoxiale , dans le golfe de Paria
, fur la côte de la nouvelle Andaloulie, au midi
des Antilles; elle peut avoir environ ioo à i io lieues
de circuit ; fa figure eft à-peu-près celle d’un triangle
, dont le plus petit côté eft tourné à l’occident
8c fait un angle rentrant, formant une grande baie
très-profonde ; cette île appartient aux Efpagnols ,
8c quoique fon terrein foit extrêmement fertile, à
peine eft-elle peuplée. L’intérieur du pays eft couvert
de forêts,remplies d’une multitude d’arbres d’une
groffeur énorme ; on y trouve beaucoup d’acaj’oux
d’une beauté admirable, dont on fe fort polir conf-
truire de grands canots 8c des'pirogues d’une feule
piece , qui peuvent porter trente 8c quarante hommes
| même plus ;■ ces arbres fervent encore à former
des madriers 8c des planches de plus de 30 pies de
longueur, qu’on emploie utilement à border des bâ-
timens de mer 8c à d’autres ufages.
Les habitans ae la Trinité trouvent abondamment
dequoi vivre à la façon du p ay s, la terre leur fournit
naturellement beaucoup de fruits ; ils peuvent
cultiver du manioc, du mahis 8c des légumes de toutes
efpe'ces, le poiffon, les crabes 8c le gibier ne leur
manquent pas ; du refte , ils font fi miférablés par leur
pareffe 8c par le peu de commerce qu’ils font, que
le gouverneur, quoique plus opulent que les autres
habitans, referve fes foulierspour s’en parer les jours
de cérémonie.
T rinité , île de la , (Géog. mod.) ou ila dell'a Trinitad
y île de l’Amérique méridionale, dans la mer
du Sud , fur la côte de la Terre-ferme , au nord de
l’embouchure de l’Orénoque. Elle appartient aux
Efpagnols ; on lui donne 25 lieues de long , fur 18
de large , mais l’air y eft mal-fain, à caufe qu’il eft
ordinairement chargé de brouillards. Colomb a découvert
cette île en 1498 ; la petite ville de Saint-Jo-
feph eft fa capitale. Latit. mirid. c). Utit.feptent. iot
3 o . fuivant les cartes hollandoifes. (D . J .)
T rin ité , la , (Géog. mod.') ou comme difent les
Efpagnols, la Trinitad, ville de l’Amérique méridionale
, dans la Terre-ferme, au nouveau royaume de
Grenade, fur le bord orientatal de la riviere de la
Magdalena, à 2 4 lieues deSanta-Fé. Latitude5 . 30.
{ D . j . y
T rinité ou T r in it a d , ( Géog. mod.) ville ou
bourgade de l’Amérique méridionale, dans la nouvelle
Efpagne, fur la côte de la mer du fud, au gouvernement
de Guatimala , 8c à 4 lieues du port d’A-
caxutla, vers le fud-oueft, dans un terroir fertile en
cacao. C’eft un lieu de grand trafic', où1 toutes les
marchandifes qui viennent du Pérou 8c .de la nouvelle
Efpagnè font tranfportées. (D . J .)
T r in it é , la , (Géog. mod.) Trinitad 5 petite ville
de l’île de Cuba , en Amérique. Elle eft fur une riviere
poiffonneufe. Son port eflracceflible '8c commode
; fon négoce confifte en tabac qui eft très-bon.
(Z J .y .) W Ê I
T R IN IU M , ( Géog. anc. ) fleuve d’Italie. Pline,
l. I I I . c. x i/, le marque dans le pays des Trentani. On
le nomme préfentement Trigno. (D . J .)
TRINIUMGELD, f. m. (Hiß . mod.) c’eft une ef-
pece de compenfation qui fut en ufage parmi les An-
glofaxons, pour punir de grands crimes dont on ne
pouvoit être abfous , qu’en payant trois1 fois une
amenAt.- Voye^ A rgent. (D . J .)
TRINO, (Géog. mod.) ville d’Italie, dans le Mont-
ferrat, proche lé Pô , à 8 milles de Cafal. Elle eft
fortifiée à la moderne, 8c a été cédée au duc de Savoy
e ën 1631. par le traité de Quierafque. Long. 2.6,
5 x . lat. 4 S. 10. (D .J . ) '
TR IN O B A N T E S , (Géog. anc.) félon Céfar, BelL
gall.-l. V . c. x x . Trinovantes. Selon Tacite, Tririoàn-
tes. Selon Ptolomée, l . I I . c. «/. peuples de la Grande
Bretagne. Ils habitaient, félon quelques-uns, aux
environs de Londres ; d’autres les mettent dans le
pays appellé depuis E jfe x ; 8c d’autres veulent qu’ils
ayent habité le Middelfex.
Les Trinobantes voyant que Céfar s’approchent de
leur p ays, lui envoyèrent des députés pour lui demander
la paix. En même tems, ils le fuppiierent dé
prendre fous fa proteftion Mandrubatius, leur ro i,
qui s’éroit retire dans les Gaules, lors de la mort,
d’Immanuantius fon pere, à qui Caflivellaunus avoit
ôté la. vie , après lui. avoir enlevé fes états. Céfar
promit de leur envoyer Mandrubatius, à condition
qu’ils lui fourniroient des vivres, 8c qu’ils lui livre-
roient quarante otages, à quoi ils obéirent fur le
champ. Les Trinobantes forent des premiers qui fe
fouleverent contre les Romains du tems de Néron. mm TRINOME, en terme de Mathématiques , eft l’af-
femblage de trois termes, ou monomes , joints le»
uns aux autres par les Agnes «f ou —. Tels foht a-^b
~-c, a " b + c a d—b * , 8cc.
TRINQUART, f. m. terme de Charpenterie , petit
bâtiment qui fert à la pêche du harang, que les François
font dans la Manche ; les trinquons font depuis
douze jufqu’à quinze tonneaux. (D . J .)
TRINQUET , f. m. terme de Marine; c’eft le fécond
mât de la galere. Voye{ Galere.
TRINQUETIN , f. m. terme de Marine ; c’eft le
bordage extérieur le plus élevé de la galere.
TRlNQUETTE, f. f. termede Marine, voile triangulaire
qu’on met à l’avant de certains vaiffeaux.
TRINQUILIMALE, ( Géog. mod. ) forterfffe de
l’île de Ceylan, dans la partie orientale de l’île , à
l’entrée de la baie de Trinquilimale, ou de Los Ar-
cos fur une pointe qui avance dans la m er, du côté
du nord. Long, fuivant le P. Noël, tO o. 5 8 . 45. lot.
8. 5 o. (D . J . )
TRIO, f. m. mufique à trois parties principales ou
récitantes. Cette efpece de compofition paffe pour la
plus excellente, 8c doit aufli être la plus régulière
de toutes. Outre les réglés générales du contre-point,
il y en a de particulières pour le trio, qui ne laiffent
pas d’être rigoureufes, mais dont la parfaite obfer-
vation fait du trio la plus agréable dé toutes le harmonies.
Ces réglés découlent toutes de ce principe,
que l’accord parfait étant formé de trois ions diffé-
rens, il faut dans chaque accord, pour remplir l’har-
mônie , diftribuer tous ces trois fons , autant qu’il
fe peut, entre les trois parties du trio. A l’égard des
diffonnances, comme onne les doit jamais doubler,
& que leur accord eft compofé de plus de trois fons,
c’en: encore une plus grande néceflité de diverfifier
8c de bien choifir les fons qui les doivent accompagner.
Delà ces diverfes réglés, de ne paffer aucun accord
fans- faire entendre la tierce ou du-moiiis la
Êxte ; par conséquent d’éviter de frapper à la fois la
quinte 8c l’oélave ; de ne pratiquer l’oélave qu’avec
beaucoup de précaution ; d’éviter la quarte autant-
qu’il eft poffible; car toutes les parties d’un trio
bien compofé, doivent, étant prites de deux en
deux, former toujours des duo parfaits ; delà, en un
mot, toutes ces petites réglés de détail, qu’on prati*
que même fans les avoir apprifes , quand on en con-
noît fuffifamment le principe.
O n doit fe rappeller ici ce que j’ai dit au mot Duo.
Ces termes duo 8c trio s’entendent feulement des parties
principales 8c obligées, 8c l’on n’y comprend
point les accompagnemens ni les remptiffages; dé
forte qu’ime mufique à quatre ou cinq parties, peut
fort bien n’être qu’un trio. (S )
TRIOBOLE, f.m. (Monnoit d'Athènes.) ifii&xoç,
nom de poids 8c de monnôie grecque, pefant ou valant
trois oboles. On donnoità Athènes, à ceux qui
afliftoient aux affembiées du peuple, un triobole f
pourvu qu’ils n’y vinffent point troptard. Voye^
Petit, de Leg. au. I I I . tit. I . Le triobole étoit la moitié
de la dragme, on du denier. ( D y J.)
TRIOCTILE, f. m. en A flrologie, eft l’alpeél ou
la. fituation de deux planètes par rapport à là terre ,
quand elles fo nt éloignées l ’une de l’autre de trois
©ôantes ou huitièmes parties d’un cercle, e’eft-à-
dire, de 135 degrés.
Cet a fp e a , que quelques-uns nomment fefqui-
quadrant, eft un des nouveaux afpeéb que Kepler
a ajouté aux anciens. F ty tç A s p e c t .
T R IO C U L U S , (Mythol.) il y avoit dans le temple
de Minerve- à Corinthe, un Jupiter en bois, qui
avoit deux yeux comme la nativre les a placés aux
hommes;. 8c un troilieme au milieu dü front. Oit
peut raifonnablement conjelivrer, dit Paulanias,
que Jupiter'a été repréfenté avec tro isy eu x ,- pour
fignifier qu^ilregnepremièrement dans le ciél, eom-
Tomt X V L
me on le croit communément; fecondemeht dans les
enfers, car le dieu qui tient fort empire dans ces
lieux fouterreîns, eit aufli appellé Jupiter par Homère;
troifiemement, for les mers, comme le té-*
moigne Efchyle : « je crois donc que quiconque a
» fait cette ftatue, lui a donné trois y e u x , pour nous
» apprendre qu’un feul & même dieu gouverne les
» trois parties du monde, que les poètes difent
» être tombées en partage à trois dieux différensi
» (D . J.)
TRIODION, f. m. (Eglife grecque.) nom d’uh li-*
vre eccléfiaftique, qui eft à l’ufage de l’églifè grec*
que » 8c qui comprend l’office d’une partie de l’année.
On nomme ce livre triodion, parce qu’il contient les
hymnes ou odes à trois ftrophes ; l’hymne même
s’appelle aufli par cette raifon triodion, comme celle
qui n’a que deux ftrophes fe nomme diodion, 8c celle
qui en a quatre, tetrodion. On peut confulter Leô
Allotius, Meiirfius, 8c Suieer, fur ce bréviaire des
Grecs. (D. J.)
TRIO D U S , (Geog. <z«c.)les Grecs doftnôiént cé
nom à un lieu où aboutiffoient trois chemins : c’eft ce
que tes Latins appellent trivia. Pàufanias, liv. VIII.
e. xxxvj. parle d’un de ces lieux qui éroit dans l’Area*
die fur le mont Ménalien; Ce fut dans ce lieu qite les
Mantinéens , par le confeil de l’oracle de Delphes -9
enlevèrent les os d Areas, fils dé Callifto. (D . J.)
TRIOLET, f. m. (Botan.) nom vulgaire de l’efpe-
cé de frefl'e, qu’on nomme aufli trefie fauVagt jaune,
Ou mieux encore lotier. Voyi{ L o t i é r . (D. J.)
T r i o l e t , (Poéjie frariç.) les François nomment
ainfi une piece de huit vers for deux rimes, 8c là
bonté de là piece confifte dans l’application heuréufe
qui fe fait des deux premiers vers qui font comme
üfi refrain. Il faut pour cela qu’ils rentrent bien dans
le- rolet, 8c qu’ils tombent au vrai lieu des paufes,
dit St. Amant, qui a expliqué les réglés auftereâ
du triolit dans lin triolet même. Comme le caraélere
de cette efpecé de rondeau eft d’être piaffant 8c naïf;
on n’en fait guere pour des éloges, ou fur des ftijeri
graves, màis-ôn les emploie volontiers pour un trait
de fatyre ou de raillerie. Exemple :
Ota vous montre^ de jugement,
De prévoyance & de courage !
- Vous-aileç au feu rarement ;
Que vous montre[ de jugement /
Mais on Vous voit avidement
Courir des premiers au pillage»
Que vous montreç de jugement
De prévoyance & de courage l
Voici Un triolet d’un genre encore préférable > c’eft
le joli triolet de Ranchin :
Le premier jour du mois de Mai
Fut U plus heureux de rna vie.
Le beau dejfein, que je'formai,
Le premier jour du mois de Mai!
Je vous vis & je vous aimai.
Si ce dejjein vous plut, Sylvie ,
Le premier jour du mois de Mai
Fut le plus heureux de ma vie.
Riefl n’èft fi doit», ni fi riaïf* (U . J.)
TRIOMPHAL, adj: ( Gram.) qui a rapport ait
triomphe. On dit, robe triomphale, char triomphalf
marche triomphale, art' triomphal.
T r i o m p h a l e , colonne, (Archet.) colonne qui
éroit élevée chez les anciens en- l’honrteut cBurt'héros,
8c dont les joints étaient cachés par autant de
couronnes qtf’îl avoit fait d’expéditions militaires.
Chacune de ces couronnes âvoit fon nom particulier
chez les Romains, comme palijfaire, qui étoit
bordée de pieux, pour avoir force une pàlilfade;
murale, qui étoit ornée de créneaux ou-de tourelles;
N N n n ij