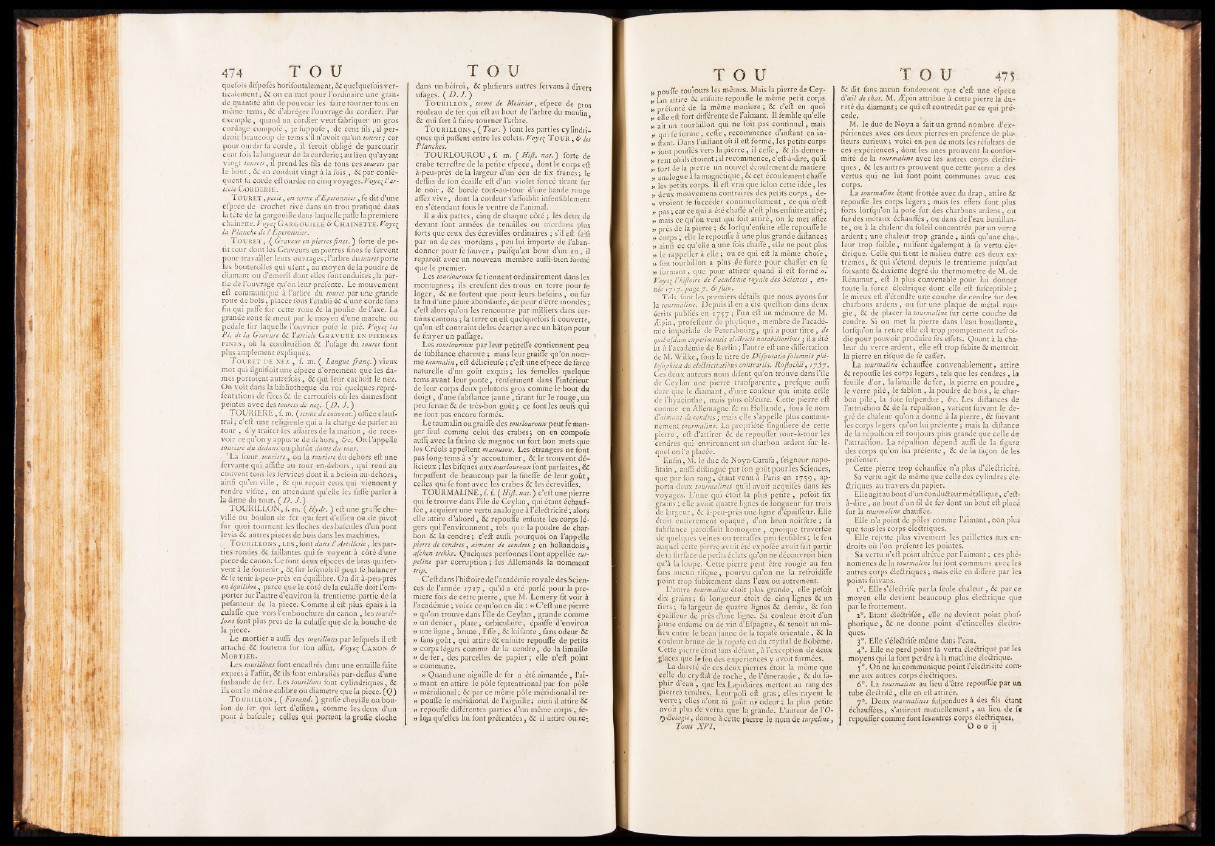
quefois difpofés horifontalement, 8c quelquefois verticalement
, Ôi on en met pour l’ordinaire une grande
quantité afin de pouvoir les faire tourner tous en
même tems, 8c d’abréger l’ouvrage du cordier. Par
exemple, quand un cordier veut fabriquer un gros
cordage compofé , je fuppofe , de cent fils., il per-
. droit beaucoup de tems s’il n’avoit qu’un touret ; car
pour ourdir fa corde, il feroit obligé de parcourir
cent fois la longueur de la corderie; au lieu qu’ayant
vingt tourets, il prend les fils de tous ces tourets par
le bout, 8c en conduit vingt à la fois ,. 8c par confé-
quent la corde eft ourdie en cinq voyages. Foye^L'article
C orderie.
T ouret , petit, en terme d'Eperonnur, fe dit d’une
efpece de crochet rivé dans un trou pratiqué dans
la tête de la gargouille dans laquelle pafle la première
chainette. Voyt^Gargouille & Chaîne tte. Foye^
la Planche de VEperonnier.
T o u r e t , ( Graveur en pierres fines. ) forte de petit
tour dont les Graveurs en pierres fines fe fervent
pour travaillerleurs ouvrages; l’arbre du touretporte
les bouterolles qui ufent, au moyen de la poudre de
diamant ou d’éineril dont elles font enduites, la partie
de l’ouvrage qu’on leur préfente. Le mouvement
eft communiqué à l’arbre du touret par une grande
roue de bois, placée fous l’établi 8c d’une corde fans
fin qui pafle fur cette roue 8c la poulie de l’axe. La
grande roue fe meut par le moyen d’une marche ou
pédale fur] laquelle l’ouvrier pofe le pié. Voye{ Les
PL de la Gravure & Y article GRAVURE EN PIERRES
fines , où la çonftruCtion 8c l’ufage du touret font
plus amplement expliqués.
T ouret de nez , f. m. (. Langue franç.') vieux
mot qui fignifioit une efpece d’ornement que les dames
portoient autrefois , 8c qui leur cachoit le nez.
On voit dans la bibliothèque du roi quelques repré-
fentations de fetes‘& de carroufels où les clames font
peintes avec des tourets de neç. ( D . J . )
TOU R1ERE, f. m. ( terme de couvent.) office clauf-
tral ; c’eft une religieufe qui a la charge de parler au
tour , d’y traiter les affaires de la maifon, de recevoir
ce qu’on y apporte de. dehors, &c. On l’appelle
touriere du dedans ouplutôtdame du. tour. —
’ La foeur touriere , ou la touriere du dehors eft une
iervante qui.aflifte au tour en-dehors, qui rend au
couvent tous les fervices dont il a befoin au-dehors,
ainfi qu’en v ille , 8c qui reçoit ceûx qui viennent y
rendre viiite, en attendant qu’elle les faflfe parler à
la dame du tour. ( Z>. J.')
TOURILLON, f. m. ( Hydr. ) eft une groffe chevillé
ou bqulon de fer qui fert d’effieu ou dé: pivot
fur quoi tournent les fléchés desbafculeS d’un pont
levis 8c autres pièces de bois dans les machines.
T ourillons , les ,font dans.VArtillerie, les parties
rondes 8c faillantes qui fe voyent à côté d’une
piece de canon. Ce font deux efpeces de bras quifer-
yent à le foutenir, 8c fur lefquels il peut fe .balancer
& fe tenir à-peu-près en équilibre. On dit à-peu-près
en équilibre, parce que le côté de la culaffe doit l’emporter
fur l’autre d’environ la trentième partie de la
pefanteur de la piece. Comme il eft plus épais à la
culaffe que vers l’embouchure du canon , les tourillons
font plus près de la culaffe que de la bouche de
la piece.
Le mortier a auffi des tourillons par lefquels il eft
attaché 8c foutenu fur fon affût. Foye^ Canon &
Mortier.
Les tourillons font encaftrés dans une entaille faite
exprès à l’affût, 8c ils font embrafles par-deffus d’une
fusbande de fer. Les tourillons font cylindriques, 8c
ils ont le même calibre ou diamètre que la piece. (Q)
T ourillon , ( Ferrand. ) greffe cheville ou bou-
lon de fer qui fert d’effieu, comme les deux d’un
pont à bafcule; celles qui portent lagroffe cloche
dans un béfroi, & plufieurs autres fervans à divers
ufages. ( D . J. ) ‘
T o u r il lon , terme de Meunier, efpece de gros
rouleau de fer qui eft au bout de l’arbre du moulin
8c qui fert à foire tourner l’arbre.
T ourillons , ( Tour. ) font les parties cylindriques
qui pafl’ent entre les colets. Voye£ T our , & les
Planches.
TOU RLO UR OU , f. m. ( Hift. nat.) forte de
crabe terreftre de la petite efpece, dont le corps eft
à-peu-près de la largeur d’un écu de fix francs ; le
deffus de fon écaille eft d’un violet foncé tirant fur
le noir, 8c bordé tout-au-tour d’une bande rouge
affez v iv e , dont la couleur s’affoiblit infenfiblemenr
en s’étendant fous le ventre de l’animal.
Il a dix pattes , cinq de chaque côté ; les deux de
devant font armées de tenailles ou mordans plus
forts que ceux des écreviffes ordinaires ; s’il eft faifi
par un de ces mordans , peu lui importe de l’abandonner
pour fe fouver, puifqu’au bout d’un an , il
reparoît avec un nouveau membre aufli-bien formé
que le premier.
Les tourlouroux fe tiennent ordinairement dans les
montagnes ; ils creufent des trous en terre pour fe
loger, 8c ne fortent que pour leurs befoins, ou fur
la fin d’une pluie abondante, de peur d’être inondés;
c’eft alors qu’on les rencontre par milliers dans certains
cantons ; la terre en eft quelquefois fi couverte,
qu’on eft contraint deles écarter avec un bâton pour
fe frayer un paffage.
Les tourlouroux par leur petiteffe contiennent peu
de fubftance charnue ; mais leur graiffe qu’on nomme
taumalin, eft délicieufe ; c’eft une efpece de farce
naturelle d’un goût exquis; lés femelles quelque
tems avant leur ponte, renferment dans l’intérieur
de leur corps deux pelotons gros' comme le bout du
doigt, d’une fubftance jaune, tirant fur le rouge, un
peu ferme 8c de très-bon goût ; ce font les oeufs qui
ne font pas encore formés.
Le taumalin ou graiffe des tourlouroux peut fe manger
feul comme celui des crabes; on en compofe
aufli avec la farine de magnoc un fort bon mets que
les Créols appellent matoutou. Les étrangers ne font
pas long-tems à s’y accoutumer, & le trouvent délicieux
; les bifques aux tourlouroux font parfaites, &
furpaffent de beaucoup par lafineffe de leur goût,
celles qui fe font avec les crabes 8c les écrevifles.
TOURMALINE, f. f. ( Hifi. nat.') c’éft une pierre
qui fe trouve dans l’île de Ceylan, qui étant échauffée
, acquiert une vertu analogue à l’éleCtricité ; alors
elle attire d’abord, 8c repouffe enfuite les corps légers
qui l’environnent, tels que la poudre de charbon
8c la cendre ; c’eft aufli pourquoi on l’appelle
pierre de cendres, aimant de cendres ; en hollandois ,
afehen trekke. Quelques perfonnes l’ont appellée tur-
peline par corruption ; les Allemands la nomment
trip.
C’eft dans l’hiftoire de l’académie royale des Sciences
de l’année 1 7 1 7 , qu’il a été parlé pour la première
fois de cette pierre, que M. Lemery fit voir à
l’académie ; voici ce qu’on en dit : « C ’eft une pierre
» qu’on trouve dans l’île de Ceylan , grande comme
»un denier, plate, orbiculaire, épaiffe d’environ
» une ligne , brune, liffe, 8c luifonte, fans odeur 8c
» fans goût, qui attire 8c enfuite repouffe de petits
» corps légers comme de la cendre, de la limaille
» de fe r , des parcelles de papier ; elle n’eft point
» commune.
» Quand une aiguille de fer a été aimantée, l’ai—
» mant en attire le pôle feptentrional par fon pôle
» méridional ; 8c par ce même pôle méridional il re-
» pouffe le méridional de l’aiguille ; ainfi il attire &
» repouffe différentes parties d’un même corps , fe-
» loji qu’elles lui font préfentées, 8c il attire ou re-
» pouffe toujours les mêmes. Mais la pierre de Cey-
| làn attire 8c enfuite repouffe le même petit corps
» préfenté de la même maniéré ; & c’eft en quoi
» elle eft fort différente de l’aimant. Il femble qu elle
» ait .un tourbillon qui ne foit pas continuel, mais
»> qui fe forme, ceffe, recommence d’inftant en in-
» liant» Dans l’inftant où il eft formé, les petits corps
» font pouffés vers la pierre, il ceffe, 8c ils demeu-
» rent où ils étoient ; il recommence, c’eft-à-dire, qu’il
» fort de la pierre un nouvel écoulement de matière
» analogue à la magnétique, 8c cet écoulement chaffe
» les petits corps. Il eft vrai que félon cette idée, les
» deux moûvemens contraires des petits corps, de-
»> vroient le luccéder continuellement, ce qui n’eft
» pas ; car ce qui a été chaffé n’eft plus enfuite attiré ;
» mais ce qu’on veut qui foit attiré, on le met affez
» près de la pierre ; 8c lorfqu’enfuite elle repouffe le
» corps ; elle le repouffe à une plus grande diftance ;
» ainfi ce qu’elle a une fois chaffé, elle ne peut plus
» le rappeller à elle ; ou ce qui eft la même chofe,
» fon tourbillon a plus de force pour chaffer en fe
» formant, que pour attirer quand il eft formé »7
Voyei Vhifioire de l'académie royale des Sciences , année
i j i j . page y. & fuiv.
Tels font les premiers détails que nous ayons fur
la tourmaline. Depuis il en a été queftion dans deux
écrits publiés en 1757 ; l’un eft un mémoire de M.
Æpin, profeffeur de phyfique, membre de l’académie
impériale de Petersbourg, qui a pour titre, de
quibufdam experimentis eleclricis notabilioribus. ; il a été
lu à l’académie de Berlin ; l’autre eft une differtation
de M. Wilke, fous le titre de Difputatio folemnis phi-
lofophica de eleclricitatibus contrariis. Rojlochii, t jS j .
Ces deux auteurs nous difent qu’on trouve dans l’île
de Ceylan une pierre tranfparente, prefque aufli
duré que le diamant, d’une couleur qui imite celle
de l’hyacinthe, mais plus obfcure. Cette pierre eft
connue en Allemagne 8c en Hollande, fous le nom
d’aimant de cendres ; mais elle s’appelle plus communément
tourmaline. La propriété finguliere de cette
pierre, eft d’attirer 8c de repouffer tour-à-tour les
cendres qui environnent un charbon ardent fur lequel
on l’a placée..
Enfin, M. le duc de Noya-Carafo, feigneur napolitain
, aufli diftingué par ion goût pour les Sciences,
que par fon rang, étant venu à Paris en .1759, apporta
deux tourmalines qu’il avoit acquifes dans fes
voyages. L’une qui étoit la plus petite , pefoit fix
grains ; elle avoit quatre lignes de longueur fur trois
de largeur, 8c à-peu-près une-ligne d’épaiffeur. Elle
étoit entièrement opaque, d’un brun noirâtre ; fa
iubftance paroiffoit homogène , quoique traverfée
de quelques veines ou terraffes peu fenfibles ; le feu
auquel cette pierre avoit été expofée avoit foit partir
de la furfoce de petits éclats qu’on ne découvroit bien
qu’à la loupe. Cette pierre peut être rougie au feu
fans aucun rifque , pourvu qu’on ne la refroidiffe
point trop fubitement dans l’eau ou autrement.
L’autre tourmaline étoit plus grande, elle pefoit
dix grains ; fa longueur étoit de cinq lignes 8c un
tiers ; fa largeur de quatre lignes & demie, 8c fon
épaifl'eur de près d’une ligne. Sa couleur étoit d’un
jaune enfumé ou de vin d’Elpagne , & tenoit un milieu
entre le beau jaune de la topafe orientale, 8c la
couleur brime de la topafe où du cryftal de Bohème.
Cette pierre étoit fans défaut, à l’exception de deux
glaces que le feu des expériences y avoit formées.
La dureté de ces deux pierres étoit la même que
celle du cryftal de roche, de l’émeraude, 8c du fo-
phir d’eau , que les Lapidaires mettènt au rang des
pierres tendres. Leur poli eft gras; elles rayent le
verre; elles n’ont ni goût ni»odeur; la plus petite
avoit plus de vertu que la grande. L’auteur de l’O-
ryllologie, donne à cette pierre le nom de turpelirie,
Tortii 1A7>7,
& dit fans aucun fondement que c’eft une efpecè
d'oeil de chat. M. Æpin attribue à cette pierre la dureté
du diamant; ce qui eft contredit par ce qui pré»
cede.
M. le duc de Noya a fait un grand nombre d’expériences
avec ces deux pierres en préfence de plu-,
fleurs curieux ; voici en peu de mots les réfultats de
ces expériences, dont les unes prouvent la conformité
de la tourmaline avec les autres corps électriques
, 8c les autres prouvent que cette pierre a des
vertus qui ne lui font point communes avec ces
corps.
La tourmaline étant frottée avec du drap, attire 8t
repouffe les corps légers ; mais fes effets font plus
forts lorfqu’on la pofe fur des charbons ardens , ou
fur des métaux échauffés , ou dans de l’eau bouillante,
ou à la chaleur du foleil concentrée par un verre
ardent ; une chaleur trop grande , ainfi qu’une chas
leur trop foible, nuifent egalement à fa vertu électrique.
Celle qui tient le milieu ëntre ces deux extrêmes,
8c qui s’étend depuis le trentième jufqu’aU
foixante 8c dixième degré du thermomètre de M. de
Réaumur, eft la plus convenable pour1 lui donner
toute la force électrique dont. elle eft fufceptible ;
le mieux eft d’étendfe une couche de cendre fur des
charbons ardens , ou fur une plaque de métal rou*
g ie, 8c de placer la tourmaline fur cette couche de
cendre» Si on met la pierre dans l’eau bouillante,
lorfqu’on la retire elle eft trop promptement refroi-*
die pour pouvoir produire fes effets. Quant à la cha*
leur du verre ardent, elle eft trop fubite & mettroit
la pierre en rifque de fe cafter»
La tourmaline échauffée convenablement, attire
& repouffe les corps légers, tels que les cendres , la
feuille d’o r , la limaille de fer, la pierre en poudre,
le verre pilé, le fablon , la poudre de bois, le charbon
pilé, la foie fufpendue, &c. Les diftances de
l’attraélion 8c de la repulfion, varient fuivant le degré
de chaleur qu’on a donné à la pierre, & fuivant
les corps légers qu’on lui préfente ; mais la diftance
de la repulfion eft toujours plus grande que celle de
l’attraftion. La répulfion dépend aufli de la figure
des corps qu’on lui préfente, 8c de la façon de les
préfenter.
Cette pierre trop échauffée n’a plus d’éleflricité.
Sa vertu agit de même que celle des cylindres électriques
au travers du papier.
Elle agit au bout d’un conducteur métallique, c’eft-
à-dire , au bout d’un fil de fer dont un bo\it eft placé
fur, la tourmaline chauffée.
Elle.n’a point de pôles comme l’aimant, non plus
; que tous les corps électriques.
Elle rejette plus vivement les paillettes aux endroits
où l’on préfente les pointes.
' Sa vertu n’ eft point altérée par l’aimant ; ces phénomènes
de la tourmaline lui font communs avec les
autres corps éleCtriques ; mais elle en diffère par les
points fui vans.
i° . Elle s’éleCtrife par la feule chaleur , 8c par ce
moyen elle devient beaucoup plus éleCtrique que
par le frottement.
20. Etant éleCtrifée, elle ne devient point phof-
phorique, 8c ne donne point d’étincelles électriques.
3°. Elle s’ éleCtrife même dans l’eau.
40. Elle ne perd point fa vertu éleCtrique par les
. moyens qui la font perdre à la machine éleCtrique.
s°. On ne lui communique point l’éleCtricite comme
aux autres corps éleCtriques.
6°. Là tourmaline au lieu d’être repouffee par un
tube éleCtrilé, elle en eft attirée.
7°. Deux tourmalines fufpendues à des fils étant
échauffées, s’attirent mutuellement , au lieu de fe
repouffer comme font les autres corps éleCtriques,
• O O O ïj