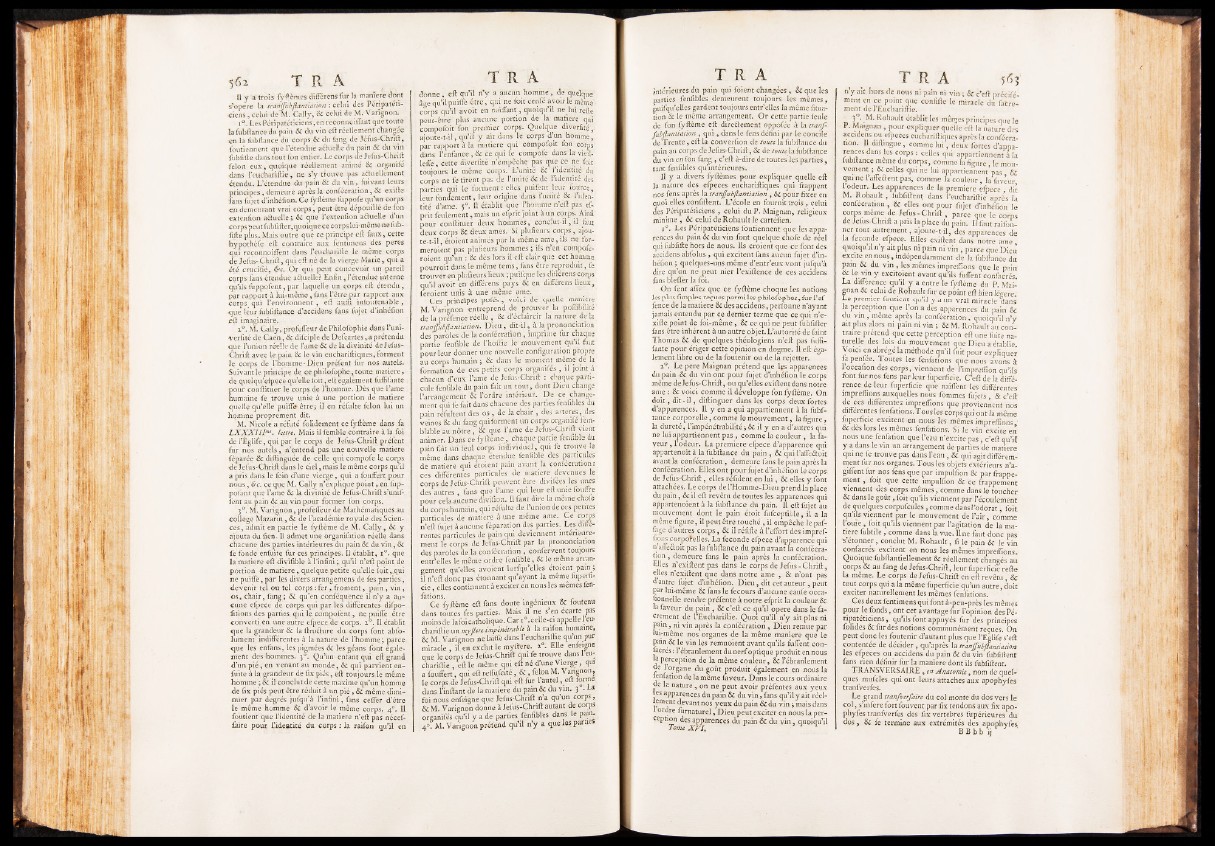
Il y a trois fyftèmes différens fur la maniéré dont
s’opère la tranjj'nbfianùaùon : celui des Peripateti-
ciens , celui de M. Cally, & celui de M. Varignon.
i° . Les Péripatéticiens , en reconneifthnt que toute
la fubftance du pain Sc du vin eft réellement changée
«n la fubftance du corps Sc du fang de Jéfus-Chrift,
foutiennent que l’étendue a&uelle du pain Sc du vin
fubfifte dans tout fon entier. Le corps de Jefiis-Chrift
félon eux, quoique réellement animé Sc organifé
dans l’euchariftie, ne s’y trouve pas ariuellement
étendu. L’étendue du pain Sc du v in , fuivant leurs
principes, demeure après la confecration, & exifte
■ fans fujet d’inhéfion. C e l'yftème fuppofe qu’un corps
en demeurant vrai corps, peut être dépouillé de fon
extenfion aôueile ; Sc que l’extenfion aûuelle d’un
corps peut fublifter,quoique ce corps lui-même nefub-
lifte plus,.Mais outre que ce principe eft faux, cette
hypothèfe eft contraire aux fentimens des peres
qui reçonnoiffent dans l’eucharifte le même corps
de Jefus-Chrift, qui eft né de la vierge Marie, qui a
été crucifié, &ç. Or qui peut concevoir un pareil
corps fans étendue aéluelle? Enfin, l’étendue interne
qu’ils fuppofent, par laquelle un corps eft étendu,
pàr rapport à lui-même,fans fêtre,par rapport aux
corps qui l’environnent , eft aulîi infoutenable ,
que leur fubfiftance d’accidens fans fujet d’inhéfion
eft imaginaire.
i° . M. Cally, profeffeur dePhilofophie dans l’uni-
Verfité de Caen, 8ç difciple de Defçartes, a prétendu
que l’union réelle de l’ame & de la divinité de Jefus-
Chrift avec le pain & le vin euehariftiques., forment
le corps de l’homme-Dieu préfent fur nos autels.
Suivant le principe de ce philolophe, toute matière,
de queiqu’efpeçe qu’elle foit, eft également fufHfante
pour conftituer le corps de l’homme. Dès que l’ame
humaine fe trouve unie, à une portion de matière
quelle qu’elle puiffe être; il en réfulte félon lui un
homme proprement; dit.
M. Nicole a réfuté folidenj,ent ce fyftème dans fa
L X X X I lIme. lettre. Mais il femble contraire à la foi
dé l’Églife, qui par le corps de lefus-Chrift préfent
fur nos autels, n’entend pas une nouvelle matière
féparée Sc diftioguée de celle qui compofe le corps
-de Jefus-Çhrift dans le ciel, mais le même corps qu’il
a pris dans le fein d’une vierge, qui a fouffert pour
nous, &c. cç que M. Cally n’explique point, en fup-
polanc que l’ame Sc la divinité de Jefus-Chrift s’unifient
au pain Sc au. vin pour former fon corps.
30. M. Varignon,profeffeur de Mathématiques au
college Mazarin, Sc de l’académie royale des Sciences,
admit en partie le fyûème de M. C a lly , Sc y
ajouta du fien. Il admet un,e organifation réelle dans
chacune des parties intérieures du pain Sc du v in , Sc
fe fonde enfuite fur ces principes. Il établit, i° . que
la matière eft divifible à l ’infini ; qu’il n’eft point de
portion de matière, quelque petite qu’elle ÎQit,qui
ne puiffe, par les divers arrangemens de fes parties,
devenir tel ou tel corps:fer froment, pain, v in ,
o s , chair, fang ; & qu’en cqnféquence il n’y a aucune
efpeçe de. corps qui par les différentes difpo-
fitions. des parties, q.ui le cdmpofent, ne puiffe être
converti en une autre efpeçe de corps. 20. Il établit
que la grandeur Sc la ftruélure du. corps font abfo-
lument indifférentes à la nature de l'homme; parcet
que les enfans, les pigmées & les géan.s font également
des hommes. 30.- Qu’un enfant qui eft grand
d’un p ié , en venant au monde, Sc qui parvient en-
fuite à la grandeur de fix pies., eft toujours,le même
homme ; Sc il conclut de cette maxime qu’un homme
de fix pies peut être réduit à un pié, & même diminuer
par degrés jufqu’à l’infini, fans ceffer d’être
le même homme & d’avoir le même corps. 40. Il
foutient que Fidentité de la matière n’eft pas nécef-
iâire pour l’identité du corps : la raifon qu’jl en
donne, eft qu’il n’y a aucun homme, de quelque
âge qu’il puiffe être, qui ne foit cenfé avoir le même,
corps qu’il avoit en naiffant, quoiqu’il ne lui relie
peut-être plus aucune portion de la matière qui
compofoit fon premier corps. Quelque diverfité ,-
ajoute-t-il, qu’il y ait dans le corps d’un homme,
par rapport à la matière qui compofoit fon corps
dans l’ enfance, 8c ce qui fe compofe dans la*vieil-
lell'e, cette diverfité n’empêche pas que ce ne foit
toujours, le même corps. Limite 8c 1 identité du
corps ne fe tirent pas de l’unité 8c de l’identité des
parties qui le forment : elles, puifent leui* fotfrce,
leur fondement, leur origine dans l’unité & l’identité
d’ame. 50. Il établit que l’homme n’eft pas' ef-
prit feulement, mais un efprit joint à un corps. Ainfi
pour conftituer deux hommes, conclut-il, iLfaut
deux corps 8c deux âmes. Si plufieurs corps, ajoute
t-il , étoient animés par la même ame, ils ne fbr-
meroient pas plufieur-s hommes ; ils n’en compofe-
roient qu’un : 8c dès lors il eft clair que cet homme,
pourroit dans, le même tems, fans être reproduit, le
trouver en plufieurs lieux ; puifque les différens corps
qu’il avoit en différens pays Sc en différens lieux,
feroient unis à une même ame;.
Ces principes pôles y voici de quelle maniéré
M. Varignon entreprend de prouver la pofffbiîïté
de la prefence réelle , 8c d’éclaircir la nature de la
tranfjubftantiation. Dieu , dit-il, à la prononciation
des paroles de la confécration , imprime fur chaque'
partie fenfible de Fhoftie le mouvement qu’il finit
pour leur donner une nouvelle configuration propre
au corps humain ; 8c dans le moment même de la
formation de ces petits corps organifës , il joint à
chacun d’eux l’ame de lefus-Chrift : chaque particule
fenfible du pain fait un tout, dont Dieu, change
l’arrangement 8c l’ordre intérieur. De ce changement
qui fe fait dans chacune des parties fenfibles du
pain refultent des os , de la chair , des a itérés, des
veines 8c du fang qui forment un Corps organifé fem-
blable;au nôtre, 8c que l’ame de lefus-Chrift Vient
animer. Dans ce fyftème, chaque partie fenfible du
pain fait un fèul corps individuel, qui fe trouve le
même dans chaque étendue ienfible des particules
de matière qui étoient pain avant la confecration.
ces différentes particules de matière devenues le
corps de lefus-Chrift peuvent être divifées les unes
des autres , fans que Famé qui leur eft unie foufffe
pour ce la-aucune divifion. IL faut dire la même chofe
du corps humain, qui réfulte dé l’union de ces petites
particules de matière à une même ame. Ce corps
n’eft fujet à aucune féparation des parties. Les differentes
particules de pain qui deviennent intérieurement
le corps de lefus-Chrift par la prononciation
des paroles de la-confecration , çonfervent toujours
entr’ elles le même ordre fenfible, & le même arrangement
qu’elles avoient lorfqu elles etoient pain ;
il n’eft donc pas étonnant qu’ayant la meme fupeifi-;
c ie , elles continuent à exciter en nous les mêmes fen-
falions. - # . •
Ce fyftème eft fans doute ingénieux 8c loutenu
dans toutes fes parties. Mais il ne s’en écarte pas
moinsde lafoicatholique. Car i°.celle-ci appelle l eur
chariftie un myfiere impénétrable à la raifon. humaine,
8c M. Varignon ne laiffe dans l’euchariftie qu’uni pur
miracle , il en exclut le myftëre. i° . Elle enfeigne
que le corps de lefus-Chrift qui fe trouve dans 1 eu-
chariftie eft le même qui eft né d’une Vierge , qui
a ïouffert’, qui eft reffùfcité, & , félon M. Varignon,
le corps de Jefus-Chrift qui eft fur l’autel, eft forme,
dans l’inftant de la matière du pain 8c du vin. 3 . La
foi nous enfeigne que Jefus-Chrift n’a qu’un corps,
& M. Varignon donne à Jefus-Chrift autant de corps
organifés qu’il y a de parties fenfibles dans, le pauv
4°. M. Varignon prétend qu’il' n’y a que las parties
intérieures dit pain qui foient changées , 8c que les
parties fenfibles demeurent toujours les mêmes,
puifqu’elles gardent toujours entr’elles la même fitua-
tion Ô£ le même arrangement. Or cette partie feule
de fon fyftème eft directement oppofée à la tranf-
fubftanùation , q u i, dans le fens défini par le concile
de Trente, eft la converfion de toute la fubftance du
pain au corps de Jefus-Chrift, 8c de toute la fubftance
du vin en fon fang , c’eft à-dire de toutes les parties,
tant fenfibles qu’intérieures.
Il y a divers fyftèmes pour expliquer quelle eft
la nature des efpeces euehariftiques qui frappent
nos fens après la tranjjubflantiation , & pour fixer en
quoi elles confiftent. L’école en fournit trois, celui
des Péripatéticiens , celui du P. Maignan, religieux
minime , 8c celui de Rohault le cartéfien.
i°. Les Péripatéticiens foutiennent que les apparences
du pain 8c du vin font quelque chofe de réel
qui fubfifte hors de nous. Ils croient que ce font des
accidens abfolus , qui excitent fans aucun fujet d’inhéfion
; quelques-uns même d’entr’eux vont jufqu’à
dire qu’on ne peut nier l ’exiftence de ces accidens
fans blefler la foi.
On fent affez que ce fyftème choque les notions
les plus fimples reçues parmi les philofophes, fur l’ef-
fence de la matière 8c des accidens, perfonne n’ayant
jamais entendu par ce dernier terme que ce qui n’e-
xifte point de foi-même, 8c ce qui ne peut fubfifter
fans être inhérent à un autre objet. L’autorité de faint
Thomas 8c de quelques théologiens n’eft pas fuffi-
fante pour ériger cette opinion en dogme. Il eft également
libre ou de la foutenir ou de la rejetter.
20. Le pere Maignan prétend que lgs apparences
du pain -8c du vin ont pour fujet d’inhéfion le corps
même de Jefus-Chrift, ou qu’elles exiftent dans notre
ame : 8c voici comme il développe fon fyftème. On
do it, dit - i l , diftinguer dans les corps deux fortes
d’apparences. Il y en a qui appartiennent à la fubftance
corporelle, comme le mouvement, la figure,
la dureté, l’impénétrabilité ; 8c il y en a d’autres qui
ne lui appartiennent pas, comme la couleur , la faveur
, l’odeur. La première efpeçe d’apparence qui
appartenolt à la fubftance du pain , 8c qui l’affe&oit
avant la confécration, demeure fans le pain après la
confécration. Elles ont pour fujet d’inhéfion le corps
de Jefus-Chrift, elles réfident en lu i, 8c elles y font
attachées. Le corps de l’Homme-Dieu prend la place
du pain, 8c il eft revêtu de toutes les apparences qui
appartenoient à la fubftance du pain. Il eft fujet au
mouvement dont le pain étoit fufceptible, il a la
même figure, il peut être touché , il empêche le paf-
fage d’autres corps, 8c il réfifte à l’effort des impref-
fions corporelles. La fécondé efpeçe d’apparence qui
n’affe&oit pas la fubftance du pain avant la confécration
, demeure fans le pain après la confécrafion.
Elles n’exiftënt pas dans le corps de Jefus-Chrift,
elles n’exiftent que dans notre ame , & n’ont pas
d’autre fujet d’inhéfion. Dieu , dit cet auteur, peut
par lui-même 8c fans le fecours d’aucune caufe occasionnelle
rendre préfente à notre efprit la couleur 8c
la faveur du pain , 8c c ’eft ce qu’il opéré dans le fa-
crement de l’Euchariftie. Quoi qu’il n’y ait plus ni
pain, ni vin après la confécration , Dieu remue par
lui-même nos organes de la même maniéré que le
pain 8c le vin les remuoient avant qu’ils fiiftent consacres
: l’ébranlement du nerf optique produit en nous
la perception de la même couleur, 8c l’ébranlement
î-e ! °.rëane du goût produit également en nous la
leniation de la meme laveur. Dans le cours ordinaire
de la nature , on ne peut avoir préfentes aux yeux
les apparences du pain 8c du vin, fans qu’il y ait réellement
devant nos yeux du pain 8c du vin ; mais dans
1 ordre furnaturel, Dieu peut exciter en nous la per-
eeption des apparences du pain 8c du v in , quoiqu’il
Tome XVI,
n’y ait hors de nous ni pam ni vin ; & c’eft précifé-
ment en ce point que confifte le miracle du fatre-
ment de l’Euchariftie.
_ 3°- /d- Rohault établit les rnênjes principes que le
P. Maignan , pour expliquer quelle eft la nature des
accidens ou efpeces euehariftiques après la confécra-
Mmi If diftingue, comme lu i, deux fortes d’apparences
dans les corps : celles qui appartiennent a la
luhftance meme du corps, comme la figure, le mouvement
; & celles qui ne lui appartiennent5pas 6c
qut ne l’affeftent pas, comme la couleur, la faveur
l’odeur.,Les apparences.dé la première efpeçe, dit
M. Rohault, lubfiftént dans l’euchàriffie après la
confécration , & elles ont pour fujet d’inhéfion le
corps même des Jefus - Chrift , parce que le corps
de Jefus-Chrift a pris la place du pain. I f faut raifon-
ner tout autrement, ajoute-t-il, des apparences de
la fécondé efpeçe. Elles exiftent dans notre ame
quoiqu’il n’y ait plus ni pain ni vin , parce que Dieu
excite en nous, indépendamment de la fubftance du
pam & du vin , les mêmes imptefiions‘que le pain
^ 'i’n y excitoient avant qu’ils fuirent confâcrés.
La différence qu’il y a entré le fyftème du P. Mài-
gnan & celui de Rohaultfur ce point eft bien légère '
Le premier foutient qu’il y.ü un vrai miracle dans
la perception que l’on a des apparences du pain Sc
du vin , même après la confécration-, quoiqu’il n’y
aitplns alors ni pain ni vin ; & M .Rohaùlt lu c o n traire
prétend que cette perception eft une fuite na-
turelle.des loesSdu mouttement que Dieu'a'établie
Voici en abrégé la méthode qu’il foit pour expliquer
fa penfee. Toutes les fenfations que nous avons à
l’occàfion des corps, viennent de l’impielEon qu’ils
font.fur nos feus par leur fuperficie. C ’eft de là différence,
de leur fuperficie que naiffent les différentes
împreffions auxquelles nous femmes fujets , & c’eft
de ces differentes impreflions que proviennent nos
différentes fenfations. Tous les corps qui ont la même
fuperficie excitent en nous les mêmes impreflions ’
& dès lors les mêmes fenfations. Si le vin excite en
nous une fenfation que l’eau n’excite pas, c’eft qu’il
y a dans le vin un arrangement de-parties de matière
qui ne fe trouve pas dans l’eau , Sc qui agit différemment
iur nos organes. Tous les objets extérieurs n’a-
giffent fur nos fens que par impulfion Sc par frappement
, foit que cette impulfion & ce frappement
viennent des corps mêmes, comme dans le toucher
Sc dans le goût, foit qu’ils viennent par l’écoulement
de quelques corpufciïles, comme dans l’odorat, foit
qu’ils viennent par le mouvement de l’air, comme
l’ouïe , foit qu’ils viennent par l’agitation de la matière
fubtile , comme dans la vue. Ilne faut donc pas
•s’étonner, conclut M. Rohault, fi le pain & le vin
confâcrés excitent en nous les mêmes impreffions.
Quoique fubftantiellement Sc réellement changés au
corps Sc au fang de Jefus-Chrift, leur fuperficie refte
la même. Le corps de Jefus-Chrift en eft revêtu, &
tout corps qui a la meme fuperficie qu’un autre, doit
exciter naturellement les mêmes fenfations.
Ces deux fentimens qui font à-peu-près les mêmes
pour le fonds, ont cet avantage fur l’opinion des Pé-
ripateticiens, qu ils font appuyés fur des principes
foüdes & fur des notions communément reçues. On
peut donc les foutenir d’autant plus que l’Eglife s’eft
contentée de décider , qu’après la tranjfubfîantiation
les efpeces ou accidens du pain Sc du vin fubfiftent
fans rien définir fur la maniéré dont ils fubfiftent.
TRANSVERSAIRE , en Anatomie, nom de quelques
mufcles qui ont leurs attaches aux apophyfes
tranfverfes.
Le grand tranfverfaire du col monte du dos vers le
co l, s’infere fort fouvent par fix tendons aux fix apophyfes
tranfverfes des fix vertebres fupérieures du
dos, Sc fe termine aux extrémités des apophyfes
BBb b i j