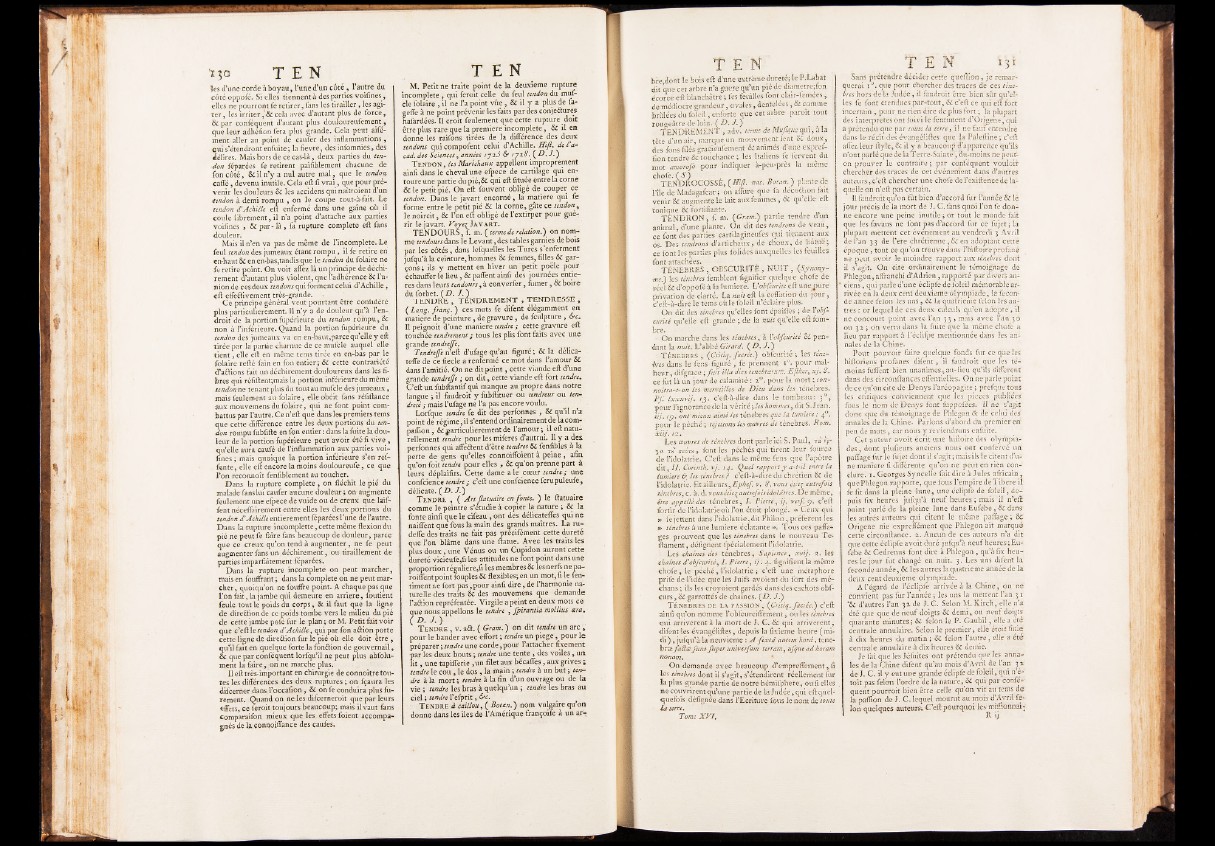
les d’une-corde à boyau, l’une d’un côte , l’autre du
côté oppofé. Si elles tiennent à des parties voifines,
elles ne pourront fe retirer, fans les tirailler, les agiter
, les irriter cela avec d’autant plus de force,
& par conféquent d’autant plus douloureufement,
que leur adhéfion fera plus grande. Cela peut aife-
ment-aller au point de caufer des inflammations ,
qui s’étendront enfuite ; la fievre, des infomnies, des
délires. Mais hors de ce cas*là, deux parties du ten-
-,don fépar.ées fe retirent paifiblement chacune de
fon côté, & il n’y a nul autre mal p que le tendon
caffé, devenu inutile. Cela eft fi v ra i, que pour prévenir
les douleurs 6c les accidens qui naîtroient d’un
tendon à demi rompu , on le coupe . tout-à-fait. Le
tendon d'Achille eft enfermé dans une gaine QÙ il
coule librement, il n’a point d’attache aux parties
voifines , & p a r - là , fa rupture complété eft fans
douleur.
Mais il n’en va pas de même de l’incomplete. Le
feul tendon des jumeaux étant rompu, il fe retire en
cn-haut & en en-bas,tandis que le tendon du folaire ne
fe retire point. On voit affez là un principe de déchirement
d’autant plus violent, que l’adhérence & l’union
de ces deux tendons qui forment celui d’Achille,
eft effeâivement très-grande. >
Ce principe général veut pourtant être confidéré
plus particulièrement. Il n’y a de douleur qu’à l’endroit
de la portion fupérieure du tendon rompu, &
non à l’inférieure. Quand la portion fupérieure du
tendon des jumeaux va en en-haut,parce qu’elle y eft
tirée par la partie charnue de ce mufcle auquel elle
t ien t , elle eft en même tems tirée en en-bas par, le
folaire refté fain en fon entier ; & cette contrariété
d’aftions fait un déchirement douloureux dans les fibres
qui réfiftent;mais la portion inférieure du même
tendon ne tenant plus du tout au mufcle des jumeaux,
mais feulement au folaire, elle obéit fans réfiftance
aux mouvemens du folaire, qui ne font point combattus
par l’autre. Ce n’eft que dans le« premiers tems
que cette différence entre les deux portions du tendon
rompu fubfifte en fon entier : dans la fuite la douleur
de la portion fupérieure peut avoir été fi vive ,
qu’elle aura caufé de l’inflammation aux parties voifines
; mais quoique la portion inférieure s’en ref-
fçnte, elle eft encore la moins douloureufe, ce que
l’on reconnoît fenfiblement au toucher.
Dans la rupture complété , on fléchit le pié du
malade fans lui caufer aucune douleur ; on augmente
feulement une efpece de vuide ou de creùx que laif-
fent néceffairement entre elles les deux portions du
tendon d'Achille entièrement féparéesl’une de l’autre.
Dans la rupture incomplette, cette même flexion du
pié ne peut fe faire fans beaucoup de douleur, parce
que ce creux qu’on tend à augmenter, ne fe peut
augmenter fans un déchirement, ou tiraillement de
parties imparfaitement féparées.
Dans la rupture incomplète on peut marcher,
mais en fouffrant ; dans la complété on ne peut marcher,
quoiqu’on ne fouffre point. Â chaque pas que
l ’on fait, la jambe qui demeure en arriéré, foutient
feule tout le poids du corps, & il faut que la ligne
de direction de ce poids tombe vers le milieu du pié
de cette jambe pofé fur le plan; or M. Petit fait voir
que c’eft le tendon d'Achille, qui par fon aéfion porte
cette ligne de direôion fiur.le pié où elle doit être ,
qu’il fait en quelque forte la fonôion de gouvernail,
& que par conféquent lorfqu’il ne peut plus abfolu-
ment la faire, on ne marche plus.
Il eft très-important en chirurgie de connoître toutes
les différences des deux ruptures ; on fçaura les
difeerner dans l’occafion, & on fe conduira plus fu-
rement. Quand on ne.les difeerneroit que par leurs
effets, ce fero.it toujours beaucoup; mais il vaut fans
comparaifori mieux que les effets foient accompagnés
de la.connoiffance des caufes.
M. Petit ne traite point de la deuxieme rupture
incomplète , qui feroit celle du feul tendon du mufcle
folaire, il ne l’a point v u e , & il y a plus de fa-
jefle à ne point prévenir les faits par des conje&ures
îafardées. Il croit feulement que cette rupture doit
être plus rare que la première incomplète, & il en
donne les raifons tirées de la différence des deux
tendons quicompofent celui d’Achille. Hifi. d e là-
cad. des Sciences, années ijo.5 & 1 7 2 8 ( D . J. )
T endon, les Maréchaux appellent improprement
ainfi dans le cheval une efpece de cartilage qui entoure
une partie du pié,& qui eft fituee entre la corne
& le petit pié. On eft fouvent obligé de couper ce
tendon. Dans le javart encorné, la matière qui fe
forme entre le petit pié 6c la corne, gâte ce tendon,
le noircit, 6c l’on eft obligé de l’extirper pour gué-,
rir le javart. Voye{ Ja v a r t .
TENDOURS, f. m. {termede relation.) on nomme
tendours dans le Levant, des tables garnies de bois
par les côtés, dans lefquelles les Turcs s’enferment
jufqu’à la ceinture, hommes 6c femmes, filles & garçons
; ils y mettent en hiver un petit poêle pour
échauffer le lieu, &paffent ainfi des journées entières
dans leurs tendours, à converfer, fumer, & boire
du forbet. (D . J.')
TENDRE , TENDREMENT , TENDRESSE ,
( Lang, franç. ) ces mots fe difent élégamment en
matière de peinture , de gravure , de fculpture , &c.
Il peignoit d’une maniéré tendre ; cettegravure eft
touchée tendrement ; tous les plis font faits avec une
grandt tendrejfe.
Tendrejfe n’eft d’ufage qu’au figuré ; & la délica-
teffe de ce fiecle a renfermé ce mot dans l’amour &
dans l’amitié. On ne dit point, cette viande eft d’une
grande tendrejfe ; on dit, cette viande eft fort tendre.
C’eft un fubftantif qui manque au propre dans notre
langue ; il faudroit y fubftituer ou tendreur ou tendreté
; mais l’ufage ne l’a pas encore voulu.
Lorfque tendre fe dit des perfonnes , & qu’il n’a
point de régime,il s’entend ordinairement de lacom-
paffion, 6c particulièrement de l’amour ; il eft naturellement
tendre pour les miferes d’autrui. Il y a des
perfonnes qui affettent d’être tendres & fenfibles/ à la
perte de gens qu’elles connoiffoient à peine, afin
qu’on foit tendre pour elles , 6c qu’on prenne part à
leurs déplaifirs. Cette dame a le coeur tendre ; une
confcience tendre ; c’eft une confcience fcrupuleufe,
délicate. J D . J.)
T endre , ( Art Jlatuaire en fonte. ) le ftatuaire
comme le peintre s’étudie à copier la nature ; & la
fonte âinfi que le cifeau, ont des délicateffes qui ne
naiffent que fous la main des grands maîtres. La ru-
deffe des traits ne fait pas precifément cette dureté
que l’on blâme dans une ftatue. Avec les traits les
plus doux, une Vénus ou un Cupidon auront cette
dureté vicieufe,fi les attitudes ne font point dans une
proportion régulière,fi les membres & les nerfs nepa-
roiffentpointfouples& flexibles; en un mot, fi le len-
timent ne fort pas ,pour ainfi d ire, de l’harmonie naturelle
des traits 6c des mouvemens que demande
l’aftion repréfentée. Virgile a peint en deux mots ce
que nous appelions le tendre , fpirantia mollius ara.
m SÊ m
T endre , v. a â . ( Gram. ) on dit tendre un arc
pour le bander avec effort ; tendre un p iege, pour le
préparer ; tendre une corde, pour l’attacher fixement
par les deux bouts.; tendre une tente , des voiles, un
l i t , une tapifferie ,un filet aux bécaffes, aux grives ;
tendre le cou , le dos , la main ; tendre à un but ; tendre
à la mort ; tendre à la fin d’un ouvrage ou de la
vie ; tendre les bras à quelqu’un ; tendre les bras au
ciel ; tendre l’efprit, &c.
T endre à caillou, ( Botan. ) nom vulgaire qu’on
donne dans les îles de l’Amérique françoife à un arb're
dont le bois eft d’une extrême dureté; le P.Labât
dit que cer arbre n’a gùere qu’un pié de diametre;fon
écorce eft blanchâtre ; lès feuilles font clair-femees,
de médiocre grandeur, ovales, dentelees, 6c comme
brfiléeS du foleil, enforte que cet arbre paroît tout
rougeâtre de loin- ( D . J. )
TENDREMENT , adv. terme de Mujiqus qui, a la
tête d’un air-, marque un mouvement lent 6c doux,
des fons filés gracieufement & -animés d’une expref-
ïion tendre & touchante ; les Italiens fe fervent du
mot amorofo pour indiquer à-peu-près la même
chofe: ( •£']) , . ,
TENDROCOSSÉ, ( Hift. nat. Botan. ) plante dé
pile de Madagafcar ; on afliire que fa déco&ion fait
venir & augmente le lait aux femmes, 6c qu’elle eft
tonique &C fortifiante. #
TENDRON , f. m. (Gram.) pàrtie tendre dun
animal, d’une plante. On dit des tendrons de veau,
ce font des parties cartilagineufes qui tiennent aux
os. Des tendrons d’artichaux, de choux, de laitue;
ce font les parties plus folides auxquelles les feuilles
font attachées. - •
TENEBRES , OBSCURITE , NUIT , (Synonyme.)
les ténèbres femblent lignifier quelque chofe de
réel & d ’oppofé à la lumière. Uobfcurite eft une pure
privation de clarté. La nuit eft la ceflation du jour,
c ’eft-à-dirè le tems où le foleil n’éclaire plus.
On dit des ténèbres qu’elles font épaifles ; de T obf-
curité qu’elle eft grande ; de la nuit qu’elle eft fom-
bre. H
- On marché dans les ténèbres, à V obfcùrité 6c pendant
la nuit. L’ abbé Girard. ( D . J .)
TÉNÈBRES , (Critiq. facrée.) obfcùrité; les ténèbres
dans le feus figuré, fe prennent i°. pour malheur,
difarace ; fuit ilia dits tentbrarum. Eflher, xj. 8.
ce fut là lin jour de calamité : z°. pour la mort ; con-
noîtra-t-on les merveilles de Dieu dans les tenébres.
Pf. Ixxxvij. 13. c’eft-à-dire dans le tombeau : 30,
pour l’ignorance de la vérité ; les hommes, dit S. Jean.
iij. i C) .1: ont'mieux aimé les ténèbres que la lumière : 40.
pour le péché; rejet tons les oeuvres de ténèbres. Rom.
■xiij. 12. ...; ' ' -, ' _ . '
Les oeuvres de ténèbres dont parle ici S. Paul, ta'éj>-
ya. t« gv.otu , font les péchés qui tirent leur fource
de l’idolâtrie. C’eft dans le même fens que l’apôtre
dit, II. Corinth. vj. 14. Quel rapport y a-t-il entre la
lumière & les ténèbres ? c’eft-à-dire du chrétien & de
l’idolâtrie. Et ailleurs,Ephef. v. 8. vous étie^ autrefois
ténèbres, c. à. d. vousétie^autrefoisidolâtres. De meme,
■ être appêllédes ténèbres, I. Pierre, ij. verf. e>. c’eft
fortir de l’idolâtrie où l’on étoit plongé. « Ceux qui
»> fe jettent dans l’idolâtrie,dit Philon, préfèrent les
» ténèbres à une lumière éclatante ». Tous ces pafla-
ges prouvent que les ténèbres dans le nouveau Te-
iftament, défignent fpécialement l’idolâtrie.
■ Les chaînes des ténèbres, Sapience, xvij. 2. les
chaînes d'obfcùrité, ï . Pierre, i j . 4. lignifient la même
chofe, le péché, l’idolâtrie ; c’ eft une métaphore
prife de l’idée que les Juifs avoient du fort des médians
; ils lès croyoient gardés dans des cachots obf-
curs, & garrottés de chaînes. (D . J.)
T énèbres de la pas s io n , (Critiq. fâcrée.) c’ eft
âinfi qu’on nômme robfcureiliement, ou les ténèbres
qui arrivèrent à la mort de f l C . & qui arrivèrent,
difent les évangéliftes, depuis la fîxieme heure (midi)
, jufqu’à la neuvième : A fextâ auttm horâ, tene-
bræ facta funt fuper univerfam terram, ufque adhoram
nonam.
On demande avec beaucoup d’emprefiement, fi
les ténèbres dont il s’agit, s’étendirent réellement fur
la plus grande partie de notre hémifphere, ou fi elles
ne couvrirent qii’une partie de la Judée, qui eft quelquefois
défignee dans l’Ecriture fous le nom de toute
la terre.
Tome X V f
Sans prétendre décider cette queftion, je remarquerai
i° . que pour chercher des traces de ces ténèbres
hors de la Judée, il faudroit être bien sûr qu’elles
fe font étendues par-tout , & c’eft ce qui eft fort
incertain , pour ne rien dire de plus fort ; la plupart
des interprètes ont fuivi le fentiment d’Origene, qui
a prétendu que par toute La terre, il ne faut entendrè
dans le récit des évangéliftes que la Paieftine ; c’eft
alfez lëitr ftyle, & il y a beaucoup d’apparence qu’ils
n’ont parlé que de la Terre-Sainte7, âu-moins ne peuf-
on prouver le contraire ; par conféquent vouloir
chercher des traces de cet événement dans d’autres
auteurs, c’eft chercher une chofe de l’exiftence de laquelle
on n’eft pas certain.
Il faudroit qu’on fût bien d’accord fur l’année & l è
jour précis de la mort de J. C. fans quoi l’on fe donne
encore une peine inutile ; or tout le monde fait
que les favans né font pas d’accord fur ce fujet ; la
plupart mettent cet événement au vendredi 3 Avril
de l’an 3 3 de l’ere chrétienne, 6c en adoptant cetté
époque, tout ce qu’on trouve dans l’hiftoire profané
ne peut avoir le moindre rapport aux ténèbres dont
il s’agit. On cite ordinairement le témoignage de
Phlëgon,affranchi d’Adrien, rapporté par diver$ an-
1 ciens, qui parle d’une éeîipfe de foleil mémorable arrivée
en la deux cent deuxieme olympiade, la fécondé
année felon; les uns, 6c la quatrième félon les autres
: or lequel de ces deux calculs qu’on adopte, il
ne concourt point avec l’an 33 , mais avec l’an 36
ou 31 ; on verra dans la fuite que la même chofe a
lieu par rapport à l ’éclifpe mentionnée dans les ani
nales de la Chine.
Pour pouvoir faire quelque fonds fur ce que leS
hiftoriens profanes difent, il faudroit que les témoins
fuffent bien unanimes, au-lieu qu’ils différent
dans des circonftances eflentielles. On ne parle point
de ce qu’on cite de Denys l’aféopagite ; prefque tous
les critiques'conviennent que les pièces publiées
fous le nom de Denys font fuppofées. If né s’agit
donc que du témoignage de Phlegon & de celui des1
annales de la Chine. Parlons d’abord du premier en
peu de mcits, car nous y reviendrons enfuite.
Cet auteur avoit écrit une hiftoire des olympiades
, dont piufieurs anciens nous ont confervé un
paffage fur le fujet dont il s’agit ; mais ils le citent d’une.
maniéré fi différente qu’on ne peut en rien conclure!
1. Georges Syncelle fait dire à Jules africain ,
I que Phlegon rapporte, que fous l’empire de Tibere il
fe fit dans la pleine lune, une écliple de foleil, depuis
fix heures jufqu’à neuf heures ; mais il n’eft
point parlé de la pleine lune dans Eufebè, 6c dans
les autres auteurs qui citent le même paffage ; 6c
Origene nie expreffément que Phlegon ait marqué
cette circonftance. z. Aucun de ces auteurs n’a dit
que cette éclipfe avoit duré jufqu’à neuf heures ;Eu-
febe 6c Cedrenus font dire à Phlegon, qu’à fix heures
le jour fut changé en nuit. 3 . Les uns difent là
fécondé année, & les autres la quatrième année de là
deux cent deuxième olympiade.
A l’égard de l’éclipfe arrivée à la Chine, on'né
convient pas fur l’année ; les uns la mettent Fan 3 i
'6c d’autres Fan 32 de J. Ç. Selon M. K irch, elle n’a
été que que de neuf doigts 6c demi , ou neuf doigts
quarante minutes ; 6c félon le P. Gairbil, elle a été
centrale annulaire. Selon le premier,.elle étoit finie
à dix heures du matin ; 6c félon l’autre , elle a ete
centrale annulaire à dix heures & demie.
Je fai que les Jéfuites ont prétendu que les annales
de la Chine difent qu’au mois d’Avril de l’an 3 2
dé J. C. il y eut une grande éclipfe de foleil, qui n’e-
toit pas félon l’ordre de la nature, 6c qui par confe--
quent pourroit bien être celle qu’on v it au tems dé
la paflîon de J. C. lequel mourut au mois d’Avril- félon
quel ques auteurs; C’eft pourquoi les’ miff onnai