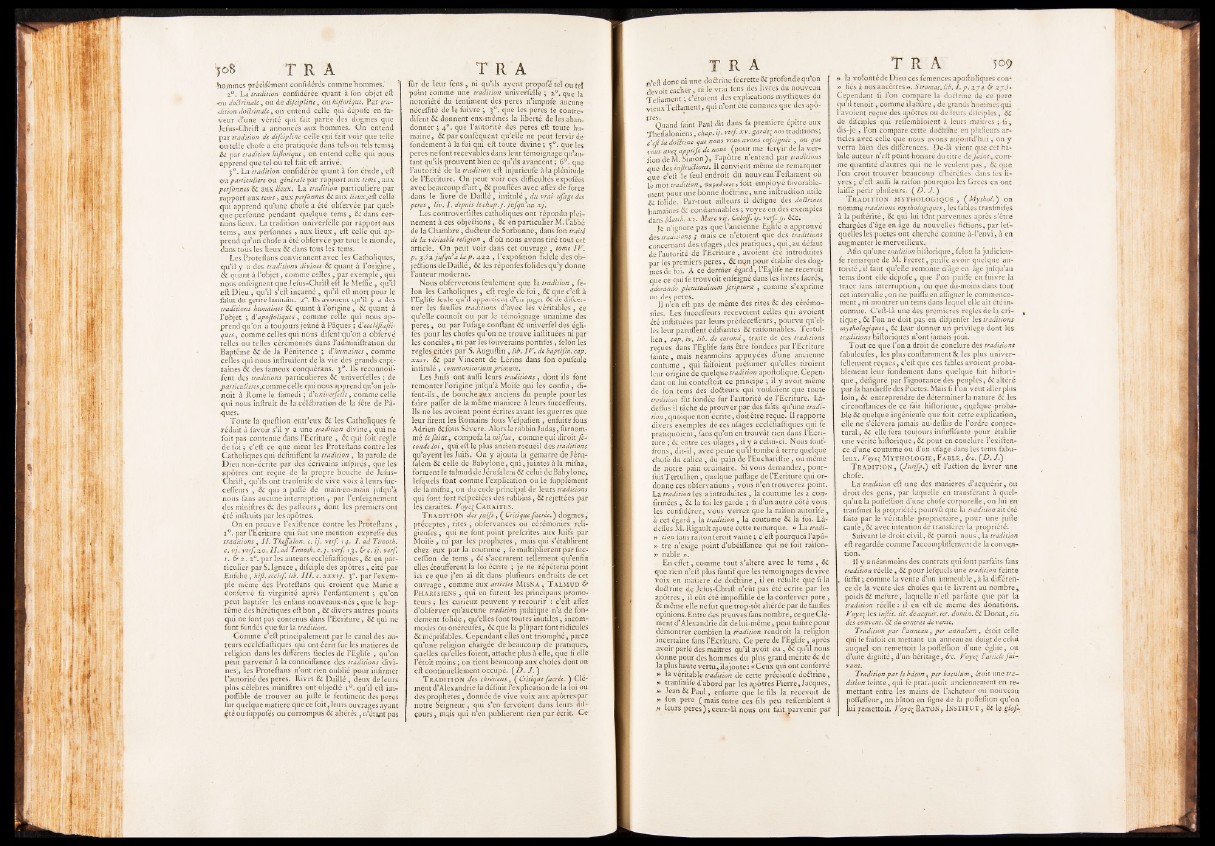
hommes précifément confidérés comme TiômnïéS.'
2°. La tradition confidérée quant à fon objet eft
•ou doctrinale, ou dedi/cipline, ou hifiorique. Par ■ tradition
doctrinale, on -entend celle qui dépofe en fa- ■
veur, d’une vérité qui fait parue des dogmes què
Jefus-Chrift a annoncés aux hommes. On entend
par tradition de difcipline -celle qui fait voir que telle '
ou telle chofe a été pratiquée dans tels ou tels terns;
& par tradition hifiorique, on entend celle qui nous ;
apprend que tel ou tel fait-elt arrivé.
30. La tradition confidérée quant à fon étude , eft
ou particulière ou generale par rapport aux tems, aux
personnes &C aux lieux. La tradition particulière par
rapport aux unis, znxperfonnes Sz aux lieux,eû. celle
qui apprend qu’une Chofe a été obfervée par quel«-.
que perfonne pendant quelque tems, &c dans certains
lieux. La tradition universelle par rapport aux
tems, aux perfonnes , aux lieu x, eft Celle qui apprend
qu’un chofe a été obfervée par tout le monde,
dans tous les lieux & dans tous les tems.
Les Proteftans conviennent avec les Catholiques,
qu’il y a des traditions divines & quant à l’origine,
oc quant à l’objet, comme celles , par exemple, qui
nous enfeignent que Jefus-Chrift eft le Meffie , qu’il
eft Dieu , qu’il s’eft incarné , qu’il eft mort pour le
falut du genre humain. 2°. Ils avouent qu’il y a des
traditions humaines ÔC quant à l’origine , &C quant à
l’objet ; lYapoßoliques, comme celle qui nous apprend
qu’on a toujours jeûné à Pâques ; d’eccléfiafiir
ques, comme celles qui nous difent qu’on a obfervé
telles ou telles cérémonies dans l’adminiftration du
Baptême & de la Pénitence ; d’humaines , comme
celles qui nous inftruifent de la vie des grands -capitaines
& des fameux conquérans. 3.®. Ils reconnoif-
fent des traditions particulières & univerfelles ; de
particulières,comme celle qui nous apprend qu’on jeu-
noit à Rome le famedi ; d’univeifelle, comme celle
qui nous inftruit de la célébration de la fête de Pâques.
Toute la queftion .entr’eux & les Catholiques fe
réduit à favoir s’il y a une tradition divine, qui ne
foit pas contenue dans l’Ecriture , & qui foit regle
de foi ; c’eft ce que nient les Proteftans contre les
Catholiques qui définiffent la tradition , la parole de
Dieu non-écrite par des écrivains infpirés, que les
apôtres ont reçue de la propre bouche de Jefus-
Chrift, qu’ils ont tranfmife de vive voix à leurs fuc-
cefleurs , & qui a paffé de main-en-main jufqu’à
nous fans aucune interruption, par l’enfeignement
des miniftres & des pafteurs, dont les premiers ont
été inftruits par les apôtres.
On en prouve l’exiftence contre les Proteftans ,
i° . par l’Ecriture qui fait une mention expreffe des
traditions , II. Thefalon. c. ij. verf. 14. I. ad Tirnoth.
c. vj. verf. 20. II. ad Tirnoth. c .j. verf. 13. & c. ij. verf.
1. & 2. 2°. par les auteurs eccléfiaftiques, & en particulier
par S. Ignace, difciple des apôtres, cité par
Eufebe, hiß. ecclef. lib. III. c. xxxvj. 30. par l’exemple
même des Proteftans qui croient que Marie a
.confervé fa virginité après l’enfantement ; qu’on
peut baptifer les enfans nouveaux-nés ; que le baptême
des hérétiques eft bon, & divers autres points
qui ne font pas contenus dans l’Ecriture, ÖC qui ne
font fondés que fur la tradition.
Comme c’eft principalement par le canal des auteurs
eccléfiaftiques qui ont écrit fur les matières de
religion dans les différens fiecles de l’Eglife , qu’on
peut parvenir à la connoiffance des traditions divines],•
les Proteftans n’ont rien oublié pour infirmer
l ’autorité des peres. Rivet & Daillé , deux de leurs
plus -célébrés miniftres ont objeâé i ° . qu’il eft im-
poffible de trouver au jufte le fentiment des peres
fur quelque matière que ce foit, leurs ouvrages ayant
f té oufiippofés ou corrompus & altérés, n’étant pas
ïûr de leur ferts , ni qu’ils ayent propôfé tel Ou tel
point comine une tradition univerfelle ; 20. que la
notoriété du fentiment des peres n’impofe aucune
néceffité de le fuivre ; 30. que les peres fe contre-
difent & donnent eux-mêmes la liberté de les abandonner
; 40. que l’autorité des peres eft toute humaine
, & par conféquent qu’elle ne peut fervir de
fondement à la foi qui eft toute divine ; 50. que les
peres ne font recevables dans leur témoignage qu’au-
tant qu’ils prouvent bien ce qu’ ils avancent ; 6°. que
l’autorité de la tradition eft injurieufe à-la plénitude
de l’Ecriture. On peut voir ces difficultés expofées
avec beaucoup d’art, & pouffées avec affez de force
. dans le livre de Daillé, intitulé, du vrai' ufage des
peres, liv. I. depuis leckap.j. jufqu'au xj.
Les controverfiftes catholiques ont répondu pleinement
â ces objeûions, & en particulier M. l’abbé
de la Chambre, do&eur dé Sorbonne, dans fon traité
de la véritable religion , d’où nous avons tiré tout cet
article. On peut voir dans cet ouvrage , tome IV.
p. 362 jufqu’à lap. 422 , l ’expofition fidele des objections
de Daillé, & les réponfes folides qu’y donne
l’auteur moderne.
Nous obferverons feulement que la tradition , félon
les Catholiques , eft réglé de foi que c’ eft à
l’Eglife feule qu’il appartient d’en juger & de difeer-
ner les fauflès traditions d’avec les véritables, ce
qu’elle connoît ou par le témoignage unanime des
peres, ou par l’ufage confiant & univerfel des égli-
fes pour les chofes qu’on ne trouve inftituées ni par
les conciles, ni par les fouverains pontifes, félon les
regles.çitées par S. Auguftin , lib. IV. de baptifm. cap.
xxiv. & par Vincent de Lérins dans fort opufcule
intitulé , commonitorium primum.
Les Juifs ont auffi leurs traditions, dont ils font
remonter l’origine jufqu’à Moïfe qui les confia , di-
fent-ils, de bouche aux anciens au peuple pour les
faire paffer de la même maniéré à leurs fucceffeurs.
Ils ne les avoient point écrites avant les guerres que
leur firent les Romains fous Vefpafien, enfuite fous
Adrien &fous$évere. Alors le rabbin Judas, furnom-
mé le faint, compofa la mifna, comme qui diroit fécondé
lo i, qui eft le plus ancien recueil des traditions
qu’ayent les Juifs. On y ajouta la gemarre de Jéru-
falem & celle de Babyîone, q ui, jointes à la mifna,
forment le talmud de Jérufalem & celui de Babyîone,
lefquels font comme l’explication ou le fupplément.
de la mifna, ou du code principal de leurs traditions
qui font fort refpeâées des rabbins, &rejettées par
lescaraïtes. Voye^ Caraïtes.
T radition des ju ifs , ( Critique facrée.) dogmes,'
préceptes, rites , obfervances ou cérémonies reli-
gieufes , qui ne font point preferites aux Juifs par
Moïfe , ni par les prophètes , mais qui s’établirent
chez eux par la coutume , fe multiplièrent par fuc-
ceffion de. tems , & s’accrurent tellement qu’enfm
elles étouffèrent la loi écrite ; je ne répéterai point
ici ce que j’ en ai dit dans plufieurs endroits de cet
ouvrage , comme aux articles Misna , T almud &
Pharisiens , qui en furent les principaux promo-
| teurs ; les curieux, peuvent y recourir : c’eft affez
d’obferver qu’aucune tradition judaïque n’a de fondement
folide, qu’elles font toutes inutiles, incommodes
ou onéreufes, & que la plupart font ridicules
& méprifables. Cependant elles ont triomphé, parce
qu’une religion chargée de beaucoup de pratiques,
quelles qu’elles foient, attache plus à elle, que fi elle
l’étoit moins ; on tient beaucoup aux chofes dont on
eft continuellement occupé. (Z>. J.')
T radition des chrétiens, ( Critique faqrée. ) Clément
d’Alexandrie la définit l’explication de la loi ou
des prophètes, donnée de vive voix aux apôtres par
notre Seigneur, qui s’en fervoient dans leurs dif-
çours, nuis qui n’en publièrent rien par écrit, Ce--
„>eft donc ni une doarine fecrette & profonde quîon
devoit cacher, ni le vrai fens des.livres du nouveau
Teftament ; c’étoient des explications myftiques du
vieux Teftament, qui n’ont é t i connues que des apôtrès.
.. . r ■ ■
Quand faint Paul dit dans fa première epitre aux
Theffaloniens, chap. ij. verf. xy. garde{ nos traditions;
c'eft. la doctrine que nous vous avons enfeignée , ou que
vous avei apprife de nous (pour me feryir de la ver-
fion de M. Simon), l’apôtre n’entend par traditions
que des infractions. Il convient même de remarquer
que c’eft le feul endroit du nouveau Teftament où
le mot tradition, Tra.fctS'èaiç, foit employé favorablement
pour une bonne do&rine, une inftrucHon utile
& folide. Par-tout ailleurs il défigne des doctrines
humaines & condamnables ; voyez-en des exemples
dans Matth. xv. Marc vij. Colof. ij. verfe,. &c.
Je n’ignore pas que l’ancienne Eglife a approuvé
des traditions ; mais ce n’étoient que des traditions
concernant des ufages, des pratiques, qui, au défaut
de l’autorité de l’Ecriture, avoient été introduites
par les premiers peres, & non pour établir des dogmes
de foi. A ce dernier égard, l’Eglife ne recevoit
que ce qui fe trouvoit enfeigné dans les livres-facrés,
adorando plenitudinem feriptura , comme s’exprime
un des peres.
Il n’en eft pas de même des rites & des cérémonies.
Les fucceffeurs recevoient celles qui avoient
été inftituées par leurs prédéceffeurs, pourvu qu’elles
leur paruffent édifiantes 6c raifonnables. Tertul-, :
lien, cap. iv. lib. de corond, traite de ces traditions
reçues dans FEglife fans être fondées par l’Ecriture
fainte, mais néanmoins appuyées d’une ancienne
coutume , qui faifoient préfumer qu’ elles tiroient
leur origine de quelque tradition apoftolique. Cepen- .
dant on lui conteftoit ce principe ; il y avoit même
de fon tems des dofteurs qui vouloient que toute
tradition fut fondée fur l’autorité de l’Ecriture. Là-
deflùs il tâche de prouver par des, faits qu’une tradi- .
tion, quoique non-écrite, doit être reçue. Il rapporte
divers exemples de ces ufàges eccléfiaftiques qui fe
pratiquoient, fans qu’on en trouvât rien dans l’Ecriture
; & entre ces ufages, il y a celui-ci. Nous fouf-
frons, dit-il, avec peine qu’il tombe à terre quelque
chofe du calice , du pain de l’Euchariftie, ou même
de notre pain ordinaire. Si vous demandez, pour-
fuitTertullien, quelque paffage de l’Ecriture qui ordonne
ces obfervations, vous n’en trouverez point.
La tradition les a introduites , la coutume les a confirmées
, & la foi les garde ; fi d’un autre .côté voust
les confidérez, vous verrez que la raifon autorife,
à cet égard , -la tradition , la coutume 6c la foi. Là-
deflus M. Rigault ajoute cette remarque. « La tradi-
» tion fans raifon feroit vaine ; c’eft pourquoi l’apô-
». tre n’exige point d’obéiffance qui ne foit raifon-
» nable ».
En effet, comme tout s’altéré avec le tems , &
que rien n’ eft plus fautif que les témoignages de vive
.voix en matière de doctrine , il en refulte que fi la
doârine de Jefus-Chrift n’eût pas été écrite par les
apôtres, il eût été impoffible de la conferver pure,
& même elle ne fut que trop-tôt altérée par de fauffes
opinions. Entre des preuves fans nombre, ce que Clément
d’Alexandrie dit de lui-même, peutfuffire pour
démontrer combien la tradition rendroit la religion
incertaine fans l’Ecriture. Ce pere de l’Eglife, après
avoir parlé des maîtres qu’il avoit eu , & qu’il nous
donne pour des hommes du plus grand mérite & de
la plus haute vertu, il a joute : «Ceux qui ont confervé
» la véritable tradition de cette précieufe doririne,
» tranfmife d’abord par les apôtres Pierre, Jacques,
» Jean & Paul, enforte que le fils la recevoit de
» fon pere ( mais entre ces fils peu reffemblent à
» leurs peres ) ; ceux-là nous ont fait parvenir par
» la volonté de Dieu ces femences apoftoliques con-
» fiés, à nos ancêtres ». Stromat. lib. I. p. 274 & 27 J .
Cependant fi l’on compare la dodrine de ce pere
qu’il tenoit, comme il allure , de grands hommes qui
l avoient reçue des apôtres ou de leurs difciples, &
de difciples qui reffembloient à leurs maîtres ; fi ,
dis-je ,■ l’on compare cette dodrihe en plufieurs articles
avec celle que nous avons aujourd’h u i, on y
verra bien des différences. De-là vient que cet habile
auteur n’eft point-honoré du titre àz faint, comme
quantité d’autres qui ne le veulent pas, & que
l’on croit trouver beaucoup d’héréfies dans fes livres
; c’eft auffi la raifon pourquoi les Grecs en ont
laiffé périr plufieurs. ( D. J. )
T r ad ition m y th o lo g iq u e , ( Myihol.) on
nomme traditions mythologiques, les fables tranfmifes
à la poftérité, & qui lui fijnt parvenues après s’être
chargées d’âge en âge de nouvelles fiftions, par lesquelles
les poetes ont cherché comme à-l’envi, à en
augmenter le merveilleux.
Afin qu’une tradition hiftorique, félon la judicieu-
fe remarque de M. Freret, puiffe avoir quelque aq*.
torité, il faut qu’elle remonte d’âge en âge jufqu’au
tems dont elle dépofe, que l’on puiffe en fuivre la
trace fans interruption, ou que du-moins dans tout
cet intervalle, on ne puiffe en affigner le commencement,
ni montrer un tems dans lequel elle ait été inconnue.
C’eft-là une des premières réglés de la critique
, & l’on ne doit pas en difpenfer les traditions
mythologiques, & leur donner un privilège dont les
traditions hiftoriques n’ont jamais joui.
Tout ce que l’on a droit de conclure des traditions
fabuleufes, les plus conftamment& les. plus univer-
fellement reçues, c’eft que ces fables avoient probablement
leur fondement dans quelque fait hiftorique
, défiguré par l’ignorance des peuples, & altéré
par la hardieffe des Poètes. Mais fi l’on veut aller plus
loin, & entreprendre de déterminer la nature & les
circonftances de ce fait hiftorique, quelque probable
& quelque ingénieufe que foit cette explication,
elle ne s’élèvera jamais au-defîus de l’ordre conjectural
, & elle fera toujours infuffifante pour établir
une vérité hiftorique, & pour en conclure l’exiftence
d’une coutume ou d’un ufage dans les tems fabuleux.
Voyei My th o lo g ie , Fa b l e , &c. (Z>. /.)
T ra d it io n , (Jurifp.) eft l ’ariion de livrer une
chofe.
La tradition eft une des maniérés d’acquérir, ou
droit des gens, par laquelle en transférant à quelqu’un
la poffeffion d’une chofe corporelle, on lui en
tranfmet la propriété; pourvû que la tradition ait été
faite par le véritable propriétaire, pour une jufte
caufe, & avec intention de transférer la propriété.
Suivant le droit c ivil, & parmi nous, la tradition
eft regardée comme l’accompliffement de la convention.
Il y a néanmoins des contrats qui font parfaits fans
tradition réelle, & pour lefquels une tradition feinte
. fuffit ; comme la vente d’un immeuble, à la différence
de la vente des chofes qui fe livrent au nombre,
poids & mefure, laquelle n’ eft parfaite que par la
tradition réelle : il en eft de meme des donations.
Voye^ les in f it. lit. de acquir.rer. domin. & Donat, lit.
des convent. & du contrat de vente.
Tradition par C anneau, per annulum , étoit celle
qui fe faifoit en mettant un anneau au doigt de celui
auquel on remettoit la poffeffion d’une eglife, ou
d’une dignité, d’un héritage, &c. Voyeç l’article fui-
vaut.
Tradition par le bâton, per baculum, étoit une tradition
feinte, qui fe pratlquoit anciennement en re-
] mettant entre les mains de l’acheteur ou nouveau
poffeffeur, un bâton en figne de la poffeffion qu’on
lui remettoit. Voye^ Bâ to n, Institut , U le glof