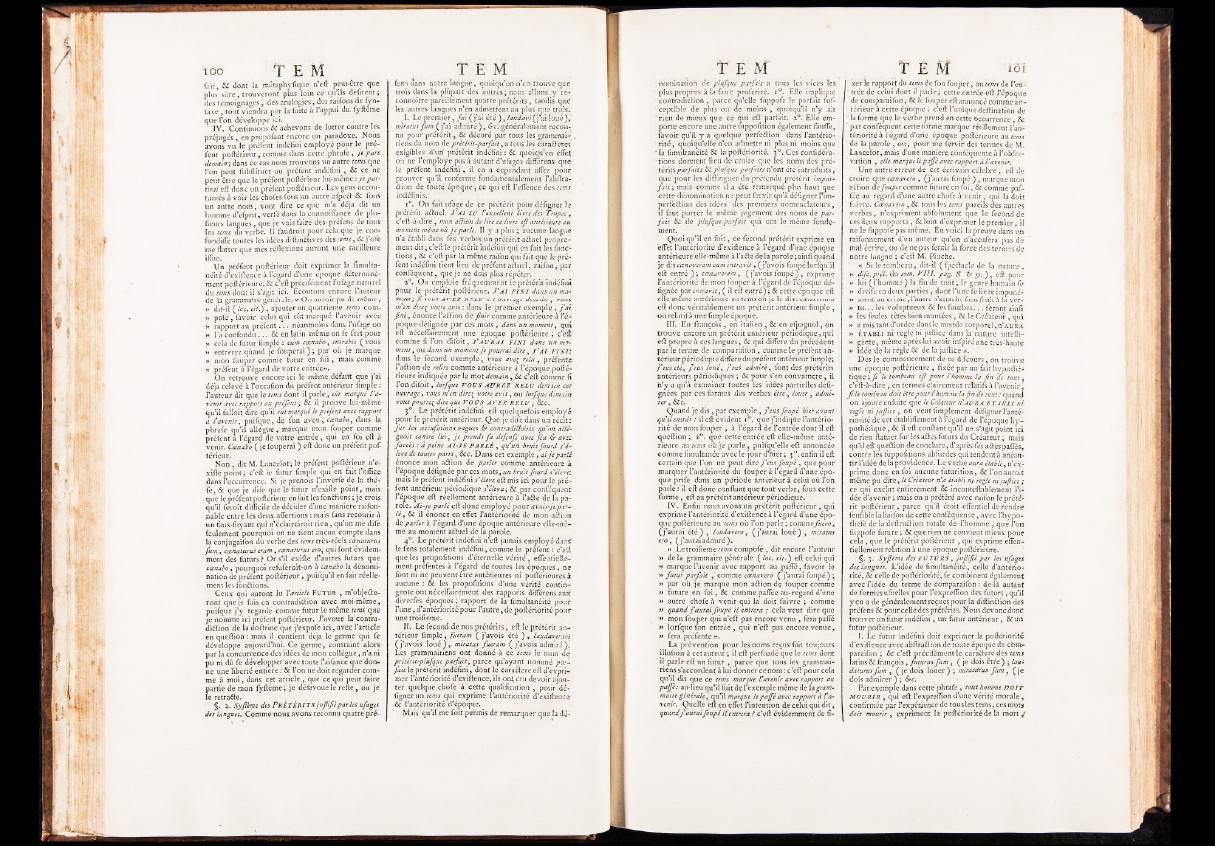
fait, & dont la métaphyfique n’eft peutjêtre que
plus sure, trouveront plus loin ce qu’ils défirent ;
des témoignages, des analogies, des raifons de fyn-
taxe , tout viendra par la fuite à l’appiii du fyfteme
que l’on développe ici.
IV. Continuons & achevons de lutter contfe les
préjugés j en propofant encore un paradoxe. Nous
avons vu le préfent indéfini employé pour le pre-
fent poftérieur, comme dans cette phrafe, je pars
\demain; dans ce cas nous trouvons un autre tems que
l’on peut fübftituer au préferit indéfini , & ce ne
peut être que le préfent' poftérieur lui-même : je partirai
eft donc un préfent poftérieur. Les gens accoutumés
à voir les chofes fous un autre afpeâ & fous
un autre nom * vont dire ce que m’a déjà dit un
homme d’efprit, verfé dans la connoifVaiice de plu-
iieurs langues , que je vais faire des prelens de tous
les tems du verbe. 11 faudroit pour cela que' je con-
fondiffe toutes les idées diftinâives des tems, & j’ofe
me flatter que mes réflexions auront une meilleure
ifliie. .
Un préfent poftérieur doit exprimer la fimultà-
néité d’exiftence à l’égard d’une époque déterminé-
ment poftérieure; & c’eft précifément l’ufage naturel
du tems dont il s’agit ici. Ecoutons encore l’auteur
de la grammaire générale. « On auroit pu de meme,
» dit-il ( loc. cit.) , ajouter un quatrième ums com-
» pofé, favoir celui qui eût marqué l’avenir avec
» rapport au préfent. . . néanmoins dans Fufa'ge on
» l’a confondu . . . & en latin même on fe fért pour
» cela- de futur fimple : cum ccenabo, intrabis (vous
» entrerez quand je fouperai ) ; par où je marque
» mon fouper comme futur en fo i, mais comme
» préfent à l’égard de votre entrée».
On retrouve encore ici le même défaut qtié j’ai
déjà relevé à i’occafion du préfent antérieur fimple :
l’auteur dit que le tems dont il parle, eut marque l a-
venir avec rapport au préfent j & il prouve lui-même
qu’il falloit dire qu’il eût marqué le préfent avec rapport
à Ûavenir, puifque, de fan aveu, ccenabo, dans la
phrafe qu’il allégué, marque mon fouper comme
préfent" à l’égard de votre entrée,. qui en foi eft à
venir. Ccenabo ( je fouperai ) eft donc un préfent poftérieur.
N o n , dit M. Lancelot; le préfent poftérieur n’e--
xifté point ; c’eft le futur fimple qui en fait l’office
dans Foccurrence. Si je prenois I’inverfe de la thé-
fe, & que je difè que le futur n’exifte point, mais
que le préfent poftérieur en fait les fondions ; je crois
qu’il feroit difficile de décider d’une maniéré raifon-
nable entre les deux affertions : mais fans recourir à
un faux-fuyant qui n’éclairciroit rien , qu’on me dife
feulement pourquoi on ne tient aucun compte dans
la conjugaifon du verbe des. ums très-réels, ccenaturus
fum, ccenaturus cram, ccenaturus ero, qui font évidemment
des futurs? Or.s’il exifte d’autres futurs que
ccenabo, pourquoi refuferoit-on à ccenabo la dénomination
de préfent poftérieur, puifqu’il en fait réellement
les fondions.
Ceux qui auront lu l’article Futur , m’objéde-
ront que je fuis en contradidion avec moi-même,
puifque j’y regarde comme futur le même tems que
je nomme ici préfent poftérieur. J’avoue la contradidion
de la dodrine que j’expofe ici, avec l’article
en queftion : mais il contient déjà le germe qui fe
développe aujourd’hui. Ce germe, contraint alors
par la concurrence des idées de mon collègue, n’a ni
pu ni dû fe développer avec toute l’aifance que donne
une liberté entière : & l’on ne doit regarder comme
à moi, dans cet article , que ce qui peut faire
partie de mon fyftème ; je défavoue le relie, ou je
le retrade.
• §. i. Syfilme des PRETERITS juflifié par les ufages
des langues. Comme nous avons reconnu quatre préfens
dans noire langue, quoiqu’on n’ én trouve que
trois dans la plûpart des autres; nous'allons y re-
connoître pareillement quatre prétérits , tandis que
les autres langues n’en admettent au plus 'que trois'.
I. Le premier, fui ( j ’ai été-), laüdâvïQ'rii loué),"
mirants fum ( j ’ai admiré), &c'. généralement reconnu
pour prétérit, & décoré par toits les grammai-* ,
rierts du nom de prétérit-parfait, a tous les càrad'eres.
exigibles d’un prétérit indéfini : & quoiqu’en effet
on ne Femploye pas à autantd’ufages'différens que
le préfent indéfini, il en a Cependant affez pour
prouver qu’il renferme fondamentalement Tabftra-
dion de toute époque, ce qui eft l’ëffencë des tems
indéfinis.
i°. On fait ufagé de ce prétérit pour défigner lé
prétérit aduel. J 'a i lu l'excellent livre des Tropes,
c’eft-à-dire , mon action de lire ce livre ejî anterieure au
moment même où. je parle. Il y a plus ; aucune langue
n’a établi dans fes verbes un prétérit aduel proprement
d it; c’eft le prétérit indéfini qui en fait les fonctions
, & c’eft par la même raifon qui fait que le préfent
indéfini tient lieu dé préfent acluel, raifon, par
eonféquent, que je né dois plus répéter.
z°. On emploie fréquemment le prétérit indéfini
pour le prétérit poftérieuri J'a i f in i dans un moment
fi.vous AVEZ RELU cet ouvrage demain y vous
jri!en dire{ votre avis : dans le premier exemple , j'ai
fin i, énonce l’adion de finir comme antérieure à Fé?
poque d'éfignée par cés mots, dans un moment, qui
eft néceflairement une époque poftérieure ; c’eft:
comme fi l’on difoit, j 'a u r a i FINI dans un moment
, ou dans un moment je pourrai dire , j 'A I FI NI:
dans le fécond exemple, vous aveç relu, préfente
l’adion de relire comme antérieure à l’époque poftérieure
indiquée par le mot demain, St c’eft comme fi
l’on difoit , lorfque VOUS AUREZ RELU demain cet
ouvrage, vous tri en dire£ votre avis, ou lorfqtu demain
vous pourrez dire que VOUS AVEZ r e lV , &c.
3°. Le prétérit indéfini eft quelquefois employé
pour le prétérit antérieur. Que je dite dans Un récit:
fur les accufations vagues & contradictoires qu'on alléj
guoit contre lui, je prends fa défenfe avec feu & avec
fuccls : à peine AI-JE PARLÉ , qu'un bruit fourd s'e-^
leve de toutes parts, &c. Dans cet exemple, ai je parlé
énonce nion adion de parler comme antérieure à
l’époque défignée par ces mots,«« bruit fourd s'élève.
mais le préfent indéfini s'élève eft mis ici pour le préfent
antérieur périodique ? éleva ; & par confcquent
l’époque eft réellement antérieure à l’ade de la parole.
Ai-je parlé eft donc employé pour av ois-je parlé
, & il énonce en effet l’antériorité de mon adion
de parler à l’égard d’une époque antérieure elle-même
au moment aduel de la parole.
4°. Le prétérit indéfini n’eft jamais employé dans"
le fens totalement indéfini, comme le prefent : c’eft-
que les propofitions d’éternelle vérité , effentielle-
ment préfentes à l’égard de toutes les époques, ne
font ni ne peuvent être antérieures ni poftérieures à
aucune : &£ les propofitions d’une vérité contingente
ont néceflairement des rapports différens aux
diverfes époques ; rapport de la fimultanéité pour
l’une, d’antériorité pour l’autre, de poftèriorité pour
une troifieme.
II. Le fécond de nos prétérits, eft le prétérit an?
térieur fimple, fueram ( j’avois été ) , laudaveram
( j’avois loué ) , miratus fueram ( j’avois admiré j'.
Les grammairiens ont donné à cë tems le nom dé
prétérit-plufque parfait, parce qu’ayant nommé parfait
le prétérit indéfini, dont le caradere eft d’exprimer
l’antériorité d’exiftence, ils ont; cru devoir ajouter
quelque chofe à cette qualification , pour défigner
un tems qui exprime l ’antériorité d’exiftence
& l’antériorité d’époque.
Mais qu’il me foit permis de remarquer que la dénomination
<d'ê plufque parfait a tous les vices les
plus propres à la faire profcrire. iQ. Elle implique
' contradidion , parce qu’elle fuppofe le parfait fiif-
' ceptible de plus ou de moins , quoiqu’il n’y ait
‘ rien de mieux que ce qui eft parfait; a°. Elle emporte
encore une autre mppofrtion également fauffe,
l’avoir qu’il y a quelque perfedion dans l’antériorité
, quoiqu’elle n’en admette ni plus ni moins que
*la fimultanéité & la poftèriorité. 30. Ces confidérà-
* rions donnent lieu de croire que les noms des pré-
t térits parfaits .& plufque parfaits n’ont été introduits,
que pour les diftinguer du prétendu prétérit imparfait
; mais comme- il a été remarqué plus haut que
cette dénominatioh ne peut fervir qu’à défigner l’im-
perfedion des idées des premiers nomenclateurs,
‘il iàut porter le même jugement des noms de parfait
& de plufque-parfait qui ont le même fondement.
Quoi qu’il en foit, ce fécond prétérit exprime en
effet l’antériorité d’exiftence à l’egard d’une époque
antérieure elle-même à l’ade de la parole ; ainfi quand
je àis ccenaveram cum intravit, ( j’avois foupé lorfqu’il
eft entré ),; ccenaveram, ; ( j’avois foupé ) , exprime
l’antériorité de mon fouper à l’égard de l’époque défignée
par intravit, ( il eft entré) ; & cette époque eft
elle même antérieure au temso'îfje le dis: ccenaveram
eft donc véritablement un prétérit antérieur fimple ,
ou relatif à une fimple époque.
III. En françois , en italien , & en efpagnol, on
trouve encore un prétérit antérieur périodique, qui
eft propre à ces langues, & qui différé du précéderit
parle terme de cpniparaifon , comme le préfent"antérieur
périodique'différé du préfent antérieur fimple;
j'eus été, feus loué, feus admiré, font des prétérits
antérieurs périodiques ; & pour s’èn convaincre , il
h’y a qu’à examiner toutes les idées partielles défi-
■ gnées par ces formes des verbes être , louer, admi-
rer, &c.
Quand jé dis , pat exemple , feu s foupé hier avant
'qiéilentrât ; il eft évident i°. que j’indiqiie l’antériorité
de mon fouper , à l’égard dé l’entrée dont il eft
qüeftiori ; z°i que cette entrée eft elle-même antérieure
afu tems oii j'e parle, puifqu’elle eft annoncée
comme fimultanée avec le jour d’hier; 30. enfin il eft
Certain que l ’on né peut dire j'eus foupé, que pour
marquer l’antériorité du fouper à l’égard d’une époque
prife dans un période antérieur à celui où l’on
parle : il eft donc confiant que tout verbe j fous cette
forme, eft au prétérit antérieur périodique.
IV. Enfin nous avons un prétérit poftérieur , fcpii
exprime l’antériorité d’exiftence à l ’égard d’une époque
poftérieure au tems où l’on parle ; comme fuero,
( j ’aurai é té ) , laudaveroy ( j ’aurai loué) , miratus
ero, ( j ’auraiadmiré);
« Le troifieme rémi eômpofé , dit encore Failteii?
» delà grammaire générale (/oc. cit.') eft celui qui
» marque l’avenir avec rapport au paffé, favoir le
">> futur parfait , comme ccenavero ( j’aurai foupé) ;
» par où je marque mon aélion de fouper comme
h future en fo i, & comme paffée au-regard d’une
» autre chofe à venir qui la doit fuiyre ; comme
» quand f aurai fôùpè il entrera : cela veut dire que
» mon fouper qui n’eft pas encore venu , fera paffé
» lorfque fon entrée , qui n’eft pas encore venue *
» fera préfente ».
La prévention pour les noms reçus fait toujours
illufiorr à cet auteur ; il eft perfuadé que le tems dont
'il parle eft un futur ,. parce que tous les grammairiens
s’accordent à lui donner ce nom : c’eft pour cela
qu’il dit que ce tems marjue Vavenir avec rapport au
paffé : au-lieu qu’il fuit de l’exemple même de grammaire
générale, qu’il marque le paffé avec rapport à Car-
venir. Quelle eft en effet l’intention de celui qui d it,
quand f aurai foupé il entrera? c’ eft évidemment de fi-
' xerle rapport du tems de fon fouper, au tems de l ’en-
' trée de celui dont il parle ; cette entrée eft l’époque
de compararfori j & le fouper eft annoncé comme antérieur
à certe époque ; c’eft l’unique destination de
la forme qiie le. verbe prend en cette occurrence &
' par eonféquent cette forme marque réellement l’antériorité
à l egard d’une, époque poftérieure au tems
de la parole , ou* pouf me fervir des termes de M.
Lancelot, mais d’une maniéré conféquente à Fôbfer-
vation , elle marque lepaffè avec rapport à l'avenir.
Une autre erreur de cet écrivain célébré , eft de
croire que ccenavero , ( j’aurai foupé ) , marque mon
aétion de fouptr comme future en foi, & comme paffée
au regard d’une autre chofe à venir, qui la doit
fuivre. Ccenavero , & tous les tems pareils des autres
verbes, n’expriment abfolument que le fécond de
ces deux rapports, & loin d’exprimer le premier, il
ne le fitppofe pas même. En voici''fa' preuve dans un
raifonnement d’un auteur qu’on n’aceuferâ pas de
mal écrifeyôu de nepas fentir lâ force des termes de
notre langue ; c’ eft M. Plitche.
« Si le tombeau, dit-il ( fpeétacle de la nature ;
» difc.prèl. du tom. VIII. pkg. 8■ '& c). ) , eft pouf
■ » lui ( l ’homme ) la fin de tout; le genre humain fe
» divife en deux parties, dont l’nnb fê livre inipuné-
» ment au crime,l’autre s’attache fims fruit à la ver-
» tu ... les voluptueux .& lesfoiirbes. . . feront ainfi
» les feules têtes bien montées , & le Créateur , qui
». a mis tant d’ordre dans.le. monde corporel, n’aura
» établi ni réglé ni juftice dans la nature intellir-
» gente, même après lui-avoir.infpiré une très-haute
‘» idée de la réglé & de la juftice ».
• Dès le commencement de ce difooufs, on trouvé
une époque poftérieure , fixée par un fait hypothé-»
tique ; f i le tombeau ejî pour L'homme la fin de tout $
c’eft-à-dire , en termes clairement relatifs à l’avenir j
f i le tombeau doit être pour l'homme l'a fin de tout : quand
on ajôute 'enfuite que le Créateur ri a u RA ETABLI rit-
réglé nijufiice, on veut Amplement défigner l’antériorité
de cet établiffement à l’égard de l’époque hypothétique
, & il eft confiant qu’il ne s’agit point ici
de rien ftatuer fur les a&es futurs du Créateur ; mais
qu’il eft queftion de conclure, d’après fes a£les pafféS,
contre lés fuppofitions abfurdes qui tendent à anéantir,
l’idée delà providence. Le verbe aura établi, n’exprime
donc en foi aucune futurition, & Fon auroit
friême pu dire, le Créateur ri a établi ni réglé ni juflice ;
ce qui exclut entièrement & inconteftablement l’idée
d’avenir ; mais on a préféré avec raifon le prétérit
poftérieur , parce qu’il étoit effentiel de rendré
fenfible laliaifon de cette conféquence, aVec l’hypo-
thefe de la deftruction totale de l’homme , que l’on
fuppofe future ; Sc que rien ne convient mieux pour
cela , qiie le prétérit poftérieur , qui exprime eflen-
tiellement relation à une époque poftérieure.
§. 3. Syfième des FUTURS, jufifié par Us ufages
des langues. L’idée de fimultanéité, Celle d’antériorité,
& celle de poftèriorité, fe combinent également
avec l’idée du terme de comparaifon : de-là autant
de formes ufuelles pour l’expreffion des futurs, qu’il
yen a de généralement reçues pour la diftinftion des
préfens & pour celle des prétérits. Nous devonedonc
trouver un futur indéfini, irn futur antérieur, & un
futur poftérieur.
I. Le futur indéfini doit exprimer la poftèriorité
d’exiftence avec abftraâion de toute époque de cbm^
paraifon ; & c’eft précifément le caraélere des tems
latins & françois, futurus fum ^ ( je dois être ) ; lau- .
daturüsfujn , ( je dois louer) ; miratitrus fum, ( je
dois admirer ) ; &c.
Par exemple dans cette phrafe, tout homme d o i t
m o u r i r , qui eft Fexpreflion d’une vérité morale j
confirmée par l’expérience de tous les tems, ces mots
doit mourir , expriment la poftèriorité de la -mort f