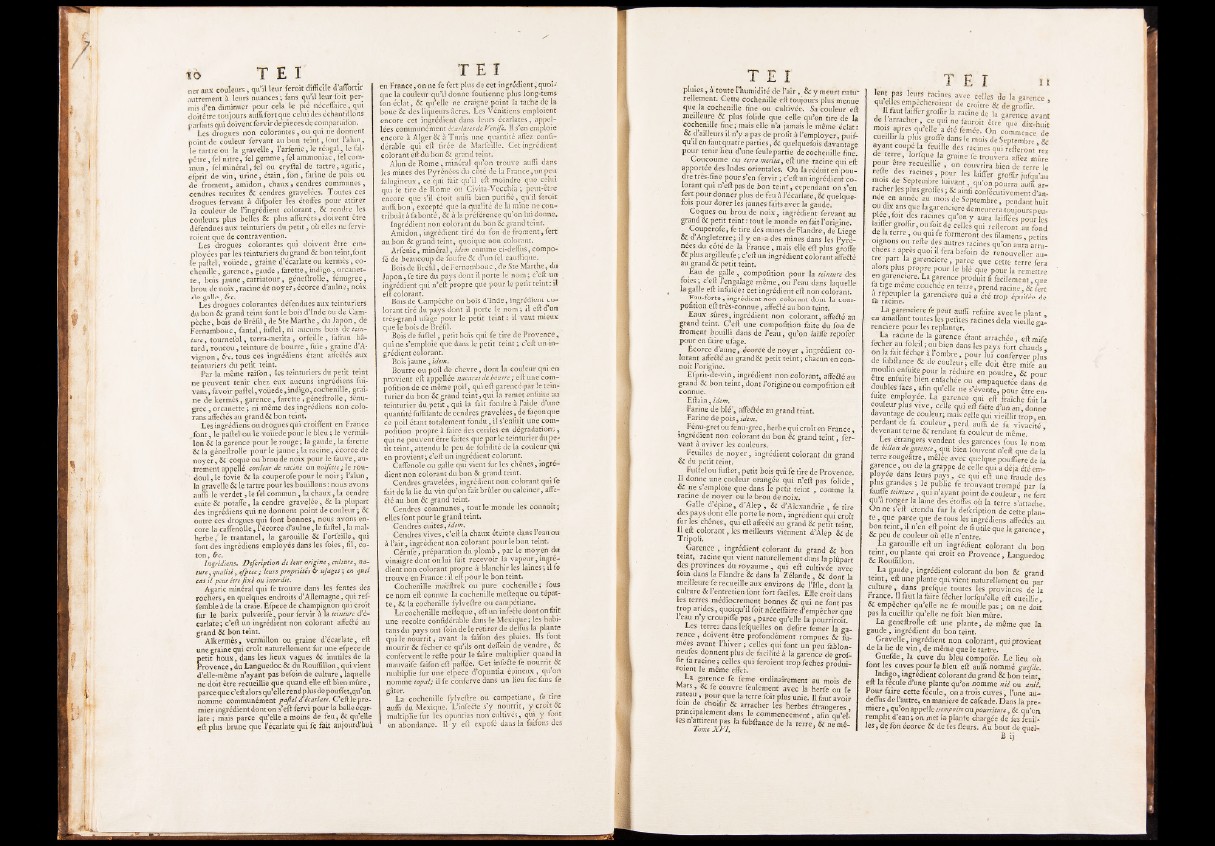
ner aux couleurs, qu’il leur feroit difficile d’affortir
autrement à leurs nuances; fans qu’il leur foit permis
d’en diminuer pour cela le pie néceffaire, qui
doit être toujours aufli fort que celui des échantillons
parfaits qui doivent fervir de pièces de comparaifon.
Les drogues non colorantes, ou qui ne donnent
point de couleur fervant au bon teint, font l’alun,
le tartre ou la gravelle , l’arfcnic, le réagal, le fal-
pêtre fel nitre, fel gemme, fel ammoniac, fel commun
ƒ fel minéral, fel ou cryftal de tartre, agaric,
efprit de vin, urine, étain, fon , farine de pois où
de froment, amidon, chaux , cendrés communes ,
cendres recuites & cendres gravelées. Toutes ces
drogues fervant à difpofer les étoffes pour attirer
la couleur de l’ingrédient colorant, & rendre les
couleurs plus belles & plus allurées, doivent être
défendues aux teinturiers du petit, où elles neferviroient
que de contravention.
Les drogues colorantes qui doivent être employées
par les teinturiers du grand & bon teint,font
le paftel, voiiede, graine d’écarlate ou kermès, cochenille
, garènçe, gaude, farette, indigo, preanet-
t e , bois jaune, carriatour, géneftrolle, fénugrec,
brou de noix, racine de noyer, écorce d’aulne, noix
de galle, &c. ' , .
Les drogues colorantes défendues aux teinturiers
du bon & grand teint font le bois d’Inde ou de Cam-
pèche, bois de Bréfil, de Ste Marthe, du Japon, de
Fernambouc, fantal, fuftel, ni aucuns bois de teinture
, tournefol, terra-merita, orfeille , fafran bâtard,
roueou, teinture de bourre, fuie, graine d’Avignon
, &c. tous ces ingrédiens étant affeûés aux
teinturiers du petit teint. # ”
Par la même raifon, les teinturiers du petit teint
ne peuvent tenir chez eux aucuns ingrédiens fui-
vans, (avoir paftel, voiiede, indigo, cochenille, graine
de kermès, garënce, farette, géneftrolle, fénugrec
, orcanette ; ni même des ingrédiens non colo-
rans affeftés au grand & bon teint.
Les ingrédiens ou drogues qui croiffent en France
„font, le paftel ou le voiiede pour le bleu ; le vermillon
& la garence pour le rouge; la gaude, la farette
& la géneftrolle pour le jaune ; la racine, écorce de
noyer, & coque ou brou de noix pour le fauve, autrement
appellé couleur de racine ou noifette ; le rou-
' ' doul, le fovie & la couperofe pour le noir ; l’alun,
la gravelle & le tartre pour les bouillons : nous avons
aufli le verdet, le fel commun, la, chaux, la cendre
cuite & potaffe, la cendre gravelée, & la plupart
des ingrédiens qui ne donnent point de couleur ; &
outre ces drogues qui font bonnes, nous avons encore
la caffenolle, l’écorce d’aulne, le fuftel, la mal-
herbe/le trantanel, la garouille & Forfeillc, qui
font des ingrédiens employés dans les foies, fil, coton,
&c.
Ingrédiens. Defcription de leur origine, culture, nature,
qualité, efpece; leurs propriétés & ujages ; en quel
cas il peut être fixé ou interdit.
Agaric minéral qui fe trouve dans les fentes des
rochers, en quelques endroits d’Allemagne, qui ref-
femble à de la craie. Efpece de champignon qui croît
fur le barix pulverifé, pour fervir à la teinture d’écarlate;
c’eft un ingrédient non colorant affeété au
grand & bon teint.
Alkermès, vermillon ou graine d’écarlate, eft
une graine qui croît naturellement fur une efpece de
petit houx, dans les lieux vagues & inutiles de la
Provence, du Languedoc & du Rouffillon, qui vient
d’elle-même n’ayant pas befoin de culture, laquelle
ne doit être recueillie que quand elle eft bien mûre,
parce que c’eft alors qu’elle rend plus de pouffet,qu’on
nomme communément pajlel d'écarlate. C’eft le premier
ingrédient dont on s’eft fervi pour la belle écarlate
; mais parce qu’elle a moins de feu, & qu’elle
çftplus brune que l’écarlate qui fe fait aujourd’hui
en France, on ne fe fert plus de cet ingrédient, quoique
la couleur qu’il donne foutienne plus long-tems
(on éclat, & qu’elle ne craigne point la tache de la
bôue & des liqueurs âcres. Les Vénitiens emploient
encore cet ingrédient dans leurs écarlates, appelées
communément écarlates de Vtnife. Il s’en emploie
encore à Alger & à Tunis une quantité affez confi-
dérable qui eft tirée de Marfeille. Cét ingrédient
colorant eft du bon & grand teint.
Alun de Rome, minéral qu’on trouve aufli dans
les mines des Pyrénées du coté de la France-, un peu
falugineux, ce qui fait qu’il eft moindre que celui
qui fe tire de Rome ou Civita-Vecchia ; peut-être
encore que s’il étoit aufli bien purifié, qu’il feroit
aufli bon, excepté que la qualité de la mine ne contribuât
à fa bonté, & à la préférence qu’on lui donne.
Ingrédient non colorant du bon & grand teint.
Amidon, ingrédient tiré du fon de froment, fert
au bon & grand teint, quoique non colorant.
Arfenic, minéral, idem comme ci-deffus, compo-
fé de beaucoup de foufre 6c d’un fel cauftique.
Bois de Bréfil, de Fernambouc, de Ste Marthe, du
Japon, fe tire du pays dont il porte le nom ; c’eft un
ingrédient qui n’ eft propre que pour le petit teint: il
eft colorant.
Bois de Campêche ou bois d’Inde, ingrédient colorant
tiré du pays dont il porte le nom ; il eft d’un
très-grand ufàge pour le petit teint : il vaut mieux
que le bois de Bréfil.
Bois de fuftel, petit bois qui fe tire de Provence,
qui ne s’emploie que dans le petit teint ; c’eft un ingrédient
colorant.
Bois jaune, idem.
Bourre ou poil de chevre, dont la couleur qui en
provient eft appellée nacaratde bourre ; eft une com-
pofition de ce même poil, qui eft garencé par le teinturier
du bon & grand teint,qui la remet enfuite au
teinturier du petit, qui la fait fondre à l’aide d’une
quantité fuffifante de cendres gravelées, de façon que
ce poil étant totalement fondu, il s’enfuit une com-
pofition propre à faire des cerifes en dégradations,
qui ne peuvent être faites que parle teinturier du petit
teint, attendu le peu de folidité de la couleur qui
| en provient ; c’eft un ingrédient colorant. ^ ^
Caffenole.ou galle qui vient fur les chênes, ingrédient
non colorant du bon & grand teint.
Cendres gravelées, ingrédient non colorant qui fe
fait de la lie du vin qu’on fait brûler ou calciner, affe-
&é au bon 6c grand teint.
Cendres communes, tout lé monde les connoît;
elles font pour le grand teint.
Cendres cuites, idem.
Cendres v ives, c’eft la chaux éteinte dans l’eau ou
à l’air, ingrédient non colorant pour le bon teint.
Cérufe, préparation du plomb , par le moyen du
vinaigre dont on lui fait recevoir la vapeur, ingrédient
non colorant propre à blanchir les laines ; il fe
trouve en France : il eft pour le bon teint. ^
Cochenille maëftrek ou pure cochenille ; fous
ce nom eft connue la cochenille mefteque ou tépat-
te , & la cochenille fylveftre ou campétiane.
La cochenille mefteque, eft un infefte dont on fait
une récolté cônfidérable dans lé Mexique ; les habi-
tans du pays ont foin de le retirer de deffus la plante
qui le nourrit, avant la faifon des pluies. Ils font
mourir 6c fécher ce qu’ils ont deflein de vendre, 6c
confervent le refte pour le faire multiplier quand la
mauvaife faifon eft paffée. Cet inféré fe nourrit 6c
multiplie fur une efpece d’opuntia epineux , qu on
nomme top ali h fe confier ve dans un lieu fec fans fe
gâter. . . .
La cochenille fylveftre ou campetiane, fe tire
aufli du Mexique. L’infiefte s’y nourrit, y croît 6c
multiplie fur les opuntias non cultivés, qui y font
en abondance. Il y eft expofe dans la faifons des
pluies, à toute l’humidité de l’a i r , & y meurt natu*
Tellement. Cette cochenille eft toujours plus menue
que la cochenille fine ou cultivée. Sa couleur eft
meilleure 6c plus folide que celle qu’on tire de la
cochenille fine; mais elle n’a jamais le même éclat:
& d’ailleurs il n’y a pas de profit à l’employer, puifl
qu’il en faut quatre parties, & quelquefois davantage
pour tenir lieu d’une feule partie de cochenille fine.
Coucoume ou terra mérita, eft une racine qui eft
apportée des Indes orientales. On la réduit en poudre
très-fine pour s’en fervir ; c’eft un ingrédient colorant
qui n’eft pas de bon teint, cependant on s’en
fert pour donner plus de feu à l’écarlate, & quelquefois
pour dorer les jaunes faits avec la gaude.
Coques ou brou de noix, ingrédient fervant au
grand 6c petit teint : tout le monde en fait l’origine.
Couperofe, fe tire des mines de Flandre, de Liege
& d’Angleterre; il y en «-a des mines dans les Pyrénées
du côté de la France , mais elle eft plus greffe
& plus argilleufe ; c’eft un ingrédient colorant affe&é
au grand 6c petit teint.-
Eau de galle, compofition pour la teinture des
foies; c’eft l’engalage même, ou l’eau dans laquelle
la galle eft infufée : cet ingrédient eft non colorant.
Eau-forte » ingrédient non colorant dont la com-
pofition eft très-connue, affeélé au bon teint.
Eaux sûres, ingrédient non colorant, affe&é au
grand teint. C ’eft une compofition faite du fon de
froment bouilli dans de l’eau, qu’on laiffe repofer
pour en faire ufage.
Écorce d’aune, écorce de noyer , ingrédient colorant
affeâé au grand & petit teint; chacun en connoît
l’origine.
Efprit-de-vin, ingrédient non colorant, affe&é au
grand & bon teint,.dont l’origine ou compofition eft
connue.
Eftain, idem.
Farine de blé’, affe&ée au grand teint.
Farine de pois, idem.
. Fénu-gret ou fénu-grec, herbe qui croît en France,
ingrédient non colorant du bon & grand teint, fervant
à aviver les couleurs.
Feuilles de noye r, ingrédient.colorant du grand
& du petit teint.
Fuftel ou fuftet, petit bois qui fe tire de Provence. ■
Il donne une couleur orangée qui n’eft pas folide, i
& ne s’emploie que dans le petit teint , comme la.
racine de noyer ou le brou de noix.
Galle d epine, d ’Alep', 6c d’Alexandrie , fe tire
des pays dont elle porte le nom, ingrédient qui croît
fur les chênes, qui eft affeété au grand 6c petit teint'.
Il eft colorant, les meilleurs viennent d’Alep & de
Tripoli. - .
Garence , ingrédient colorant du grand & bon
teint, racine qui vient naturellement dans la plûpart
des provinces du royaume, qui eft cultivée avec
foin dans la Flandre & dans la Zélande , & dont la
meilleure fe recueille aux environs de l’Ifle, dont la
culture & l’entretien font fort faciles. Elle croît dans
les terres médiocrement bonnes & qui ne font pas
trop arides, quoiqu’il foit néceffaire d’empêcher que
leau n’ycroupiffe pas, parce qu’elle la pourriroit.
Les terres dans lefquelles on defire femer la ga-.
rence, doivent être profondément rompues 6c fu-
meés avant l’hiver ; celles qui font un peu fablon-
neufes donnent plus de facilité à la garence de grof-
fir fa racine ; celles qui feroient trop feches produi-
roient le même effet.
La garence fe feme ordinairement au mois de
Mars, & fe couvre feulement- avec la herfe ou Te
rateau, pour que la terre foit plus unie. Il faut avoir
loin de choifir & arracher les herbes étrangères,
principalement dans le commencement, afin qu’elles
n attirent pas la fubftance.de la terre, 6c ne mê-
Tome X VI.
lent pas leurs racines avec celles de la garence .
qu elles empechetoicnt de croître & de greffir.
Ilfeutlaiffergroffirla racine de la garence avant
de 1 arracher ce qui ne fauroit être que dix-huit
mois apres m, elle il été femée. On commence de
cueillir la plus greffe dans le mois de Septembre &
ayant coupe la feuille des racines qui relieront reî
de-terre, lorfque la graine fe trouvera affez mûre
pour être «cueillie , on couvrira bien de terre le
relie des racines, pour les laiffer grollîr iufqu’au
mois; de Septembre buvant 1 qu’on pourra SH arracher
les plps greffes ; & ainfi confécutivement d’an*
nee en année au mois de Septembre, pendant huit
M Ü f g n i garenciere demeurera toujours peu*
P 5 : r îïes racines qu’on y aura biffées pour les
laiffer groffir, oufoit de celles qui relieront au fond
de la terre, ou qui fe formeront des filamens , petits
oignoqs .oirrefte des autres racines qu’on aura arra-
ehees t aures quoi il fera befoin de renouveller autre
part la garenciere, parce que cette terre fera
alors plus, propre pour le blé que pour la remettre
en garenciere. La garencè.produit fi fediement que
la tige ihçme edachée éii terre, prend racine, & fert.
à repeupler la garenciere qui a été trop épuilée de
la racine.
La racine de la garence étant arrachée, eft mife
fecher au foleil ; ou bien dans les pays fort chauds.
tU U ÿ S g M à !om k e , pour lui conferver plus
de fubftairce & de couleur ; elle doit être mife au
moulin enfuite pour ta réduire en poudre, & pour
S B H enfichée ou empaquetée dans de
doubles lacs, afin qu elle lie s’évente, pour être en-
imte employée. La garence qui eft fraîche fait la
couleur plus v iv e , celle qui eft faite d’un an’, donne
davantage de couleur; mais Çejle qui vieillit trop en
perdant de fa couleur , perd aufii de fa vivacité
devenant terne & rendant fa couleur de même ’
Les étrangers vendent .des garences fous le nom
de hUon de garence, qui bien fouyent n’eft que de la
terre rougeâtre, mêlee avec quelque pouffiere'de la
garence, ou de la grappe de celle qui a déjà été employée
dans leurs pays , ce qui eft . une. fraude des
plus grandes ; lé public fe trouvant trompé par la
faillie ceinture , qui n’ayant point de couleur ne fert
qu’àJSSigér la laine dés étoffés.oii la terré s’attache.
On ne s’eft étendu fur là defcription de cette plante
, que parce que de tous tes ingrédiens affeftés au
bon.teint, i| n’en eft point de fi utile que la garence
& peu de couleur où elle n’entre. *
La garouille eft Un ingrédient colorant du bon
teint, ou plante qui cfoîf en Provence, Languedoc
& Rouffillon. °
La gaude, ingrédient colorant du bon & grand
teint, eft une plante qui vient naturellement ou par
culture, dans prefque toutes les provinces delà
France.Jl faut la faire fécher lorfqu’elle eft cueillie,
& empecher qu’elle ne fe mouille pas ; on ne doit
pas la cueillir qu’elle ne foit bien mûre.
La geneftrolle eft une plante, de même que la
gaude , ingrédient du bon teint.
Gravelle, ingrédient non colorant, qui provient
de la lie de v in , de même que le tartre.
Guefde, la cuve du bleu compofée. Le lieu oh
font les cuves çour le bleu eft aufîi nommé guefde.
Indigo, ingrédient colorant du grand & bon teint,
eft la fécule d’une plante qu’on nomme nil ou anil.
Pour faire cette fécule, on a trois cuves, l’une aii-
deffus de l’autre, en maniéré de cafcade. Dans la première,
qu’on appelle trempoire ou pourriture, & qu’en
remplit d’eau -, on met la plante chargée de fes feuilles,
de fon écorce & de (es fleurs. Au bout de quel