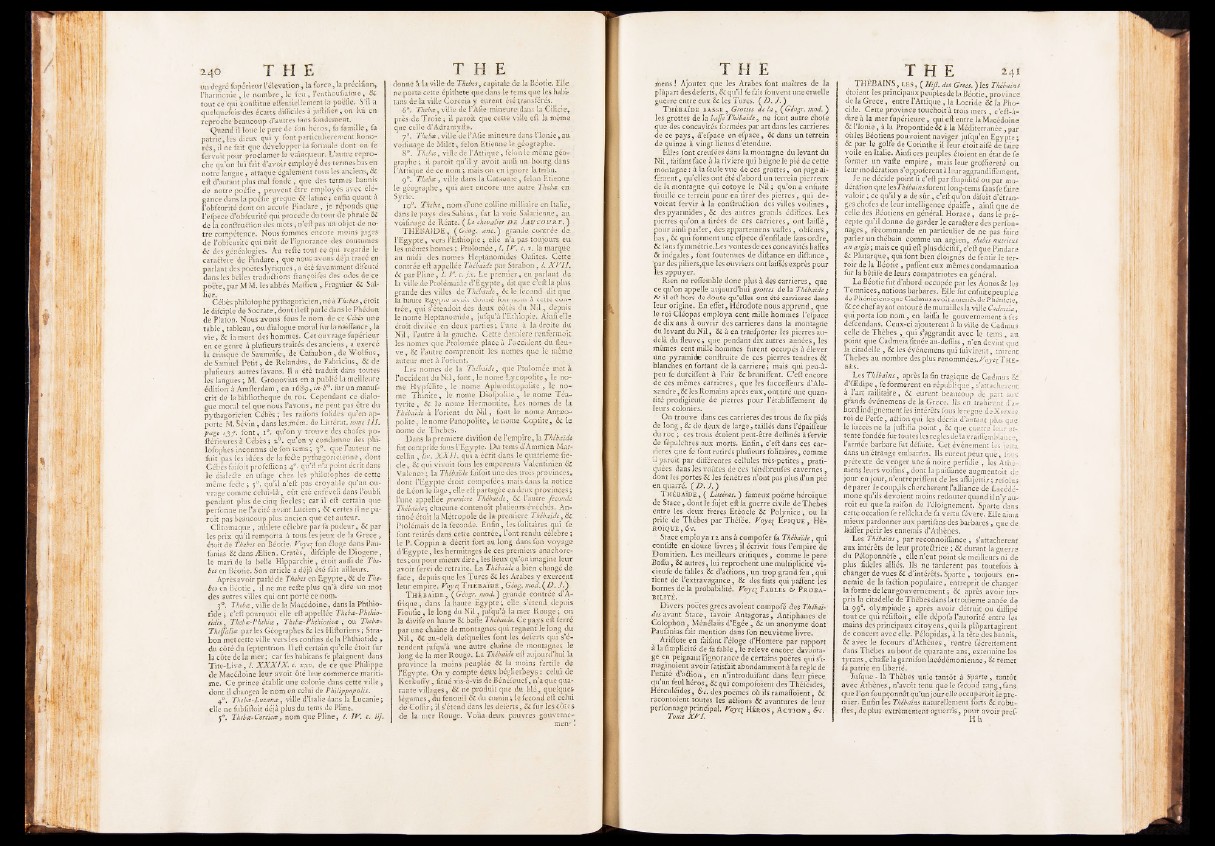
un degré fupérieur l’élévation-, la force, la precifion^
l’harmonie , le nombre, le feu , l’enthoufiafme, &
tout ce qui conftitue effentiellement la poëfie. S il a
quelquefois' des écarts difficiles à juftifiet> , on lui- en
reproche beaucoup d’autres fans fondement.
Quand iï îoue le pere de fon- héros , fa familleg fa
patrie, les dieux qui y font particulièrement honorés,
il ne fait que développer la formule dont on fe
■ fervoit pour proclamer le vainqueur. L’autre reproche
qu’on lui fait d’avoir employé des-termes bas en-
notre Tangue, attaque également tous les anciens, &
eft d’autant plus mal fondé , que des- termes bannis
de notre poéfie , peuvent être employés avec élégance
dans la poéfie greque Sfc latine- ;* enfin quant à
■ Pobfcurité dont on accufe Pindare , je réponds que
l’efpece d’obfcurité qui procédé du tour de phrafe &
de la conftruâion des mots; n’eftpas un objet de notre
compétence. Nousfommes encore moins juges
de rbbfcurité qui naît de l’ignorance des coutumes
& des généalogies. Au refte tout ce qui regarde le
cara&ere de Pindare, que nous avons d'eja trace en
parlant des poètes lyriqués, a été f avammént difcufe
dans Tes belles traduirions françoifes des odes de ce
pôete, par MM. les abbes Maffieu , Fraguier Rallier
.C
ébès philofophe pythagoricien, né à TheUs, étoit
le difciple de Socrate, don t il eft parlé dans le Phédon
de Platon. Nous avons fous le nom de ce Cébès une
table, tableau, ou dialogue moral furlanaiffance, la
v ie , & la mort des homnïes. Cet ouvrage fupérieur
en ce »enre à plufieurs traités des anciens, a exercé
la critique de Saumaife , de C'af'aubon , de W olfius,
de Samuel- Petit, de Relanchrs, de Fabrieius-, & de
plufieurs autres favans. Il a été traduit d'ins- toutes
les langues ;. M. Gronovius en a publié la meilleure
édition à Amfterdam , en 1689 , in-8°. fur un manuf-
crit de là bibliothèque du roi. Cependant ce dialogue
moral tel que nous l’avons, ne peut pas être du
pythagoricien Cébès ; les raifons folides qu’en apporte
M. Sëvin , dans les.mém. de Littérat. tome III.
page 137. fon t, i°. qu’on y trouve des choies pq-
ftérieures à Cébès ; 20. qu’on y condamne des phi-
lofop'bèS inconnus de fon tems; 30. que l’auteur ne
fuit pas les idées de la fecle pythagoricienne, dont
Cébès faifoit profefîîon; 40.'qu’il n’a point écrit-dans
le dialede en ufage chez les philofophes de cette
même feâe ; 50,. qu’il n’eft pas croyable qu’un ouvrage
comme celui-là, eût été ënfeveli dans l’oubli
pendant plus de cinq fiecles ; car i l eft certain que
perfonne ne l’a cité avant Lucien ; & certes il ne pa-
roît pas beaucoup plus ancien que Cet auteur.
Clitomaque , athlete célébré par fa pudeur, & par
les prix qu’il remporta à tous les jeux de la Grece ,
étoit de Tkebes en Béotie. Foye^ fon éloge dans Pau-
fanias & dans Ælien. Cratès, difciple de Diogene,
le mari de la belle Hipparchie, étoit auffi de Tke-
bes en Béotie. Son article a déjà été fait ailleurs.
Après avoir parlé de Thebes en E gypte, & de The-
bes en Béotie, il ne me refte plus qu’à dire un mot
des autres villes qui ont porté ce nom.
- 30. Thtbic, ville de là Macédoine, dans la Phthio-
tide ; c’eft pourquoi elle eft appellée Theboe-Phthio-
tidis, Theboe-Phthioe , Theboe-P hthioticoe , ou Theboe-
Theffalioe par les Géographes & les Hiftoriens ; Stra-
bon met cette ville vers les confins delà Phthiotide ,
du côté du feptentrion. Il eft certain qu’elle étoit fur
la côte de la mer; car fes habitans fe plaignent dans
Tite-Live, l. X X X IX . c. xxv. de ce que Philippe
de Macédoine leur avoit ôté leur commerce maritime.
Ce prince établit une colonie dans cette v ille ,
dont il changea le nom en celui de Pkilippopolis.
a°. Theboe-Lucanoe, ville d’Italie dans la Lucanie ;
elle ne fubfiftoit déjà plus du tems de Pline.
5®. Theboe-Corcicoef nom que Pline, /. IF. e. iij.
donne à la ville de Tkebes, capitale de la Béotie. Elle
ne porta cette épithete que dans le tems que les habk
tans de la ville Corceia y eurent été transférés.
6°. Thebes. y ville de l’A-fte mineure dans la. £iliçier
près-de Troie ; il paroît que cette ville, eft la même
que celle d’Àdramyfte.
7°. Thehoe . ville de l’Afie mineure dans IT© nie, au
voilinage de Mile't-, félon. Etienne le géographe.
8°. Theboe, ville de l’Attique, félon le même géo- -
graphe ; il paraît qu’ il y avoit auffi, un bourg dans
l’Attique de ce nom; maison en ignore la tribu.
o°. Thehoe, ville dans la Ça ta© a ie , félon Etienne
le géographe, qui met encore une autre Thehoe en
Syrie.
io°. Thehoe, nom d’une colline milliaire en Italie,,
dans le pays des Sahias , fur la voie Saiarienne, au
voilinage de Réate. (Le chevalier D E Ja U c o u r t . ),
THÉBA1D E , ( Géog, anc. ) grand® contrée de..
l’Egypte, vers l’Ethiopie ; elle n’a pas toujours eu
les mêmes bornes ; Ptolomée , 1. IF . c. v. la marque
au midi des nomes Heptanomides Oafites. Cette
contrée eft appellée Thébaïde par Strabon , L. X F I I .
& par Pline, l. F. c. jx . Le premier, en parlant de
la ville de Ptolém-aïde d’E g y p te d it que c’eft la plus
grande des villes de Thébaïde, & le fécond dit que .
la haute Egypte avoit donné fon nom à cette contrée,
qui s’étendoit des deux côtés du N il, depuis
le nome Heptanomide, jufqu’à l’Ethiopie. Ainfi elle
étoit divifée en deux parties ; l’une à la droite du
Nil,- l’autre à la.gauche. Cette dern-iere renfermoit
les nomes que Ptolomée place à l’occident du fleuve
, & l’autre comprenoit les. nomes que le même
auteur met à l’orient.
Les nomes de la Thébaïde, que Ptolomée met à
l’occident dû Nil, font, le nome Lyc ©polit©, le nome
Hypfélite, le nome Aphroditopolite , le nome
Thinite, le. nome Diofpolite , le nome Téa-
ty r ite , & le nome Hermontite-. Les nomes de la
Thébaïde à l’orient du N il, font le nome Antæo-
polite, le nome Panopolite, le nome Coptite, & le
nome de Thebes.
Dans la première divifion de l’empire, la Thébaïde
fut comprife fous l’Egypte. Du temsd’Ammien Marcellin.
, liv. X X I I . qui a écrit dans le quatrième fte-
cle, ôc qui vivoit fous les empereurs Valentinien &
Valence ; la Thébaïde faifoit une des trois provinces,
dont l’Egypte étoit compofée; mais dans la notice
de Léon le fage, elle eft partagée en deux.provinces j
l’une appellée première Thébaïde, & l’autre féconds
Thébaïde ; chacune contenoit plufieurs évéchés. An-
tinoé étoit la Métropole de la première Thébaïde, Sc
Ptolémaïs de la fécondé. Enfin, les folitaires. qui fe.
font retirés dans cette contrée, l’ont rendu célébré ;
le P. Coppin a décrit fort au long dans fon voyage
d’Egypte, les hermitages de ces premiers anachorètes
; ou pour mieux dire, les lieux qu’on imagine leur
avoir fervi de retraite. La Thébaïde a bien changé de
face, depuis que les Turcs & les Arabes y exercent
leur empire. Foye{T hébaïde , Géog. mod.ÇD. J.')
T h ç ba ïd e, ( Géogr. mod. ) grande contrée d’Afrique,
dans la haute Egypte; elle s’étend depuis
Fioufie , le long du N il, jufqu’à la mer Rouge ; on
la divife en haute & baffe Thébaïde. Ce pays eft ferré
par une chaîne de montagnes qui régnent le long du
N il, & au-delà defquelles font les deferts qui s’étendent
jufqu’à une autre chaîne de montagnes lff
long de la mer Rouge. La Thébaïde eft aujourd’hui la
province la moins peuplée & la moins fertile de
l’Egypte, On y compte deux béglierbeys : celui de
: Kerkoffy, fitué vis-à-vis de Bénéfouef, n’a que quarante
villages, & ne produit que du blé, quelques
légumes, du fenouil & du cumin ; le fécond eft celui
de Coffir ; il s’étend dans les deferts, & fur les côtes
de la mer Rouge. Voila, deux pauvres gouverner
ihens ! Ajoutez que les Arabes font maîtres de la
plupart des deferts, & qu’il fe fait foüvent une cruelle
guerre entre eux & les Turcs. ( D. J. )
THÉBAÏDE BASSE , Grottes de l a , (Géûgr. mod. )
les grottes de la baffe Thébaïde, ne font autre chofe
que des concavités formées par art dans les carrières
de ce pays, d’efpace en efpace, & dans un terrein
de quinze à vingt lieiies d ’étendue.-
Elles font creufées dans la montagne du levant du
N il, faifant face à la riviere qui baigne le pié de cette
montagne : à la feule vue de ces grottes, on jiige ai-
fément, qu’elles ont été d’abord un terrein pierreux
de la montagne qui cotoye le Nil ; qu’on a enfuite
touillé ce terrein pour en tirer des pierres , qui dévoient
fervir à la conftruéHori des villes voifines ,
des pyarmides, & des autres grands édifices. Les
pierres qu’on a tirées de ces carrières, ont laiffé,
pour ainfi parler, des appartenions vaftes, obfcurs ,
bas, & qui forment une efpece d’enfilade fans ordre,
& fans fymmétrie.Les voûtes de ces concavités baffes
& inégales, font foutenues de diftance en diftance ,
'par des piliers,que les ouvriers ont laifles exprès pour
les appuyer.
Rien ne reffemble donc plus à des carrières, que
Ce qti’on appelle aujourd’hui grottes de la Thébaïde ;
& il eft hors de doute qu’elles ont été carrières dans
leur origine. En effet, Hérodote nous apprend, que
le roi Cléopas employa cent mille hommes l’efpaçe
de dix ans à ouvrir des carrières dans la montagne
du levant du N il, & à en tranfporter les pierres au-
delà du fleuve; que pendant dix autres années, les
mêmes cent mille hommes furent occupés à élever
une pyramide cônftruite de ces pierres tendres &
blanches en fortant de la carrière ; mais qui peu-à-
peu fe durciffent à l’air bruniffent. C’eft encore
de ces mêmes carrieres, que les fucceflèurs d’Alexandre,
& les Romains après eiix, ont tiré une quantité
prodigieufe de pierres pour l’établiffement de
leurs colonies.
On trouve dans ces carrières des trous de lix piés
de long, & de deux de large, taillés dans l’épaifieur
du roc ; ces trous étoient peut-être deftinés à fervir
de fépulchres aux morts. Enfin, c’eft dans ces carrières
que fe font retirés plufieurs folitaires, comme
îl paroît par différentes cellules très-petites , pratiquées
dans les voûtes de ces ténébreufes cavernes ,
dont les portes & les fenêtres n’ont pas plus d’un pié
én quarré. ( D . J. ) .
T hébaïde, ( Littérat. ) fameux poème héroïque
de Stace, dont le fujet eft la guerre civile de Thebes
entre les deux freres Etéocle & Polynice, ou la
prife de Thèbes parThéfée. Foye^ Ep iq u e , Héroïque
, &c.
; Stace employa 12 ans à compofer fa Thébaïde, qui
confifte en douze livres; il-écrivit fous l’empire de
Domitien. Les meilleurs critiques, comme le pere
Boflii, & autres, lui reprochent une multiplicité vi-
cieufe de fables & d’aétions, un trop grand feu , qui
tient de l’extravagance, & des faits qui paffent les
bornes de la probabilité. Foyc{ Fables 6* Pro b a b
il ité .
Divers poètes grecs avoient compofé des Thébaides
avant Stace, lavoir Antagoras, Antiphanes de
Colophon, Ménélaiis d’Égée, & un anonyme dont
Paufanias fait mention dans fon neuvième livre.
Ariftote en faifant l’éloge d’Homere par rapport
à la fimplicité de fa fable, le releve encore davantage
e» peignant l’ignorance de certains poètes qui s’i-
maginoient avoir fatisfait abondamment à la réglé de
Punit© d’a â ion , erï n’introduifant dans leur piece.
qti’un feul héros, & qui compofoient clés Théféïdes,
Hérculéïdes, &c. des poèmes oû ils ramaflbient, &
racontoient toutes les a&ions & avantures de leur
perfonnageprincipal. Foyer Hé r o s , A c t io n , &c.
Tome X F I.
THÉB AINS, LES, ( HIß. des Grecs. ) les Thebaini
étoient les principaux peuples de la Béotie, province
de la G rece, entre l’Attique , la Locride ôc la Pho-*
eide. Cette province touchoit'à trois mers c’eft-à-*
dire à la mer fupérieure, qui eft entre la Macédoine
& l’ïonie, à la Propontide & à la Méditerranée , pat
oûles Béotiens pou voient naviger jufqu’en Egypte ;
& par le golfe de Corinthe il leur ëtoit aifé de faire
voile en Italie. Ainfi ces peuples étoient en état de fë
former Un vafte empire, mais leur grôffîereté ou
leur modération s’oppoferent à leur aegrandiffement»
te ne décide point fi c’ eft par ftupidité ou par mpJ
déràtion que les Tkébains furent long-tems fansfe faire
valoir ; ce qu’il y a de sû r, c’eft qu’on difoit d’étran*
ges chofes de leur intelligence épaifîe , . ainfi que de
celle des Béotiens en général. Horace, dans le précepte
qu’il donne de garder le caraftere des perfon^
riages, recommande en particulier de ne pas faire
parler Un thébain comme un argien, thebis nutritui
an argis ; mais ce qui eft plus décilif, c’eft que Pindare
& Plutarque, qui font bien éloignés de fentir le terroir
de la Béotie , paffent eux mêmes condamnation
fur la bêtife de leurs compatriotes en général.
La Béotie fut d’abord occupée par les Aones& les
Temnices , nations barbares. Elle fut enfuitepeuplée
do Phéniciens que Cadmus avoit amenés de Phénicie,
& ce chef ayant entouré de murailles la ville Cadmeia,
qui porta fon nom, en laiffa le gouvernement à fes
defeendans. Ceux-ci ajoutèrent à la ville de Cadmus
celle de Thèbes , qui s’aggrandit avec le tems , au
point que Cadmeïa fituée au-deffus, n’en devint que
la citadelle , & les événemens qui fuivirent, mirent
Thebes au nombre des plus renommées. Mj^ T he-
BÈS.
Les Thébalns, après la fin tragique de Cadmus Sâ
d’OEdipe, fe formèrent en république , s’attachèrent
à l’art militaire, & eurent beaucoup de part aux
grands événemens de la Grece. Ils en trahirent d'a--
bord indignement les intérêts fous le regne de Xerxès
roi de Perfe, aélion qui les décria d’autant plus que
le fuc.cès ne la juftifia point, & que. contre leur attente
fondée fur toutes les réglés de la vraisemblance
l’armée barbare fut défaité. Cet événement les jetta
dans un étrange embaiTas. Ils eurent peur, que, fçus
prétexte de venger une fi noire perfidie , les Athénien^
leurs vôifins', dont la puiffance augmentoit de
jour en jour, n’entrepriffent de les affujettif ; refolus
déparer le coup,ils cherchèrent l’alliance de Lacédémone
qu’ils devoiènt moins redouter quand il n’y au-
roit eu que la raifon de l’éloignement. 'Sparte clans
cette occafion fe relâcha de fa vertu féver.e. Eile aima
mieux pardonner aux partifans des barbares, que de
laiffer périr les ennemis d’Athènes. j
Les Thébains, par recoiinoiffance , s’attachèrent
aux intérêts de leur proteftrice ; & durant la guerre
du Péloponnèfe , elle n’eût point de meilleurs ni de
plus fideles alliés. Ils ne tardèrent pas toutefois à
changer de vues & d’intérêts. Sparte , toujours ennemie
de la faftion populaire , entreprit de changer
la forme de leur gouvernement; & après, a voir fur-
pris la citadelle de Thèbes dans latroifieme année de
la 99e. olympiade ; après avoir détruit ou difîipé
tout ce qui réfiftoit, elle dépofa l’autorité entre les
mains des principaux citoyens, qui la plupart agirent
de concert avec elle. Pélopidas, à la tête des bannis,
& avec le fecours d’Athènes , rentre fécrettement
dans Thèbes au bout de quarante ans, extermine les
tyrans, chaffela garnifon lacédémoniënne, & remet
fa patrie en liberté.
Jufque- là Thèbes unie tantôt à Sparte, tantôt
avec Athènes, n’avoit tenu que lé {ecohd rang,fans
que l ’on foupçonnât qu’ùrï jour elle occubérbit lé premier.
Enfin les Thébaîns naturellement forts & robu-
fteS y de plus' extrêmement agtiérris, pour avoir pref
H h