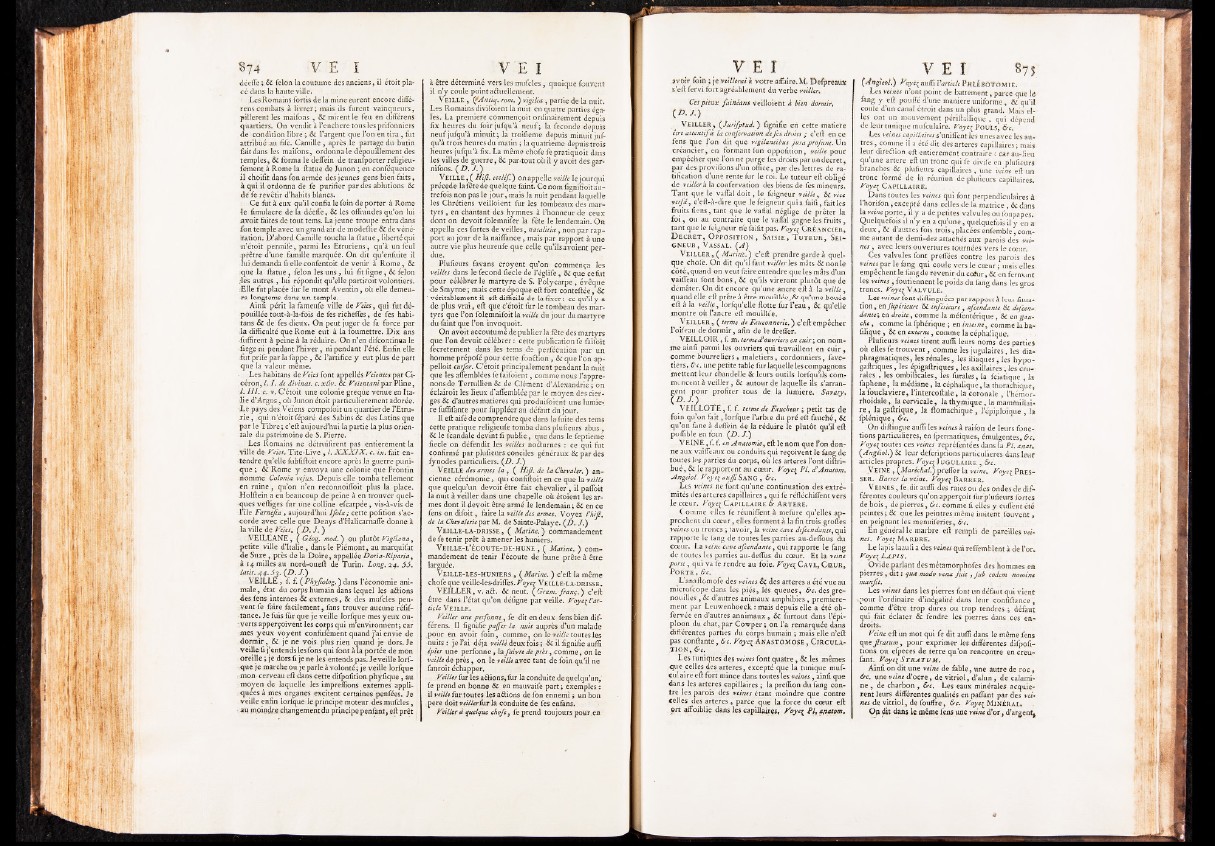
« 7 4 V E I
déeffe félon la coutume des anciens, il étoit placé
dans la haute ville.
' Les Romains fortis de la mine eurent encore diffé-
rens combats à livrer ; mais ils furent vainqueurs,
pillèrent les maifons , & mirent le feu en diiférens
quartiers. On vendit à l’enchere tous les prifonniers
de condition libre ; 6c l’argent que l’on en tira , fut
attribué au fîfc. Camille, après le partage du butin
fait dans les maifons, ordonna le dépouillement des
temples, 6c forma le delfein de tranlporter religieu-
fément à Rome la ftatue de Junon ; èn conféquence
il choifit dans fon armée des jeunes gens bien faits,
à qui il ordonna de fe purifier par des ablutions 6c
de fe revêtir d’habits blancs.
Ce fut à eux qu’il confia le foin de porter à Rome
le fimulacre de la dédie, 6c les offrandes qu’on lui
avoit faites de tout tems. La jeune troupe entra dans
fon temple avec un grand air de modeftie & de vénération.
D’abord Camille toucha la ftatue, liberté qui
■ n’étoit permife, parmi les Etruriens, qu’à un feul
;prêtre d’une famille marquée. On dit qu’enfuite il
lui demanda fi elle confentoit de venir à Rome, 6c
;qiie la flatue, félon les uns, lui fit ligne, 6c félon
dés autres , lui répondit qu’elle partiroit volontiers.
:Elle fut.placée fur le mont Aventin, où elle demeur
a longtems dans un temple.
Ainfi périt la fameufe ville de Vues, qui fut dépouillée
tout-à-la-fois de fes richeffes, de fes habi-
tans & de fes dieux. On peut juger de fa force par
la difficulté que Rome eut à la foumettre. Dix ans
•fuffirent à peine à la réduire. On n’en difcontinua le
• fiege ni pendant l’hiver, ni pendant l’été. Enfin elle
fut prife par la fappe, & l’artifice y eut plus de part
que la valeur même.
Les: habitans de Véies font appelles Ve.ieh.tes par Ci-
.céron, /, I.de divinat. c.xliv. 6c Veltntani par Pline,
l . III. c. v. C ’étoit une colonie greque venue en Italie
d’Argos, où Junon étoit particulièrement adorée.
•Lé pays des. Veïens co.mpofoit un quartier de l’Etru-
^rie, . qui n’étoit féparé des Sabins 6c des Latins que
par le Tibre ; c’eft aujourd’hui la partie la plus orientale
du patrimoine de S. Pierre.
Les Romains ne détruifirent pas entièrement la
.'ville, de Veïes. T ite-Live , /. X X X IX . c. ix. fait entendre
qu’elle fubfifloit encore après là guerre punique
; & Rome y envoya une colonie que Frontin
nomme Colonia vejus. Depuis elle tomba tellement
en ruine, qu’on n’en reconnoiffoit plus la place.
Holftein a eu beaucoup de peine à en trouver quelques
vertiges fur une colline efcarpée, vis-à-vis de
Vile .Farnefia, aujourd’hui Ifola; cette pofition s’accorde
avec celle que Denys d’Halicarnaffe donne à
la ville de Vues, (D . J.')
VEILLANE, ( Géog. mod. ) ou plutôt Vigliana,
petite ville d’Italie , dans le Piémont, au marquifat
de Suie , près de la Doire, appellée Doria-Riparia,
à 14 milles au nord-oueft de Turin. Long. 24. 55.
latit. 4 4 .5j , (Z). J.)
VEILLE, f. £ ( Phyjîolog. ) dans l’économie animale
, état du corps humain dans lequel les aélions
des f,éns internes-& externes, & des mùfcles peuvent
fe faire facilement, fans trouver aucune réfif-
.tance. Je fuis fur que je veille lorfque mes yeux ou-
: verts apperçoivent les corps qui m’environnent; car
mes yeux voyent confùfement quand j’ai envie de
dormir, & je ne vois plus rien quand je dors. Je
veille fi j’entends les fons qui font A la portée de mon
oreille ; je dors fi je ne les entends pas. Je veille lorfque
je marche ou je parle à volonté; je veille lorfque
■ mon cerveau eft dans cette difpofition phyfique, au
moyen de laquelle les impreffions externes appliquées
à mes organes excitent certaines penfées. Je
veille enfin lorfque le principe moteur desmufcles,
au moindre changement du principe.penfant, eft prêt
V E I
à être déterminé vers les mufcles , quoique fouvent
il n’y coule point aéluellement.
V eille , (fAntiq. rom. ) vigilia , partie de la nuit.
Les Romains divifôient la nuit en quatre parties égales.
La première commençoit ordinairement depuis
fix heures du foir jufqu’à neuf ; la fécondé depuis
neuf jufcju’à minuit; la troifieme depuis minuit jufqu’à
trois heures du matin ; la quatrième depuis trois
heures jufqu a fix. La même chofe fe pratiquoit dans
les villes de guerre, 6c par-tout où il y avoit des gar-
nifons. ( D . J. )
Veille , ( Hifi. eccléf. ) on appelle veille le jourqui
précédé la fête de quelque faint. Ce nom fignifioit autrefois
non pas le jour, mais la nuit pendant laquelle
les Chrétiens veilloient fur les tombeaux des martyrs
, en chantant des hymnes à l’honneur de ceux
dont on devoit folemniier la fête le lendemain. On
appella ces fortes de veilles, natalitioe, non par- rapport
au jour de la naiffance, mais par rapport à une
autre vie plus heureufé que celle qu’ils avoient perdue.
Plufieurs fovans croyent qu’on commença les
veilles dans le fécond fiecle de l’églife, & que ce fut
pour célébrer le martyre de S. Polycarpe, évêque
de Smyrne ; mais cette époque eft fort conteftée, 6c
* véritablement il eft difficile de la fixer : ce qu’il y a
de plus vrai, eft que c’étoit fur le tombeau des martyrs
que l’on folemnifoit la veille du jour du martyre
du faint que l’on invoquoit.
On avoit accoutume de publier la fête des martyrs
que l’on devoit célébrer : cette publication fe faifoit
fecretement dans les tems de perfécution par un
homme prépofé pour cette fonûion, & que l’on ap-
pelloit curfor. C ’etoit principalement pendant la nuit
que les affemblées fefaifoient, comme nous l’apprenons
de Tertullien & de Clément d’Alexandrie ; on
éclairoit les lieux d’affemblée par le moyen des cierges
& d’autres matières qui produifoient une lumière
fuffifante pour fuppléer au défaut du jour.
Il eft aifé de comprendre que dans la fuite des tems
cette pratique religieufe tomba dans plufieurs abus.-
& le fcandale devint fi public, que dans le feptieme
fiecle on défendit les veilles noéturnes : ce qui fut
confirmé par plufieurs conciles généraux 6c par des
fynodes particuliers; {D. J.')
Veill e des armes la , ( de la Chevaler. ) ancienne
cérémonie , qui confiftoit en ce que la veille
que quelqu’un devoit être fait chevalier , il paffoit
la nuit à veiller dans une chapelle où étoient les armes
dont il devoit être armé le lendemain; & en ce
fens on difoit, foire la veille des armes. Voyez Phi f l.
de la Chevalerie par M. de Sainte-Palaye. {JD. J.)
Veille-la-d r is s e , ( Marine. ) commandement
de fe tenir prêt à amener les huniers.
Veille- l’Éco u te-de-hune , ( Marine. ) commandement
de tenir l’écoute de hune prête à être
larguée.
Veille- les-HUNIERS , ( Marine. ) c’eft la même
chofe que veille-les-driffes. Voye^ Veille-la-drisse.
VEILLER, v. aft. & neuf. {Gram, franç.) c’eft
être dans l’état qu’on défigne par veille. Voye^Varticle
Veille.
Veiller une perfonne, fe dit en deux fens bien dif-
férens. Il fignifie pajfer la nuit auprès d’un malade
.pour en avoir foin, comme, on le veille toutes les
nuits: je l’ai déjà veillé deux fois; & il fignifie auffi
épier une perfonne, lafuivrede prés, comme, on le
veille de près, on le veille avec tant de foin qu’il ne
fatiroit échapper.
Vùller fur les aâions, fur la conduite de quelqu’un,
fe prend en bonne 6c en mauvaife part ; exemples :
il veille fur.toutes les a&ions de fon ennemi ; un bon
pere doit veiller fur la conduite de fes enfons.
Veiller à quelque chofe, fe prend toujours pour .en
VET
.avoir foin ; je veillerai à votre affaire. Mi Defprèâüx
s’eft fervi fort agréablement du verbe veillen
Ces pieux faihédns Veilloient à bien dormit.
{ £ . J .)
V eil ler, ( Jurifptud. ) fignifie en cette matière
être attentif à la confervaùon de fes droits ; e’ eft en ce
fens que l’on dit que vigilantibus jura profung. Un
créancier, en formant fon oppofition, veille pour
empêcher que l’on ne purge fes droits par un decret,
par des provifions d’un office, par des lettres de ratification
d’une rente fur le roi. Le tuteur eft obligé
de veiller à la confervation des biens de fes mineurs.
Tant que le vaffal do it, le feigneur veille, & vice
verfâ, c’eft-à-dire que le feigneur qui a faifi, fait les
fruits fiens, tant que le vaflàl néglige de prêter la
f o i , ou au contraire que le vaffal gagne les fruits,
tant que le feigneur vie faifit pas. Voye[ C réancier,
D e c r e t , Op p o s it io n , Sa is ie , T u t eu r , Se igneur,
V assal. {A )
V eiller, ( Marini.') c’ eft prendre garde à quelque
chofe. On dit qu’il faut veiller les mâts 6c non le
côté,quand on veut faire entendre que les mâts d’un
vaiffeau font bons, 6c qu’ils vireront plutôt que de
démâter. On dit encore qu’une ancre eft à la veille,
quand elle eft prête à être mouillée, 6c quùrne bouée
eft à la veille, lorfqu’elle flotte fur l’eau, 6c qu’elle
montre où l’ancre eft mouillée.
V eiller , ( terme de Fauconnerie. ) c’ eft empêcher
,1’oifeau de dormir, afin de le dreffer.
VEILLOÏR, f. m. terme eTouvriers en cuir ; on nomme
ainfi parmi les ouvriers qui travaillent en cuir ,
comme bourreliers , maletiers, cordonniers, fave-
tiers, 6c. une petite table fur laquelle les compagnons
mettent- leur chandelle & leurs outils lorfqu’ils conv*
mencent à veiller, 6c autour de laquelle ils s’arrangent
pour profiter tous de la lumière. Savdry. WHÊÊk V EILLOTE, f. f. terme de Faucheur ; petit tas de
foin qu’on fait, lorfque l’arbre du pré eft fauché, &
qu’on fane à delfein de la réduire le plutôt qu’il eft
poffibie en foin (D . J.)
VEINE, f. f. en Anatomie, eft le nom que fon donne
aux vaiffeaux ou conduits qui reçoivent le fang de
toutes les parties du corps, où les arteres l’ont diftri-
bué, 6c le rapportent au coeur. Voye^ PI. d’Anatom.
Angeiol. Voye{ aujji S AN G , &c.
Les veines ne font qu’une continuation des extrémités
des arteres capillaires, qui fe réfléchiffent vers
Je coeur. Voye[ Capillaire & A rtere.
Comme elles fe réunifient à mefure qu’elles approchent
du coeur, elles forment à la fin trois groffes
veines ou troncs ; lavoir, la veine cave defcendante9 qui
rapporte le lang de toutes les parties au-deffous du
coeur. La veine cave aj,'tendante, qui rapporte le fang
de toutes les parties au-deffus du coeur. Et la veine
porte, qui va fe rendre au foie. Voye^ C ave, Coeur,
Po r t e , .6c, \
L’anaftomofe des veines 6ç des arteres a été vue au
microfcope dans les piés, lés queues, &c. des grenouilles
, & d’autres animaux amphibies, premièrement
par Leuwenhoeck : mais depuis elle a été ob-
fervée en d?autres annimaux, 6c furtout dans l’épiploon
du chat, par Cowper; on l’a remarquée dans
différentes parties du corps humain ; mais elle n’eft
pas confiante, &c. Voye^ A n a stom o se, C irculat
io n , & ç.
Les tuniques des veines font quatre, 6c les mêmes
que celles des arteres, excepté que la tunique muf-
culaire eft fort mince dans toutes les veines, ainfi que
dans les arteres capillaires ; la preffion du fang contre
les parois des veines étant moindre que contre
celles des arteres , parce que la force du coeur eft
ort affoiblie dans les capillaires, é^oye^ PI, atiatom.
V E I 875
(Aügteàl.) Vryii auffi l’article PHLeBÔ'TÔMîÊ;
. Les veines n’ont point de battement, parce que lé
fang y eft pouffé d’une maniéré uniforme, & qu’il
coule d’un canal étroit dans un plus grand. Mais eU
les o n t un mouvement périftallique , qui dépend
de lèiir tunique mufcùlaire. Voyc[ Pouls, & c.
Les veines capillaires s’unifient les unes avec lés autres
, comme il a été dit des arteres capillaires ; mais
leur dirèdion eft entièrement contraire c car âu-lieit
qu une artere eft un tronc qui fe divife en plufieurs
branches 6c plufieurs capillaires , une veine eft un
tronc formé de la réunion de plufieurs capillaires,
Voye^ C ap il lair e .
^ Dans toutes les veines qui font perpendiculaires à
l’horifén ; excepté dans celles de la matrice , & dans
la veine porte , il y a de petites valvules ou foupapes»
Quelquefois il n’y en a qu’une, quelquefois il y en a
deux, & d’autres fois trois, placées enfemble, comme
autant de demi-dez attachés aux parois des vtl+
nés , avec leurs ouvertures tournées vers le coeur,
Ces valvules font preffées contre les parois des
veines par le fang qui coule vers le coeur ; mais elles
empêchent le fang de revenir du coôur, & en fermant
les veines , foutiennent le poids du fang dans les gros
troncs. Voye^ Valvule.
Les veines font diftinguées par rapport à leur fitua-
tion , en fupérieure 6c inférieure , afeendante 6c defeen-
dante ; en droite, comme la méfentérique, 6c en gauche
, comme la fphérique ; en interne, comme la ba*
filique , 6c en externe, comme la céphalique.
Plufieurs veines tirent auffi leurs noms des parties
où elles fe trouvent, comme les jugulaires, les diaphragmatiques,
les rénales, les iliaques, les hypo*
gaftriques, les épigaftriques, les axillaires ; les crurales
, les ombilicales, les furales, la feiatique , la
faphene, la médiane, la céphalique, la thorachique,
la fouclaviere, l’intercoftale, la coronale , l’hémor-
rhoïdale ,1 a cervicale, la thymique , la mammillai-*
r e , la gaftrique, la ftomachique, l’épiploïque , la
fplénique , &c.
On diftingue auffi les veines à raifon de leurs fonctions
particulières, en fpermatiques, émulgentes,
Voyt{ toutes ces veines repréfentées dans la PL. anau
(Angéiol.) 6c leur deferiptions particulières dans leur
articles propres. Voye{ J ugulaire , &c.
V EINE , {Maréchal.) preffer la veine. Poye^ PRESSER.
Barrer la veine. Voye[ Barrer.
V eines , fe .dit auffi des raies ou des ondes de différentes
couleurs qu’on apperçoit fur plufieurs fortes
de bois, dé pierres, &c. comme fi elles y euffent été
peintes ; & que les peintres même imitent fbuveht,
en peignant les menuiferies, 6c.
En général le marbre eft rempli de pareilles veines.
Foyei Marbre.
Le lapis lazuii a des veines qui reffemblent à de l’or.
Foye[ L a p i s .
Ovide parlant des métamOrphofes des hommes en
pierres , dit : qua modo vena fu it } fub codent no mine
manjit.
Les veines dans les pierres font un défaut qui vient
^pour l’ordinaire d’inégalité dans leur confiftance,
comme d’être trop dures ou trop tendres ; défaut
qui fait éclater 6c fendre les pierres dans ces endroits.
V\ine eft un irtot qui fe dit auffi dans le même fens
que firatum, pour exprimer les différentes difpofi-
tions ou efpeces de terre qu’on rencontre en creu-
fant. Voye{ S t r a t u m .
Ainfi on dit une veine de fable, une autre de roc ,
6c. une veine^ d’ocre, de vitriol, d’alun, de calamine
, de charbon , & c. Les eaux minérales acquièrent
leurs différentes qualités en paffant par des veines
de vitriol, de fouftre, &c. Voyt{ M inéral.
Oo dît dans le même fens une veine d’o r , d’argent^