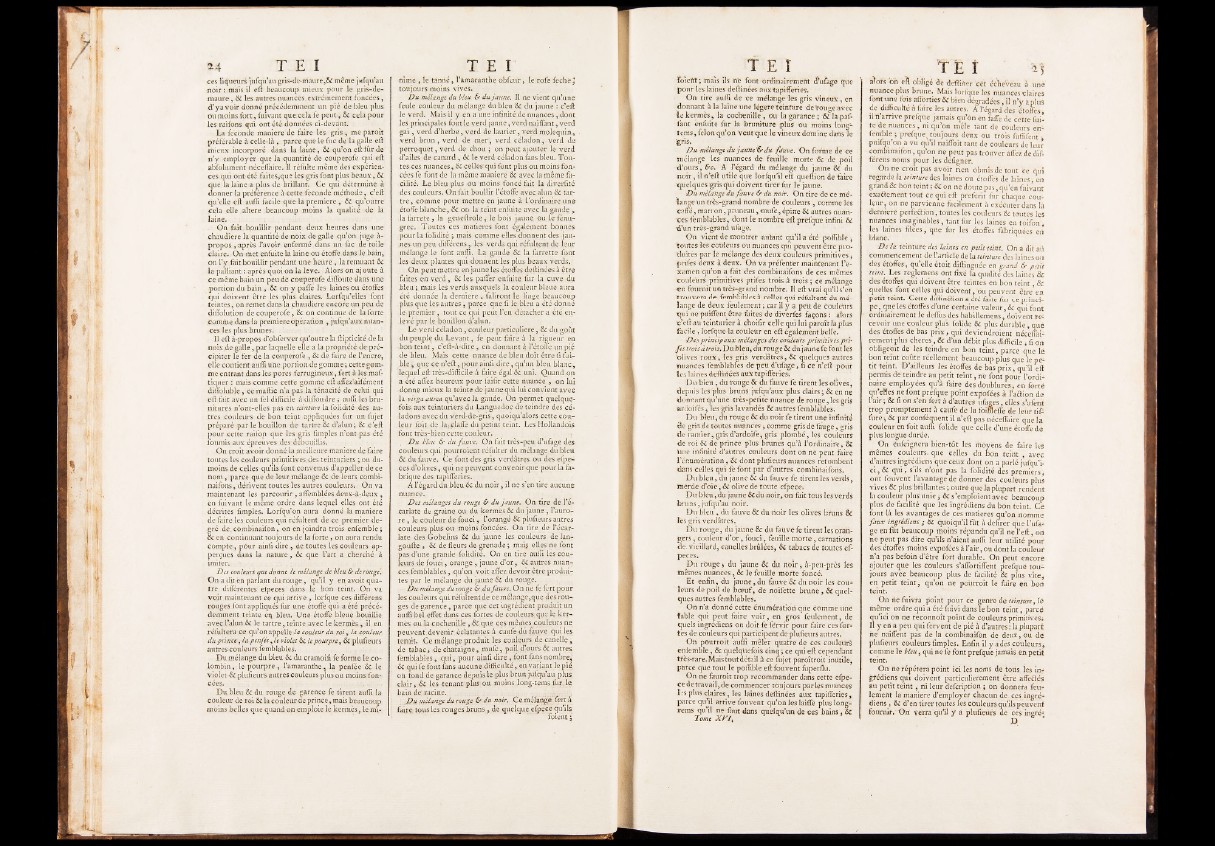
ces liqueurs jufqu’au gris-de-maure,& même jHfqu’au
-noir : mais il eu beaucoup mieux pour le gris-de-
maure ,6c les autres nuancés extrêmement foncées,
d ’ y a voir donné précédemment un pié de bleu plus
mt moins fort, fuivant que cela fe peut',. 6c cela pour
les raifons qui ont été données ci-devant,
La fécondé maniéré de faire les gris ; me paroît
-préférable à celle-là ,■ parce que le fuc de la galle eft
mieux incorporé dans la laine, 6c qu’on eft'fûr de
n’y employer que la quantité de couperofe qui eft
abfolument néceffaire. Il réfulte même des expériences
qui ont été faites,que les gris font plus beaux, &
que la laine a plus de brillant. Ce qui détermine à
donner la préférence à cette fécondé méthode, c’eft
qu’elle eft auffi facile que la première , 6c qu’outre
cela elle .altéré .beaucoup moins la qualité de la
laine,
- On fait, bouillir pendant deux heures dans u n e
chaudière la quantité de noix de galle qu’on juge à-
proposi , après l’avoir enfermé dans un fac de toile
claire. On met énfuite la laine ou étoffe dans le bain,
on l’y fait bouillir pendant une heure , la remuant 6c
la palliant : après quoi on la leve. Alors on ajoute à
ce même bain un peu de couperofe diffoiite dans une
portion du bain , & on y .paffe les laines où étoffes
qui doivent être les plus claires. Lorfqu’elles font
teintes, on remet dans la chaudière encore un peu de
diflolution de couperofe, 6c on continue dè la forte
comme dans la première opération , jufqu’aiix nuances
les plus brun es.
IL eft à-propos d’obferver qu’outre la ftipticité de la
noix.de galle, par laquelle elle a la propriété de précipiter
lé fer de la couperofe , 6c de faire de l’encre,
elle contient auffi une.portion.de gomme » cette gomme
entrant dans lès pores ferrugineux, fert à les maf-
tiquer : mais comme cette gomme eft affëz'aifément
diffoiuble , ce maftic n’a pas.la ténacité de celui- qui
eft fait avec un fel difficile à diflou dre ; auffi les brunit
ur es n’ont-elles pas en teinture la folidité- des autres
couleurs dé bon teint appliquées fur-un fujet
préparé par le bouillon -.de- tartre 6c d’alun; & c ’eft
pour .cette raifop que les gris Amples n’ont pas été
fournis aux épreuves desrdebouillis.
On croit avoir donné la meilleure maniéré de faire
toutes les couleurs primitives, des teinturiers ; ou du-
moins de celles qu’ils font .convenus d’appeller de ce
nom, parce que de leur mélange 6c de leurs combi-
naifons, dérivent toutes les autres couleurs., On va
maintenant les parcourir , affemblées deux-à7deux ,
en fuivant le même ordre dans lequel elles ont été
décrites fimples. Lorfqu’on aura donné la maniéré
de faire les'couleurs qui réfultënt de ce premier degré
de. combinaifon, on en joindra trois enfemble;
6c en continuant toujours de la forte, on aura rendu
compte, pour ainli dire , -dè toutes les couleurs ap-
perçues dans la nature , 6c que l’art a cherché à
imiter.:,■ ».
Des couleurs que donne le mélange de blcu & de rouge'.
On a dit èn parlant du rouge, qu’il y en avoit quatre
différentes' elpeces dans le bon teint. On va
voir maintenant ce qui arrive , lorfque ces différens
rouges.font appliqués fur une étoffe qui a été précédemment
teinte eq bleu.TJne étoffe bleue bouillie
avec l’alun 6c le tartre, teinte avec le kermès., il en
réfultera- ce qu’on appelle -/a couleur du roi,, la couleur,
dit prince, ta penfée, le violet 6c le pourpre, & .plufieurs
autres couleurs femblabl.es.
Du mélange du bleu 6c du cramoifi fe forme le colombia,
le pourpre, l’amaranthe. la penfée 6c le
violet & plufieurs autres couleurs plus ou moinsfon-,
cées.
Du, bleu & du rouge de garen.ee fe tirent auffi la
couleur de roi 6c la couleur de prince, mais beaucoup:
moins belles que quand on emploie le kermès., le minimè
, le tanrté, l’amaranthe obfcur, le rofe fechè $
toujours moins vives.
Du mélange du bleu & du jaune. II ne vient qu’une
feule couleur du mélange du bleu 6c du jaune : c’eft
le verd. Mais il y en a une infinité de nuances, dont
les principales font le verd jaune, verd na.iffant, verd
g a i, verd d’herbe, verd de laurier, verd molequin,
vërd brün, verd de mer', verd céladon, verd de
perroquet, verd de chou ; on peut ajouter le verd
d’ailes de canard, 6c le verd céladon fans bleu. Toutes
ces nuances, Sccelles'qui font plus ou moins foncées
fe font de la même maniéré ôç avec, la même facilité.
Le bleu plus Où moins foncé fait la diverfité
des coulçurs. On fait boullir l’étoffe avec alun 6c tartre,
comme pour mettre en jaune à l ’ordinaire un®
étoffe blanche, 6c on. la teint enfuite avec la gau de ,
la farrete , la geneftrole, le bois jaune, ou le fénu-
grec. Toutes ces matières font également bonnes
.pour la folidité ; mais comme elles donnent des (jaunes
un peu différens, les verds qui réfultënt de leur
mélange le font auffi. La gaude 6c la farrette font
les deux plantes qui donnent les plus beaux verds. ;
On peut mettre en jaune les étoffes deftinées à être
faites en verd , 6c les, paffer enfuitë. fur la cuve du
bleu ;, mais les Verds auxquels la couleur bleue aura
été donnée la derniere , faliront le linge beaucoup
.plus que les autres , parce que fi le bleu a été donné
le premier , tout ce qui peut l’en détacher a été enlevé
par le bouillon d’alun.
Le verd céladon, couleur particulière, 6c du goût
du peuple du Levant, fe peut faire à la rigueur en
bon teint, c’eft-à-dire, en donnant à l’étoffe un pié
de bleu. Mais cette, nuance de bleu doit être fifoi-
bley que ce n’eft, pour-ainfi dire, qu’un bleu blanc-,
lequel eft très-difficile à faire égal & uni. Quand on
a été affez heureux pour faifir cette nuance , on lui
donne mieux la teinte de jaune qui lui convient avec
la yirgaaurea qu’avec.la gaude. On permet, quelquefois.
aux teinturiers du Languedoc de teindre des céladons
avec du verdçde-gris, quoiqu’alors cette couleur
fpk de la^çlàffe du petint teint. Les Hollandois
font très-bien çe.tte couleur.
Du bleu & du fauve. On fait très-peu d’ufage des
coulëurs qui p.ourroient réfulter du mélang.e du bleu
6c du fauve. Ce font des gris verdâtres ou des efpev
ces d’olives, qui ne peuvent convenir que pour la fabrique
des tapiffories.
A l’égard du bleu 6c du noir, il ne s’en tire aucune
nuance.;
Des mélanges du rouge & du jaune. On tire de l’é-
.carlate de graine où du kermès & du jaune , l’aurore
, le couleur de fouci, l ’orangé & plufieurs autres
couleurs plus ou moins foncées. On tire de l’écarlate
des Gobelins 6c du jaune les couleurs de laa-
goufte , 6c de fleurs de grenade ; mais elles ne font
pas d’une grande folidité. On en tire auffi les couleurs
de fouci, orange , jaune d’o r , & autres nuan-r
.ces femblables, qu’on vpit affez devoir être produites
par le mélange du jaune & du rouge.
Du mélange du rouge &,du fauve. On ne fe fert pour
les couleurs qui réfultënt de ce mélange,que des rouges
de garence, parce que cet ingrédient produit un
auffi bel effet dans ces fortes de couleurs, que le kermès
o,u la cochenille , & :que cesJmêmes .couleurs ne
peuvent , devenir éclatantes à caufe du fauve qui les
ternit. Ce mélange produit les couleurs de canelie ,
de tabac, de châtaigne, mufe, poil ,d’ours 6c autres,
femblables, qui, pour ainfi dire , font Caps nombre^
6c qui fe font fans aucune difficulté, en variant le pie,
où fond de garance depuis,le plus brun jufqu’au plus,
clair, 6c les .tenant plus ou moins fong-tems fur. le
bain de; racine. . . v c. :
Du mélange du rouge <S* du noir. Ge. mélange fert à
faire tous les rouges bruns, de quelque efpece qu’ils
foient;
ïcncftt ; mais ils ne font ordinairement coulage que
|iour les laines deftinées auxtapifferies.
On tire auffi de -ce mélange lès gris Vineux, erî
donnant à la laine une légère teinture de'Tougeavec
le kermès, la cochenille, o’u la garance ; & la paf-
iànt enfuite fur la bruniture plus ou moins lohg-
tems, félon qu’on Veut que le vineux démine dans le
BU I \
Du mélangé du jaune & du fdtive. On form e de ce
mélange les nuances de feuille morte & de poil
d ’ours, &o. A l’égard du mélange du jaune 6c du
n o ir, il n ’eft utile que lorsqu'il eft queftion de foire
■ quelques gris qui doivent tirer fur le jaune.
Du mélange du fauve & du noir. On tire dé ce mélange
un très-grand nombre de couleurs, comme les
'cafte, marron, pruneau, mufe,épine 6c autres nuances
fembîables, dont le nombre eft prefque infini 6c
■ d’un très-grand ufege.
On vient de montrer autant qu’il a été poffiblè -,
toutes les couleurs où nuances qui peuvent être produites
par le mélange des deux couleurs primitives *
prîtes deux à deux. On va préfentër maintenant l’examen
qu’on a fait des combinaifons de ces mêmes
couleurs primitives prifes trois à trois ; ce mélange
•en fournit Un très-grand nombre. Il eft vrai qu’il s’en
trouvera dé femblables à celles qui réfuirent du mélange
de deux feulement ; car il y a peu de couleurs
•qui ne puiffent être faites de diverfes façons : alors
c ’eft au teinturier à choifir celle qui lui paroît la plus
facile, lorfque là eolileür en eft également belle.
■ Des principaux mélanges des couleuts primitives prî*
.fes trois à trois. Du bleu j du rouge Sc du jaune fe font les
olives rou x, -les gris verdâtres, 6c quelques autres
•nuances femblables de peu d’ufage , fi ce n’eft pour
les 1 aines deftidées aux tapifferiesi
Du bleu, du rouge & du fauve fe tirent les olives,
depuis les'plus bruns jufqu’atix plus clairs; & en n e
donnant qu’une très-petite nuance dè rouge, les gris
ardoifés ^ les gris lavandés & autres femblables.
Du bleu, du rouge & du noir fe tirent une infinité
de gris de toutes nuances > comme gris de fauge, gris
de ramier, grisd’ardoife, gris plombé^ les coulëurs
de roi & dé prince plus brunes qu’à l’ordinaire * &
Une infinité d’autres couleurs dont on ne peut faire
l’énumération, 6c dont plufieurs nuancés retombent
dans Celles qui fe font par d’autres combihaifohs.
Du b leu, du jaune 6c du fauve fe tirent les verds,
hrerde d’o ie, 6c olive de toute efpece»
Du bleu, du jaune 6c du noir, on fait tous les verds
bruns, jufqu’au noir.
Du bleu , du fauve &c du tioir les olives bruns &
les gris verdâtres.
Dii rouge, du jaune 6c du fauve fe tirent les orangers
, couleur d’o r , fouci, feuille morte, carnations
de. Vieillard, eanellës brûlées, & tabacs de toutes ef-
peceSi
Du rbuge * du jatine 6c du hoir * à-peu-près ie$
înêmes nuancés, & le feuille morte foncé;
Et enfin , du jaune ^ du fauve 6c du noir les fcou-
leiifs dè poil de boeuf, de noifette brunë, & quelques
autres femblables.
Oh n’a donné cette énumération que comme Uné
labié qui peut faire v o ir , en gros feulement, de
quels ingrédiens on doit fe férvir pour faire ces fortes
de couleurs qui participent de plufieurs autres.
On pourroit auffi mêler quatre de ces couleurs
enlemble, 6c quelquefois cinq; ce qui eft cependant
tfès^rare. Mais tout détail à ce lujet paroîtroit inutile,
parce qüë tout le poffiblè eft fouvent fuperflu.
On ne fauroit trop recommander dans cette ëfpe-
ce de travail, de commencer tbujours parles nuànces
les plus claires, les laines deftinées aux tapifferiës,
parce qu’il arrive fouvent qu’on les laiffe plus long-
rems qu’il ne fout dans quelqu’un de ces bains, 6c
Tome X P I i
atofs ôh eft oblige de deftirter cët échévèau à unè
nuance .plus brune. Mais lorique les nuances claires
fontune fois affôrties & bien dégradées > il n’y a plus
de difficulté à faire les autres. A l’égard des étoffes,
il n’arrive prefque jamais qu’on en faffe de cette fuite
de nuances , ni qu’on mêle tant de couleurs enfemble;
prefque^ toujours deux ou trois füffifent i
puifqu’on a vu qu’il naiffoit tant de couleurs de leur
combinaifon, qu’on ne peut pas trouver affez de différens
noms pour les défigner.
On ne croit pas avoir rien obmis de tout ce qui
regarde la teinture des laines ou étoffes de laines; en
grand 6c bon teint ; 6c on ne doute pas, qii’en fuivant
exactement tout ce qui eft preferit fur chaque couleur,
on ne parvienne facilement à exécuter dans là
derniere perfection, toutes les couleurs 6c toutes les
nuances imaginables, tant fur les laines en toifon,
les laines filées, que fur les étoffes fabriquées en
blanc.
De là teinture des laines en petit teint. On a dit au
■ commencement de l’article de la teinture des laines ou
des étoffes, qu’elle étoit diftingilée en grand & pêtït
teint. Les reglemens Ont fixé la qualité des laines 6c
des étoffes qui doivent être teintes en bon teint, 6c
quelles font celles qui doivent, ou peuvent être en
petit teint. Cette diftin&ion a été faite fur ce principe,
que les étoffes d’une certaine valeur, 6c qui font
ordinairement le deffus des habillemens, doivent recevoir
une couleur plus folide & plus durable, que
des étoffes de bas prix, qui deviendroient nécefiai-
rement plus cher es, 6c d’un débit plus difficile ; fi on
obligeoit de les teindre en bon teint, parce que lé
bon teint coûte réellement beaucoup plus que le pe*
tit teint. D’ailleurs les étoffes de bas prix, qu’il eft
permis de teindre au petit teint, ne font pour I’ordi*
naire employées qu’à faire des doublures ; en forte
qu’eMes ne font prefque point expoféeS à l’aûion de
l’air ; & fi on s’ëh fert à d’autres ufages, elles sTifent
trop promptement à caufe de la foiieffe de leur tib
fure ; & par eonféquent il n’eft pas néceffaire que la
couleur en foit auffi folide que celle d’une étoffe de
plus longue durée.
On énfeigriera bien-tôt les moyens de faire les
mêmes couleurs, que celles du bon teint , avec
dW res ingrédiens que ceux dont on a parlé jufqu’i-
c i , 6c q ui, s’ils n’ont pas la folidité des premiers i
ont fouvent l’avantage de donner des couleurs plus
vives & plus brillantes ; outre que la plupart rendent
la couleur plu^Unie 3 & s’emploient avec beaucoup
plus de facilité que les ingrédiens du bón teint. Ce
font là les avantages de ees matières qu’on nomme
faux ingrédiens ; 6c quoiqu’il fût à defirer que l ’ufa-
ge en fut beaucoup moins répandu qu’il ne l’eft, on
ne peut pas dire qu’ils n’aient auffi leur utilité pour
des étoffes moins expofées à l’air, ou dont la couleur
n’a pas befoin d’être fort durable. On peüt encore
ajouter que les Couleurs s’àffortiffetit prefqué toujours
avec beaucoup plus- de facilité & plus vite*
en petit teint; qu’on ne pourroit le faire en bon
teint;
On rie fuivra point pour ce gènrë de teinture, lé
riiême ordre qui a été fuivi dans le bon teint, parcé
qu’ici oh ne reconnoît point de couleurs primitivesi
Il y en a peu qui fervent de pié à d’autres : la plupart
rie naiffent pas de la combinaifon de deux, ou dé
plufieurs couleurs fimplès. Enfin il y a des couleurs;
commè le bleu i qui ne fe font prefque jamais eh petit
teint;
Ori ne répétera point ici les noms de totis les inr
gtédiens qui doivent particulièrement être affeâés
au petit tein t, ni leur defcriptiôn ; on donnera feu*
lëmeht la maniéré d’employer chacun de ees ingré*
diens j 6c d’en tirer toutes les couleurs qu’ils peuvent
fournir. On verra qu’il y a plufieurs de ces ingfé*