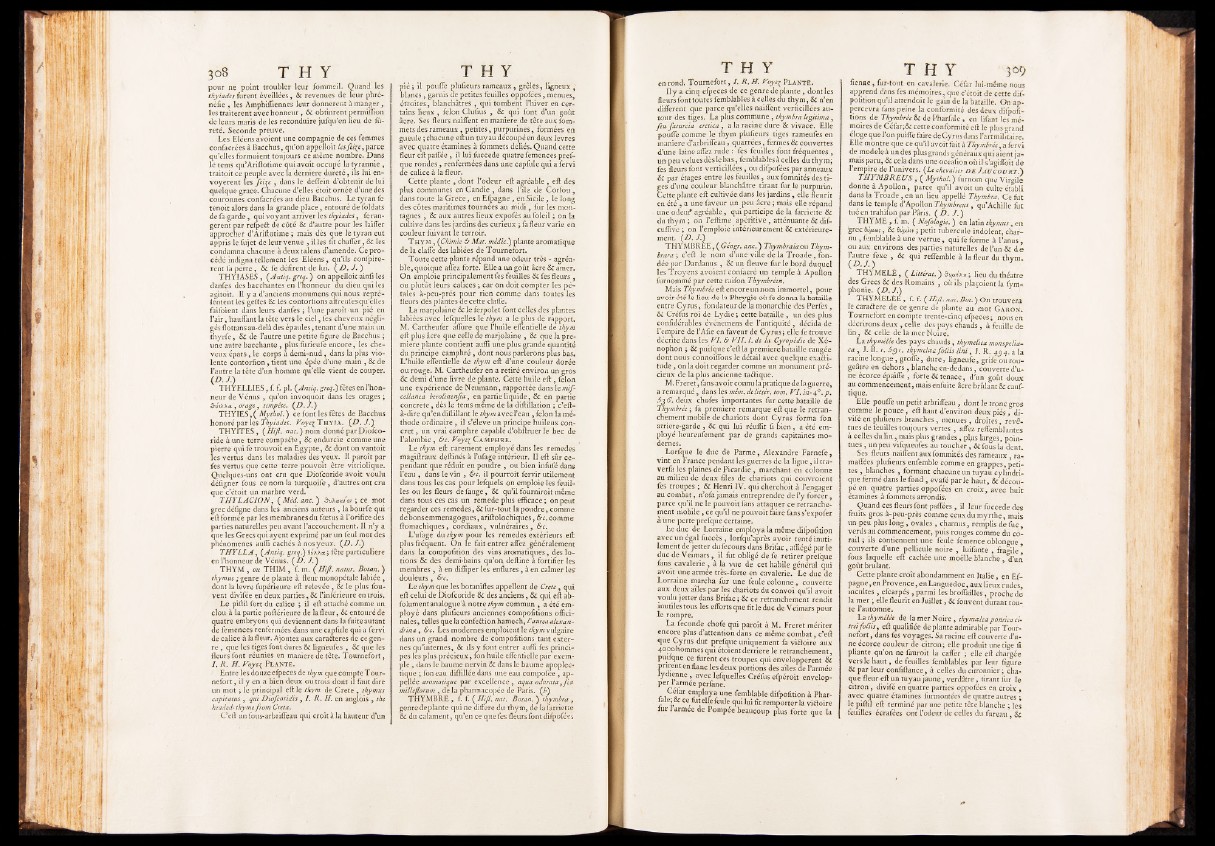
pour ne point troubler leur fommeil. Quand les
thyiades furent éveillées, & revenues de leur phré-
néfie , les Amphifliennes leur donnèrent à manger ,
les traitèrent avec honneur, 6c obtinrent permiftion
de leurs maris de les reconduire jufqu’en heu de fureté.
Seconde preuve.
Les Eléens avoient une compagnie de ces femmes
confacrées à Bacchus, qu’on appelloit lesfei^e, parce
qu’elles formoient toujours ce même nombre. Dans
lë tems qu’Arifïotime qui avoit occupé là tyrannie ,
traitoit ce peuple avec la derniere dureté, iis lui envoyèrent
les fei{e , dans le deffein d’obtenir de lui
quelque grâce. Chacune d’elles étoit ornée d’une des
couronnes confacrées au dieu Bacchus. Le tyran fe
tenoit alors dans la grande place, entouré de foldats
de fa garde, qui voyant arriver les thyiades, fe rangèrent
par relpeâ: de côté 6c d’autre pour les laiffer
approcher d’Ariftotime ; mais dès que lé tyran eut
appris le fujet de leur venue , il les nt chaffer, 6c les
condamna chacune à deux talens d’amende. Ce procédé
indigna tellement les Eléens , qu’ils confpire-
rent fa perte, 6c fe défirent de lui. ( D . J .)
THYIASES , (.Antiq. greq. ) on appelloit ainfi les
danfes des bacchantes en l’honneur du dieu qui les
agitoit. II y a d’anciens monumens qui nous repré-
fentent les geftes 6c les contorfions affreufes qu’elles
faifoient dans leurs danfes; l’une paroît un pié en
l’air, hauffant la tête vers le ciel, fes cheveux négligés
flottans au-delà des épaules, tenant d’une nîain un
thyrfe, 6c de l’autre une petite figure de Bacchus ;
une autre bacchante, plus furieufe encore, les cheveux
épars, le corps à demi-nud, dans la plus violente
contorfion, tient une épée d’une main , & de
l’autre la tête d’un homme qu’elle vient de couper.
(D . J.)
THYELLIES , f. f. pl. (Antiq. greq.') fêtes en l’honneur
de Vénus , qu’on invoquoit dans les orages ;
$ûtXXa. , orage, tempête. (D . J.)
THYIES, ( Mythol. ) ce font les fêtes de Bacchus
honoré par les Thyiades. Voye^Twnk. (D . J.)
THYITES , (Hiß. nat. ) nom donné par Diofco-
ride à une terre compaâe, 6c endurcie comme une
pierre qui fe trouvoit en Egypte, 6c dont on vantoit
les vertus dans les maladies des yeux. Il paroît par
fes vertus que cette terre pouvoit être vitriolique.
Quelques-uns ont cru que Diofcoride avoit voulu
défigner fous ce nom la turquoife, d’autres ont cru
que c’étoit un marbre verd.
THYLACION, ( Mèd.anc. ) $uXetx/cv ; ce mot
grec défigne dans les anciens auteurs , la bourfe qui
eft formée par les membranes du foetus à l’orifice des
parties naturelles peu avant l’accouchement. Il n’y a
que les Grecs qui ayent exprimé par un feul mot des
phénomènes auffi cachés à nos yeux. (D .J .)
THY LLA , (Antiq. greq.) Qvxxa.; fête particulière
en l’honneur de Vénus. (D .J . )
THYM , ou THIM , f. m. ( Hiß. natur. Botan. )
thymus ; genre de plante à fleur monopétale labiée ,
dont la levre fupérieure eft relevée , 6c le plus fou-
vent divifée en deux parties, 6c l’inférieure en trois.
Le piftil fort du calice ; il eft attaché comme un
clou à la partie poftérieure de la fleur, 6c entouré de
quatre embryons qui deviennent dans la fuite autant
de femences renfermées dans une capfule qui a fervi
de calice à la fleur. Ajoutez aux cara&eres de ce genre
, que les tiges font dures 6c ligneufes , 6c que les
fleurs font réunies en maniéré de tête. Tournefort,
J. R. H. Voye{ Plante.
Entre les douze efpeces de thym que compte Tour-
nefort, il y en a bien deux ou trois dont il faut dire
un mot ; le principal eft le thym de Crete , thymus
capitatus , qui Diofcoridis , /. R. H. en anglois , the
headed- thyme front Creta.
C’eft un fous-arbriffeau qui croît à la hauteur d’un
pié ; il pouffe plufieurs rameaux, grêles, ligneux ,
blancs, garnis de petites feuilles ôppofées, menues,
étroites, blanchâtres , qui tombent l’hiver en certains
lieux, félon Clulius , & qui font d’un goût
âcre. Ses fleurs naiffent en maniéré de tête auxfom-
mets des rameaux, petites, purpurines, formées en
gueule ; chacune eft un tuyau découpé en deux levres
avec quatre étamines à fommets déliés. Quand cette
fleur eftpaffée , il lui fuccede quatre femences pref-
que rondes, renfermées dans une capfule qui a fervi
de calice à la fleur.
Cette plante , dont l’odeur eft agréable , eft des
plus communes en Candie , dans l’ile de Corfou,
dans toute la GreCe, en Efpagne, en Sicile , le long
des côtes maritimes tournées au midi, fur les montagnes
j 6c aux autres lieux expofés aufoleil ; on ia
cultive dans les jardins des curieux ; fa fleur varie en
couleur fuivant le terroir.
T hym , (Chimie & Mat. médic.) plante aromatique
de la claffe des labiées de Tournefort.
Toute cette plante répand une odeur très - agréable,
quoique allez forte. Elle a un goût âcre & amer.
On emploie principalement fes feuilles & fes fleurs ,
ou plutôt leurs calices ; car on doit compter les pétales
à-peu-prés pour rien comme dans toutes les
fleurs des plantes de cette clafle.
La marjolaine 6c le ferpolet font celles des plantes
labiées avec lefquelles le thym a le plus de rapport.
M. Cartheufer affure que l’huile effentielle de thym
eft plus âcre que celle ae marjolaine , 6c que la première
plante contient auffi une plus grande quantité
du principe camphré, dont nous parlerons plus bas.
L’huile effentielle de thym eft d’une couleur dorée
ou rouge. M. Cartheufer en a retiré environ un gros
6c demi d’une livre de plante. Cette huile e f t , félon
une expérience de Neumann, rapportée dans 1 emif-
cellanea berolinenjia, en partie liquide, 6c en partie
concrète, dès le tems meme de la diftillation ; c’eft-
à-dire qu’en diftillant le thym avec l’eau , félon la méthode
ordinaire, il s’élève un principe huileux concret
, un vrai camphre capable d’obftruer le bec de
l’alembic, &c. Voye{ Camphre.
Le thym eft rarement employé dans les remedes
magiftraux deftinés à l’ufage intérieur. II eft sûr cependant
que réduit en poudre , ou bien infiifé dans
l’eau , dans le vin , &c. il pourroit fervir utilement
dans tous les cas pour lefquels on emploie les feuilles
ou les fleurs de fauge, 6c qu’il fourniroit même
dans tous ces cas un remede plus efficace ; on peut
regarder ces remedes, & fur-tout la poudre, comme
de bons emmenagogues, ariftolochiques, &c. comme
ftomachiques, cordiaux, vulnéraires , &c.
L’ufage du thym pour les remedes extérieurs eft
plus fréquent. On le fait entrer affez généralement
dans la coropofition des vins aromatiques, des lotions
& des demi-bains qu’on deftine à fortifier les
membres , à en diffiper les enflures, à en calmer les1
douleurs, &c.
Le thym que les botaniftes appellent de Crete , qui
eft celui de-Diofcoride 6c des anciens, 6c qui eft ab-
folument analogue'à notre thym commun , a été employé
dans plufieurs anciennes compofitions officir
nales, telles que la confection hamech, l'aureaalexan-
drina , &c. Les modernes emploient le thym vulgaire
dans un grand nombre de compofitions tant externes
qu’internes, & ils V font entrer auffi fes principes
les plus précieux, (on huile effentielle par exemple
, dans le baume nervin 6c dans le baume apoplectique.
; fon eau diftillée dans une eau compofee, ap-
pellée aromatique par excellence , aqua odorata 9feti
milleflorum , de la pharmacopée de Paris, (b)
THYMBRE , f. f. ( HUI, nat. Botan. ) thymbra ,
genre déplanté qui ne différé du thym, de lafarriette
6c du calament, qu’en ce que fes fleurs font difpofées
en rond. Tournefort, I. R. H. Voye^ Plante.
Il y a cinq efpeces de ce genre déplanté, dont les
fleurs font toutes femblables à celles du thym, & n’en
different que parce qu’elles naiffent verticillées autour
des tiges. La plus commune , thymbra Légitima,
feu faturcia cretica , a la racine dure & vivace. Elle
pouffe comme le thym plufieurs tiges rameufes en
maniéré d’arbriffeau, quarrées, fermes 6c couvertes
d’une laine affez rude : fes feuilles font fréquentes ,
un peu velues dès le bas, femblables à celles du thym;
fes fleurs font verticillées, ou difpofées par anneaux
6c par étages entre les feuilles, aux fomnités des tiges
d’une couleur blanchâtre tirant fur le purpurin.
Cette plante eft cultivée dans les jardins, elle fleurit
en été , a une faveur un peu âcre ; mais elle répand
une odeuf agréable, qui participe de la farriette 6c
du thym ; on l’eftime apéritive , atténuante 6c dif-
euffive ; on l’emploie intérieurement 6c extérieurement.
(D . J.)
TH Y MBREE, ( Géogr. anc. ) Thymbraïa ou Thym-
brara ; c’eft le nom d’une ville de la Troade, fondée
par Dardanus , 6c un fleuve fur le bord duquel
les T royens avoient confacré un temple à Apollon
furnommé par cette raifon Thymhrèen.
Mais Thymbrée eft encore un nom immortel, pour
avoir été le lieu de la Phrygie oit fe donna la bataille
entre Cyrus , fondateur de la monarchie des Perfes ,
6c Créfus roi de Lydie ; cette bataille , un des plus
confidérables événemens de l’antiquité , décida de
l’empire de l’Afie en faveur de Cyrus; elle fe trouve
décrite dans les FI. & V II. L. de la Cyropédie de Xé-
nophon ; 6c puifque c’eft la première bataille rangée
dont nous connoiffons le détail avec quelque exafti-
tude , onia doit regarder comme un monument précieux
de la plus ancienne taâique.
M. Freret, fans avoir connu la pratique de la guerre,
a remarqué, dans les mèm. de littér. toni. VI. in-q°. p.
6$ G. deux chofes importantes fur cette bataille de
Thymbrée ; fa première remarque eft que le retranchement
mobile de chariots dont Cyrus forma fon
arriere-garde , 6c qui lui réuffit fi bien, a été employé
heureufement par de grands capitaines modernes.
Lorfque le duc de Parme, Alexandre Farnefe,
vint en France pendant les guerres de la ligue, il tra-
verfa les plaines de Picardie , marchant en colonne
au milieu de deux files de chariots qui couvroient
fes troupes ; & Henri IV. qui cherchoit à l’engager
au combat, n’ofa jamais entreprendre de l’y forcer,
parce qu’il ne le pouvoit fans attaquer ce retranchement
mobile, ce qu’il ne pouvoit fairè fans s’expofer
à une perte prefque certaine.
Le duc de Lorraine employa la même difpofition
avec un égal fuccès , lorfqu’après avoir tenté inutilement
de jetter dufecours dans Brifac, affiégé par le
duc de Veimars, il fut obligé de fe retirer prefque
fans cavalerie , à la vue de cet habile général qui
avoit une armée très-forte en cavalerie. Le duc de
Lorraine marcha fur une feule colonne, couverte
aux deux aîles par les chariots du convoi qu’il avoit
voulu jetter dans Brifac ; 6c ce retranchement rendit
inutiles tous les efforts que fit le duc de Veimars pour
.le rompre.
La fécondé chofe qui paroît à M. Freret mériter
encore plus d’attention dans ce même combat, c’eft
que Cyrus dut prefque uniquement fa viftoire aux
4000hommes qui étoient derrière le retranchement,
puifque ce furent ces troupes qui enveloppèrent 6c
prirent en flanc les deux portions des aîles de l’armée
lydienne, avec lefquelles Créfus efpéroit envelopper
l’armée perfane.
. e? P W a une femblable difpofition à Phar-
lale, oc ce fut elle feule qui lui fit remporter la victoire
îurlarmeede Pompée beaucoup plus forte que la
fienne, fur-tout, en cavalerie. Céfàr lui-même nous
apprend dans fes mémoires, que c’étoit de cette difpofition
qu’il attendoit lé gain de la bataille. On ap-
percevra fans peine la conformité des deux difpofi-
tions de Thymbrée 6c de Pharfale , en lifant les mémoires
de Céfar;& cette conformité eft le plus grand
éloge que l’on puiffe faire deCyrusdans l’artmilitaire.
Elle montre que ce qu’il avoit fait à Thymbrée, a fervi
de modèle à un des plus graqds généraux qui aient jamais
paru, & cela dans une occafion oîi il s’agifloit de
l’empire de l’univers. (Le chevalier d e J au co u r t .)
THYM BREUS, ( Mythol.) furnom que Virgile
donne à Apollon, parce qu’il avoit un culte établi
dans la Troade , en un lieu appeilé Thymbra. Ce fut
dans le temple d’Apollon Thymbreus, qu’Achille fut
tué en trahifon par Pâris. (D . J .)
THYME , f. m. ( Nofologie. ) en latin thymus, en
jgrec Oùpaç, 6c ôvpkv ; petit tubercule indolent, charnu
, femblable à une verrue, qui fe forme à l’anus,
ou aux environs des parties naturelles de l’un & de
l’autre fexe , 6c qui reffemble à la fleur du thvm.
( D . j . ) . , m
THà M ELE, ( Littéral,') ; lieu du théâtre
des Grecs 6c des Romains , où ils plaçoient la fym-
phonie. (D. J.)
THYMÉLÉE, f. f. ( Hijl. nat. Bot. ) On trouvera
le cara&ere de ce genre de plante au mot Garon.
Tournefort en compte trente-cinq efpeces; nous en
décrirons deux , celle des pays chauds , à feuille de
lin, 6c celle de la mer Noire.
La thymêlée des pays chauds, thymelica monspelia-
ca, J. B. i. J g i . thymeloea foliis lini, J. R. 4^4. a la
racine longue , groffe, dure, ligneufe, grife ou rougeâtre
en dehors , blanche en-dedans, couverte d’une
écorce épaiffe , forte 6c tenace, d’un goût doux
au commencement, mais enfuite âcre brûlant6c cauf-
tique.
Elle pouffe un petit arbriffeau , dont le tronc gros
comme le pouce, eft haut d’environ deux pies , di-
vifé en plufieurs branches , menues , droites, revêtues
de feuilles toujours vertes , affez reffemblantes
à celles du lin , mais plus grandes, p^us larges, pointues
, un peu vifqueufes au toucher, &fous la dent.
Ses fleurs naiffent aux fommités des rameaux ra-
maffées plufieurs enfemble comme en grappes, petites
, blanches , formant chacune un tuyau cylindrique
fermé dans le fond, evafé par le haut, & découpé
en quatre parties oppofées en croix, avec huit
étamines à fommets arrondis.
Quand ces fleurs font paffées , il leur fuccede des
fruits gros à-peu-près comme ceuxdu myrthe, mais
un peu plus long , ovales , charnus, remplis de fu c ,
verds au commencement, puis rouges comme du corail
; ils contiennent une feule femence oblongue ,
couverte d’une pellicule noire , luifante , fragile
fous laquelle eft cachée une moelle blanche , d’un
goût brûlant.
Cette plante croît abondamment en Italie, en Ef-
pagne, en Provence, en Languedoc, aux lieux rudes,
incultes , efearpés , parmi les broffailles, proche de
la mer ; elle fleurit en Juillet, & fouvent durant toute
l’automne.
La thymélée de la mer Noire, thymceleapontica ci-
tréi foliis, eft qualifiée de plante admirable par Tournefort
, dans fes voyages. Sa racine eft couverte d’une
écorce couleur de citron; elle produit une tige fi
pliante qu’on ne fauroit la caffer ; elle eft chargée
vers le h aut, de feuilles femblables par leur figure
6c par leur confiftance, à celles du citronnier ; cha-
que'fleur eft un tuyau jaune, verdâtre, tirant fur le
citron, divifé en quatre parties oppofées en croix ,
avec quatre- étamines furmontées de quatre autres ;
le piftil eft terminé par une petite tête blanche ; les
feuilles écrafées ont l’odeur de celles du fureau, 6c