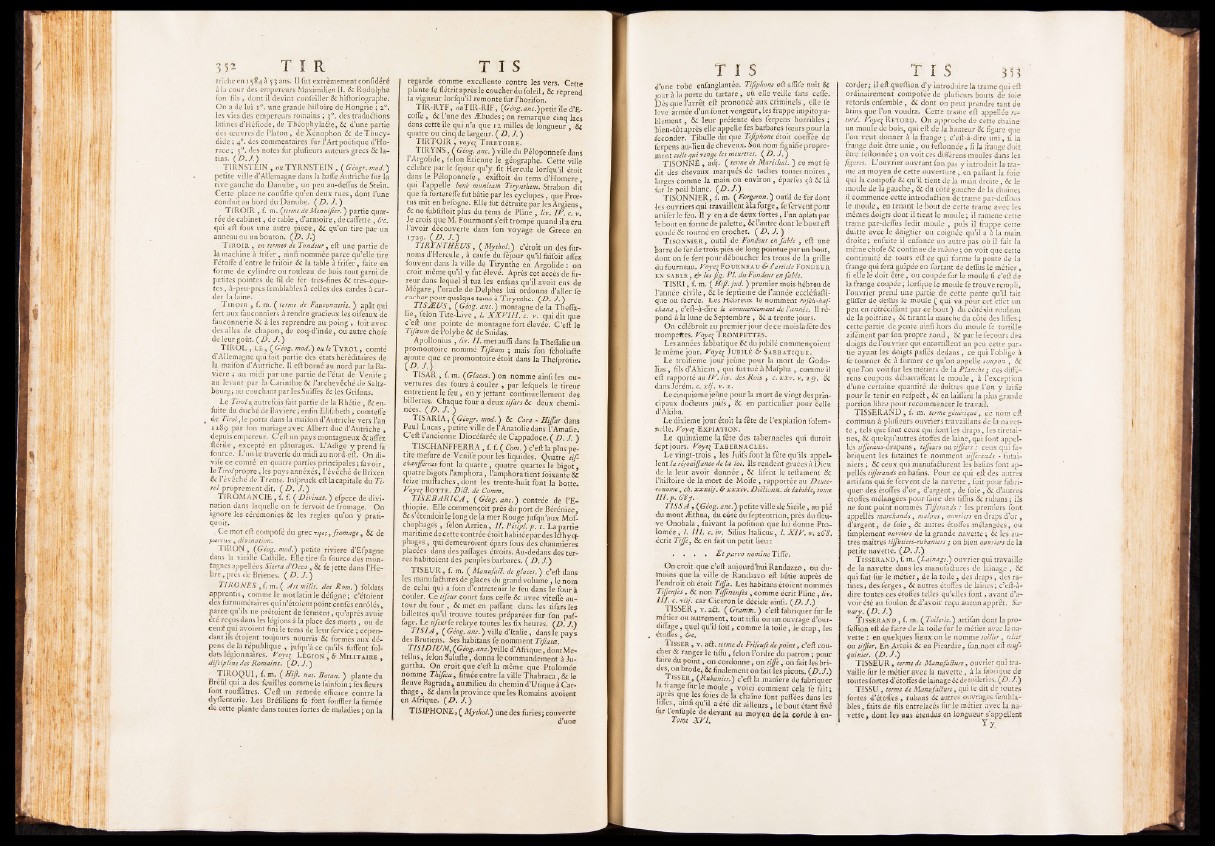
3 5 2 T I R
triche en 1 5 84 à'5 3 ans. Il fut extrêmement confidéré
à la cour des empereurs Maximilien II. & Rodolphe
fon fils , dont il devint confeiller 8c hiftoriographe.
On a de lui i° . une grande hiftoire de Hongrie ; 20.
les vies des empereurs romains ; 30. des traduâions
latines d’Héfiode,de Théophylaâe, 8c d’une partie
des oeuvres de Platon, de Xénophon 8c de Thucydide
; 40. des commentaires fur l’A rt poétique d’Horace
; 50. des notes fur plufieurs auteurs grecs 8c latins.
( D .J .)
TIRNSTEIN , ou TYRNSTEIN, ( Géogr. mod. )
petite ville d’Allemagne dans la baffe Autriche fur la
rive gauche du Danube, un peu au-deffus de Stein.
Cette place ne confifte qu’en deux rues, dont l’une
conduit au bord du Danube. ( D . J. )
TIROIR , f. m. (terme de Menuijier. ) partie quar-
rée de cabinet, de table, d’armoire, de caffette &c.
qui eft fous une autre piece, 8c qu’on tire par un
anneau ou un bouton. (D . J.)
T iroir , en termes de Tondeur, eft une partie de
la machine à frifer, ainfi nommée parce qu’elle tire
l’étoffe d’entre le frifoir 8c la table à frifer, faite en
forme de cylindre ou rouleau de bois tout garni de
petites pointes de fil de fer très-fines 8c très-coiir-
te s , à-peu-près femblables à celles des cardes à carder
la laine.
T iroir , f. m. ( terme de Fauconnerie. ) apât qui
fert aux fauconniers à rendre gracieux les oifeaux de
fauconnerie 8c à les reprendre au poing , loit avec
des ailes de chapon, de coq-d’inde, ou autre chofe
de leur goût. (D . J. )
TIROL , le , ( Géog. mod.') ou le T yr o l , comté
d’Allemagne qui fait partie des états héréditaires de
la maifon d’Autriche. Il eft borné au nord par la Bavière
; au midi par une partie de l’état de Venife ;
au levant par la Carinthie 8c l ’archevêché de Saltz-
bourg; au couchant par les Suiffes 8c les Grifons.
Le Tirol a autrefois fait partie de la Rhétie , 8c en-
fuite du duché de Bavière; enfin Elifabeth, comteffe
de Tirol, le porta dans la maifon d’Autriche vers l’an
12.89 par fon mariage avec Albert duc d’Autriche ,
depuis empereur. C’eft un pays montagneux 8c affez
ftérile , excepté en pâturages. L’Adige y prend fa
fource. L’un le traverfe du midi au nord-eft. On di-
vife ce comté en quatre parties principales ; favoir
leT/ro/propre, les pays annéxés, l ’évêché de Brixen
& l’évêché de Trente. Infpruck eft la capitale du 77-
roi proprement dit. (D . J .)
TIROMANCIE , f. f. ( Divinat. ) efpece de divination
dans laquelle on le fervoit de fromage. On
ignore les cérémonies 8c les réglés qu’on y prati-
quoit.
Ce mot eft compofé du grec r/poç, fromage, 8c de
[Mtvruct, divination.
T IRON , (Géog. mod.) petite riviere d’Efpagne
dans la vieille Caftille. Elle tire fa fource des montagnes
appellées Sierra d'Occa , & fe jette dans l’Hè-
b re, près de Brienes. ( D . J . )
TIRONES , f. m. (A r t milit. des Rom. ) foldats
apprentis, comme le mot latin le défigne ; c’étoient
des fiïrnumeraires quin’étoientpointcenfésenrôlés,
Çarce qu’ils ne prêtoient de ferment, qu’après avoir
été reçus dans les légions à la place des morts, ou de
ceu£ qui avoient fini le tems dè leur fervice ; cependant
ils etôient toujours nourris & formés aux dépens
de la république , jufqu’à ce qu’ils fuffent foldats
légionnaires. Vqyei LÉGION , & MILITAIRE ,
difcipline des Romains. (D. J. )
TIROQUI, f. m. ( Hijl> nat. Botan, ) plante du
Bréfil qui a des feuilles comme le fainfoin ; Tes fleurs
font rouffâtres. Ç’eft un remede efficace contre la
dyffenterie. Les Bréfiliens fe font fouffler la fumée
de cette plante dans toutes fortes de maladies ; on la
T I S
regarde comme excellente contre les vers. Cette
plante fe flétrit après le coucher du foleil, 8ç reprend
la vigueur lorfqu’il remonte fur l’horifon.
TIR-RYF, oaTIR-RIF, (Géog.anc.) petit île d’E-
coffe , 8c l’une des Æbudes; on remarque cinq lacs
dans cette île qui n’a que 12 milles de longueur , 8c
quatre ou cinq de largeur. ( D .J . )
TIRTOIR , voye£ TlRETOIRE.
TIRYNS, ( Géog. anc. ) ville du Péloponnefe dans
I’Argolide, félon Etienne le géographe. Cette ville
célébré par le fejour qu’y, fit Hercule lorfqu’il étoit
dans le Péloponnefe, exiftoit du tems d’Homere,
qui l’appelle benï munitam Tirynthem. Strabon dit
que fa fortereffe fut bâtie par les cyclopes, que Proe-
tus mit en befogne. Elle fut détruite par les Argiens,
& ne fubfiftoit plus du tems de Pline , liv. IF . c. v.
Je crois que M. Fourmont s’eft trompé quand il a cru
l ’avoir découverte dans fon voyage de Grece en
1729. ( D . J . )
TIRYNTHEUS, (Mythol.) c’étçit un des fur-
noms d’Hercule, à caufe du féjour qu’il fàifoit affez
fouvent^dans la ville de Tirynthe én Argolide : on
croit même qu’il y fut élevé. Après cet accès de fureur
dans lequel il tua les enfans qu’il avoit eus de
Mégare, l’oracle de Delphes lui ordonna d’aller fe
cacher pour quelque tems à Tirynthe. (D . J. )
T ISÆ U S , (Géog. anc.) montagne de la Theffa-
liy , félon T ite-Live , l .X X V I I I . c. v. qui dit que
c eft une pointe de montagne fort élevée. C ’eft le
Tifoeum de Polybe 8c de Suidas.
Apollonius , liv. II. metaufli dans laTheffalieun
promontoire nommé Tifceum ; mais fon fcholiafte
ajoute que ce promontoire étoit dans la Theforotie.
( D . J . ) - P
TISAR , f. m. (Glaces.) on nomme ainfi les ouvertures
des fours à couler , par lefquels le tireur
entretient le feu , en y jettant continuellement des
billettes. Chaque four a deux tifars 8c deux cheminées.
( D . J . )
TISARIA, (Geogr. mod,^ 8c Cara - Hiffar dans
Paul Lucas, petite ville de l’Anatolie dans l’Amafie.
C ’eft l’ancienne Diocéfarée de Cappadoce.( D . J. )
TISCHANFFERRA, f. f. ( Com. ) c’eft la plus petite
mefure de Venife pour les liquides. Quatre tif-
éhanjferras font la quarte, quatre quartes le bigot,
quatre bigots l’amphora, l’amphora tient foixante 8c
feize muftaches, dont les trente-huit font la botte.
V Bo t t e . Dict. de Comm.
T ISE B A R IC A , (Géog. anc.) contrée de l’Ethiopie.
Elle commençoit près du port de Bérénice,
8c s’étendoit le long de la mer Rouge jufqu’aux Mof-
chophage's , félon Arrien, II. Pèripl. p. 1. La partie
maritime de cette contrée étoit habitée par des Iélhy cf-
phages, qui demeuroient épars fous des chaumières
placées dans des paffages étroits. Au-dedans des terres
habitoient des peuples barbares. ( D. J.)
TISEUR, {. m. ( Manufacl. de glaces. ) c’eft dans
les manufaûures de glaces du grand volume, le nom
de celui qui a foin d’entretenir le feu dans le four à
couler. Ce tifeur court fans ceffe 8c avec vîteffe autour
du four , 8c met en paffant dans les tifars les
billettes qu’il trouve toutes préparées fur fon paf-
fage. Le tifeurie relaye toutes les fix heures. (D. J.)
T ISIA , ( Géog. anc. ) ville d’Italie, dans le pays
des Brutiens. Ses habitans fe nomment Tifiatce.
TISIDIUMj (Géog. anc.)ville d’Afrique, dontMe-
tellus, félon Salufte, donna le commandement à Ju-
gurtha. On croit que c’eft la même que Ptolomée
nomme Thifica, fituée entre la ville Thabràca, 8c le
fleuve Bagrada, au milieu du chemin d’ütique à Carthage
, 8c dans la province que les Romains avoient
en Afrique. ( D . J . )
TISIPHONE, ( Mythol.) une des furies; couverte
d’une
T I S
d’une Lobe eùfanglantée. Tifiphone eft affife nuit 8c
jour à la porte du tartare , où elle veille fans ceffe.
Dès que l’arrêt eft prononcé aux criminels , elle fe
leve armée d’un fouet vengeur-, les frappe impitoyablement
, 8c leur prélente des ferpens horribles ;
bien-tôt après elle appelle fes barbares foeurs pour la
féconder. Tibulle dit que Tifiphone étoit coëffée de
ferpens àiu-Iieu de cheveux. Son nom lignifie proprement
celle qui venge les meurtres. ( D. J. ^
TISONNÉ , adj. ( terme de Maréchal. ) ce mot fe
dit des chevaux marqués de taches toutes noires ,
larges comme la main ou environ , éparfes çà 8c là
fur le poil blanc. (D .J .)
TISONNIER, f. m. (Forgeron.) outil de Ter dont
les ouvriers qui travaillent àla forge , fe fervent pour
attifer le feu. Il y en a de deux fortes, l’un aplati par
le bout en forme de palette, 8c l’aiutre dont le bout eft
coudé 8c tourné en crochet. ( D . J. )
T isonnier, outil de Fondeur en fiable J eft une
barre de fer de trois piés de long pointue par un bout,
dont on fe fert pour déboucher les trous de la grille
du fourneau. Voye\ Fourneau & Üarticle Fondeur
EN SABLE, & les fig. PL du Fondeur en fable.
TISRI, f. m. ( Htfi.jud. ) premier mois hébreu de
l’année civile, 8c le feptieme de l’année eccléfiafti-
que ou facrée. Les Hébreux le nomment rofch-haf-
chana, c’eft-à-dire U commencement de l'année. Il répond
à la lune de Septembre , 8c a trente jours.
On célébroit au premier jour de ce moislafêtedes
trompettes. Voye^ T rompettes.
Les années fabbatique 8c du jubilé commençoient
le même jour. Voyej Jubilé & Sa bba t iqu e.
Le troifieme jour jeûne pour la mort de Godo-
lias, fils d’Ahican , qui fut tué àMafpha , comme il
eft rapporté au IV. liv. des Rois , c. xxv. v. z g . 8c
dans Jérém. c. xlj. v. 2.
Le cinquième jeûne pour la mort de vingt des principaux
dofteürs juifs, 8c en particulier pour celle
d’Akiba.
Le dixiémè jour étoit la fête de l ’expiation foleitt-
nelle. Voyei Ex piat io n.
Le quinzième la fête des tabernacles qui duroit
fept jours. Voye^ T abern ac les.
Le vingt-trois , les Juifs font la fête qu’ils appellent
la réjouijfance de la loi. Ils rendent grâces à Dieu
de la leur avoir donnée , 8c lifent le teftament 8c
l’hiftoire de la mort de Moïfe , rapportée au Deute-
ronome, ch. x x x ïij. & xxxiv. Diclionn. de labible. tome
III. p. 68y .
T IS S A , (Géog. anc.) petite ville de Sicile, au pie
du mont Æthna, du coté du fepîentrion,près du fleuve
Onobala, fuivant la pofition que lui donne Pto-
lomée, l. III. c. iv. Silius Italiens, l. X IV . v» 2681
•écrit Tijfe, 8c en fait un petit lieu.
. . . » E t parvo nàmine Tiffe.
On croit que ç’eft: aujourd’hui Randazzo, où du-
imoins que la ville de Randazzo eft bâtie auprès de
l’endroit oii etoit Tijfa. Les habitans étoient nommés
Tifienfes, 8c non Tiffinenfes, comme écrit Pline, /m
II I . c. viij. car Cicéron le décide ainfi. (D . J .)
TISSER > v. aà . ( Gramfn. ) c’eft fabriquer fur le
métier ou autrement, tout tiffu ou un ouvrage d’our-
diffage, quel qu’il foit, comme la toile, le drap, les
étoffes, &c.
T isser , v. a£L terme de FrifeuJe de point, c’eft coucher
8c ranger le tiffu, félon l’ordre du patron ; pour
taire du point, on cordonne, on tijfe, on fait les bri-
des, on brode, 8c finalement on fait les picots. (D . J.)
T isser , (Rubanier.) c’eft la maniéré de fabriquer
la frange fur le moule , voici comment cela fe fait;
apres que les foies de la chaîne font paffées dans les
liffes, ainfi qu’il a été dit ailleurs , le bout étant fixé
itir lenfuple de devant au moyen de là corde à en-
Tortte JfVI*
côfder ; il eft qüeftion d’y introduire la trame qui eft
ordinairement compofée de plufieurs bouts de foie
retords enfemble , & dont on peut prendre tant de
brins que l’on voudra. Cette trame eft appeilée retord.
Vjÿei R etord. On approche de cette chaîne
un moule de bois, qui eft de la hauteur 8c figure que
l’on veut donner à la frange ; c’eft-à-dire uni, fi la
frange doit être unie, ou feftonnée, fi la frange doit
être feftonnée ; on voit ces différens moules dans les
figures. L’ouvrier ouvrant fon pas y introduit la trame
au moyen de cette ouverture, eii paffant la foie
qui la compofe 8c qu’il tient de la main droite, 8c le
moule de la gauche, Sc du côté gauche de la chaîne;
il commence cette introduftion de trame par-deffous
le moule, en tenant le bout de cette trame avec les
mêmes doigts dont il tient le moule ; il ramene cette
trame par-deftus ledit moule , puis il frappe cette
duitte avec le doigtier ou coignée qu’il a à la main
droite ; enfuite il enfonce un autre pas où il fait la
même chofe 8c continue de même ; on voit que cette
continuité de tours eft ce qui forme la pente de la
frange qui fera guipée en fortant de deffus le métier,
fi elle le doit être, ou coupée fiir Le moule fi e’eft de
la frange coupée ; borique le moule fe trouve rempli,
l’ouvrier prend une partie de cette pente qu’il fait
gliffer de defiiis le moule ( qui va pour cet effet un
peu enrétréciffant parce bout ) du côté-dù rouleau
de la poitrine, 8c tirant la marche du côté des liftés ;
cette partie de pente ainfi hors du moule fe tortille
aiférnent par fon propre rond, 8c par le fecours des
doigts de l’ouvrier qui entortillent un peu cette partie
ayant les doigts paffés dedans, ce qui l’oblige à
fe tourner 8c à former ce qu’on appelle coupon , 8c
que l’on voit fur les métiers de la Planche ; ces diffé-
rens coupons débarraffent le moule, à l’exception
d’une certaine quantité de duittes que l’on y laiffe
pour le tenir en refpecl, 8c en laiffanr la plus grande
portion libre pour recommencer le travail.
TISSERAND , f. m. terme générique, ce nom eft
commun à plufieurs ouvriers travaillans de la navette
, tels que font ceux qui font les draps, les tiretai-
nes, 8c quelqu’autres étoffes de laine, qui font appelles
tijferans-<h'a\>ans, tijfeurs ou tijfiers : ceux qui fabriquent
les fùtaines fe nomment ùjferands - futai-
niers ; 8c ceux qui manufacturent les bafins font appelés
tifjerands en bafins. Pour ce qui eft des autres
artifans qui fe fervent de la navette, foit pour fabrique
tv des étoffes d’o r , d’argent, de foie , 8c d’autres
étoffes mélangées pour faire des tiffus 8c rubans ; ils
ne font point nommés Tijjerands : les premiers font
appellés marchands, maîtres, ouvriers en draps d’or ,
d’argent, de foie , 8c autres étoffes mélangées, ou
Amplement ouvriers de la grande navette ; 8c les autres
maîtres tifiutiers-rubaniers ; o.u bien ouvriers de la
petite nayejtç. (D . J.)
TISSERAND, f. m. (Lainage.) ouvrier qui travaille
de la navette dans les manufactures de lainage , 8c
qui fait fur le métier, de la toile, clés draps , des ratines
> des forges, 8c autres étoffes de laines ; c’ eft-à-
dire toutes ces étoffes telles qu’elles font, avant d’avoir
été au foulon 8c d’avoir reçu aucun apprêt. Sa-
vary. (D . J.)
T isserand , f. m. (Toilerie.) artifan dont la pro-
feftion eft de faire de la toile fur le métier avec la navette
î en quelques lieux on le nomme toilier, telier
ou tiffitr. En Artois 8c en Picardie, fon nom eft muf-
quinier. (JJ. J.)
TISSEUR, urmt de Manufacture, ouvrier qui travaille
fur le métier avec la navette , à la fabrique de
toutes fortes d’étoffes de lainage 8c de toileries. (D.J .)
TISSU , terme de Manufacture, qui le dit de toutes
•fortes d’étoffes , rubans 8c autres ouvrages femblables
, faits de fils entrelacés fur le métier avec la navette
, dont lçs uns étendus en longueur s’appellent
y Y