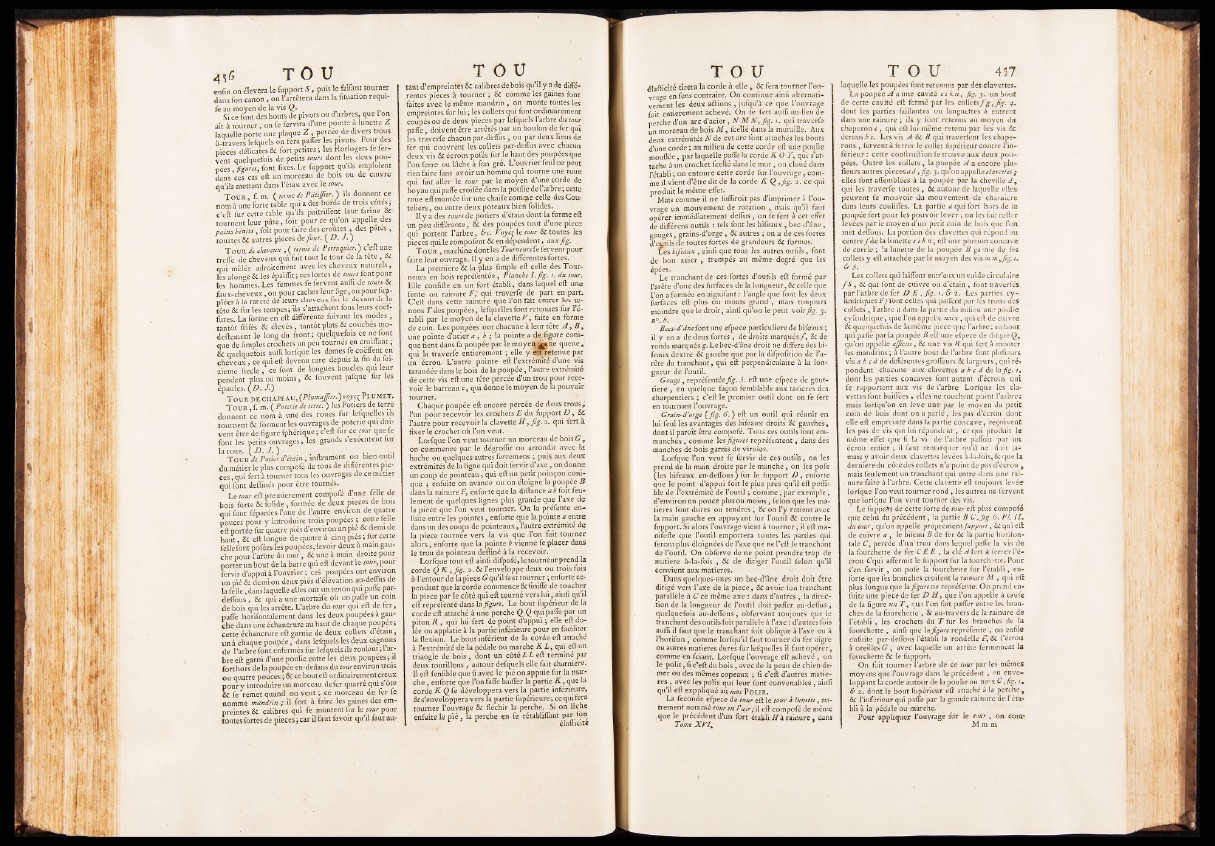
enfin on élevera le fupport S , puis le faifant tourner
dans fon canon, on l’arrêtera dans la fituaüon requi- ;
fe au moyen de la vis Q.
Si ce font des bouts de pivots ou d arbres, que 1 on
ait à tourner, onfe fervira d’une pointe à lunette Z
laquelle porte une plaque Z .percée de divers trous
à-travers lefquels on fera paffer les pivots. Pour des
pièces délicates Sc fort petites ; les Horlogers fe. 1er-
vent quelquefois de petits tours dont les deux poupées
, figures, font fixes. Le fupport qu’ils emploient
dans ces cas eft un morceau de bois ou de cuivre
qu’ils mettent dans l’étau avec le tour.
T our f. I ( « de Pûtifttr. ) ils donnent ce
nom à une forte table qui a des bords de trois côtes;
c ’eft fur cette table qu’ils paitriffent leur farine &
tournent leur pâte, lo ir pour Ce qu’on appelle dés
foins bénits, foit pour faire des croûtes , des; pâtés,
tourtes ôç autres pièces de four. { D . J . )
T our de cheveux I ttrnét de Perruquier.') c’eft une
treffe I cheveux qui fait tout le tour de la tê te , &
qui M H S adroitement a^ec lés cheveux naturels,
lès alonoe & les épailîit ; ces fortes de tours font pour
les hommes. .Les femmes fe fervent aufli de tours &
faux-cheveux, ou pour cacher leur âge,Ou pour ius-
pléenà la rareté de leurs cheveux fur le devant de.la
tête ôc fur les tempes ; ils s’attachent fous leurs coef-
fures La formé en eft différente ftlivant lqs modes ,
tantôt frifés & élevés, tantôt plats &,couche:s,ino-
déftement le long du front; quelquefois ce ne font
que de Amples crochets un peu tournes en croiflant ;
& quelquefois aufli lorfque les dames fe coeffent en
cheveux » ce qui eft devenu rare depuis la fin du lei-
zieme fiecle , ce font de longues boucles qui leur
pendent plus ou moins, ôc fouvent jufque lur les
épaules. (LL L.)
T our DE chapeau, (PlumaJfier.)voyei Plumet.
T our , f. m. ( Poterie de terre. ) les Potiers de terre
donnent ce nom à une des roues fur lesquelles ils
tournent Ôc forment les ouvrages de poterie qui doivent
être de figure fphérique ; c’eft fur ce tour que fe
font les petits ouvrages ; les grands s’exécutent lur
la roue. ( D . J . ) ..
T our de Potier d'étain, infiniment ou bien outil
du métier le plus compofé de tous de différentes pièces
, qui fert à tourner tous les ouvrages de ce metier
qui font deftinés pour être tournés.
Le tour eft premièrement compofe d’une folle de
bois forte Ôcfolide , formée de deux pièces de bois
qui font féparées l’une de l’autre environ de quatre
pouces pour y introduire trois poupées ; cette lelle
eft portée fur quatre piés d’environ un pie & demi de
haut, ôc eft longue de quatre à cinq pies ; fur cette
feilefont pofées les poupées, favoir deux à main gauche
pour l’arbre du tour, Ôc une à main droite pour^
porter un bout de la barre qui eft devant le tour, pour
fervir d’appui à l’ouvrier; ces poupées onteuviron
un pié ôc demi ou deux piés d’élévation au-deflus de
la felle, dans laquelle elles ont- un tenon qui paffe par-
deffous , 6c qui a une mortaife oit on paffe un coin
de bois qui les arrête. L’arbre du tour qui eft de fer,
paffe horifontalement dans les deux poupees à gauche
dans une échancrure au haut de chaque poupee;
cette échancrure eft garnie de deux collets d’etain,
un à chaque poupée, dans lefquels les deux oignons
de l’arbre font enfermés fur lelquels ils roulent ; l’arbre
eft oarni d’une poulie entre les deux poupées ; il
fort hors de la poupée en-dedans du tour environ trois
ou quatre pouces ; ÔC ce bout eft ordinairement creux
pour y introduire un morceau de fer quarré qui s’ôte
& fe remet quand on veut ; ce morceau do fer fe
nomme mandrin ; il fert à faire les gaines des empreintes
ÔC calibres qui fe montent fur le tour pour
toutes fortes de pièces ; car il faut favoir qu’il faut autant
d’empreintes 6c calibres de bois qu’il y a de diffé-
rentes pièces à tourner ; 6c comme les gaines font
faites avec le même mandrin, on monte toutes les
empreintes fur lui; les collets qui font ordinairement
coupés ou de deux pièces par lefquels l’arbre du tour
paffe, doivent être arrêtés par un boulon de fer qui
les traverfe chacun par-deffus, ou par deux liens de
fer qui couvrent les collets par-deffus avec chacun
deux vis 6c écrous pofés fur le haut des poupees que
l’on ferre ou lâche à fon gré. L’ouvrier feul ne peut
rien faire fans avoir un homme qui tourne une roue
qui fait aller le tour par le moyen d’une corde de
boyau qui paffe croifée dans la poulie del arbre ; cette
roue eft montée fur une chaife comme celle des Couteliers
, ou entre deux poteaux bien folides.
Il y a des tours de potiers d’etain dont la forme eft
un peu différente, ôc des poupées tout d’une piece
qui portent l’arbre, &c. Voye^ le tour ÔC toutes les
pièces qui le compofent ôc en dépendent, aux fig.
T our , machine dont les Tourneurs fe fervent pour
faire leur ouvrage. Il y en a de differentes fortes.
La première Ôc la plus fimple eft celle des Tourneurs
en bois repréfentée, Planche I.fig. t. du tour.
Elle çonfifte en un fort établi, dans lequel eft une
fente ou rainure F* qui traverfe de part en part.
C’eft dans cette rainure que l’on fait entrer les tenons
T des poupées, lefquelles font retenues fur l’établi
par le mbÿen de la clavette V , faite en forme
de coin. Les poupées ont chacune à leur tête A , B ,
une pointe d’acier a , b ; la pointe a défigure conique
tient dans fa poupée~par le moyer\|^ne queue,
qui la traverfe entièrement ; elle y efpretenue par
un écrou. L’autre pointe eft l’extréihite d’une vis
taraudée dans le bois de la poupée, l’autre extrémité
de cette vis eft une tête percée d’un trou pour recevoir
le barreau c , qui donne le moyen de la pouvoir
tourner.
Chaque poupée eft encore percée de deux trous,'
l’un pour recevoir les crochets E du fupport .D, ôc
l’autre pour recevoir la clavette H, fig. z. qui fert à
fixer le crochet oit l’on veut.
Lorfque l’on veut tourner un morceau de bois G ,
on commence par le dégroflir ou arrondir avec la
hache ou quelques autres ferremens ; puis aux deux
extrémités de la ligne qui doit fervir d’axe, on donne
ùn coup de pointeau, qui eft un petit poinçon conique
; enfuite on avance ou on éloigné la poupée B
j dans la rainure F, enforte que la diftance a b foit feulement
de quelques lignes plus grande que l’axe de
la piece que l’on veut tourner. On la préfente en-
fuite entre les pointes, enforte que la pointe a entre
dans un des coups de pointeaux, l’autre extrémité de
la piece tournée vers la vis que l’on .fait tourner
alors, enforte que la pointe b vienne fe placer dans
le trou de pointeau deftiné à la recevoir.
Lorfque tout eft ainfi difpofé, le tourneur prend la
corde Q K , fig. 2. ôc l’enveloppe deux ou trois fois
à-l’entour de la piece (P qu’il faut tourner ; enforte cependant
que la corde commence ôefiniffe de toucher
la piece par le côté qui eft tourné vers lui, ainfi qu’il
eft repréfenté dans la figure. Le bout fupérieur de la
corde eft attaché à une perche Q Q qui paffe par un
piton R , qui lui fert de point d’appui ; elle eft do-
lée ou applatie à la partie inférieure pour en faciliter
la flexion. Le bout inférieur de la corde eft attache
à l’extrémité de la pédale ou marche K L , qui eft un
triangle de bois , dont un côté L L eft terminé par
deux tourillons, autour defquels elle fait charnière.
Il eft fenfible que fi avec le pié on appuie fur la marche
, enforte que l’onfaffe baiffer la partie K , que la
corde i f Q fe développera vers la partie inférieure,
ôc s’enveloppera vers la partie fupérieure; ce qui fera
I tourner l’ouvrage ôc fléchir la perche. Si on lâche
enfuite le p ié , la perche en fe rétabliffant pa rfoa
r élafticite
élafticite tirera la corde à elle , ôc fera tourner l’oit-
vrage en fens contraire. On continue ainfi alternativement
les deux allions , jufqu’à ce que l’ouvrage
foit entièrement achevé. On fe fert aufli au-lieu de
perche d’un arc d’acier, N M N , fig. /. qui traverfe
un morceau de bois M , fcéllé dans, la muraille. Aux
deux extrémités N de cet arc font attachés les bouts
d’une corde ; au milieu de cette corde eft une poulie
mouflée, par laquelle paffe la corde K O Y, qui s'attache
à un crochet fcellé dans le m ur, ou cloué dans
L’établi ; on entoure cette corde fur l’ouvrage , comme
il vient d’être dit de la corde K Q ,fig. 2. ce qui
produit le même effet.
Mais comme il ne fufliroit pas d’imprimer à l’ouvrage
un mouvement de rotation , mais qu’il faut
opérer immédiatement deffus, on fe fert à cet effet
de différens outils : tels font les bifeaux, bec-d’âne ,
gouges , grains-d’orge , ôc autres ; on a de ces fortes
d’outils de toutes fortes de grandeurs ôc formes;
Les bifeaux, ainfi que tous les autres outils, font
de bon acier , trempés au même degré que les
épées.
Le tranchant de ces fortes d’outils eft formé par
l’arête d’une des furfaces de la longueur, ôc celle que
l ’on a formée en aiguifant ; l ’angle que font les deux
furfaces eft plus ou moins grand , mais toujours
moindre que le droit, ainfi qu’on le peut voir fig. 3.
n°. b.
Becs-d'âne font une efpece particulière de bifeaux ;
il y en a de deux fortes , de droits marqués/, Ôc de
ronds marqués g. Le bec-d’âne droit ne différé des bi-
feaux dextre ôc gauche que par la difpofition de l’arête
du tranchant, qui eft perpendiculaire à la longueur
de l’outil.
Gouge, repréfentée fig. S- eft une efpece de gouttière
, en quelque façon femblable aux tarières des
charpentiers ; C’eft le premier outil dont on fe fert
en tournant l’ouvrage.
Grain-d'orge ( fig. 6'.') eft un outil qui réunit en
lui feul les avantages des bifeaux droits ôc gauches,
dont il paroît être compofé. Tous ces outils font emmanches
, comme 1es figures repréfontent, dans des
manches de bois garnis de viroles.
Lorfque l’on veut fe fervir de ces outils, on les
prend de la main droite par le manche, on les pofe
(les bifeaux en-deffous ÿ fur le fupport D , enforte
que le point d’appui foit le plus près qu’iL eft pofli-
ble de l’extrémité de l’outil ; comme, par exemple,
d’environ tin pouce plus ou moins, félon que les matières
font dures ou tendres , ÔC on l’y retient avec
la main gauche en appuyant fur l’outil Ôc contre le
fiipport. Si alors l’ouvrage vient à tourner, il eft ma-
nifefte que l’outil emportera toutes les parties qui
feront plus éloignées de l’axe que ne l’eft le tranchant
de l’outil. On obferve de ne point prendre trop de
matière à-la-fois , ôc de diriger l’outil félon qu’il
convient aux matières. '
Dans quelques-unes un bec-d’âne droit doit être
dirigé vers l’axe de la piece, ôc avoir.fon tranchant
parallèle à C ce même axe : dans d’autres, la direction
de la longueur de l’outil doit paffer au-dêffus ,
quelquefois au-deffous, ©bforvânt toujours que le
tranchant des outils foit parallèle à l’axe : d’autres fois
aufli il faut qüe le tranchant foit oblique à l’axe ou à
l’horifon, comme lorfqu’il faut tourner du fer aigre
ou autres matières dures fur lelquelles il faut opérer,
comme en feiant. Lorfque l’ouvrage eft achevé , on
.le polit, fi c’eft du bois, avec de la peau de chien-de-
mer ou dès mêmes copeaux ; fi e’eft d’autres matières
, avec les polis qui leur font convenables , ainfi
qu’il eft exppliqué au mot Po lir.
La fécondé efpece de tour eft le tour à lunette, autrement
nomme tour en l'air •:il eft compofé de même
vque le precedent d’un fort établi L fà rainure, dans
Tome X V l%
laquelle les poupées font retenues par des c lavettes.
La poupée A a une cavité t i k n , fig. 3. un bout
de cette cavité eft fermé par les collets ƒ g , fig- 4.
dont les parties faillantes ou languettes A entrent
dans une rainure ; ils y font retenus, au moyen du
chaperon e , qui eft lui-même retenu par les vis ôc
écrous A c. Les vis A de B qui traverfent les chaperons
, fervent à ferrer le collet fupérieur contre l’inférieur.;
çette conftruélion fe trouve aux deux poupées.
Outre les collets;, la poupée A a encore plu*
fleurs autres piecesa d , fig. 3. qu’on appelle clavettes ;
elles font affemblées à la poupée par la cheville d ,
qui les traverfe toutes , ôc autour de laquelle elles
peuvent fe mouvoir du mouvement de charnière
dans leurs couliffes. La partie a qui fort hors de la
poupée fert pour les pouvoir lever ; on les fait refiler
levées par le moyen d’un petit coin de bois que l’on
met deffous. La portion des clavettes qui répond an
centre ƒ de la lunette e ik n , eft une portion concave
de cercle ; !a lunette de la poupée B garnie de fes
collets y eft attachée par le moyen des vis m m ,fig. /«
& 5.
Les collets qui laiffent entr’euxun vuide circulaire
f S , ôc qui font de cuivre ou d’etain , font traverfés
par l'arbre de fer D E , fig. 1. & 2. Les parties c y lindriques
-F/font celles qui paffent par les trous des
collets , l'arbre a dans la partie du milieu une poulie
cylindrique, que l’on appelle noix, qui eft de cuivre
ôc quelquefois de la même piece que l’arbre; au bout
qui paffe par la poupée B eft une efpece de dilque Q,
qu’on appelle affiette, ÔC une vis H qui fert à monter
les mandrins ; à l’autre bout de l’arbre font plufieurs
vis ab cd de differentes groffeursôc largeurs, qui répondent
chacune aux clavettes a b c d de h fig. /.
dont les parties concaves font autant d’écrous qui
fe rapportent aux vis de l’arbre Lorfque les clavettes
font baift'ées > elles ne touchent point l’arbre :
mais lorfqu’on en lev-e une par le moyen du petit
coin de bois dont on a parle ,. les pas d’écrou- dont
elle eft empreinte dans fa partie concave, reçoivent
les pas de vis qui lui répondent, ce qui produit le
même1 effet que fi la v i.'d e l’arbre paffoit par un
écrott entier ; il faut remarquer qu’il ne doit jamais
y avoir deux clavettes levées à-la-fois, ôc que la
dernieredu côté des collets n’a point de pas d’écrou #
mais feulement un tranchant qui entre dans Une rainure
faite à l’arbre. Cette clavette eft toujours levée
lorfque l’on veut tourner rond , les autres ne fervent
que lorfque l’on veut tourner des vis.
Lê fupport de cette forte de tour eft plus compofé
que celui du précédent, la partie B C , fig. 6 . PI. II.
du tour, qu’on appelle proprement fupport, ÔC qui eft
de cuivre a , le bifeau B de fer Ôc l’a partie horifon-
tale C , percée d’un trou dans lequel paffe la vis de
-la fourchette de fer C E E , la cle A fert à ferrer l’écrou
6’qui affermit le fupport fur la fourchette. Pour
s’en fervir , on pofe la fourchette fur l’établi, en-
forte que fes branches croifent la rainure M , qui eft
plus longue que la figure ne repréfente. On prend en-
fuite une piece de fer D H , que l’on appelle à caufe
de fa figure un T , que l’on fait paffer entre les branches
de la fourchette , & au-traversde la rainure de
l’établi , les crochets du T fur les branches de la
fourchette , ainfi que la figure repréfente , on enfile
enfuite par-deflbus l’établi la rondelle F, & l’écrou
à oreilles , avec laquelle on arrête fermement la
fourcherte Sc le fupport.
On fait tourner l’arbre de ce tour par les mêmes
moyens que l’ouvragé däns le précédent, éri enveloppant
la corde autour de la poulie ou noix C ,fig. 1.
& 2. dont le bout füpérieur eft attaché à la perche,
ôc l’inférieur qui pafle par la grande rainure dè l’établi
à la pédale ou marche.
Pour appliquer l’ouvrage fiîr le tour, on com.'
Mm m