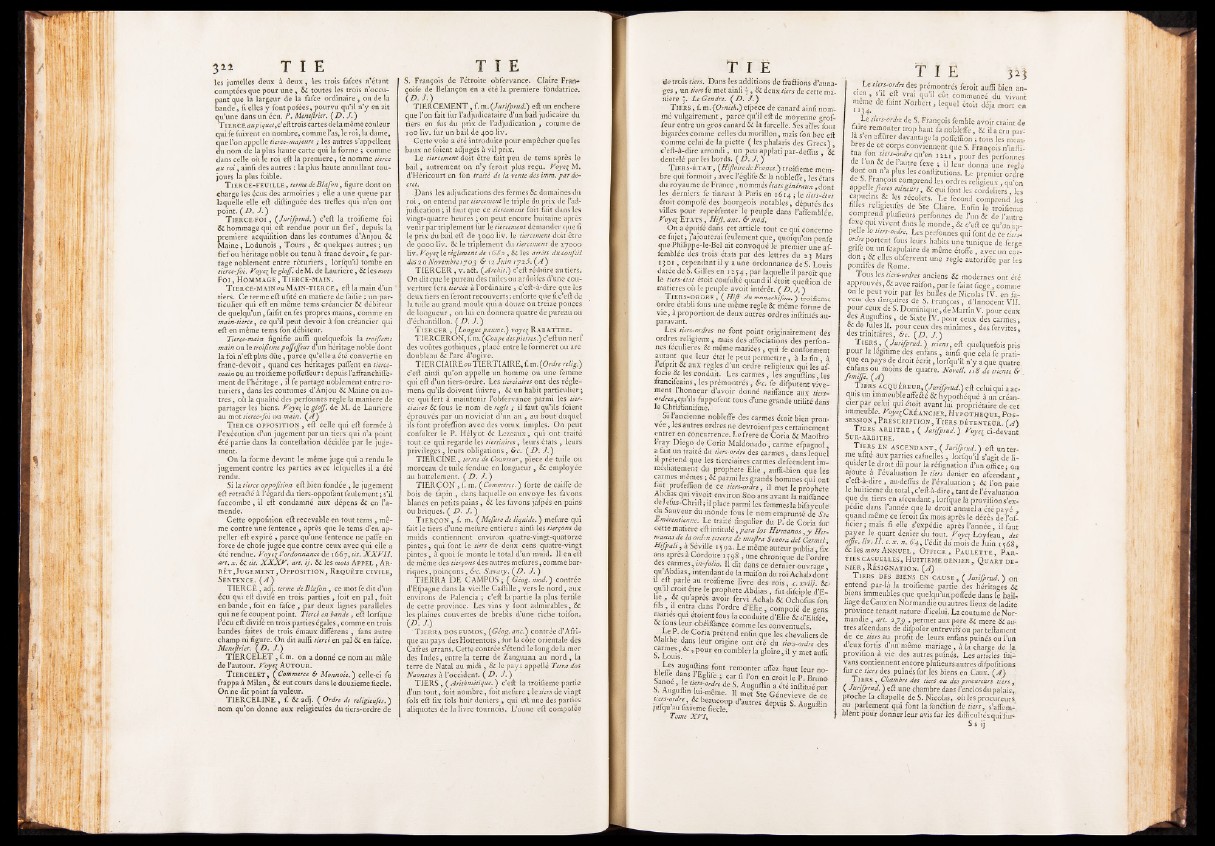
les jumelles deux à deux, les trois fafces n’étant
comptées que pour une, 6c toutes les trois n’occupant
que la largeur de la fafce ordinaire , ou de la
bande, fi elles y font pofées, pourvu qu’il n’y en ait
qu’une dans un écu. P. Menefrier. (D . J .)
T ierce au piquet tC eft. trois cartes delà même couleur
quife fuivent en nombre, comme l’as, le roi, la dame,
que l’on appelle tiercc-majeurc ; les autres s’appellent
du nom de la plus haute carte qui la forme ; comme
dans celle où le roi eft la première, fe nomme tierce
au roi, ainfi des autres : la plus haute annullant toujours
la plus foible.
T ierce-feuille, terme de B lo f on, figure dont on
charge les éeus des armoiries ; elle a une queue par
laquelle elle eft diftinguée des trefles qui n’en ont
point. ( D . J. )
T ierce-foi , ( Jurifprud. ) c’ eft la troifieme foi
& hommage qui eft rendue pour un f ie f , depuis la
première acquifition dans les coutumes d’Anjou 6c
Maine, Lodunois , Tours , 6c quelques autres ; un
fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, fe partage
noblement entre rôturiers, lorfqu’il tombe en
tierce-foi. Voyeç Xeglojf. de M. de Laurier e , & les mots
Foi , Hommage , T ierce-main.
T ierce-main ou Main-tierce , eft la main d’un
tiers. Ce terme eft ulité en matière de faifie ; un particulier
qui eft en même tems créancier 6c débiteur
de quelqu’un, faifit enfes propres mains, comme en
main-tierce, ce qu’il peut devoir à fon créancier qui
eft en même tems fon débiteur.
Tierce-main fignifie auffi quelquefois la troifieme
main ou le troifieme pojfejj'eur d’un héritage noble dont
la foi n’eft plus due, parce qu’elle a été convertie en
franc-devoir, quand ces héritages paffent en tierce-
main ou au troifieme poffeffeur : depuis l’affranchiffe-
ment de l’héritage , il fe partage noblement entre roturiers
, dans les coutumes d’Anjou 6c Maine ou autres
, où la qualité des perfonnes réglé la maniéré de
partager les biens. Foye^ le glojf. de M. de Lauriere
au mot tierce-foi ou main. (.A )
T ierce opposition , eft celle qui eft formée à
l’exécution d’un jugement par un tiers qui n’a point
été partie dans la conteftation décidée par le jugement.
On la formé devant le même juge qui a rendu le
jugement contre les parties avec lefquelles il a été
rendu.
Si la tierce oppojition eft bien fondée , le jugement
eft retra&é à l’égard du tiers-oppofant feulement ; s’il
fuccombe, il eft condamné aux dépens 6c en l’amende.
Cette oppofition eft recevable en tout tems , même
contre une fentence , après que le tems d’en ap-
peller eft expiré , parce qu’une fentence ne paffe en
force de chofe jugée que contre ceux avec qui elle a
été rendue. Foye^l*ordonnance de 1667,lit. X X V I I .
art. x. 6c tit. X X X V . art. ij. 6c les mots Appel , Arr
ê t , Ju gemen t, Op posit ion, Requête civile,
S entence. (A)
TIERCÉ , adj. terme de Blafon, ce mot fe dit d’un
écu qui eft divifé en trois parties , foit en pal,. foit
en bande, foit en fafce , par deux lignes parallèles
qui ne fe coupent point. Tiercé en bande, eft lorfque
l’écu eft divifé en trois parties égales, comme en trois
bandes faites de trois émaux différens , fans autre
champ ni figure. On dit auffi tiercé en pal 6c en fafce.
Menejirier. \D . J.)
TIERCELET , 1. m. on a donné ce nom au mâle
de l’autour. Foyc{ Autour.
T iercelet, ( Commerce & Monnoie.j celle-ci fe
frappa à Milan, & eut cours dans le douzième fiecle.
On ne dit point fa valeur.
TIERCELINE , f. & adj. ( Ordre de religieufes. )
nom qu’on donne aux religieufes du tiers-ordre de
S. François de l’étroite obfervance. Claire Fran-
çoife de Befançon en a été la première fondatrice. pia f , , . TIERCEMENT, f. m. ( Jurifprud.) eft un enchère
que l’on fait fur l’adjudicataire d’un bail judicaire du
tiers en fus du prix dë l’adjudication , comme de
100 liv. fur un bail de 400 liv.
Cette voie a été introduite pour empêcher que les
baux ne foient adjugés à v il prix.
Le tiercement doit être fait peu de tems après le
b a il, autrement on n’y feroit plus reçu. Foye{ M.
d’Héricourt en fon traité de la vente des imm. par decret
.D
ans les adjudications des fermes & domaines du
r o i , on entend par tiercement le triple du prix de l’adjudication
; il faut que ce tiercement foit fait dans les
vingt-quatre heures ; on peut encore huitaine après
venir par triplement fur le tiercement demander que fi
le prix du bail eft de 3000 liv. le. tiercement doit être
de 9000 liv. 6c le triplement du tiercement de 27000
liv. Voye{ le règlement de 1682., 6c les arrêts du confeil
des 2 o Novembre 1703 & 12 Juin \ jx 5 . (A )
TIERC ER, v . aft. ('Arcb.it.) c’eft réduire au tiers.
On dit que le pureau des tuiles ou ardoifes d’une couverture
fera tiercée à l’ordinaire, c’eft-à-dire que les
deux tiers en feront recouverts ;enforte que fi c’eft de
la tuile au grand moule qui a douze ou treizè pouces
de longueur, on lui en donnera quatre de pureau ou
d’échantillon. ( D . J. )
T iercer , (_Longue paume.") voyeç R a b a t tr e .
TIERCER ON, f. m. (Coupe des pierres.) c’eft un nerf
des voûtes gothiques, placé entre le formeret ou arc
doubleau 6c l’arc d’ogive.
TIERCIAIREouTIERTIAIRE, f.m.(Ordre relig.)
c’ eft ainli qu’on appelle un homme ou une femme
qui eft d’un tiers-Ordre. Les tierciaires ont des régle-
mens qu’ils doivent fuivre , & un habit particulier ;
ce qui fert à maintenir l’obfervance parmi les tierciaires
6c fous le nom de réglé ; il faut qu’ils foient
éprouvés par un noviciat d’un an , au bout duquel
ils font profeffion avec des voeux fimples. On peut
confulter le P. Hélyot 6c Lezeaux, qui ont traité
tout ce qui regarde les tiertiaires, leurs états , leurs
privilèges, leurs obligations, 6*c. (D . J.)
TIERCINE, terme de Couvreur, piece dë tuile ou
morceau de tuile fendue en longueur, 6c employée
au battelement. ( D. J .)
T IER ÇO N , f. m. (Commerce.) forte de caiffe de
bois de lapin , dans laquelle on envoyé les favons
blancs en petits pains , 6c les favons jafpés en pains
ou briques. ( D . J. )
TiERÇON , f. m. ( Mefure de liquide. ) mefure qui
fait le tiers d’une mefure entière: ainfi les tierçons de
muids contiennent environ quatre-vingt-quatorze
pintes, qui font le tiers de deux cens quatre-vingt
pintes, à quoi fe monte le total d’un muid. Il en eft
de même des tierçons des autres mefures, comme barriques
, poinçons, &c. Savary. ( D . J .)
TIERRÀ DE CAMPOS ; ( Géog. mod.) contrée
d’Efpagne dans la vieille Caftille, vers le nord, aux
environs de Palencia ; c’eft la partie la plus fertile
de cette province. Les vins y font admirables, 6c
les plaines couvertes de brebis d’une riche toifon.
(D . J.) WÈÊÊÊ
T ierra dos fumos, ( [Géog. anc.) contrée d’Afrique
au pays des Hottentots, fur la côte orientale des
Cafres errans. Cette contrée s’étend le long de la mer
des Indes, entre la terre de Zanguana au nord , la
terre de Natal au midi, & le pays appelle Terra dos
Naonetas à l’occident. (D - J .) ^
TIERS , ( Arithmétique. ) c’eft la troifieme partie
d’un tout, foit nombre, foit mefure ; le tiers de vingt
fols eft fix fols huit deniers , qui eft une des parties
aliquotes de la livre tournois, L’aune eft compofée
de trois tiers. Dans les additions de fractions d’aunages
, un tiers fe met ainfi y , & deux tiers de cette maniéré
f. Le Gendre. ( D . -J.)
T iers , f . m.(Ornitk.) efpece dë canard ainfi nommé
vulgairement, parce qu’il eft de moyenne grof-
feur entre un gros canard & la farcelle. Ses ailes font
bigarées comme celles du morillon, mais fon bec eft
comme celui de la piette ( les phalaris des G re cs) ,
c’eft-à-dire arrondi, un peu applati par-deffiis 6c
dentelé par les bords. ( D. J. )
T iers-é t a t , (Hifioirede France.) troifieme membre
qui formoit, avec l’églife 6c la noblefle i les états
du royaume de France, nommés états généraux, dont
les derniers fe tinrent à Paris en 1614 ; le iiers-êtàl
étoit compofé des bourgeois notables, députés des
villes pour représenter le peuple dans l’alfeiiiblée.
Voye%_ ETATS, Hiß. anc. & mod.
On a épuifé dans cet article tout ce qui concerne
ce fujet ; j’ajouterai feulement que, quoiqu’on penfé
que Philippe-le-Bel ait convoqué le premier une af-
lemblée des trois états par des lettres du 23 Mars
130 1, cependant il y a une ordonnance de S. Louis
datée de S. Gilles en 1254, par laquelle il paroît que
le tiers-état étoit confulté quand il étoit queftion de
matières où le peuple avoit intérêt. ( D .J . )
TIERS-ORDRE, ( Hiß. du monuchifmé. ) troifiefne
ordre établi fous une même règle & même forme de
vie, à proportion de deux autres ordres inftiuiés auparavant.
Les tiers-ordres ne font point originairement des
ordres religieux * mais des aflbciations des perfonnes
féculieres 6t même mariées, qui fe conforment
autant que leur état le peut permettre , à la fin , à
1 efprit & aux réglés d’un ordre religieux qui les af-
focie & les conduit. Les carmes , les auguftiiis les
francifcains, les premontres, &c. fë difputent vive-
ment l’honneur d’avoir donné naiffance aux tiers-
fuppofent tous d’une grande utilité dans
le Chnftiamfme.
Si l’ancienne noblefle des carmes étoit bien prouvée
, les autres ordres ne devraient: pas certainement
entrer en concurrence. Le frere de Coria 6c Maoftro
Fray Diego de Coria Maldonado , carme efpagnol,
a fait un traité du tiers-ordre des carmes , dans lequel
il prétend que les tierciaires carmes defeendent immédiatement
du prophète Elie , auffi-.bien que les
carmes fernes ; 6c parmi les grands hommes qui ont
ait profemon de ce tiers-ordre, il met le prophète
Abdias qui vivoit environ 800 ans avant la naiffance
de Jelus-Chrift ; il place parmi les femmes la bifayeulé'
du Sauveur dû monde fous le nom emprunté de S te
Emerentienne. Le traité fingulïer du P. de Coria fur
cette mattere eft intitulé, para las Hcrmdnôs ,y Her-
nmnas de laorden tercera de nueßra Senora del Carmel,
Hifpali j à Séville 1592. Le même auteur publia fix
ans apres à Cordoire 1598 , une chronique de l’ordre
des carmes, Il dit dans ce dernier ouvrage,
qu Abdias, intendant de la maifion du roi Achab dont
il eft parle au troifieme livre des rais, c.xviij. 60
qu il croît etre le prophète Abdias , fût difciple d’E-
he , & qu apres avoir fervi Achab & Ochofias fon
nls , il entra dans l’ordre d’Elie , c.ompofé de gens
maries qui etoient fous la conduite d’Elie & d ’Elifée,
àc fous leur obéiflance comme les conventuels.
\/i lu ‘ j C r i a Prétend enfin que les chevaliers de
Malthe dans leur origine ont été du tiers-ordre des
carmes, 6c, pour en combler la gloire, il y met auffi
ç , . . » v-«** ii 1 un en croit ie r . tsruni
m m m ■ s - ^ a i n a & £ § ■ pa
L t ^ “ l u:-nême- 11 met Ste Génevieve de c
s U j U H jufqu au fixreamëM fîè'Bcle.W I i M - de^p uis S.A^uuaguufiti.iii
Tome X F L
U tkrs-orJn dès prémontrés Ceroit auffi bien an-
aen , s il eft vrai qu’il eût commencé du vivant
meme de feint Norbert ; lequel étoit déjà mort en
D 9 B B B B m . ; 1
Le (ters-orl/e. dé S. Fiançais fémble avoir craint de
K 3 & M ÿ S t« p haut fà nobieffe , & il a ciu part
là s en affiner davantage la poffeffion i lotis les mem-
nriSdé ce earps conviennent que S. François n’infti-
tua Ion £lïïs~Ôrdr-e qù’èn i ï i i , pour des perfonnçi;
de I un & de autre face ; il leur. donna une réglé
dont on n a plus les cbnftitutions. Le premier ordre
de ^nçois Comprend les ordres religieux , qu’on
appellef-erés mineurs, & qui font les Cordeliers les
capucins 6c les récôlets. Le fécond comprend’ les
filles religieufes de Ste Claire. Enfin le troifieme
comprend plufieurs perfonnes de l*un 6c de l’autre
iexe qui vivent dans le monde, 6c c’eft ce qu’on appelle
le tiers-ordre. Les perfonnes qui font de ce tiers-
° . f Poftent fous leurs habits une tunique de forge
gnie Ou un fcapulaire de même étoffe, avec un cor-
dott ; 6c elles obfervent une réglé autoriféè par les
poriufes de Rome.
Tous les tiers-ordres anciens & modernes ont été
appiouves, 6cavec raifon, parle faint fiege, comme
on le peut Voir par les biiiîes de Nicolas IV. en faveur
des tierçaires de S. François , d’innoçent VII.
pouf ceux <Jë S. Dominique, de Martin V. pour ceux 9 ^xte pour ceux des carmes,
oc de Jules II. pour ceux des minimes, des fervitesi
destrinitaifès, &c. ( D . J .)
(Jw fp n d . ) triens) eft quelquefois pris
pour la légitimé des enfans , ainfi que cela fe prati-
que en pays de droit écrit, lorfqu’il n’y a que quatre
ehfàns ou moins de quatre. Novell. n8 de triente &
femiffè. (A)
T iers acquéreur, (Jurifprud.) eft celui qui a acquis
un immeuble affeaé & hypothéqué à un créancier
par çélui qui etoit avant lui propriétaire de cet
immeuble. Voye^ Créancier, Hypothéqué, Possession
, Prescription , T iers détenteur. (A )
T iers a r b it r e , ( Jurifprud.) Foye? ci-devant
SuA-arbitre.
T iers en ascendant , (Jurifprud.) eft un terme
ufite aux parties cafuelles j lorfqu’il s’agit de li-
qiuder le droit dû pour la réfignation d’un office ; on
ajouté à l’évaluation le tiers denier en afeendant
c’eft-à-dire , au-deflùs de l’évaluation ; 6c l’on paie
le huitième du total, c’eft-à-dire, tant de l’évaluation
que du tiers en alcendant, lorfque la provifion s’ex-
P _ 5 l’année que le droit annuel a été payé ,
quand même ce feroit fix mois après le décès de l’of-
ficier ; mais fi elle s’expédie après l’année, il faut
payer le quart denier du fout. foye{ Loyfeau, des
offic. liv.ilî. c.x. n. 6 4, l’édit du mois de Juin 1568,
6c les mots Annuel , Of f ic e , Pa u l e t t e , Par-
TIES CASUELLES, HUITIEME DENIER , ÇiüART DENIER
, R ésignat ion. (A)
T iers des biens en c a u se , (Jurifprud.) on
entend par-là la troifieme partie des héritages 6c
piehs immeubles que quelqu’un poffede dans, le bail-
liagë deCauxen Normandie ou autres lieux de ladite
province tenant nature d’icelui. La coutume de Normandie
, art. x j$ , permet aux pere 6c mere & autres
afeendans de difpofer entrevifs’ou parteftàment
^.e 7^rs au profit de leurs enfàns puînés ou l’un
d’eux fortfs d’un même mariage , à la charge de la
provifion à vie des autres puînés. Les articles fui-
vans contiennent encore plufieurs autres difpofitions
fur ce tiers des puînés fur les biens en Caux. (A )
TlERS, Chambré des tiers ou des procureurs tiers.
( Jurifprud. ) eft une chambre dans l’enclosdu palais j,
proche la chapelle de S. Nicolas, où les procureursj
au parlement qui font la fonélion de tiers, s’affem-
blënt pour donner leur avis fur les difficultés quiTur*
S s i j