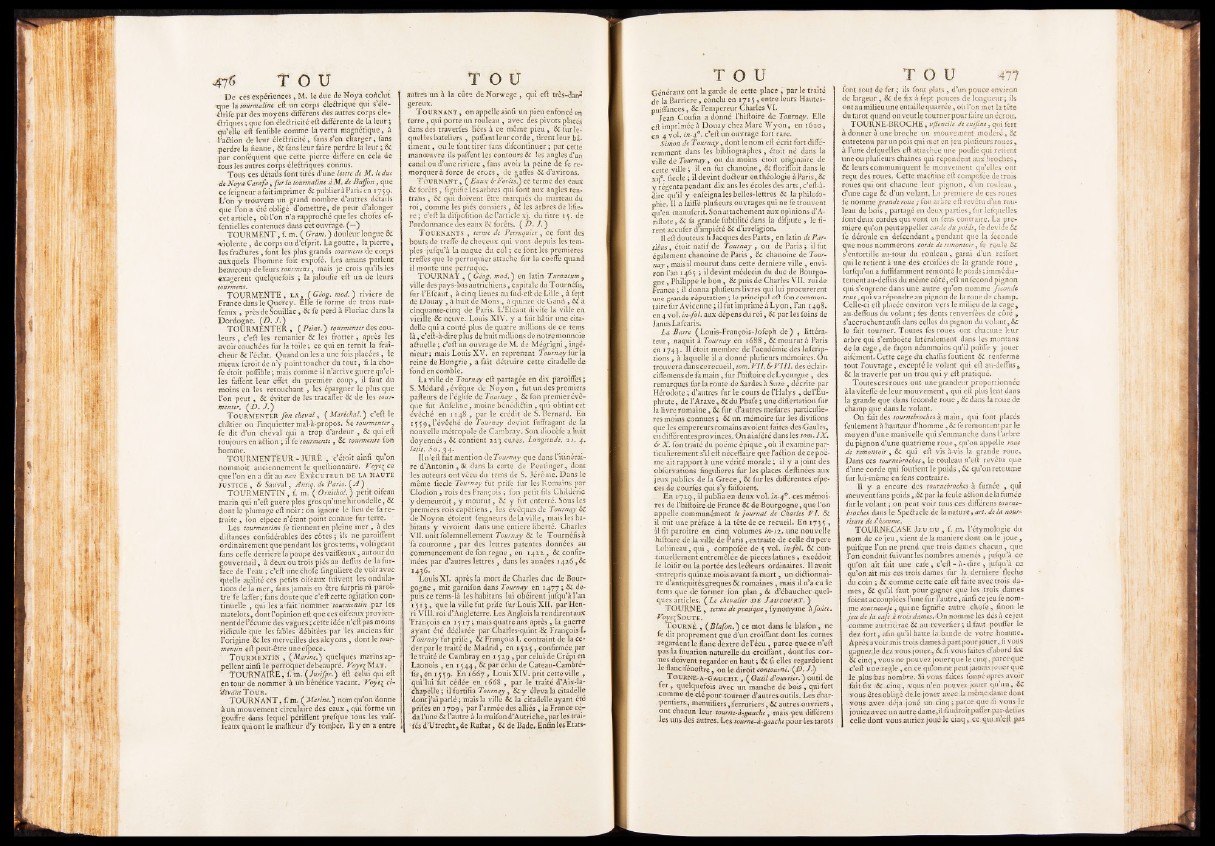
De cés expériences, M. le diic de Noya coAclut
Tque la tourmaline eft un corps éle&rique qui s’éle-
èrife pât des moyens différens dès autres corps électriques
; que fon éle&ricité eft différente de la leur ;
qu’elle eft fenfible comme la vertu magnétique, à
Ta&ion de leur èleftricité, fans s’en charger, fans
perdre la Tienne, & fans leur faire perdre la leur ; 8c
par confequent que cette pierre différé en cela de
tous les autres corps éleôriques connus.
Tous ces détails font tirés d’une lettre de M. le dut
de Noya Carafa, fur là tourmaline à M. de B-ujfon, que
ce feigneur a fait imprimer 8c publier à Paris en 17 5 9.
L’on y trouvera un grand nombre d’autres détails
que Ton a été obligé d’omettre, de peur d’alonger
cet article, oh l’on n’a rapproché que les chofes ef-
fentielles contenues dans cet ouvrage. (—)
TOURMENT, f m. ( Gram. ) douléur longue &
•Violente, de corps ou d’efprit. La goutte, la pierre,
les fradures , font les plus grands tourmens de corps
auxquels l’homme fôit exp'ofé. Les amans parlent
beaucoup de leurs tourmens, mais je crois qu’ils les
exagèrent quelquefois ; la jaloufie eft un de leurs
■ tburrhetis.
TOURMENTE, l a , ( Géog. mod.) riviere de
France dànsle Quéfcy. Elle fe forme_de trois ruif-
feaiix, près de Souiliac, & fe perd à rloriac dans la
Dordogne. (Z). J. )
TOURMENTER , ( Peint.') tourmenter des couleurs
, c’eft les remanier & les frotter, après les
avoir couchées fur la toile ; ce qui en ternit la fraîcheur
& l’éclat. Quand on les a une fois placées , le
mieux feroitde n’y point toucher du tout, f i la choie
étOit pôfîîble ; mais comme il n’arrive gu ere qu’elles
faffeftt leur effet du premier coup, il faut du
moins en les retouchant, les épargner le plus que
l’on peut , 8c éviter de lés tracaffer 8c de les tourmenter.
(Z). J .)
T ourmenter fon cheval, ( Maréchal. ) c’eft le
châtier Ou finquietter mal-à-propos. Se tourmenter,
fe dit d’un cheval qui a trop d’ardfeür , 8c qui eft
toujours en âftion ; il Te tourmente , 8c tourmente foft
homme.
TOURMENTEUR - JURÉ •, Vêtait ainfi qu’on
nommoit anciennement le queftionnaire. Voye{ ce
que l’on en a dit au nïot 'Ex écuteur de la haute
JUSTICE , & Sauvai, Xntiq. de Paris. ( A )
TOURMENTIN, f. m. ( Ofnithol. ) petit oifeau
marin qui n’eft guère plus gros qu’une hirondelle, 8c
dont le plumage'eft nôir : on ignore le lieu de fa retraite
, fon efpece n’étant'point connue fur terre.
Les toutmenti'ns fe tienhent en pleine mer , à des
diftances confidérables des côtes ; ils ne.paroiffent
ordinairement que pendant lés 'gros tem's, voltigeant
fans ceffe derrier'e la pôupe des Vàiffeaux, autour du
gouvernail, 'à deux ou trois piés âu deffUsdef a fur-
face de l’eau ; c’eft ürtë éhofe fingüliere de voiravec
'quelle agilité Oês petits oifèàux fiiivent les ondula-
iions de la mer, fans.jamais en être fürpris lii paroi-
tre fe laffèr; farls doute que'c’eft cette agitation continuelle
, Oui lés a'fait nommer tourmentin .par les
matelots, dont l’opinion eft que ces'oifèaux proviennent
de l’écume des vagues ; cèfte idée n’éft'pas moins
ridicule que lès faciès débitées par 'les anciens fur
l’origine & les merveilles des alcyons., dont le iour-
mentin eft peüt-être üne efpece.
T ourmentin , {Marine.) quelques marins appellent
airifi le perroquet debeàüpré. Voye^ Ma t .
TÔURNATREj'f. m.^Zttr^'r.) éft Celui qui eft
entour de n om m e r tm bénéfice vacant. ‘Voyt{ ci-
aêvarit TbÜR.
TOURNANT, f. m. ( Marine.)ho'm qu’on donUe
à un mouvement circulaire des eaux , qui forme un
gouffre dans lequel périffent prefque 'tous les vaif-
ieâux qui ont le malheur d’y tomber, 11 ÿ en a'entre
autres un à la côte de Norvège , qui eft très-dan“
gerèux.
T ournant , on appelle ainfi un pieu enfoncé en
ferre , qui porte un rouleau , avec dès pivots placée
dans des traverfes liées à Cè même pieu, 8c fur lequel
les bateliers , paffant leur corde, tirent leur bâtiment
, ou le font tirer fans difeontinuer ; par cette
manoeuvre ils paffent lés contours & les angles d’un
canal ou d’une riviere , fans avoir la peine de fe remorquer
à force de crocs, de gaffes 8c d’avirons.
T ournant , ( Eaux & Forêts.) ce terme des eaux
Sc forêts, lignifie les arbres qui font aux angles rentrâtes
, 8c qui doivent être marqués du marteau du
roi, comme les piés corniers , 8c les arbres de lifie-
re ; c’eft la difpofition de l’article xj. du titre 15. de
l’ordonnance des eaux 8c forêts. {JD. J .)
T ournants , terme de Perruquier , ce font des
bouts de treffe de cheveux qui vont depuis les temples
qufqu’à la nuque du col ; ce font les premières
treffes que le perruquier attache fur la coeffe quand
il monte une perruque.
TOURNAI , ( Géog. mod. ) en latin Turnacum ,
ville des pays-bas autrichiens, capitale du Tournéfis,
fur l’Efcaut, à cinq lieues au fud-eft de Lille , à fept
de Douay , à huit de MohS;, à quinze de Gand, & à
cinquante-cinq de Paris. L’Efcaut divife la ville en
vieille 8c neuve. Louis X IV. y a fait bâtir une citadelle
qui a coûté plus de quatre millions de ce tems
là , :c’eft-à-dire plus de huit millions de notre monnoie
ââueïle; c’eft un ouvrage de M. de Mégrigni, ingénieur;
mais Louis X V . en reprenant Tournay fur la
reine de Hongrie, a fait détruire cette citadelle de
fond en comble.
La ville de Tournay eft partagée en dix paroiffes;
S. Médard, évêque de Noyon , fut un des premiers
pafteiirs de l’églife de Tournay , & fon premier évêque
fut Anfelme, moine bénédiftin , qui obtint cet
évêché en 1148 , par le crédit de S. Bernard. En
15 5 9 ,l’évêché de Tournay devint fuffragant de la
nouvelle métropole de Cambray. Sort, diocèfe a huit
doyennés, & contient 223 cures. Longitude. 2 1 .4 .
l'atit. 50 .3 4 .
Il n’eft fait mention de Tournay que dans l’itinéraire
d’Antonin , & dans la carte de Peutinger, dont
les auteurs ont vécu du tems de S. Jérôme. Dans le
même fiecle Tournay fut prife fur les Romains par
Clodiôn, rois des François ; fon petit fils Childeric
y dëmèuroit, y mourut, 8c y fut enterré. Sous les
premiers rois capétiens, les évêques de Tournay 8c
de Noyon étoïent feigneurs de la ville, mais les habitons
y vivoient dans Une entière liberté. Charles
VII. unit folemneilement Tournay 8c le Tournéfis à
Ta'couronne , par des lettres patentes données au
'commencement de fon régné , en 1422 , Sc confirmées
par d’autres lettres , dans les années 1426,6c
I4 3 6 - • WÊÊ !. .
Louis XI. après la mort de Charles duc de Bourgogne
, mit garnifon dans Tournay en 1477 ; 8c depuis
ce tem's-là les habitans lui obéirent jufqu’à l ’an
1513 , que la ville fut prife fur Louis XII. par Henri
VIÎI. roi d’Angleterre. Les Anglois la rendirent aux
‘François en 15 17 ; mais quatre ans après , la guerre
ayant été déclarée par Charles-quint •'& François I.
T oûrnay fut p rife, & François I. contraint de la ce-
d'ërrpar le traité de Madrid, en 1525 ,. confirmée, par
Te traité de Cambray en 1529, par celui de Crépi en
Lâonois , en 1544, 8c par celui de Cateau-Cambré-
"fïs, én 1 < 59. Èn i 6 6 7 , Louis XIV. prit cette ville,,
qlu^lui'mt cédée en i66'8 , par le traité d’Aix-la-
'Chapélle ; il fortifia Tournay, & y éleva la citadelle
Jdonf j’ai parlé ; mais la ville & la citadelle ayant été
prifés en 1709, par l’armée des alliés , la France ce-
daTune & l’autre à la rnaifon d’Autriche , par les trai-
"fésd’Utrecht,de Raftat, 8c de Bade, EnnnlesEtats-
Généraux ont la garde de cette place , par le traité
de la Barrière, conclu en 1715 , entre leurs Hautes-
puiffances, 8c l’empereur Charles VI.
Jean Coufin a donné l’hiftoire de Tournay. Elle
eft imprimée à Douay chez Marc V y o n , en 1620,
en 4 vol. in-40. c’eft un ouvrage fort rare.
Simon de Tournay, dont le nom eft écrit fort différemment
dans les bibliographes, étoit né dans la
ville de Tournay, ou du moins étoit originaire de
cette ville ; il en fut chanoine, 8c florifloit dans le
xijc. fiecle ; il devint dofteur en théologie à Paris, 8c
y régenta pendant dix ans les écoles des arts, c’eft-à-
dire qu’il y enfeigna les belles-lettres 8c la philofo-
phie. Il a laiffé plufieurs ouvrages qui ne fe trouvent
qu’en manuferit. Son attachement aux opinions d’A-
riftote, 8c fa grande fubtilité dans la difpute , le firent
accufer dfimpiété 8c d’irreligion»
Il eft douteux fi Jacques des Parts, en latin de Par-
tibus, étoit natif de Tournay , ou de Paris ; il fut
également chanoine de Paris , 8c chanoine de Tournay
, mais il mourut dans cette derniere ville , environ
l’an 1465 ; il devint médecin du duc de Bourgo-
gne, Philippe le bon , ÔC puis de Charles VII. roi de
France ; il donna plufieurs livres qui lui procurèrent
une grande réputation ; le principal eft fon commentaire
fur Avicenne ; il fut imprimé à Lyon, l’an 1498.
en 4 vol. in-fol. aux dépens du ro i, 8c par les foins de
Janus Lafcaris»
La Barre ( Louis-François-Jofeph d e ) , littérateur,
naquit à Tournay en 16 8 8 ,8c mourut à Paris
en 1743. Il étoit membre de l’académie des Infcrip-
tions , à laquelle il a donné plufieurs mémoires. On
trouvera dans ce recueil, tom. V II.& V III. desédair-
ciffemens de fa main, fur l’hiftoire de Lycurgue, des
remarques fur la route de Sardes à Suze , décrite par
Hérodote ; d’autres fur le cours de l’Halys , del’Ea-
phrate, de l’Araxe, 8c du Phafe ; une differtation fur
la livre romaine, 8c fur d’autres mefures particulier
res moins .connues^ 8c un mémoire fur les divifions
que les empereurs romains avoient faites des Gaules,
en différentes provinces,. On ainféré dans les tom. IX.
& X . fon traité du poëme épique , oii il examine particulièrement
s’il eft néceffaire que l’a&ion dece poëme
ait rapport à une vérité morale ; il y a joint des
©bfervations fingulieres fur les places, deftinées aux
jeux publics de la Grece , 8c fur les différentes efpe-
tes de courfès qui s’y faifoient,
En 1729, il publia en deux vol. in-40..ces mémoires
de l’hiftoire de France 8c de Bourgogne, que Ron
appelle communément h journal de Charles V I. 8c
il mit une préface à la tête de ce recueil. En 173 5 >
il-fit paroître en cinq volumes in-/2. .une nouvelle
•hiftoire de la ville de Paris, extraite de celle du pere
Lobineau, q u i, compafée de 5 vol» in-fol. Sc continuellement
entremêléede pièces latines » excédoit
lé loifir ou la portée des leêieurs ordinaires. Il avait
-entrepris-quinze mois avant fa mort, un didionnai-
re d’antiquitésgreques 8c-romaines , mais il n’aÆu'le
items que de former fon plan , & d’obaucher quelques
articles. {Le chevalier JD-E Jaucourt.J)
TOURNE , terme de pratique, fynonyme h foute.
Voyt^S OUT-E.
T ourné , ( B l a f o n ce mot dans le blafon , ne
fe dit proprement que d’un croiffant dont les cornes
regardentle-ïlanc dextre del’écu , parce quece n ’eft
.pasila fituation naturelle du -croiffant, dont les cornes
doivent-regarder-en haut ; 6c-fi elles regardaient
le flanc tféneftre, -on le diroit contourné. f D . J.j)
T ourne-a -ga»u che Outil d?ouvrier. ).outil de
f e r , quelquefois avec un manche de bois ,-quidert
icomme dégelé pour-tourner d’autres outils. Les dhar-
pentiers,.menuifiers ,ferruriers ,»8c autres-ouvriers,
ont chacun leur tourne-àrgauche, mais-peu dïfférens
les uns des autres. Les tourne-à-gauche pour-lestarots
font tout de fer ; ils font plats , d’un pouce environ
de largeur, 8c de fix à fept pouces de longueur-; ils
ont au milieu une entaille quarrée, oii l’on met la tête
du tarot quand on veut le tourner pour faire un écrou.
TOURNE-BROCHE, uftencile de cuijine, qui fert
à donner à une broche un mouvement modéré, 8c
entretenu par un pois, qui met en jeu plufieurs roues ,
à l’une defquelles eft attachée une poulie qui retient
une ou plufieurs chaînes qui répondent aux broches,
8c leurs communiquent le mouvement qu’elles ont
reçu des roues. Cette machine eft compofée de trois
roues qui ont chacune leur pignon, d’un rouleau,
d’une cage 8c d’un volant, La première de ces roues
fe nomme grande roue ; fon arbre eft revêtu d’un rouleau
de bois , partagé en deux parties, fur lefquelles
font deux cordes qui vont en fens contraire. La première
qu’on peutappeller corde du poids, fe dévidé 8ç
fe déroule en defeendant, pendant que la fécondé
que nous nommerons torde de remontoir, fe roule 8c
s’entortille au-tour du rouleau, garni d’un reffort
qui le retient à une des eroifées de la grande roue »
lorfqu’on a fuffifamment remonté le poids ; immédiatement
au-deffus du même côté, eft un fécond pignon
qui s’engrene dans une autre qu’on nomme fécondé
roue, qui va répondre au pignon de la roue de champ.
Celle-ci eft placée environ vers le milieu de la cage,
au-deffous du volant ; fes dents renverfées de côté ,
s’accrochent aufîi dans celles du pignon du volant, 8c
le fait tourner. Toutes fes roues ont chacune leur
arbre qui s’emboëte latéralement dans les montans
de la cage, de façon néanmoins qu’il puiffe y jouer
aifément. Cette cage .du chaffis foutient 8c renferme
tout l’ouvrage, excepté le volant qui eft au-deffus ,
8c la traverfe par un trou qui y eft pratiqué.
Toutes ces roues ont une grandeur proportionnée
àlayîteffe de leur mouvement, qui eft plus lent dans
la grande que dans fécondé roue, 8c dans la roue de
champ que dans le volant.
On fait des tournebroches à main, qui font placés
feulement à hauteur d’homme, 8c fe remontent par le
moy en d’une manivelle qui s’emmanche dans l’arbre
du pignon d’une quatrième roue, qu’on appelle roue
de remontoir, 8c qui eft vis à-vi? la grande roue.
Dans ces tournebroches, le rouleau n’,eft revêtu que
d’une corde qui foutient le poids , 8c qu’ooretouene
fur lui-même en fens contraire»
H y .a encore des tournebroches à fumée , qui
-meuventfans poids 9 C8c par la feule aâion de la fumée
fur le volant ; on p.eut voir tous ,ces différen? pourne-
broches .dans le Speâaclede la nature, art. de la nourriture
de Ü.homme.
TO.URNECAS.E Jeu .du , f. ni. l’étymologie du
nom de ;ce jeu , vient de la maniéré dont on le jou e,
puifque l’on ne prend que trois dames chacun, que
Ton conduit fuivant les’nombres amenés , jufqu’à ce
qu’on .ait fait une café , .c’eft -à -d ire , jufqu’à ce
qu’on ait mis ces trois dames fiu la derniere fléché
-du coin ; oomme ce.tte café eft faite avec trois dames
, 8c qu’i l faut pour gagner que les trois dames
.foient.acGOUplées l’une fur l’autre ,ainfi ce jeu fe nomme
itournecaje, qui.ne fignifie autre choie, finon le
jeu de la café à trois dames. Qii nomme les des à ce jeu
comme amtriftrac 8c ,au reverfier.; il faut pouffer le
dez ffort, afin qu’il batte la.bande de votre .homme»
Après avoir mis trois <lames:à partpour jouer, fi vous
gagnez\le- dez vous .jouez , .8cfi vous faites .d’abord fix
8c cinq, vous ne pouvez jouer que le cinq, parce qye
c’eft unejtegle , en_ce quîonme peut jammsijouer que
,1e plus bas nombre.-Si vous faites fonué après avoir
faitfix /8c-cinq, .vqusjfen pouvez jouer qu’un, 8c
-vous .êtes.obligé deie-jouer avec ,1a même,dame dont
•vous avez -déjà -joué un . cinq ; parce, que ifi vous le
. jouiezavec un autre dame,il faudroit paffer. par-deffvis
-celle dont vous.auriez .jouéfe cinq, .ce qiù.n’eft pas