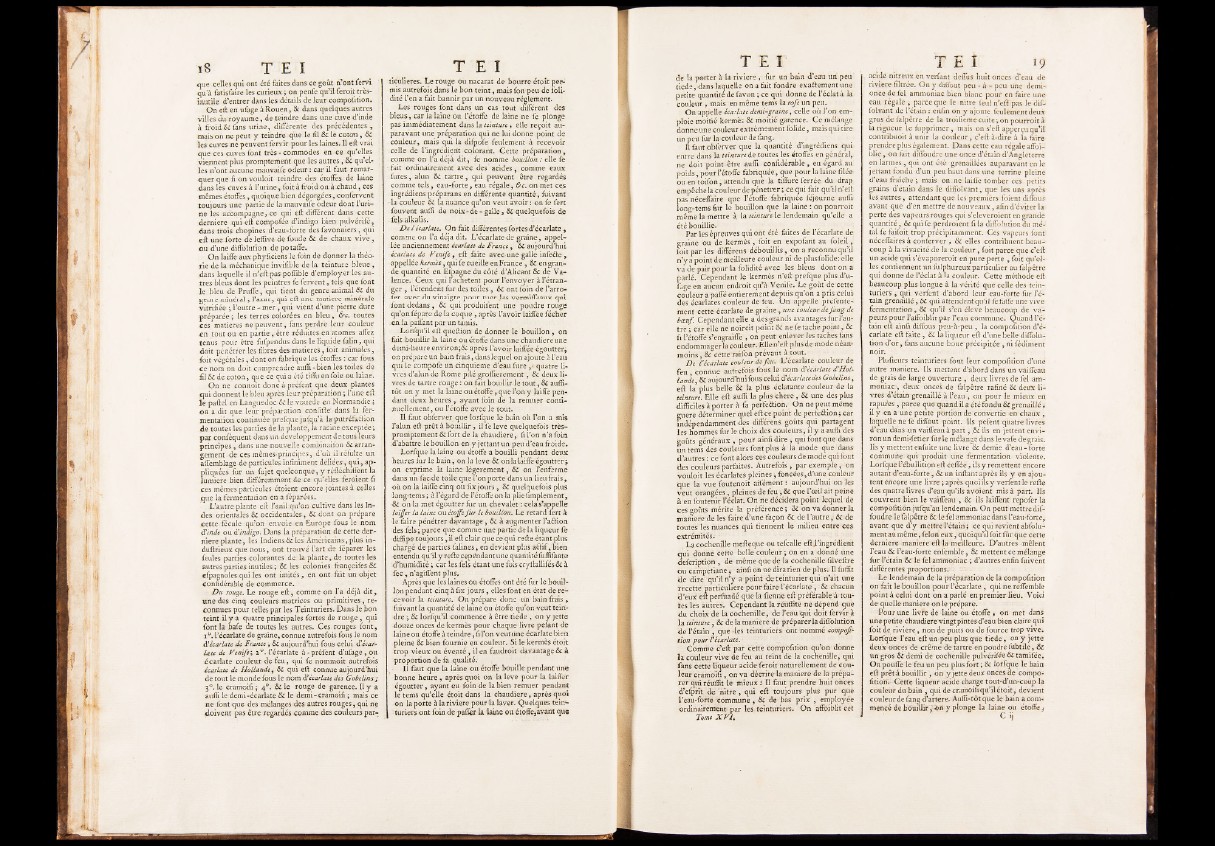
<jue celles qui ont été faites dans ce goût n’ont fervi
qu’à Satisfaire les curieux ; on penfe qu’il ferait très-
inutile d’entrer dans les détails de leur compofition.
On eft en ufage à Rouen, & dans quelques autres
villes du royaume, de teindre dans une cuve d’inde
à froid &c fans urine, différente des précédentes ,
mais on ne peut y teindre que le fil &c le coton, &c
les cuves ne peuvent fervir pour les laines. Il eft vrai
que ces cuves font très - commodes en ce qu’elles !
viennent plus promptement que les autres, &t qu’elles
n’ont .aucune mauvaife odeur : car il faut, remarquer
que. fi on vouloir teindre des étoffes, dé laine
dans les cuves à l’urine, foit à froid ou àxhaud, ces
mêmes étoffes, quoique.bien dégorgées, confervent
toujours une partie ae la mauvaife odeur dont l’urine
les accompagne, ce qui eft différent dans cette
derniere qui eft compofee d’indigo bien pulvérifé,
dans trois chopines d’eau-forte des Savonniers, qui
eft une forte de leffive de foude & de chaux v iv e ,
ou d’une diffolution de po taffe.
. On laiffe aux phyficiens le foin de donner la théorie
de la méchanique invifible de la teinture bleue,
dans laquelle il n’eft pas poffible d’employer les autres
bleus dont les peintres'fe fervent, tels que font
le bleu de Pruffe, qui tient du genre animal & du
genre minéral ; l’azur, qui eft une matière minérale
vitrifiée ; l’outre - mer , qui vient d’une pierre dure
préparée ; -les terres colorées, en bleu, &c. toutes
,ces matières ne peuvent, fans perdre leur couleur
en tout ou en partie.,:être réduites en atomes affez
tenus pour être fufpendus dans le liquide fâlin, qui
doit pénétrer les fibres des matières, loin animales, r
foit végétales, dont on fabrique les étoffes car fous
c e nom on doit comprendre .auffi - bien les.toiles de
fil & de coton, que ce qui -a été tiffii en foie ou laine.
On ne connoît donc à préfent que deux plantes
qui donnent le bleu après leur préparation ; l’ une eft
le paftel en Languedoc & le vouede en Normandie ;
on a dit que leur préparation confifte' dans la fermentation
continuée prefque jufqu’ à laputrelàction
de toutes les parties de la planté, la racine exceptée;
par conféquent dans un développement de tou$.leurs
principes, dans une nouvelle combinaifon & arrangement
de ces mêmes- principes, d’où il réfulte un
affemblage-de particules infiniment déliées, qui, appliquées
fur un fujet quelconque, y réfléchilfent la
lùmiere bien différemment de ce qu’elles feraient fi
ces mêmes particules étpient encore jointes à celles
que la fermentation-en a féparées.
L ’autre plante eft l’anilq.u’on cultive dans les Indes
orientales & occidentales , & dont on prépare
cette fécule-qu?on envoie en Europe fous le nom
d’inde ou à'indigo. Dans la préparation de cette derniere
plante, les Indiens &: les Américains, plus in-
duftrieux que nous, ont trouvé l’art de féparer les
feules parties colorantes de la plante, de toutes les
autres parties inutiles; & les colonies françoifesôc
cfpagnoles qui les ont imités , en ont fait un objet
confidérable de commerce.
Du rouge. Le rouge eft, comme on l’a déjà dit,
une des cinq couleurs matrices ou primitives, reconnues
pour telles par les Teinturiers. Dans le bon
teint il y a quatre principales fortes de rouge, qui
font la bafe de toutes les autres. -Ces rouges font,
i° . l’écarlate de graine, connue autrefois fous le nom
d? écarlate de France ; & aujourd’hui fous celui d’écar-
late de Venife; a p. l’écarlate à-préfent d’ufage , ou
écarlate couleur de feu, qui fe nommoit autrefois
écarlate de Hollande, & qui eft connue aujourd’hui
de tout le monde fous le nom d’écarlate des Gobelins ;
30. le cramoifi ; 40. & le rouge de garence. Il y a
auffi le demi-écarlate & le demi-cramoifi ; mais ce
ne font que des mélanges des autres rouges, qui ne
doivent pas être regardés comme des couleurs particulieres.
Le rouge ou nacarat de bourre étoit per«'
mis autrefois dans le bon teint, mais Son-peu de Solidité
l’en a fait bannir par un nouveau réglement.
Les rouges font dans un cas tout différent des
bleus, car la laine ou l’ étoffe de laine ne fe plonge
pas immédiatement dans la teinture, elle reçoit auparavant
une préparation qui ne lui donne point de
couleur, mais qui la difpofe feulement à- recevoir
■ celle de l’ingrédieiît colorant. Cette préparation ,
comme on l’a déjà dit, fe nomme bouillon : elle fè
• fait ordinairement avec des acides, , comme eaux
dures., alun & tartre, qui peuvent être regardés
comme tels, eau-forte, eau régale, &c. on met ce.s
ingrédiens préparans en différente quantité, fuivant
-la couleur 6l la nuance qu’on veut avoir : on fe fert
fouvent aufii de noix-de - galle, & quelquefois de
; fiels .alkalis.
De l'écarlate. On fait différentes fortes d’écarlate ,
comme on l’a déjà dit. L’écarlate de graine, appel-
lée .anciennement écarlate de France, & aujourd’hui
écarlate de Venife , eft faite avec-une galle infeâe ,
appellée kermès, quife cueille en France , & en grande
quantité en El pagne du côté d’Alicant & de Valence.
Ceux qui l’achetent pour l ’envoyer à l’étranger
, l’étendent fur des toiles, & ont foin de l’arro-
lèr avec du vinaigre pour tuer les vermiffeaux qui
font dedans, & qui produisent une poudre rouge
qu’on fépare de la cpque , après l’avoir iaiffée fécher
en la paflant par un tamis.
'Loriqu’il eft queftipn de donner le bouillon , on
, fait bouillir la laine ou étoffe dans une chaudière une
-demirheure environ;^ après l’avoir Iaiffée égoutter;
on prépare un bain frais, dans lequel on ajoute à l’eau
qui le compofe un cinquième d’eau fure ,* quatre li-
vres.d’alun de Rome pilé grolîierement, & deux livres:
de tartre rouge : on fait bouillir, le tout, & auffi-
tôt .on y met la laine ou étoffe, que l’on y laiffe pendant
deux heures, ayant foin de la remuer continuellement
, ou l’ étoffe avec le tout.
Il faut obferver que lorfque le bain où l’on a mis
l’alun eft prêt à bouillir, il fe leve quelquefois très-
proniptement & fort de la chaudière, fi l’on n’a foin
d’abattre le bouillon en yjettantun peu d’eau froide.
Lorfque la laine ou-étoffe a bouilli pendant deux
heures lùr le bain, on la leve & oh la laiffe égoutter;
on exprime la laine légèrement, & on l’enferme
-dans un faede toile que l ’on porte dans un lieu frais,
où on la laiffe cinq ou fix jours, & quelquefois plus
long-tems ; à l’égard de l’étoffe on la plie Amplement,
& on la met égoutter fur un chevalet : cela s’appelle
laijjer la laine ou étoffe fur le bouillon. Le retard fort à
le faire pénétrer davantage, & à augmenter l’aftion
des fels; parce que comme une partie de la liqueur le
-diflipe toujours, il eft clair que ce qui refte étant plus
chargé de parties Salines, en devient plus âétif, bien
entendu qu’il y refte cepéndant une quantité Suffisante
d’humidité ; car les fels étant unefois cryftallifés&à
fe c , n’agiffent plus.
Après que les laines ou étoffes ont été fur le bouillon
pendant cinqàfix jours, elles font en état de recevoir
la teinture. On prépare donc un bain frais ,
fuivant la quantité de laine ou étoffe qu’on-veut teindre
; & lorfqu’il commence à être t-iede , on y jette
douze onces de kermès pour chaque livre pefant de
laine ou étoffe à teindre , -fi l’on veutiine écarlate bien
pleine & bien fournie en couleur. Si le kermès étoit
•trop vieux ou éventé, il en faudroit davantage & à
proportion de fa qualité.'
'• - Il faut que la laine ou étoffe bouille pendant une
bonne heure, après quoi on la leve pour la laiflèr
égoutter, ayant eu foin dé la bien remuer pendant
le tems qu’elle étoit dans la chaudière , après quoi
on la porte à la riviere pour la laver. Quelques tein1-
tuners ont foin de paffer la laine ou étoffe,avant que
de la porter à la rivieré ,■■ •fur un bain d’eau urï peu
tiede, dans laquelle on a fait fondre exaftement une
petite quantité de favon ; ce qui donne de l’éclat à la
Couleur , mais en même tems la rofe un peu.
On appelle écarlate demi-graine, celle où l ’on emploie
moitié kermès & moitié garence. Ce mélange
donne une couleur extrêmement Solide, mais qui tire
un peu fur la couleur de fang.. î
Il faut obferver que la quantité d’ingrédiens qui
entre dans la teinture de toutes les étoffes en général,
ne doit point être auffi confidérable , eu égard au
poids, pour l’étoffe fabriquée, que pour la laine filée
ou en toifon, attendu que la tiffure ferrée du drap
empêche la couleur de pénétrer ; ce qui fait qu’il n?eit
pas néceffaire que l’étoffe fabriquée Séjourne auffi
longrtems for le bouillon que la laine : on pourroit
même la mettre à \zteinture le lendemain qu’elle a
été bouillie; , , . , '
Par les épreuves qui ont été faites de l’écarlate de
graine ou de kermès, foit en expofant au Soleil,
foit par les différens débouillis, on a reconnu qu’il
n’y a point de meilleure couleur ni de plus folide: elle
va de pair pour la Solidité avec les bleus dont on a
parlé. Cependant le kermès n’eft prefque plus d’u-
fage en aucun endroit qu’ à Venife. Le goût de cette
couleur a paffé entièrement depuis qu’on a pris celui
des écarlates couleur de feu. On appelle préfente-,
ment cette écarlate de graine, une couleur de fang de
boeuf. Cependant elle a des grands avantages lur l’autre
; car elle né noircit point & ne fe tache point, &
fi l’étoffe s’engraiffe , on peut enlever les taches fans
endommager la couleur. Elle n’eft plus de mode néanmoins,
& cëtte raifon prévaut à tout.
De l'écarlate couleur defeu. L?écarlatecoUleur de
Feu connue autrefois fous lé nom d’écarlate d'Hol*
lande, & aujourd’hui fou S celui d’écarlatedes Gobelins,
eft la plus belle & la plus éclatante' couleur de la
teinture. Elle eft auffi la plus chere , & une des plus
difficiles à porter à fà perfection. On ne peut même
guere déterminer quel eft ce point de pertëétion; car
indépendamment dès différens goûts qui partagent
les hommes furie choix des couleurs, il y a auffi des
goûts généraux , pour ainfidire ; qui font que dans
un tems dès douleurs font plus à la mode que dans’
d ’autres : ce font alors ces couleurs de mode qui font
des couleurs parfaites. Autrefois , par exemple ,■ on
vouloit les écarlates pleines ; foncées, d’une couleur
que la vue fouîénoit aiiëment : aujourd’hui on lès
veut orangées, pleines dé feu ; & que l’oeil ait peine
à en Soutenir l?éelàt. On ne décidera point lequel de
tes goûts mérité là préférence ; & on va donner la
maniéré de les faire d’une façon & de l’autre,1 & de
foutes les nuances qui tiennent le milieu entre ces
extrémités."; - '
La cochenille mefteque ou tefcallë eft ^’ingrédient
qui donne cette belle couleur ; On en a dônflé une
deferiptiqn , dé même que de la cochenille filveftre
ou campètiane'; ainfion né dira rien-de plus»1 II iùffit
de dire qu’il n’y appoint de teinturier qui n’ait Une
recette, particulière pour faire l’écarlate , & chacun
d ’eux eft perfuadë que la fienne eft préférable & toutes
les autres. Cependant la réûffite né dépend que
du choix de la cochenille, de l’eau qui doit fervir à
la teinture, & de la maniéré dé préparer là diffolution
dé l’étain , que -les teinturiers ont nommé compoff
tion pour f écarlate. ■
Comme c’eft par cette compofition qu’ôn donne
la couleur vive de feu au teint dé la cochenille, qui
fans cette liqueur acide ferait naturellement de coupleur
cramoifi, on va décrire-la maniéré de la préparer
qui réüffit le mieux : Il faut prendre huit onces
d’ efprit de lhitre , qui eft toujours plus pur qüè
l ’eau-forte commune, & de bas prix , employée
ordinairement par les teinturiers. On affôjbiit eet
Tome X V L
acide nitreux en verfant deiffus huit onces d'eau de
riviere filtrée. On y diflbut peu - à - peu une demi-
once de fel ammoniac bien blanc pour en faire une
eau régale , parce que le nitre Seul n’eft pas le dif-
folvant de l’étain : enfin on y ajoute feulement deux
gros de l’alpêtre de la troifieme cuite ; on pourrait à
la rigueur le fupprimer, mais on s’eft apperçu qu’il
contribuoit à unir la couleur, c’eft-à-dire à la faire
prendre plus également. Dans cette eau régale affoi-
blie, on fait diffoudre une once d’étain d’Angleterre
en larmes , qui ont été grenaillées auparavant en le
jettant fondu d’un peu haut dans une terrine pleine
d’eau fraîche ; mais on.ne laiffe tomber ces petits
grains d’étain dans le diffolvant, que les uns après
les autres, attendant que les premiers foient diffoiu
avant que d’en mettre de nouveaux, afin d’éviter la
perte des vapeurs rouges qui s’eleveroient en grande
quantité, & qui fe perdroient li la diffolution du métal
fe faifoit trop précipitamment. Ces vapeurs font
néceffaires à conferver , & elles contribuent beaucoup
à la vivacité de la couleur, foit parce que c’eft
un acide qui s’évaporerait en pure perte , foit qu’elles
contiennent un fulphureux particulier au Salpêtre
qui donne de l’éclat à la couleur. Cette méthode eft
beaucoup plus longue à la vérité que celle des teinturiers
, qui verfent d’abord leur eau-forte fur l’étain
grenaillé, & qui attendentqu’il fefaffe une vive
fermentation , & qu’il s’en éleve beaucoup de vapeurs
pour l’affoiblir par L’eaii commune. Quand Pétain
elt ainfi diffous peu-à-peu , la compofition d’écarlate
eft faite, & la liqueur eft d’une belle diffolution
d’oir, fans aucune boue précipitée , ni Sédiment
noin •
Plufieürs teinturiers font leur compofition d’uné
autre maniéré. Ils mettent d’abord dans un vaiffeau
de grais de large ouverture , deux livres de fel ammoniac?,
deux onces de Salpêtre rafirié & deux livres
d’étain grenaillé à l’eau , ou pour le mieux en
rapur'es , parce que* quand il a été fondu & grenaillé ;
il y en a une petite portion de convertie en chaux ,
laquelle ne fè diffout point. Ils pefent quatre livres
d’eau dabs un vaiffeau à p art, ,tk ils en jettent envi-
ronun demi-fetier fur le mélange dans le vafe de grais.
Ils y mettent enfuite une livre ÔC demie d’eau - forte
commune- qui produit une fermentation violente.
Lorfque l’ébullition eft ceffée, ils y remettent encore
autant d’eau-forte, & u n inftant après ils y en ajoutent
ëncçre une livre ; après quoiilsy verlent le refte
des quatre livres d’eau qu’ils avoient mis à part. Ils
couvrent bien le vaiffeau-, :& ils laiffent repofer la
compofition jufqu’au lendemain. On peut mettre dif-
foudre lefalpêtre & le fel ammoniac dans l’eau-forte,
avant que d’y mettre l’étain ; ce qui revient absolument
aii même 4 félon eux,; quoiqu’il foit fur que cette
derniere maniéré eft la meilleure. D ’autres mêlent
l’eau & Peau-forte enfemble, & mettent ce mélange
fur Pétain &c lé fel ammoniac ; d’autres enfin Suivent
différentes proportions.'-'
Le lendemain de la préparation de la compofition
on fait le bouillon pour l’écarlate, qüi ne reffèmble
point à celui dont on a parlé en premier lieu. Voici
de quelle maniéré on le préparé.
Pour une livre dé laine ou étoffe , ori inet dans
une-petite chaudiere- vingt pintes d’eau bien claire qui
foit de riviere, non de puits ou de Source trop vive.
Lorfque l’éàu eft un-peu plus que tiede, on y jette
deux-onces de crème de tartre en poudre Subtile, &
Un gros & demi de cochenille pulvérifée & tamifée.
On pouffe le feu un peu plus fort ; & loffqué le bain
eft prêt à bouillir, on y jette deux onces de compo-
fitiom: Getïe liqueur acide change tbut-d’un-coùp la
couleur du bain , qui de cramoifi qu’il étoit, devient
couleur de fang d’artere. Auffi-tôt que le bain a commencé
de bouillir ,-bn y plonge la laine ou étoffe <