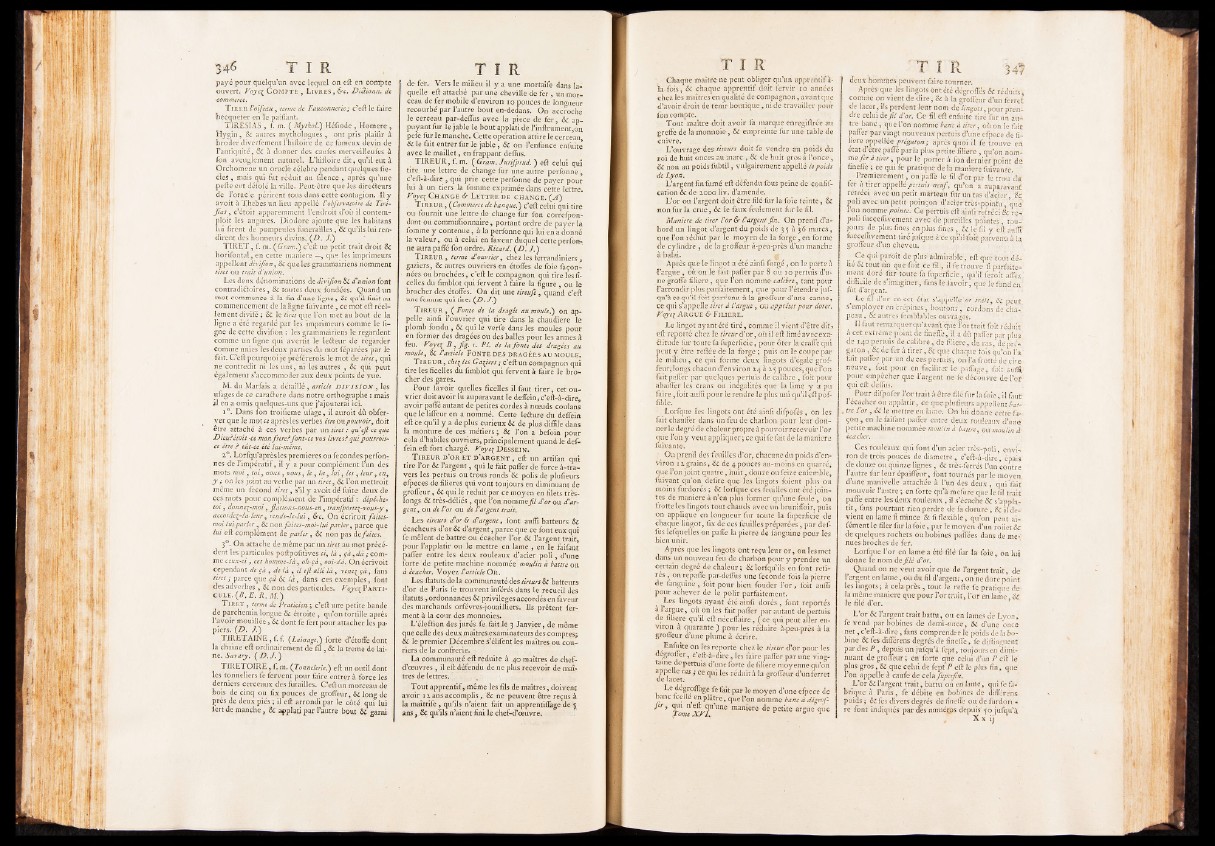
payé pour quelqu’un avec lequel on eft en compte
ouvert. Voyez C om pte , Livr es, &c. Diclionn. de
^commerce.
T irer Foifeau, terme de Fauconnerie ; c’eftle faire
becqueter en le paiflant.
TIRÉS! AS , f. m. ( Mythol.') Héfiode , Homere,
Hygin, & autres mythologues, ont pris plaifir à
broder diverfement Fhifloire de ce fameux devin de
l’antiquité, & à donner des caufes merveilleufes à
fon aveuglement naturel. L’hiftoire dit, qu’il eut à
Orchomene un oracle célébré pendant quelques fie-
cleS, mais qui fut réduit au filence , après qu’une
pelle eut déiolé la ville. Peut-être que les directeurs
de l’oracle périrent tous dans cette contagion. Il y
avoit à ïhebes un lieu appellé F obfervatoire de Tiré-
fia s , c’étoit apparemment l’endroit d’oii il contem-
ploit les augures. Diodore ajoute que les habitans
lui firent de pompeufes funérailles, & qu’ils lui rendirent
des honneurs divins. (D . J.)
T IR E T , f. m. (Gram?) c’elt un petit trait droit &
horifontal, en cette maniéré —, que les imprimeurs
appellent divijlon, & que les grammairiens nomment
tiret oïl trait d'union.
Les deux dénominations de divijlon & d'union font
contradictoires, & toutes deux fondées. Quand un
mot commence à. la fin d’une ligne, & qu’il finit au
commencement de la ligne fuivante, ce mot elt réellement
divifé ; & le tiret que l’on met au bout de la
ligne a été regardé par les imprimeurs comme le fi-
gne de cette divifion : les grammairiens le regardent
comme un ligne qui avertit le leCteur de regarder
comme unies les deux parties du mot féparées par le
fait. C’elt pourquoi je préférerois le mot de tiret, qui
ne contredit ni les uns, ni les autres , & qui peut
également s’accommoder aux deux points de vue.
M. du Marfais a détaillé, article d i v i s i o n , les
ufages de ce caraCtere dans notre orthographe : mais
il en a omis quelques-uns que j’ajouterai ici.
i° . Dans Ion troifieme ufage, il auroit dû obfer-
ver que le mot ce après les verbes être ou pouvoir, doit
etre attaché à ces verbes par un tiret: quejlceque
Dieu ?étoit -ce mon frere?font-ce vos livres? qui pourroit-
ce être ? eût-ce été lui-même.
2°. Lorfqu’après les premières ou fécondés perfon-
nes de l’impératif, il y a pour complément l’un des
mots moi , toi, nous , vous, le , la, lu i le s , leur, en,
y ; on les joint au verbe par un tiret, & l’on mettroit
même un fécond tiret, s’il y avoit dé fuite deux de
ces mots pour complément, de l’impératif : dépêche-
toi , donnez-moi, jlattons-nous-en, tranjporter-vous-y ,
accordez~la-leur, rends-le-lui, &c. On écriroit faites-
moi lui parler, & non faites-moi-lui parler, parce que
lui elt complément de parler, & non pas dè faites.
3°. On attache de même par un tiret au mot précédent
les particules pollpofitives ci, là , gà, dà ; comme
ceux-ci, cet homme-là, oh-çà, oui-dài. Onécrivoit
cependant de g à , de là , il ejl allé là , venez g à , fans
tiret ; parce que gà & là , dans ces exemples, font
des adverbes , & non des particules. Voyez Pa r t icule.
(B. E. R. M.)
T iret , terme de Praticien ; c’elt une petite bande
de parchemin longue & étroite , qu’on tortille après
l’avoir mouillée, & dont fe fertpour attacher les papiers.
(d . y.)
TIRETAIN E, f. f. (Lainage.) forte d’étoffe dont
la chaine elt ordinairement de f il, & la treme de laine.
Savary. ( D .J . )
TIRETOIRE, f. m. (Tonnelerie.) elt un outil dont
les tonneliers fe fervent pour faire entrer à force les
derniers cerceaux des futailles. C’elt un morceau de
bois de cinq ou fix pouces de groffeur, & long de
près de deux piés ; il elt arrondi par le côté qui lui
fert de manche, & applati par l’autre bout & garni
de fer. Vers le milieu il y a une mortaife dans la-i
quelle elt attaché par une cheville de fe r , un morceau
de fer mobile d’environ io pouces de longueur
recourbé par l’autre bout en-dedans. On accroché
le cerceau par-deffus avec la piece de fer, & appuyant
fur le jable le bout applati de l’inltrument,on
pele fur le manc,he. Cette opération attire le cerceau,
& le fait entrer fur le jable, & on l’enfonce enfuite
avec le maillet, en frappant delfus.
TIREUR, f. m. ( Gram. Jurifprud. ) elt celui qui
tire une lettre de change fur une autre perfonne,
c’elt-à-dire , qui prie cette perfonne de payer pour
lui à un tiers la fomme exprimée dans cette lettre.
Voyez C h a n g e & L e t t r e d e c h a n g e ,
. T i r e u r , (Commerce de banque. ) c’elt celui qui tire
ou fournit une lettre de change lur fon correfpon-
dant ou commiflîonnaire, portant ordre de payer la
fomme y contenue, à la perfonne qui lui en a donné
la valeur, ou à celui en faveur duquel cetteperfon-,
ne aura paffé fon ordre. Ricard. (D . J.)
T i r e u r , terme d'ouvrier, chez les ferrandiniers ,
gaziers, & autres ouvriers en étoffes de foie façonnées
ou brochées, c ’elt le compagnon qui tire les ficelles
du fimblot qui fervent à faire la figure , ou le
brocher des étoffes. On dit une tireufe, quand c’eft
une femme qui tire. (D . J.)
T i r e u r , (Fonte de la dragée au moule?) on appelle
ainfi l’ouvrier qui tire dans la chaudière le
plomb fondu , & qui le verfe dans les moules pour
en former des dragées ou des balles pour les armes à
feu. Voyez B , fig. i. PI. de la fonte des dra gèes au
moule, & l'article F o n t e d e s d r a g é e s a u m o u l e .
T i r e u r , ckezles Gaziers ; c’elt un compagnon qui
tire les ficelles du limblot qui fervent à faire le brocher
des gazes.
Pour favoir quelles ficelles il faut tirer, cet ouvrier
doit avoir lu auparavant le delfein, c’eft-à-dire,
avoir palfé autant de petites cordes à noeuds coulans
que le lilfeur en a nommé. Cette leéture du delfein
elt ce qu’il y a de plus curieux & de plus diffile dans
la monture de ces métiers ; & l’on a befoin pour
cela d’habiles ouvriers, principalement quand le def-
fein elt fort chargé. Voyez D e s s e in .
T i r e u r d ’o r e t d ’a r g e n t , elt un artifan qui
tire l’or & l’argent, qui le fait paffer de force à-travers
les pertuis ou trous ronds & polis de plufieurs
efpeces de filières qui vont toujours en diminuant de
grolfeur, & qui le réduit par ce moyen en filets très-
longs & très-déliés , que l’on nomme fil d'or ou d'argent
, ou de l'or ou de l'argent trait.
Les tireurs ctor & d'argent, font auffi batteurs &
écacheurs d’or & d’argent, parce que ce font eux qui
fe mêlent de battre ou écacher l ’or & l’argent trait,
pour l’applatir ou le mettre en lame , en le faifant
palfer entre les deux rouleaux d’acier p o li, d’une
forte de petite machine nommée moulin à battre ou
à écacher. Voyez F article O r .
Les llatuts de la Communauté des tireurs & batteurs
d’or de Paris fe trouvent inférés dans le recueil des
llatuts, ordonnances & privilèges accordés en faveur
des marchands orfévres-jouailliers. Us prêtent ferment
à la cour des monnoies.
L’éleétion des jurés fe.fait le 3 Janvier, de même
que celle des deux maîtres examinateurs des comptes;
& le premier Décembre s’élifent les maîtres ou cou-
riers de la confrérie.
La communauté elt réduite à 40 maîtres de chef-
d’oeuvres , il elt défendu de ne plus recevoir de maîtres
de lettres. .
Tout apprentif, même les fils de maîtres, doivent
avoir 12 ans accomplis, & ne peuvent être reçus à
la maîtrife, qu’ils n’aient fait un apprentiflâge de 5
ans, & qu’ils n’aient fini le chef-d’oeuvre.
Chaque maître ne peut obliger qu’un apprentif à-
la fois, & chaque apprentif doit lervir 10 années
chez les maîtres en qualité de compagnon, avant que
d’avoir droit de tenir boutique, ni de travailler pour
fon compte.
Tout maître doit avoir fa marque enregiltrée au
greffe de la monnoie, & empreinte fur une table de
■ cuivre.
L’ouvrage des tireurs doit fe vendre au poids du
roi de huit onces au marc , & de huit gros à l’once -,
& non au poids fubtil, vulgairement appellé le poids
•de Lyon.
L’argent fin fumé elt défendu fous peine de confif-
cation & de 2000 liv. d’amende.
L’or ou l’argent doit être filé fur la foie teinte, &
non fur la crue, & le faux feulement fur le fil.
Maniéré de tirer For G F argent fin. On prend d’ abord
un lingot d’argent du poids de 3 5 à 36 marcs,
que l’on réduit par le moyen de la forge , en forme
de cylindre , de la groffeur à-peü-près d’un manche
à balai.
Après que le lingot a été ainfi forgé, on le porte à
Targue , oii on le fait paffer par 8 ou 10 pertuis d’u-
,,ne groffe filiere, que l’on nomme calibre, tant pour
•l’arrondir plus parfaitement, que pour l’étendre jufqu’à
ce qu’il foit parvenu à la groffeur d’une canne,
ce qui s’appelle tirer à l'argue , ou apprêter pour dorer.
Voyez A r g u e & F i l i e r e .
Le lingot ayant été tiré, comme il vient d’être dit»
eft reporté chez le tireur d’o r , où il eft limé avec exactitude
fur toute fa fuperficie, pour ôter la craffe qui
peut y être refiée de la forge ; puis on le coupe par
le milieu, ce qui forme deux lingots d’égale grof-
feur| longs chacun d’environ 24 à 25 pouces, que l’on
fait paffer par quelques pertuis de calibre , foit pour
abaiffer les crans ou inégalités que la lime y a pu
faire, foit auffi pour le rendre le plus uni qu’il eft pof-
fible.
Lorfque les lingots Ont été ainfi difpofés , on les
fait chauffer dans un feu de charbon-pour leur donner
le degré de chaleur propre à pouvoir recevoir l’or
que l’on y veut appliquer; ce quife fait de la maniéré
fuivante.
; On prend des feuilles d’or, chacune du poids d’environ
12 grains, & de 4 pouces au-moins en quarré;
que l’on joint quatre, huit, douze ou feize enfemble,
fuivant qu’on defire que les lingots foient plus ou
moins furdorés ; & lorfque ces feuilles ont été jointes
de maniéré à n’en plus former qu’une feule , On
frotte les lingots tout chauds avec un bruniffoir, puis
on applique en longueur fur toute la fuperficie de
chaque lingot, fix de ces feuilles préparées, par def-
fus lefquelles on paffe la pierre de fanguine pour les
bien unir.
Après que les lingots ont reçu leur o r, on les met
dans un nouveau feu de charbon pour y prendre un
certain degré de chaleur ; & lorfqu’ils en font retires
, on repaife par-deffus une fécondé fois la pierre
de fanguine, foit pour bien fouder l’o r , foit auffi
pour achever de le polir parfaitement.
Les lingots ayant été ainfi dorés, font reportés
à l’argue, oii on les fait paffer par autant de pertuis
de filiere qu’il eft néceflaire, (ce qui peut aller environ
à quarante ) pour les réduire à-peu-près à la
groffeur d’une plume à écrire.
Enfuite on les reporte chez le tireur d’or pour les
degroffer, c’eft-à-dire, les faire paffer par une vingtaine
de pertuis d’une forte de filiere moyenne qu’on
appelle ras i ce qui les réduit à la groffeur d’unferret
de lacet.-
Le degroffage fe fait par le moyen d’une efpece de
banc fcelte en plâtre, que l’on nomme banc à dégrof-
Jer} qui neü. quune maniéré de petite argue que
Tome X V I . 0 1
deux homffies peuvent faire tourner.
Après que les lingots ont été dégroffiés & réduits»
comme on vient de dire, & à la groffeur d’un ferret
de lacet, ils perdent leur nom de lingots, pour prendre
celui de f il d'or. Ce fil eft enfuite tiré fur un autre
banc, que l’on nommé banc à tirer, oh on le fait
paffer par vingt nouveaux pertuis d’une efpece de filiere
appellée prégaton; après quoi il fe trouve en
état d être paffe par la plus petite filiere , qu’on nom-
mefer à tirer, pour le porter à fon dernier point dé
finefle ; ce qui fe pratique de la maniéré fuivante.
Premièrement, on paffe le fil d’or par le trou dit
fer à tirer appellé pertuis neuf, qu’on a auparavant
rétréci avec un petit marteau fur un tas d’acier, ÔC
poli avec un petit poinçon d’aciér très^poinfu, que'
l’on nomme pointe. Ce pérîüi’s cfi ainfi rétréci & rè-
póli fucceffivement avec de pareilles pointes , toujours
de plus fines en plus fines , & le fil y eft auffi
fucceffivement tiré jufque à c e qii’ibfoit pârvênu à la,
groffeur d’un cheveu.
Ce qui paroît de plus- admirable, eft que tout délié
& tout fin que foit Ce fil ,, il fe trouve fi parfaitement
doré fur toute fa fuperficie, qu’il'feroit affez,’
difficile de s’imaginer , fans le ià vo ir , que le fond en
fut d’argent.
t Le fi! d’or en cet état s'àppéîle > trait, & peut
s-’employer en crépines, bourOnf, cordons de chapeau
, & autres femblàbles ouvrages.
Il faut remarquer qu’à vautqhél’or trait foit réduit
à cet extrême point de fineffe, il a dû paffer par plus
de 140 pertuis de calibre , de fi.'iere, de ras, dé pre*
gaton , de fer à tirer, & que chaque fois qu’on l’a
fait paffer par un de ces pertuis» on l’a frotté dé cire
neuve, foit pour en faciliter le paffage, foit auffi
pour empêcher que l’argent ne fe découvre de Tof
qui eft deffus.
Pour difpofer l’or trait à être filé fur la foie, i l faut
Pécacher ou applatir, ce que plufieurs appellent bat-
. tré l'or , & le mettre en lame. On lui donne cetrè-fa*.
Çon , en le faifant paffer entre deux rouleaux d’unâ
petite machine nommée moulin à battre, ou moulin à
écacher. • i
Ces rouleaux qui font d’un acier très-poli, envi*
ron de trois pouces de diamètre, c’eft-à-dire, épais
de douze ou. quinze lignes , & très-ferréS l’un contre
l’autre fur leur épaiffeur, font tournés par le moyen
d’une manivelle attachée à l’un des deux, qui fait
mouvoir l’autre ; en forte qu’à mefure que le fil trait
paffe entre les deux rouleaux, il s’écache & s’appla-
tit, fans pourtant rien perdre de fa dorure ; & il devient
en lame fi mince & fi flexible, qu’on peut ai-
fément le filer fur la foie, par le moyen d’un roiiet &
de quelques rochets ou bobines paffées dans de me-''
nues broches de fer.
Lorfque l’or en lame a été filé fur la foie, on lui
donne le nom de filé d'or.
Quand on ne veut avoir que de l’argent trait, de
l’argent en lame, où du fil d’argent, on ne dore point
les lingots ; à cela p rès, tout le refie fe pratique de
la même maniéré que pour l’or trait, l’or en lame ôC
le filé d’or.
L’or & l’argent trait battu, ou en lames de Lyon,
fe vend par bobines de demi-once, & d’une once
n et, c’eft-à-dire, fans comprendre le poids de la bobine
& fes différens degrés de fineffe, fe diflinguent
par des P , depuis un jufqu’à fept, toujours en diminuant
de groffeur; en forte que celui'd’un P eft le
plus gros, & que celui de fept P eft le plus fin, que
l’on appelle à caufe de cela fuperfin.
L’or & l’argent trait, battu on en laine, qui fe fabrique
à Paris, fe débite en bobines de différens
poids ; & fes divers degrés de finefle ou de furdon>
re font indiqués par des numéros depuis 50 jufqu’à
X x ij