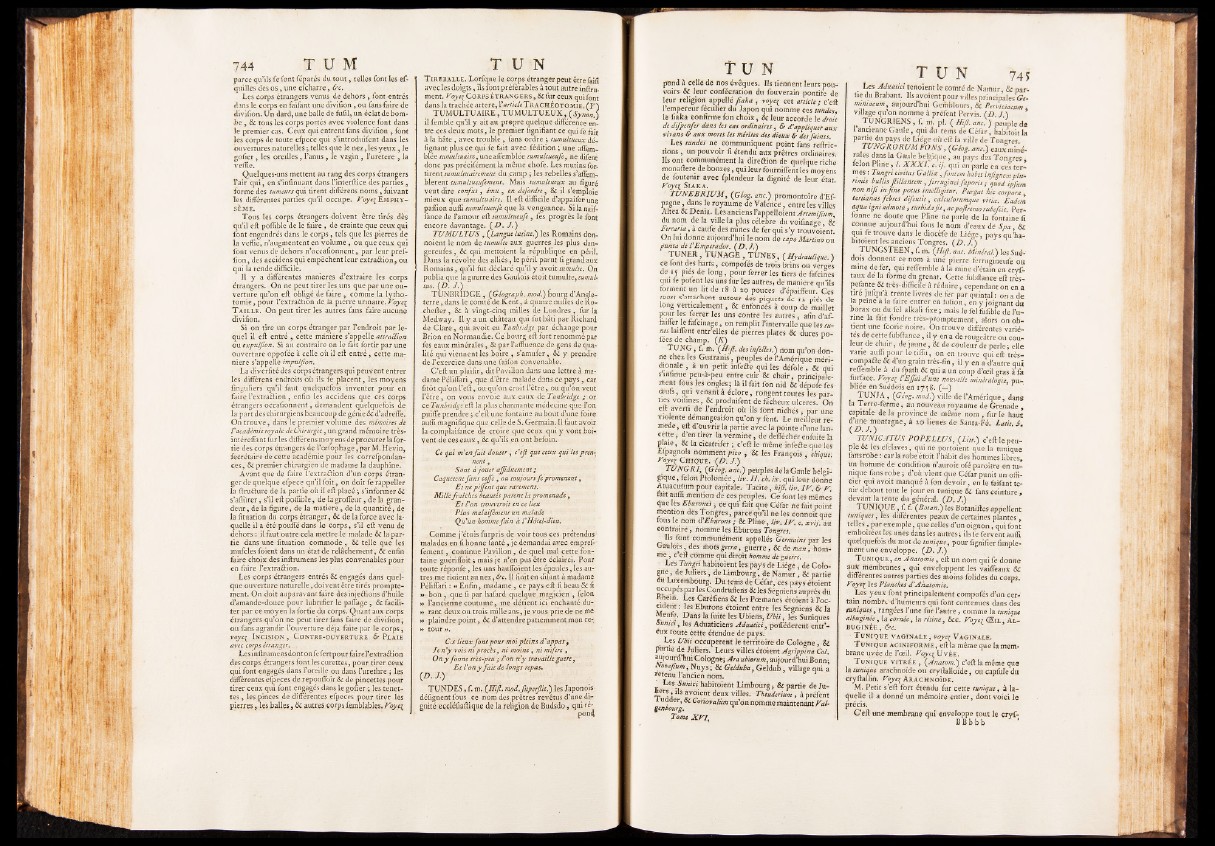
7 4 4 T U M
parce qu’ils fe font féparés du tout, telles font les ef-
quilles des o s , une elcharre, &c.
Les corps étrangers venus de dehors, font entrés
dans le corps en faifant une divifion , ou fans-faire de
divifion. Un dard, une balle de fufil, un éclat de bombe
, & tous les corps portés avec violence font dans
le premier cas. Ceux qui entrent fans divifion , font
les corps de toute efpece qui s’introduifent dans les
ouvertures naturelles ; telles que le nez, les y e u x , le
gofier, les oreilles, l’anus, le vagin., l’uretere , la
veflie.
Quelques-uns mettent au rang des corps étrangers
l’air qui, en s’infinuant dans l’interfiice des parties ,
forme des tumeurs qui tirent différens noms, fuivant
les différentes parties, qu’il occupe. Foyt{ Em physème.
Tous les corps étrangers doivent être tirés dès
qu’il eft poflible de le faire , de crainte que ceux qui
font engendrés dans le corps , tels que les pierres de
la veflie, n’augmentent en volume, ou que ceux qui
font venus, de dehors n’occafionnent, par leur pref-
fion, des accidens qui empêchent leur extradion, ou
qui la rende difficile.
Il y a différentes maniérés d’extraire les corps
étrangers. On ne peut tirer les uns que par une ouverture
qu’on eft obligé de faire , comme la lytho-
tomie, pour l’extradion dé. la pierre urinaire. Foye[
T a ille. On peut tirer les autres fans faire aucune
divifion.
Si on tire un corps étranger par l’endroit par lequel
il eft entré ., cette manière s’appelle attraction
ou expulfion'. Si au contraire on le fait fortir par une
ouverture oppofée à celle oh il eft entré, cette maniéré
s’appelle impuljion.
La diverfité des corps étrangers qui peuvent entrer
l'es différens endroits où ils fe placent, les moyens
finguliers qu’il faut quelquefois inventer pour en
faire l’extradion, enfin les accidens que ces corps
étrangers occafionnent, demandent quelquefois de
la part des chirurgiens beaucoup de génie & d’adreffe.
On trouve, dans le premier volume des mémoires de
l'académie royale de Chirurgie, un grand mémoire très-
intéreflant fur les différens moyens de procurer la for-
tie des corps étrangers de l’oefophage, par M. Hèvin,
fecrétaire de cette académie pour les correfpondan-
ces, & premier chirurgien de madame la dauphine.
Avant que de faire l’extra&ion d’un corps étranger
de quelque efpece qu’il foit, on doit fe rappeller
la ftrufture de la partie oii il eft placé ; s’informer &
s’afiùrer, s’il eft poflible, de la groffeur, de la grandeur
, de la figure, de la matière, de la quantité', de
la fituation du corps étranger, & de la force avec laquelle
il a été pouffé dans le corps, s’il eft venu de
dehors : il faut outre cela mettre le malade & la partie
dans une fituation commode , ôt telle que les
mufcles foient dans un état de relâchement, & enfin
faire choix des inftrumens les plus convenables pour
en faire l’extraélion.
Les corps étrangers entrés & engagés dans quelque
ouverture naturelle, doivent être tirés promptement.
On doit auparavant faire des injeâions d’huile
d’amande-douce pour lubrifier le paffage , & faciliter
par ce moyen la fortie du corps. Quant aux corps
étrangers qu’on ne peut tirer fans faire de divifion j
ou fans agrandir l’ouverture déjà faite parle corps,
voyei Incision , C ontre-ouverture & Pjlaie
avec corps étranger. .,
Les inftrumens dont on fe fért pour faire l’extraâion
des corps étrangers font les curettes, pour tirer ceux
qui font engagés dans l’oreille ou dans l’urethre ; les
différentes efpeces de repouffoir & de pincettes pour
tirer ceux qui font engagés dans le gofier r9 les tenet-
te s , les pinces de différentes efpeces pour tirer les
pierres, les balles, & autres corps fejnblables. Foye^
T UN
T ireballe. Lorfque le corps étranger peut êtrefaifï
avec les doigts, ils font préférables à tout autre infiniment.
Foye{ Corps étrangers , & fur ceux qui font
dans la trachée artere, \article T r a ch éo tom ie . (T )
TUMULTUAIRE, TUMULTUEUX, (Synon.)
il femble qu’il y ait au propre quelque différence entre
ces deux mots, le premier lignifiant ce qui fe foit
à la hâte, avec trouble, fans ordre ; tumultueux dé-
fignant plus ce qui fe fait avec féditioii ;'une affem-
blée tiunultuaire, une affemblée tumultueufe, ne difent
donc pas précifément la même chofe. Les mutins for-
tirent tumultuairement du .camp ; les rebelles s’affem-
blerent tumultueiifcment. Mais tumultueux au figuré
veut dire confus, ému , en defordre, & il s’emploie
mieux que -tumuliuaire. Il eft difficile d’appaifer une
paffion auffi tumultueufe que la vengeance. Si la naif-
fance de l’amour eft tumultueufe , fes progrès le font
encore davantage. (D . / .)
TUMULTUS , (Langue latine.) les Romains don-
noient le nom de tumulte aux guerres les plus dan-
gereufes, & qui mettoient la république en péril.
Dans la révolte des alliés, le péril parut fi grand aux
Romains, qu’il fut déclaré qu’il y avoit tumulte. On
publia que la guerre des Gaulois étoit tumulte, tumuU.
tus. (JD. ƒ.) .
TUNBRIDGE , (Géograph. mod.) bourg d’Angleterre
, dans le comté de K ent, à quinze milles de Ro-
-chefter, & à vingt-cinq milles de Londres , fur la
Medway. Il y a un château qui fut bâti par Richard
de Clare, qui avoit eu Tunbridge par échange pour
Brion en Normandie. Ce bourg eft fort renommé par
fes eaux minérales par l’affluence de- gens de qualité
qui viennent les boire , s’amufer, ôc y prendre
de l’exercice dans une faifon convenable.
C’eft un piaifir, dit Pavillon dans une lettre à madame
Péliffari , que. d’être malade dans ce pays, car
fitôt qu’on l’eft, ou qu’on croit l’être, ou qu’on veut
l’être, on vous envoie aux.eaux de Tunbridge ; or
c e'Tunbridge eft la plus charmante médecine que Ton
puiffe prendre ; .c’eft une fontaine au bout d’une foire
auffi magnifique que celle de S. Germain. Il faut avoir
la complaifance dé croire que ceux qui y vont boivent
de ces e a u x q u ’ils en ont befoin..
Ce qui m'en fait douter , c'èjl que ceux qui-les prennent
,
S ont à jouer ajfiduement ;
Caque'tent fans cejfe , ou toujours fe promènent,
E l ne pifjent q u e rarement:
Mille fraîches beautés parent la promenade ,
E t l'on trouverait en ce lieu
Plus malaifément un malade '
Qu'un homme fain à l'Hôtel-dieu.
Comme j ’étois furpris de voir tous ces prétendus-
'malades .en fi bonne fanté, je demandai avec empref-
fement ^ continue Pavillon, de quel mal cette fontaine
guériffoit ; mais je n’en pus être éclairci. Pour
toute réponfe, les uns hauffoient les épaules, lesau-'
tres me rioient pu nez, &c. Il finit en diiant à madame
Péliffari : « Enfin, madame , ce pays eft fi beau & fi
»> bon , que fi par hafard quelque magicien , félon
» l’ancienne coutume., me détient ici enchanté du-
» rant deux ou trois mille ans, je vous prie de ne me
» plaindre point, & d’attendre patiemment mon re-;
» tour».
Cis lieux font pour moipleins d'appas 9
Je n'y vois ni procès ^ ni moint, ni mifere ,
On ÿ fonne très-peu yl'oti n'y travaille guère ,
Et l'on y fait de longs repas;
i p . r y
TUNDES, f. m. (Hift-mod.fuperfiitj) les Japonois
défignent fous ce nom des prêtres revêtus d’une di-
gnité;eçclëfiaftique de la religion de Budsdo, qui répond
T U N
pond à cellé de nos évêques. Ils tiennent leurs pouvoirs
& leur cônfécration dii fouverairt pontife de
leur religion appellé fiaka , vcyeç cet article ; c’eft
l’empereur féculier du Japon qui nomme ces tutides,
lé fiaka confirme fon choik * & leur accorde le droit
de difpenfer dànS les cas ordinaires, 6* d'appliquer aune
divans & aux morts Us métiliS dis dieux & des faims.
Les mndes ne communiquent point fans reftric-
tfonS, Urt pouvoir fi étendu aüx prêtres ordinaires.
Ils ont- communément là direction de quelque riche
monaftere de bonzes, qui leur fourniffent les moyèns
de foutenir avec fplendeur la dignité de leur état.
Voyeg_ Sia k a .
tÜ N E B R lU M , ([Géog.ahc,,) promontoire d’Ef-
pagrte, dans le royaume de Valence, entré les villes
Aitea & Dénia. Lés anciens l’appeiloient Anethifium,
du nom de la ville la plus célébré du voifinage, &
Ferraria, à caüfe de§ mines de fer qui s’y trouvoient.
On lui donne aujourd’hui le nom de capo Martino ou
pUfita de l'Etnpétàdot. ( D. Jî)
TU NER, TUNAGE , TUNES t ( Hydraulique. )
C6 font des harts, compoies de trois, brins ou vetgës
de i 5 piés de long ÿ pdiif fèfrer les tiers de ftfeines
qui te pôfênt les uns fur les autres, de maniéré qu'ils
forment un lit de r8 à 20 ponces d’épaiffeur. GeS
otrui s’attachent àutôùt des piquets dé 11 piés de
lsng verticalement, & enfoncés i éoup de maillet
pouf lés ferrer les uns contre les autres, afin d’af*
foiffer le fafeinage, on remplit l’intétvalle que les innés
laiffent entr’elles dë piètres plates & dures po-
I fées de champ. (K ) .
TU N G , f m. (J î’ft . désinfectes.} nom qu’on donné
chez les Guaranis, peuples de l’Amérique méridionale
, à un petit infefte qui lés défalè , & qui
s’infinue pett-à-peu entre clair Si chair, principale-
met« fous les d^ lc s ; là il fait fon nid Si dépoté fes-
deufs, qui VeHahtà éclore, rongent toutes lès pàrz
ties voilines, Si produifent de Scheux ulcères, On
eft averti de l’endroit oh ils font nichés , par une
violente démangeàifon qtfon y fènt. Le meilleur remède
, eft dfoiivrir la partie avec la pointe d’Une lancette,
d’en tirer làvérhiiAe , de défféehër énfiiife la
plaie, & là cieatrifer ; c’eft le même infefle que les
Efpagnols liOniftient pito-i Si lés François .'t/iiotic:
V y-c- CtffQüÈ, -(t). /.)
TUNG RI, (Grog, aiit.) peuplés de’ Ia Gaule bèlgU
gique, félon Ptoloniëé, m . 11. d . qui leur donne
Atuacuftnii pouf dapifalé. Tacite, Kif -, Ih. i r .-0 V;
ftit atlfii meHtiort de Ces peuples. Gé font lés Mêttes
que içs E m m a t ee qui feit que Céfar ne feit point
mention dès Tongres, parce qu’il ne les connoît que
tous le no» â’Éturoris; Sc Pline , Uv-, I K c, nvij. ati
eörttmiirè , rtömme les Ebùrbns T&ngréSi
Ils font côrnmùftëffierit appellés Germains par les
Gailfois, des mots gêna, guerre , 81 de min, hort-
Kté , C’eft crömme qui diroh hotnhie de guerre.
; Tütigri hàbitoiènt lés pays de Liège j de Goto-
ghé j de JxdiërS , de Limbotirg, de Narnur, & parfië
da Lifxembôttfg. Dit tems de Géfàt, ces pays éiôiënt
occupés par les Çondrufieris & les Sêgniens auprès du
Rhéili. Les Caréfiens &t lés Pcèrtiaftes éfoient à Foc-
cident : léS Ebuforis étôient etttre lès Segnieiis & là
Meufe. Dans la fuite les Ubieris, Ubli, les Suriiques
Sütiiii, les Aduaticiens Aduatid , poffédetetlt entr’-
tôlrtè Cette étendue dé pays;
Les Ubii occupèrent le territoire de Cologne, &
p'àrfië dé Juliers. Leurs villes étoient Agrippina Col.
?Ujourd’huiColognej Ara ubiorum, aujourd’hui Bonn;
nvefîuth, Nuys; & Geldubü, Geldub, village qui a
retenu l’ahciéh nom.
Lts Suhici habitoieht Limbourgj & partie de Ju-
avo^e” t ^eux villes. Theudenum, à préfent
udder, & Cotiovalùm qu'on nomme maintenant Fai-
genbourg.
Tome X F I .
T U N 745
t Les Aduaiici tenoient le comté de Namur, & par^
tie du Brabant. Ils avoient pour villes principales Ge-
miniacum, aujourd’hui Gemblours, & Pervuiacum
village qu’on nomme à préfent Pervis. (D. J .) 9
TUNGRIENS, f. m. pl. ( Hiß. am. ) peuple de
1 ancienne Gaulé, qui du tems de Céfor, habitoit la
partie du pays de Liège oh eft la ville de Tongres.
TÜNGRORUM FON S , (Géog. anc.) eaux minérales
dans la Gaule belgique, au pays des Tolleres «
félon Pline, l. X X X I . c. ij. qui en parle en ces termes
: Tungri civitas G allia ,fontem habet infîgnem plu*
rimis bullis ßillantem , ferrUginei faporis ; quod ipfum
non nifi in fine potus intelligitur. Purgat hic corpora 1
tenianas febres difeutit, caUuloramque vitia. Eadem
àqua igrii admota , turbidafit, depoftremo rubéfiât. Per-
fonne ne doute que Pline né parle de la fontaine lï
connue aujourd’hui fous le nom d’eaux dé Spa &
qui fe trouve dans le diocèfe de Liège , pays qu’ha-
bitoient les anciens Tongres. (D .J .)
. TUNGStE EN, f. m. (Hiß. nui. Minéral.) les Suédois
donnent ce nom à Une pierre ferrugineufe ou
mine de fer, qui feffemble à là mine d’étain en cryf-
taux dé la forme du grenat. Gette ftibftanee eft très-
pefante & tres-difficile à feduire; cependant on en a
tiré jtifqu’à trente livrés de fer par quintal : on a de
la peine à la faire entrer en fufion, en y joignant du
borax ou du Tel alkali fixe ; mais le fel fufible de l’urine
là fâit fondre très-promptement, alors on obtient
Une feorie noire. On trouve différentes variétés
de cette fubftanee, il y en a de rougeâtre ou couleur
de ehàit, de jàitnë, U de couleur de perle ; elle
varie auffi pour le tiffu, on en trouve qui eft très-
compâfle Se d’tin grain très-fin, il y en a d’autre qui
reflèmble à du fpath Se qui a un coup d’oeil gras à fa
furfoee. Foye{ ÜEffai J une nouvelle minéralogiei pii-,
bliée ên Suédois en 173 8-. (—)
TUNJA , (Géog. mod.) ville de l’Artiériquè, dans
la Terre-fermé, àu nouveau royaume de Grenade ,
capitale de la province de même nom , fur le haut
d’une montagne, à 20 lieues de Santa-Fé. Latit. S. WSBSm TUmCATUS POPELLUS, (Lin.) c’eft le peuplé
Sé les-éfclaves, qui ne portoient que la tunique
faits robe: car là robe étoit l’habit des hommes libres
Un hotnirie dë êolndition n’auroit ofé paroître en tunique
fans robe ; d’où vient que Céfar punit un officier
qiii avoit manqué à fon devoir, en le faifont tenir
debout tout le jour en tunique Sc fans ceinture ,
devant la tente du général. (D. J.)
TUNIQUE , fi f. (Botan.) tes Botaniftes appellent
iuniquesj lés différentes peaux de certaines plantes ,
telles, par exemple, que celles d’un oignon, qui font
•emboîtées les-uhës dans lès autres; ils Te fervent auffi
quelquefois du mot de tunique, pour fignifîer Amplement
une eôvdoppe. (D . Ji)
T unique, en Anatomie, eft un nom qui fe donne
aiiX mémbràfieS , qui enveloppent les vaiffeau* ôc
différentes autres parties des moins folides du corps.
Foyt{ les Planches d'Anatomie.
Les yeux font principalement eompofés d’un certain
nombffd’humeurs qui font contenues dans des
tuniques, rangées l’une fur l’autre , Comme ta. tunique
dlbugirtée, la eOrnée, la rétine, Stc. Foye^ <3£il j Al-
BUGINÉÈ , & C .
T unique vagînale j voyei V aginale.
•Tunique acinifORMe , eft la même que la membrane
uvée.de l’oeil. F’oye^ Uvée.
T unique v iTree , (Anatom.) c’eft la même que
la tunique arachnoïde ou cryftàlloïde, ou capfule du
cryftallin. Fôye{ Arachnoïde.
M. Petit s’eft fort étendu fur cëtte tunique, à laquelle
il a donné un mémoire entier, dont voici le
précis.
C ’eft une membrane qui enveloppe tout le cryf-
B B b b b