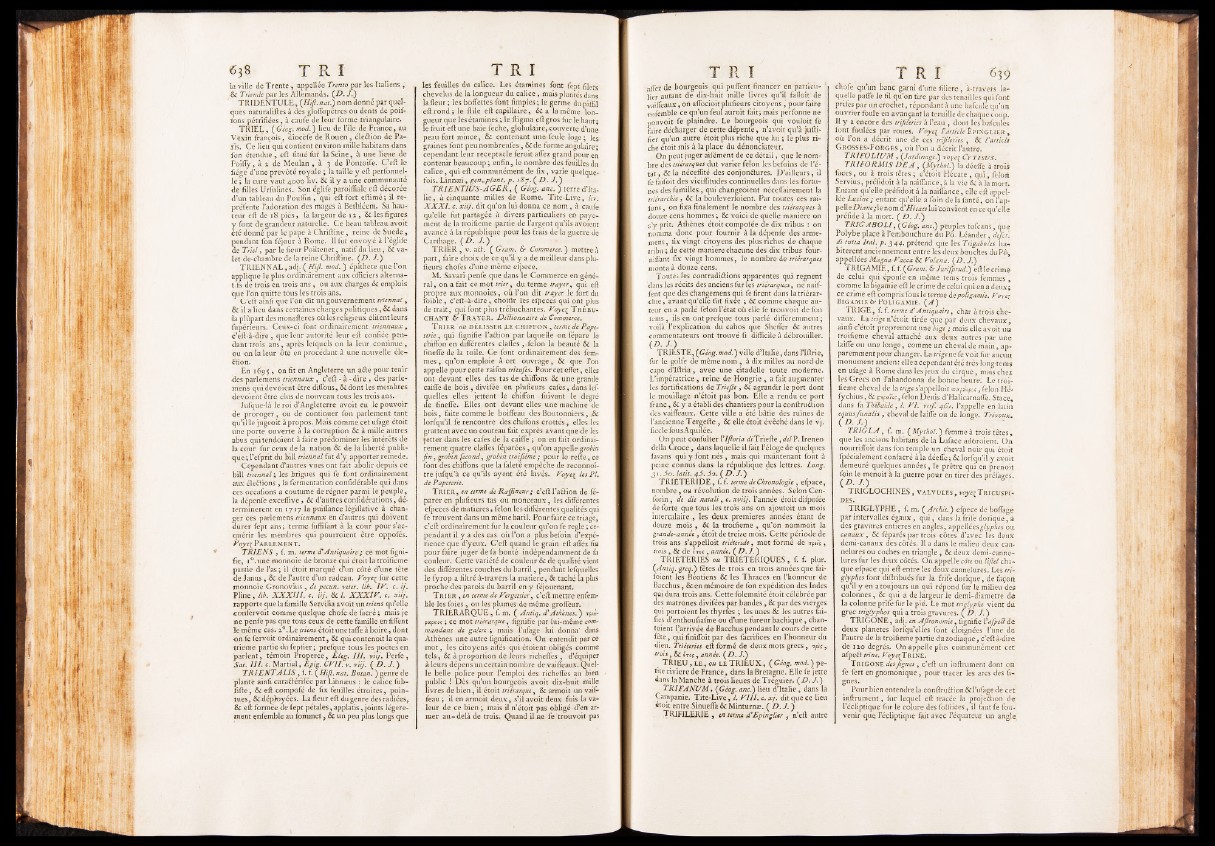
la ville de Trente -, appellëe T-rento par les Italiens ,
Sc T runde par les Allemands. (D . J .)
TRIDENTULE, {Hiß. nat.) nom donné par quelques
naturaliftes à des gloffopëtres ou dents de poif-
tons pétrifiées, à caufe de leur forme triangulaire.
TRIEL, {Géog. mod.') lieu -de l’île de France, au
Vexin frànçois, diocèfe de Rouen, ëleéfion de Paris.
Ce lieu qui contient environ mille habitans dans
fon étendue , eft fitué fur là Seine, à une lieue de
Poifly, à 2 de Meulan , à 3 de Pontoife. C’eft le
fiége d’une prévôté royale ; la taille y eft perfonnel-
le ; là cure vaut 4000 liv. & il y a une communauté
de filles Urfulines.. Son églife paroifliale eft décorée
d’un tableau-du Pouflin , qui eft fort eftimé ; il re-
préfente l’adoration des mages à Bethléem. Sa hau--
teuf eft de 18 piés, fa largeur de 12, 8c les figures
y font de grandeur naturelle. Ce beau tableau avoit
été donné par le pape à Chriftine, reine de Suede,
pendant fon féjour à Rome. Il fut envoyé à l’églife
de Triel, par le fieur Poiltenet, natif du lieu, 8c valet
de-chambre de la reine Chriftine. (D . J .)
TRIENNAL, adj. {H iß . mod. ) épithete que l’on
applique le plus ordinairement aux officiers alternatifs
de trois en trois ans, ou aux charges 8c emplois
que l’on quitte tous les trois ans.
C’eft ainfi que l’on dit un gouvernement triennal,
& il a lieu dans certaines charges politiques ,<8c dans
la plupart des monafteres où les religieux élifent leurs
fupérieurs. Ceux-ci font ordinairement triennaux,
c’eft-à-dire , que leur autorité leur eft confiée pendant
trois ans, après lefquels on la leur, continue,
ou ori la leur ôte en procédant à une nouvelle éle-
£lion.
En 160 5 , on fit en Angleterre un a£Ie pour tenir
des parlemens triennaux , c’eft - à - d ire, des parle-
menS qui dévoient être diflbus, 8c dont les membres
dévoient être élus de nouveau tous les trois ans.
Jufque-là le roi d’Angleterre avoit eu le pouvoir
de proroger, ou de continuer fon parlement tant
qu’iîle jugeoit àpropos. Mais comme cetufage étoit
une porte ouverte à la corruption 8c à mille autres
abus quitendoient à faire prédominer les intérêts de
la cour fur ceux de la nation 8c de la liberté publique
; l’efprit du bill triennal fut d’y apporter remede.
Cependant d’autres vues ont fait abolir depuis-ce
bill triennal ; les brigues qui fe font ordinairement
aux élections, la fermentation confidérable qui dans
ces occafions a coutume de régner parmi le peuple,
la dépenfe exceffive , 8c d’autres confédérations, déterminèrent
en 1717 la puiffance légiflative à changer
ces parlemens triennaux en d’autres qui doivent
durer fept ans; terme fuffifant à la cour pour s’acquérir
les membres qui pourroient être oppofés.
Voye^ Parlement.
T R IE N S , 1. m. terme <T Antiquaire ; ce mot lignifie,
i°.une monnoie de bronze qui étoit la troifieme
partie de l’as ; il étoit marqué d’un côté d’une tête
oe Janus, & de l’autre d’un radeau. Voye^ fur cette
monnoie Gronovius , de pecun. veter. lib. IV . c. ij.
Pline, lib. X X X I I I . c. iij. 8c l. X X X I V . c. x iij.
rapporte que la famille Servilia avoit un trient qu’elle
confervoit comme quelque chofe de facré ; mais je
ne penfe pas que tous ceux de cette famille enfiffent
le même cas. 2°.Le trient étoit une tafle à boire, dont
o n fe fervoit ordinairement, 8c qui contenoit la quatrième
partie dufeptier; prefque tous les poètes en
parlent, témoin Properce, Êleg. I I I . viij, Perfe,
Sat. I I I . c. Martial, Epig. CV1I . v. viij. { D . J . }
T R I E N T A L I S , f. f. {H iß . nat. Botan. ) genre de
planté ainfi caraélérifée par Linnæus le calice fub-
fifte, & eft compofé de fix feuilles étroites, pointues,
&;dépk>yées. La fleur eft du genre des radiées,
& eft formée de fept pétales, applatis, joints légèrement
çnf emble au fbnunet, & un peu plus longs que
les feuilles du calice. Les étamines font fept filets
chevelus de la longueur du c a lic e , mais plantés dans
la fleur ; les boffettes font Amples ; le germe du piftil
eft rond ; le ftile eft cap illaire , 8c a la même longueur
que les étamines ; le ftigma eft gros fur le haut •
le fruit eft une baie feche, globulaire* couverte d’une
peau fort mince, 8c contenant une feule lo g e ; les
graines font peu nombreufes, & de forme angulaire ;
cependant leur réceptacle feroit affez grand pour en
contenir beaucoup; enfin, le nombre des feuilles du
c a lic e , qui eft communément de f ix , varie quelquefois.
Linnæi , g e n * p l a n t , p . i 8 y . { D . J . ' )
TRIENTIUS-A GE R , ( Géog. anc. ) terre d’ Italie
, à cinquante milles de Rome. T ite -L iv e , liv.
X X X I . c. xiij. dit qu’on lui donna ce n om , à caufe
qu’elle fut partagée à divers particuliers en payement
de la troifieme partie de l’argent qu’ils avoient
avancé à la république pour les frais de la guerre de
Carthage. (D . J. )
T R IE R , v . a£I. ( Gram. & Commerce. ) mettre à
pa r t, faire choix de ce qu’il y a de meilleur dans plu-
fieurs chofes d’une même elpece.
M. Savari penfe que dans lé Commerce en génér
a l, on a fait ce mot trier, du terme trayer, qui eft
propre aux monnoies, o îj l’on dit trayer le fort du
fo ib le , c’e ft-à-dire , chôifir les efpeces q u ip n t plus
de tra it, qui font plus trébuchantes. Voye{ T rébuch
an t 6* T r a yer . Dictionnaire de Commerce.
T rier o u délisser jLE chiffon , terme de Papeterie
, qui lignifie l’a&ion par laquelle on fépare le
chiffon en différentes claffes , -félon la beauté 8c la
fineffe de la to ile. C e font ordinairement des femmes
, qu’on emploie à cet o u v ra g e , 8c que l’on
appelle pour cette raifon trieufet. Pour cet e ffe t, elles
ont devant elles des tas de chiffons 8c une grande
caiffe de bois , divifée en plufiëurs ca fé s , dans le f
quelles elles jettent lé chiffon fuivant le degré
de fineffe. Elles ont devant elles- une machine de
b o is , faite comme le boiffeau des B outonniers, ,8c
lorfqu’il fe rencontre des chiffons c ro tté s , elles les
grattent av ec un couteau fait exprès avant que de les
je tter dans les cafés de la caiffe ; on en fait ordinairement
quatre claffes fépa ré es , qu’on appelle grobin
fin , grobin fécond, grobin troifieme ; pour le r e fte , ce
font des chiffons que la faleté empêche de reconnoî-
tre jufqu’à ce qu’ils ayent été lavés. Voye^ les PI.
de Papeterie.
T rier, en terme de Rafifineur; c’eft l ’a&ion de fé-
parer en plufiëurs tas ou monceaux, les différentes
efpeces de matières, félon les différentes qualités qui
fe trouvent dans un même baril. Pour faire ce triage,
c’eft ordinairement fur la couleur qu’on fe réglé ; cependant
il y a des cas où l’on a plus befoin d’expé-
riencé que d’y e u x . C ’eft quand le grain eft aflez fia
pour faire juger de fa bonté indépendamment de fa
couleur. Cette variété de Couleur 8c de qualité vient
des différentes couches du b a r ril, pendant lefquelles
le fy ro p a filtré à-travers la matière, & taché la plus
proche des parois du barril en y féjournant.
T rier , en terme de Vergettier, c’eft mettre enfem-
ble les fo ie s , ou les plumes de même groffeur.
T R IÉ R A R Q U E , f. m, ( Antiq. d’Athènes. ) t/>/«-
petpKaç ; ce mot trier arque, fignifie par lui-même commandant
de galere ; mais l’ufage lui donna' dans
Athènes une autre lignification. O n entendit par ce
m o t , les citoyens aifés qui étoient obligés comme
t e ls , & à proportion de leurs richeffes , d’équiper
à leurs dépens un certain nombre de vaiffeaux. Quelle
belle police pour l’emploi des richeffes au bien
public 1 D è s qu’un bourgeois avo it dix-huit mille
livres de b ien , il étoit trierarque, 8c armoit un vaif-
feau ; il en armoit d eu x , s’il avo it deux fois la valeur
de ce bien ; mais il n’étoit pas obligé d’en armer
a u -d e là de trois. Quand il ne fe trou voit pas
aflez de bôurgeois qui puffent financer en particulier
autant de dix-huit mille livres qu’il falloir de
vaiffeaux, ori aflocioit plufiëurs citoyens,’ pour faire
enfemble ce qu’un feul auroit fait; mais perfonne ne
pouvoit fe plaindre. Le bourgeois qui vouloit fe
faire décharger de cette dépenfe, n’avoit qu’à jufti-
fier qu’un autre étoit plus riche que lui ; le plus riche
etoit mis à la place du dénonciateur.
On peut juger aifément de ce détail, que le nombre
des triérarques dut varier félon les befoins de l’état
, 8c la nécefiité des conjonélures. D’ailleurs, il
fe faifoit des viciflitudes continuelles dans les fortunes
des familles, qui changeoient néceffairement la
triérarchie, & la bouleverfoient. Par toutes ces rai-
fons, on fixa finalement le nombre des triérarques à
douze cens hommes ; 8c voici de quelle maniéré on
s’y prit; Athènes étoit compofée de dix tribus : on
nomma donc pour fournir à la dépenfe des arméniens,
lix vingt citoyens des plus riches de chaque
tribu ; de cette maniéré chacune des dix tribus four-
niffant fix vingt hommes, le nombre de triérarques
monta à douze cens.
Toutes les contradiftions apparentes qui régnent
dans les récits des anciens fur les triérarques, ne naif-
fent que des changemens cjui fe firent dans la triérarchie
, avant qu’elle fut fixee ; 8c comme chaque auteur
en a parlé félon l’état où elle fe trouvoit de fon
tems, ils en ont prefque tous parlé différemment;
voilà l’explication du cahos que Sheffer & autres
commentateurs ont trouvé fi difficile à débrouiller.
( D . J .)
TRIESTE, {Géog.mod.") ville d’Italie, dans l’Iftrie,
fur le golfe de même nom , à dix milles au nord de
capo d’Iftria, avec une citadelle toute moderne.
L’impératrice , reine de Hongrie , a fait augmenter
les fortifications de Triefie , 8c agrandir le port dont
le mouillage n’étoit pas bon. Elle a rendu ce port
franc, & y a établi des chantiers pour la conftruétion
des vaiffeaux. Cette ville a été bâtie des ruines de
l’ancienne Tergefte, 8c elle étoit évêché dans le vj.
fiecle fous Aquilée.
On peut confulter VIfioria ^iTriefte, delV. Ireneo
délia C roce, dans laquelle il fait l’éloge de quelques
favans qui y font nés , mais qui maintenant font à
peine connus dans la république des lettres. Long.
3 1 . 5 o. latit. 46. 5 z . ( D . J . )
TRIÉTERIDE, f. f. terme de Chronologie, efpace,
nombre, ou révolution de trois années. Selon Cen-
. forin, de die natali, c. xviij. l’année étoit difpofée
de forte que tous les trois ans on ajoutait un mois
intercalaire , les deux premières années étant de
douze mois , & la troifieme , qu’on nommoit la
grande-année, étoit de treize mois. Cette période de
trois ans s’appelloit triéteride, mot forme de Tptîç,
trois, & de trtç , année. { D . J. )
TRIÉTERIES ou TRIÉTÉRIQUES, f. f. plur.
(Antiq. greq.') fêtes de trois en trois années que fai-
foient les Béotiens & les Thraces en l’honneur de
Bacchus, & en mémoire de fon expédition des Indes
qui dura trois ans. Cette folemnité étoit célébrée par
des matrones divifées par bandes, & par des vierges
qui portoient les thyrfes ; les unes & les autres lài-
fies d’enthoufiafme ou d’une fureur bachique, chan-
toient l’arrivée de Bacchus pendant le cours de cette
fête , qui finiffoit par des facrifices en l’honneur du
dieu. Triéteries eft formé de deux mots grecs, tpu,
trois, & Îtoç , année. { D . J.')
TRIEU, l e , ou le TRIEUX, ( Géog. mod. ) petite
riviere de France, dans la Bretagne. Elle fe jetté
dans la Manche à trois lieues de Treguier. (D .J . ')
T R IF A N U M , (Géog. anc.) lieii d’Italie , dans la
Campanie. Tite-Live, l. V I I I . c. x j . dit que ce lieu
étoit entre Sinueffa & Minturnæ. ( D . J . )
TRIFILERIE , en ternu d ’Epinglitr , n’eft autre
chofe qu’un banc garni d’une filiere, à-travers laquelle
paffe le fil qu’on tire par des tenailles qui font
prifes par un crochet, répondant à une bafcule qu’un
ouvrier foule en avançant la tenaille dé chaque coup.
Il y a encore des trifiletics à l’eau , dont les bafcules
font foulées par roues. Voye{ C article ÉpiNglier ,
ou 1 on a décrit une de ces trifileries , & l ’article
Grosses-Forges , où l’on a décrit l'autre.
TRIFOLIUM t (Jardinage.) voyeç Cy t i s ÜS.
TRI FO RMIS D E A , (Mythol.) la déeffe à trois
faces, ou à trois têtes ; c'étoit Hécate , qui, félon
Servius, préfidoit à la naiffance, à la vie 8c à la mort;
Entant qu’elle préfidoit à la naiffance, elle eft appel*
lée Lucine ; entant qu’elle a foin de la fanté, ôn l’ap*
pelle Diane; le nom a Hécate lui 'convient ence qu’elle
préfide à la mort. ( D .J . )
TRIG ABOLI, (Géog. anc.) peuples tofcanS, que
Polybe place à l'embouchure du Pô. Léander, defer.
di tutta liai. p. 344, prétend que les Trlgaboles habitèrent
anciennement entre les deux bouches du Pô,
appellées Magna-Vacca & Volana. (D. J.)
TRIGAMIE, U.(Gram. &Jurifprud.) eftl e crime
de celui qui époufe en même tems trois femmes ,
comme la bigamie eft le crime de celui qui en a deux;
ce crime eft compris fous le terme depoligamie. Voyc^
Bigamie 6* Poligamie. (A )
TRIGE, f. f. terme d'Antiquaire, char à trois chevaux.
La trige n’étoit tirée que par deux chevaux,
ainfi c’étoit proprement une bige ; mais elle avoit un
troifieriie cheval attaché aux deux autres par une
laiffe ou une longe, comme un cheval de main, apparemment
pouf changer. La trige ne fe voit fur aucun
monument ancien: elle a cependant été très-long-tems
en ufage à Rome dans les jeux du cirque, mais chez
les Grecs on l’abandonna de bonne heure. Le troifieme
cheval de la trige s’appelloit mrapéopce, félon He-
fychius, & ç-epaTtç, félon Denis d’Halicarnaffe. Stace,
dans fa Tliébdide, l. VI. verfi. ^Cj. l’appelle en latin
equusfunalis , cheval de laiffe ou de longe. Trévoux.
( D . J.'-) * '
TRIG L A , f. m. (Mytlidl.) femme à trois têtes,
que les anciens habitans de la Luface adOrôient. On
nourrifloit dans fon temple un cheval noir qui étoit
fpécialement confacré à la déeffe; 8c lorfqu’il y avoit
demeuré quelques années, le prêtre qui en prenoit
foin le menoit à la guerre pour en tirer des préfagesl
( D . J . )
TRIGLOCHINES, valvules , voye{ T ricuspi-
des.
TRIGLYPHE, f. m. ( Archit. ) efpece de boffagè
par intervalles égaux, q ui, dans la frife dorique, à
! des gravures entières en angles, appelléesglyphes ou
canaux , & féparés par trois côtes d’avec lès deux
demi-canaux des côtés. Il a dans le milieu deux cannelures
ou coches en triangle, & deux demi-cannelures
fur les deux côtés. On appelle côte ou lifiel chaque
efpace qui eft entre les deux cannelures. Les tri-
glyphes font diftribués fur la frife dorique, de façon
qu’il y en a toujours un qui répond fur le milieu des
colonnes, 8c qui a de largeur le demi-diametre de
la colonne prife fur le pié. Le mot triglyphe vient du
grec triglyphos qui a trois gravures. ( D . J . ) v
TRIGONE, adj. m Afironomie, fignifie Vafpeclde
deux planètes lorfqu’elles font éloignées l’une de
l’autre de la troifieme partie du zodiaque, c’eft à-dire
de 120 degrés. On appelle plus communément cet
afpeâ trine. VoyefYRiaE.
T rigone desfignes, c’ eft un infiniment dont on
fe fert en gnomonique, pour tracer les arcs des fignes.
Pour bien entendre la conftru&ion 8d’ufage de cet
infiniment, fur lequel eft tracée la projeéhon dé
l’écliptique fur le colure des folftices, il faut fe fou-
venir que l’écliptique fait avec l’équateur un angle