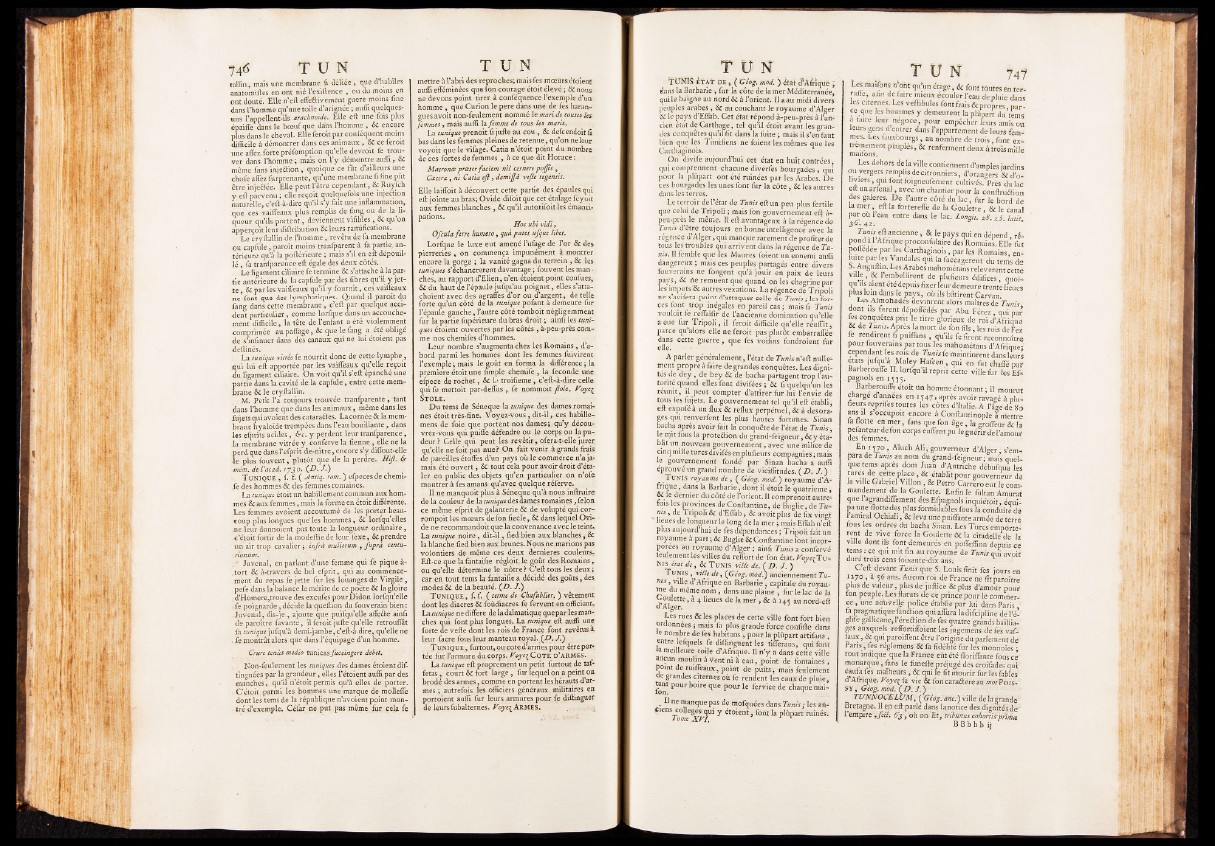
i i l l i
;m m m i
l l l l i
IfiillS
746 T U N
tallin, mais une membrane fi déliée , que d’h-ahiles
anatomiftes en ont nié l’exiftence , ou du moins en
ont douté. Elle n’eft effe&ivement guere moins fine
dans l’homme qu’une toile d’arignee ; aufîi quelques-
uns l’appellent-ils arachnoïde. Elle eft une fois plus
.épaiffe dans le boeuf que da’ns l’homme , & encore
plus dans le cheval. Elle feroit par conféquent moins
difficile à démontrer dans ces animaux, & ce feroit
une allez forte préfomption qu elle devroit fe trouver
dans l’homme ; mais on l’y démontre auffi , &
même fans inje&ion, quoique ce fût d’ailleurs une
chofe affez furprenante, qu’une membrane fi fine pût
être injeétée. Elle peut l’être cependant, & Ruyfch
y eft parvenu ; elle reçoit quelquefois une injedtion
naturelle, c’eft-à-dire qu’il s’y fait une inflammation,
.que ces vaiffeaux plus remplis de fang oud e la liqueur
qu’ils portent, deviennent vifibles , &c qu’on
apperçoit leur diftribution & leurs ramifications.
Le cryftallin de l’homme, revêtu de fa membrane
ou capfule, paroît moins tranfparent à fa partie, antérieure
qu’à la poftérieure ; mais s’il en eft dépouillé
, fa tranfparence eft égale des deux côtés.
Le ligament ciliaire fe termine & s’attache à la partie
antérieure de la capfule par des fibres qu’il y jet-
t e , & par les vaiffeaux qu’il y fournit, ces vailfeaux
ne font que des lymphatiques. Quand il paroît du
fang dans cette membrane, c’ eft par quelque accident
particulier, comme lorfque dans un accouchement
difficile, la tête de l’enfant a ete violemment
comprimée au paffage, & que le fang a été obligé
de s’infinuer dans des canaux qui ne lui étoient pas
deftinés. . .
La tunique vitrée fe nourrit donc de cette lymphe,
qui lui eft apportée par les vaiffeaux qu’elle reçoit
du ligament ciliaire. On voit qu’il s eft épanché une
partie dans la cavité de la capfule, entre cette membrane
& le cryftallin.
M. Petit l’a toujours trouvée tranfparente , tant
dans l’homme que dans les animaux, même dans les
iù jets qui avoient des cataraûes. La cornée & la membrane
hyaloïde trempées dans l’eau bouillante, dans
les efprits acides, &c. y perdent leur tranfparence,
la membrane vitrée y conferve la fienne , elle ne la
perd que dans l’efprit de-nitre, encore s’y diflbut-elle
■ le plus fouvent, plutôt que de la perdre. Hijl. &
■ mém.deTacad. 1730. (D . / .)
T unique , f. f. ( Jmiq. rom. ) efpecesde chemi-
fe des hommes & des femmes romaines.
La tunique étoitun habillement commun auxhom-
més & aux femmes, mais la forme en étoit différente.
Les femmes avoient accoutumé de les porter beaucoup
plus longues que'les hommes , & lorfqu’elles
ne leur donnoient pas toute la longueur ordinaire,
c ’étoit fortir de la modeftie de leur, fexe, & prendre
un air trop cavalier ; infrà muLierum , fuprà centu-
rionum.
; • Juvenal, en parlant d’une femme qui fe pique à-
,tort & à-travers, de bel efprit, qui au commencement
du repas fe jette fur les louanges de Virgile ,
pefe dans la balance le mérite de ce poète & la gloire
d’Homere,trouve des excufes pourDidon lorfqu’elle
fe poignarde, décide la queftion du fouverain bien:
Juvenal, dis-je , ajoute que puifqu’elle affedte ainfi
de paroîtré favante, il feroit jufte qu’elle retrouffât
fa tunique jufqu’à demi-jambe,c’eft-à dire, qu’elle ne
. fe montrât alors que dans l’équipage d’un homme.
Crure tenus medio tunicas fuccingere debet.
Non-feulement les tuniques des dames étoient dif-
tinwuées par la grandeur, elles l’étoient auffi par des
manches, qu’il n’étoit permis qu’à elles de porter.
. C’étoit. parmi les hommes une marque de mollefle
dont les tems de la république n’avoient point mon-
- tré d’exemple. Céfar ne put pas même fur cela fe
T U N
mettre à l’abri des reproches; maisfies moeurs éfdîenf
auffi efféminées que fon courage étoit élevé ; & nous
ne devons point tirer à conféquence l’exemple d’un
homme , que Curion le pere dans une de fies harangues
avoit non-feulement nommé le mari de toutes les
femmes , mais auffi la femme de tous les maris.
La tunique prenoit fi jufte au cou , &. defcendoit fi
bas dans les femmes pleines de retenue, qu’on ne leur
voyoit que le vifage. Catia n’étoit point du nombre
de ces fortes de femmes , à ce que dit Horace :
Matrones proeter faciem nil cernere pofjîs ,
Cetera , ni Catia ejl, demiffâ vejle tegentis.
Elle laiffoit à découvert cette partie des épaules qui
eft jointe au bras; Ovide difoitque cet étalage féyoit
aux femmes blanches , & qu’il autorifoit les émancipations.
Hoc ubi vidi ,
O feula ferre humero, quà patet ufque libet.
Lorfque le luxe eut amepé l’ufage de l’or & des
pierreries , on commença impunément à montrer
encore la gorge ; la vanité gagna du terrein, & les
tuniques s’echancrerent davantage ; fouvent les man ches,
au rapport d’Elien, n’en étoient point coufues,
& du haut de l’épaule jufqu’au poignet, elles s'attachaient
avec des agraffes d’or ou d’argent., de telle
forte qu’un côté de la tunique pofant à demeure fur
l’épaule gauche, l’autre côté tomboit négligemment
fur la partie fupérieure du bras droit ; ainfi les tuniques
étoient ouvertes par les côtés , à-peu-près comme
nos chemifes d’hommes.
Leur nombre s’augmenta chez les Romains, d’abord
parmi les hommes dont les femmes fuivirent
l’exemple; mais le goût en forma la différence ; la
première étoit une fimple chemife , la fécondé une
efpece de rochet, & L; troifieme, ç’eft-à-dire celle
qui fe mettoit par-deffus ,, fe nommoit fiole. Foye£
Sto l e .
Du tems de Séneque la tunique des dames romaines
étoit très-fine. Voyez-vous, dit-il, ces habille—
mens de foie que portent nos dames; qu’y découvrez
vous qui puiffe défendre ou le corps ou la pudeur
? Celle qui peut les revêtir, ofera-t-elle jurer,
qu’elle ne foit pas nue? On fait venir à grands frais
de pareilles étoffes d’un pays où le commerce n’a jamais
été ouvert, & tout cela pour avoir droit d’étaler
en public des objets qu’en particulier on n’ofe
montrer à fes amans qu’avec quelque réferve.
Il ne manquoitplus à Séneque qu’à nous inftruire
de la couleur de la tunique des dames romaines, félon,
ce même efprit de galanterie & de volupté qui cor-
rompoit les moeurs de fon fieclé, & dans lequel Ovide
ne recommandoit que la convenance avec le teint.
La tunique noire, dit-il, lied bien aux blanches, &
ia blanche fied bien aux brunes. Nçus ne marions pas
volontiers de même ces deux dernieres couleurs.
Eft-ce que la fantaifie régloit, le goût des Romains,
ou qu’elle détermine le nôtre? C’eft tous les deux;
car en tout tems la fantaifie a décidé des goûts, des
modes & de labèauté. (D . J.')
T u n iq u e , f. f. ( terme de Çhafublier. ) vêtement
dont les diacres & foûdiacres fe fervent en officiant.
La tunique ne différé de la dalmatique que par les manches
qui font plus longues. La tunique, eft auffi une,
forte de vefte dont les, rois de France font revêtus à
leur facre fous leur manteau rpyal. (Z). /.)
T u nique , furtout, ou; cote d’armes pour être portée
fur l’armure du corps. J'ây^CoTE d’armes.
La tunique eft proprement un petit furtout de taffetas,
court & fort large, lurlequelonapeintou
brodé des armes, comme en portent les hérauts d’armes
; autrefois lès.officiers généraux militaires enr
portaient auffi fur leurs armures pour fe diftinguer
de leurs fubalternes. Foye^ Armes,
T U N
TÜNÎS e ï AT DÉ j ( Géog. mod. ) état d*Afriqii‘ë ÿ
dans la Barbarie -, fur la côte de Ja mer Méditerranée,
qui le baigne àü nord& à l’orient. II a au midi divers
peuples arabes * & au couchant le royaume d’Alger
& le pays d’Effab. Cet état répond à-peu-près à Pan*
ciert état de Carthage, tel qu’il étoit avant les grandes
conquêtes qu’il fit dans la fuite ; mais il s’en faut
bien que les Tunifiens ne foient les mêmes que les
Carthaginois*
On divife aujourd’hui cet état en huit contrées,
qui comprennent chacune diverfes bourgades, qui
pour la plûpart ont été ruinées par les Arabes. De
ces bourgades les unes font fur la côte $ & lés autres
dans les terres.
Le terroir de l’état de Tunis eft un peu plus fertile
que celui de Tripoli ; mais fon gouvernement eft à-
peu-prèsle même. Il eft avantageux à la régence de
Tunis d etre toujours en bonne intelligence avec la
régence d’A lger, qui mahque rarement de profiter de
‘tous les troubles qui arrivent dans la régence de Tunis.
Ilfemble que les Maures foient un ennemi auffi
dangereux ; mais ces peuples partagés entre divers
fouverains ne fongent qu’à jouir en paix de leurs
pays, & ne remuent que quand on les chagrine par
les im p ô tsa u t re s vexations. La régence de Tripoli
ne s’avifera point d’attaquer celle de Tunis; les forces
font trop inégales en pareil cas ; mais fi Tunis \
vouloit fe reflaifir de l’ancienne domination qu’elle
a eue fur Tripoli, il feroit difficile qu’elle reiifTît,
parce qu’alors elle ne feroit pas plutôt embarraffée
dans cette guerre, que fes voifins fondroient fur
elle*
A parler généralement, l’état de Tunis n’eft nulle*
ment propre à faire de grandes conquêtes. Les dignités
de d e y , de bey & de bacha partagent trop l’autorité
quand elles font divifées ; & fi quelqu’un les
réunit, il peut compter d’attirer fur lui l’envie de
tous fes fujets. Le gouvernement tel qu’il eft établi,
eft expofeà un flux & reflux perpétuel, & à desorages
qui renverferit les plus hautes fortunes. Sinan
bacha apres avoir fait la conquête de l’état de Tunisf
le mit fous la protection du grand-feigneur, & y éta-
blit un nouveau gouvernement, avec une milice de
cinq mille turcs divifés enplufieurs compagnies ; mais
le gouvernement fondé' par Sinan bacha a auffi
éprouvé un grand nombre de viciflitudes. (D . J .)
T unIs royaurne d e , ( Géog. mod-, ) royaume d’A-
friq ü e , dans la Barbarie, dont il étoit le q u a trième ,
& le dernier du côté de l’orient. U eomprenoit autre*
fois les provinces de Conftantine, de Buglie, de Tu-
^ nis, de Tripoli & d’Eflab, & avoit plus de fix vingt
% ues Iongûeiir le long de la mer ; mais Eflab n’eft
plus aujourd’hui de fes dépendances ; Tripoli fait un
royaume à part ; & Buglie & Conftantine font in cor*
porees au royaume d’Alger ; ainfi Tunis a conferve
feulement lés villes du reffort de fon état, Foyer Tu*
nis état de, & T unis ville de. CD . J . ) -
T u n is , ville de, (Géog. mod^y anciennement 7a-
nts »ville d’Afrique en Barbarie, capitale du royau-
ïne du même nom, dans une plaine , fur le lac de la
Goulette, à 4 lieues de la mer, & à 145 au nord-eft
d Alger.
Les rues & lès places de cette ville font fort bien
ordonnées ; mais fa plus grande force confifte dans
fe nombre de fes habitans , pour la plûpart àrtifans ,
entre lefquels fe diftinguent les tifferans, qui font
fa meilleure toile d’Afrique. Il n’y a dans cette ville
aucun moulin à vent ni à eau, point de fontaines ,
point de ruiffeaux, point de puits , mais feulement
de grandes citernes où fe rendent les eaux de pluie,
tent pour boire que pour le fervice de chaque mai-
U ne manque pas de mofquées dans Tunis; les ail,'
tiens coUeges-qui y étoient., font la plûpart ruinés.'
Tome X r l . r
T U N 7 4 7
le s maifohs. n’ont qu’un étage, & font toutes enter-
rafle * afin de faire mieux écouler l’eau de pluie dans
les citernes. Les veftibules font frais & propres par-
ce que es hommes y demeurent la plûpart du tems
â taire leur négoce, pour empêcher leurs amis ou
leurs gens d’entrer dans l’apparténient de leurs femmes.
Les fauxbourgs, au nombre de trois font extrêmement
pfenplés, & renferment deux à trois mille
manons.
Les dehors dé la ville contiennent d’amples jardins
ou vergers remplis de citronniers, d’orangers & d’o-
liviers, qui font foigneufement cultivés. Près du lac
eft un arfenal, avec un chantier pour la coriftruéHon
des galeres. De l’autre côté du la c , fur le bord de
la mer, eft la fortereffe de la Goulette , & le canal
par où l’eau entre dans le lac. Longit. x8. xâ latit
3 G- 42.
m m ^ ancienne, & ie pàÿs qui en dépend, M Afrique proconfulàire des Romains. Elle fiit
poifedee par les Carthaginois, par les Romains. en-
frnte par les Vandales qui la faccagerent du tems de
5; Augultin. Les Arabes mahométans relevèrent cette
vdle , & l’embellirent de plufieurs édifices , qu o t
qu ils aiettt ete depuis fixer leur demeure trente lieues
plus loin dans le pays, où ils bâtirent Carnau.
Les Almohades devihrent altirs maîtres de Tunis.
dont ris forent dépoffédés par Abu Ferez, qui pa#
les conquêtes prit le titre glorieux de roi d’Afrique
SC de Tunis. Après la mort de fon fils, les rois de Fei
fe rendirent fi puiffans , qu’ils fo firent reconnoître
pour fouverains par tous les mahométans d’Afrique:'
cependant les rois de Tunis fe maintinrent dans leurs
états jufquà Mulëy Hafcen, qui en fut chaffè par
Barberouffe II. lorfqu il reprit cette ville fut les Eft
pagnols en 1535.
Barberouffe étoit lin homme étonnant ; il mourut
chargé d’anuëës en t 547 , après avoir ravagé à plufieurs
repnfes toutes les côtes d’Italie. A l’âge de 80
ans il s’Occupoit encore à Conflaminople S mettre
fa flotte eh mer, fans que fon â g e , la groffeur & la
pefanteur dé fon eorps éuffent pu le guérir de l’amouf
des femmes.
En i 5 76, Aluch Ali,'gouverneur d’Alger s’empara
de Tunis m nom du ^rand-feigneur; mais quelque
tems: après dom Juan d’Autriche débufoua les
turcs de rtite place, & établit pour gouverneur de
la ville Gabriel Vdlon , & Petto Carrero eut le colin
mandement de la Goulette, Enfin le foltan Amurat
que 1 agrandiffement des Efpagriols inquiétoit, équi-
çàune flotte dès plus formidables fous la conduite dé
1 amiral Ochiali, & leva une puiffante armée de terre
fous les ordres du bacha Sinan. Les Turcs empdrte^
rent de vive'force la Goulette Sc ia citadelle de la
ville dont ils font demeurés-eh pôffeffion depuis ce
tems: ce qui .mit' fin au royaume de Tuiiis qui avoit
dure trois cens foixante-dix ans,
C’éft devint Tunis que S. Louis finit fes jours en
t z 70 , A 5-6 ans. Aucun roi de France ne fit paroîtré
plus de valeur, plus de juftice -& plus d’amôûr pour
fon peuple. Les ffatuts de ce prince pour le conrmer-
,ée-, unè neûiVelJe police établie par lui dans Paris
fa pragmatiquefaiiiiion qui affura la difcipline de Té-
glife gallicane, l’éreftion de fes quatre grands bailliages
auxquels reffortiffoient les jùgemens de fes vaft
faux, & qui paroiffent être l’origine du parlement dé'
Paris, fes réglemens Se fa fidélité fur les monhdies »
tout indique que la France eût été floriffante fous ce '
monarque, fans le funefte préjugé des croifades qui ’
éaufa fes malheurs , & qui le fit mourir fur lés fables
d’Afrique. Foyrt fa vie Se fon caraftere au « « P o is - •'
SY, Géog. mod. (Z>. J .\
TUNN&CË LUM i^Gédg; ànc.j ville delà grande
Bretagne* Il en eft parle dans lanotice des dignités de:
l ’empire rfect. 6g où on-litftnbanus cohorti's-prifncs
B B b b b ij