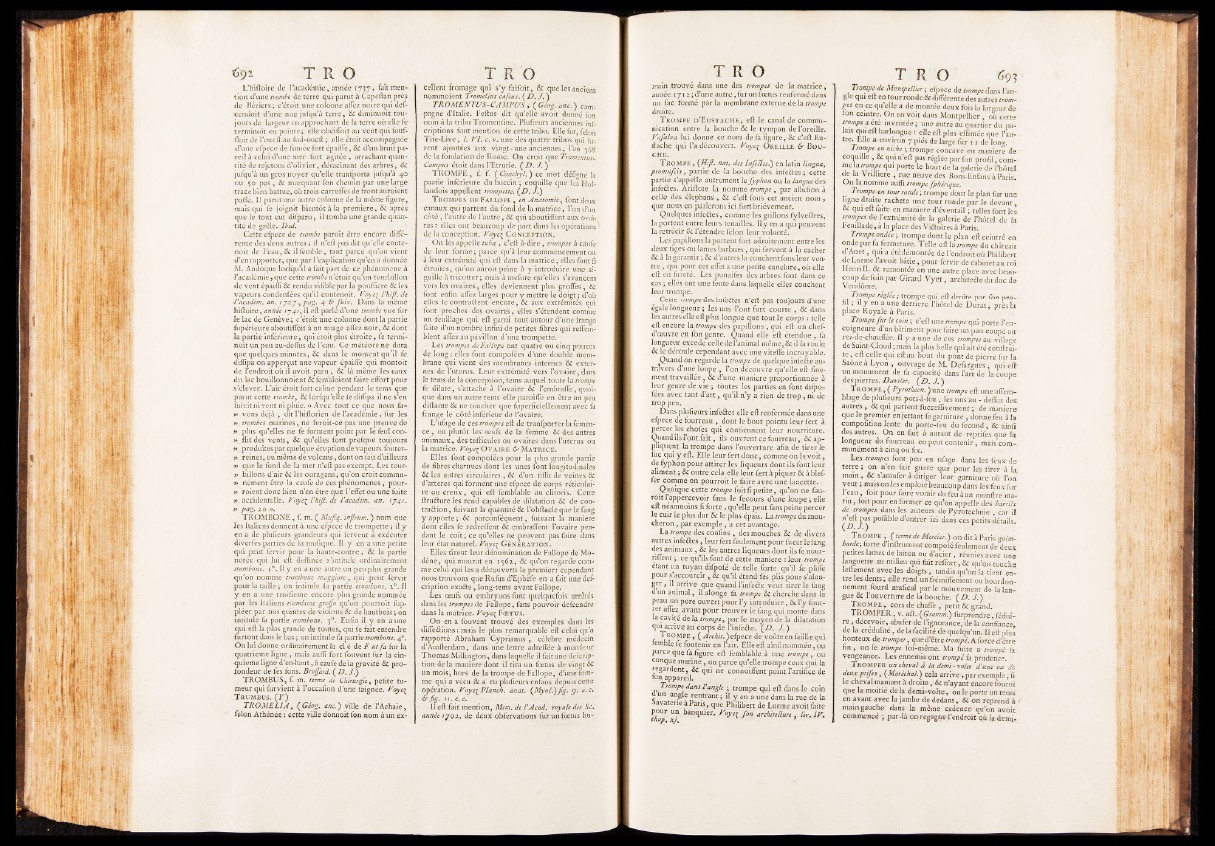
<>9* T R O
L’hiftoire de l ’académie, année 1737, fait mention
d’une trombe de terre qui parut à Capeftan près
de Bcziers ; c’étoit une colonne affez noire qui def-
'Cendoit d’une nue jufqu’à terre, 6c diminuoit toujours
de largeur en approchant de la terre où elle fe
terminoit en pointe; elle obéiffoit au vent qui fouf-
floit de l’oueft au fud-oneft ; elle étoit accompagnée
d’une efpece de fumée fort épaiffe, 6c d’un bruit pareil
celui d’une mer fort agitée , arrachant quantité
de rejetons d’olivier, déracinant des arbres, 6c
jufqu’à un gros noyer qu’elle tranfporta jufqu’à 40
•ou 50 pas , & marquant fon chemin par une large
4race bien battue, où trois carrofl'es de front auroient
pafl'é. Il parut une autre colonne de la même figure,
mais qui fe joignit bientôt à la première, 6c après
que le tout eut difparu, il tomba une grande quantité
de grêle. Ibid.
. Cette efpece de trombe paroît être encore différente
des deux autres ; il n’eft pas dit qu’elle conte-
noit de l ’eau, 6c il femble, tant parce qu’On vient
d’en rapporter, que par l ’explication qu’en a donnée
M. Andoque lorfqu’il a fait part de ce phénomène à
•l’académie, que cette trombe n ’étoit qu’un tourbillon
de vent épaiflî & rendu vifible par la poufîiere 6c les
vapeurs condenfées qu’il contenoit. Voye{ l'hijl. de
•L'académ. an. 1 JQ.J, pag. 4 & fuiv. Dans la même
hiftoire, année 1741, il eft parlé d’une trombe vue fur
le lac de Genève; c ’étoit une colonne dont la partie
fupérieure aboutiffoit à un nuage affez noir, 6c dont
•la partie inférieure, qui étoit plus étroite, fe terminoit
un peu au-deffus de l ’eau. Ce météore ne dura
que quelques minutes, 6c dans le moment qu’il fe
diffipa on apperçut une vapeur épaiffe qui montoit
de l’endroit où il avoit paru , & là même les eaux
du lac bouillonnoient & fembloient faire effort pour
s ’élever. L’air étoit fort calme pendant le tems que
sparut cette trombe, 6c lorfqu’elle fe diffipa il ne s’en
ïiiivit ni vent ni pluie. « Avec tout ce que nous fa-
» vons déjà , dit l ’hiftorien de l’académie, fur les
9> trombes marines, ne feroit-ce pas une preuve de
» plus qu’elles ne fe forment point par le feul con-
»„flitdes vents, 6c qu’elles font prefque toujours
» produitespar quelque éruption de vapeurs fouter-
■ ». reines., ou même de volcans, dont on fait d’ailleurs
» que le fond de la mer n’eft pas exempt. Les tour-
» billons d’air 6c les ouragans, qu’on croit cominu-
-» nément être la caufe de ces phénomènes, pour-
» roient donc bien n’en être que l’effet ou une fuite
».accidentelle. Voye^l'hiji. dç l'académ. an. 1741.
» pag. 20 ».
TROMBONE, f. m. ( Mujîq. infirum. ) nom que
les Italiens donnent à une efpece de trompette ; il y
en a de plufieurs grandeurs qui fervent à exécuter
diverfes parties de la mufiquë. Il y en a une petite
•qui peut fervir pour la haute-contre, 6c la partie
notée qui lui eft deftinée s ’intitule ordinairement
-trombone. i°. Il y en a une autre un peu plus grande
qu’on nomme trombone maggiore, qui .peut fervir
.pour la taille; on intitule fa partie trombone. z°. Il
y en a une troifieme encore plus grande nommée
par les -Italiens trombone grojfo qu’on pourroit fup-
pléer par nos quintes de violons 6c de hautbois ; on
intitule fa partie trombone. 30. Enfin il y en aune
qui eft la plus grande de toutes, qui fe fait entendre
furtout dans le bas ; on intitule fa partie trombone. 40.
On lui donne ordinairement la cl é de F ut fa fur la
quatrième ligne, mais auffi fort fouvent fur la cinquième
ligne d’en-haut,:à caufe delà gravité & profondeur
de fes fons. Brojfard. ( D. / .)
TROMBUS, f. m. terme de Chirurgie, petite tumeur
qui furvient à l’occafion d’une làignée. Voyez
T rumbus. (T )
TROME L IA , ( Gèog.. anc.') ville de l’Âchaïe,
félon Athénée : cette ville donnoit fon nom à un ex-
T R O
Cellent fromage qui s ’y fa ifo it , 6c que les anciens
nommoient Tromelius cafeus- {D . J. )
TROMENTUS-CAMPUS ,• ( Geog. anc. ) campagne
d’Italie. Feftus dit qu’elle avoit donné fon
nom à la tribu Tromentine; Plufieurs anciennes inscriptions
font mention de cette tribu. Elle fut, feloh
Tite-Live, /. VI. c. v. une des quatre tribus qui furent
ajoutées aux vingt-une anciennes, l’an 368
de la fondation de Rome. On croit que Tromentus*•
Campus étoit dans l’Etrurie. (Z>. /. )
TROMPE, f. f. ( Conchyl. ) ce mot défigne la
paatie inférieure du buccin ; coquille que les Hol-
landois appellent trompette. {JD. J.)
T rompés de Fallope , en Anatomie, font deux
canaux qui partent du fond de la matrice, l’un d’un
côté , l’autre de l’autre, 6c qui aboutiffent aux ovaires
: elles ont beaucoup de part dans les opérations'
de la conception. Voye^ C onception.
On les appelle tubee, c’eft-à-dire , trompes à caufe
de leur forme ; parce qu’à leur commencement ou
à leur extrémité qui eft dans la matrice, elles font fi
étroites, qu’on auroit peine à y introduire une aiguille
à tricotter ; mais à mefure qu’elles s’avancent
vers les ovaires, elles deviennent plus groffes, 6c
font enfin affez larges pour y mettre le doigt ; d’où
elles fe contra&ent encore, 6c aux extrémités qui
font proches des ovaires, elles s’étendent comme
un feuillage qui eft garni tout-autour d’une frange
faite d’un nombre infini de petites fibres qui reffem-
blent affez au pavillon d’une trompette.
Les trompes de Fallope ont quatre ou cinq pouces
de long : elles font compofées d’une double membrane
qui vient des membranes internes 6c externes
de l’uterus. Leur extrémité vers l’ovaire, dans
le tems'de la conception, tems auquel toute la trompe
fe dilate, s’attache à l’ovaire 6c l’embraffe, quoique
dans un autre tems elle paroiffe en être un peu
diftante 6c ne toucher que fuperficiellement avec fa
frange le côté inférieur dé l’ovaire.
L ’ufage de ces. trompes eft de trànfporterlafemen-
c e , ou plutôt les oeufs de la femme 6c des autres
animaux, des tefticules ou ovaires dans l’uterus ou
la matrice. Voye1 Ov aire & Ma tr ic e .
Elles font compofées pour la plus grande partie
de fibres charnues dont les unes font longitudinales
6c les autres circulaires , 6c d’un tiffu de veines 6c
d’arteres qui forment une efpece de corps réticulaire
ou creux, qui eft femblable au clitoris. Gette
ftrufture les rend capables de dilatation 6c de con-
traâion, fuivant la quantité 6c l’obftacle que le fang
y apporte ; 6c parconféquent, fuivant la maniéré
dont elles fe redreffent 6c embraffent l’ovaire pendant
le coït ; ce qu’elles ne peuvent pas faire dans
leur état naturel. Voye{ Génération.
Elles tirent leur dénomination de Fallope de Mo-
dène, qui mourut en 1562, 6c qu’on regarde comme
celui qui les a découverts le premier: cependant
nous trouvons que Rufus d’Ephèfe en a fait une def-
cription exafte, long-tems avant Fallope.
Les oeufs ou embryons font quelquefois arrêtés
dans les trompes de Fallope, fans pouvoir defeendre
dans la matrice. Voye^ Foetus.
On en a fouvent trouvé des exemples dans les
différions: mais le plus remarquable eft celui qu’a
rapporté Abraham Cyprianus , célébré médecin
d’Amfterdam, dans une lettre adreffée à monfieur
Thomas Millington, dans laquelle il faitune deferip-
tion de la maniéré dont il tira un foetus de vingt 6c
un mois, hors de la trompe de Fallope, d’une fem-
me qui a vécu & a eu plufieurs enfans depuis cette
opération. Voye{ Planck. ânat. {Myoljfig. g . c. cl
& fig. 11. e. e.'
Il eft fait mention, Mem. de P Acad, royale des Sel
année i j ç 2, de deux ôbfervarions fur un foetus hu-
T R O
main trouvé dans une des trompes de fa matrice,
année 1712; d’une autre, fur un foetus renfermé dans
un fac formé par la membrane externe de la trompe
droite.
T rompe d’Eu st a ch e , eft le canal de communication
entre la bouche 6c le tympan de l’oreille.
Vafalva lui donne ce nom de fa figure, 6c c’eft Eu-
ftache qui l’a découvert. Voye^ Oreille & Bouche.
T rompe , {H‘ß . nat. des Infectes.) en latin lingua,
promufeis, partie de la bouche des infeâes ; cette
partie s’appelle autrement le fyphon ou la langue des
infeftes. Ariftote la nomme trompe , par allufion à
celle des élephans , 6c c’eft fous cet ancien nom,
que nous en parlerons ici fort brièvement.
Quelques infe&es, comme les grillons fylveftres,
la portent entre leurs tenailles. Il y en a qui peuvent
la rétrécir 6c l’étendre félon leur yolonté.
Les papillons la portent fort adroitement entre les
deux tiges 011 lames barbues, qui fervent à la cacher
& à la garantir ; 6c d’autres la couchent fous leur ventre
, qui pour cet effet a une petite canelure, où elle
eft en fureté. Les punaifes des arbres font dans ce
cas ; elles ont une fente dans laquelle elles couchent
leur trompe.
Cette trompe des infe&es n’eft pas toujours d’une
égale longueur ; les uns l’ont fort courte , & dans
les autres elle eft plus longue que tout le corps : telle
eft encore la trompe des papillons , qui eft un chef-
d’oeuvre en fon genre. Quand elle eft étendue , fa
longueur excede celle de l’animal même, & il la roule
& le déroule cependant avec une vîteffe incroyable.
Quand on regarde la trompe de quelque infeéte au-
travers d’une loupe , l’on découvre qu’elle eft finement
travaillée, & d’une maniéré proportionnée à
leur genre de vie ; tôutes les parties en font difpo-
fees avec tant d’art, qu’il n’y a rien de trop, ni de
trop peu.
Dans plufieurs infeâes elle eft renfermée dans une
efpece de fourreau , dont le bout pointu leur fert à
percer les chofes qui contiennent leur nourriture.
Quand ils l’ont fait, ils ouvrent ce fourreau, & appliquent
la trompe dans l’ouverture afin de tirer le
fuc qui y eft. Elle leur fert donc, comme on le v o it,
de fyphon pour attirer les liqueurs dont ils font leur
aliment ; 6c outre cela elle leur fert à piquer 6c à bief-
fer comme on pourroit le faire avec une lancette.
Quoique cette trompe foit fi petite, qu’on ne fau-
roit l’appercevoir fans le fecours d’une loupe ; elle
eft neanmoins fi forte, qu’elle peut fans peine percer
le cuir le plus dur & le plus épais. La trompe du moucheron
, par exemple, a cet avantage.
La trompe des coufins , des mouches 6c de divers
autres infeftes, leur fert feulement pour fucer le fang
des animaux, 6c les autres liqueurs dont ils fe nour-
riffent ; ce qu’ils font de cette maniéré : leur trompe
étant un tuyau difpofé de telle forte qu’il fe pliffe
pour s’accourcir ,_ 6c qu’il étend fes plis pour s’alon-
g fr > ri arrive que quand l’infecte veut tirer le fang
d un animal, il alonge fa trompe 6c cherche dans la
peau un pore ouvert pour l’y introduire, & l ’y fourrer
affez^ avant pour trouver le fang qui monte dans
la cavité de.la trompe, par le moyen de la dilatation
qui arrive au corps de l’infefte. {D . / .)
T rompe , ( Archit. ) efpece de voûte en faillie qui
femble fe foutenir en l’air. Elle eft ainfi nommée, ou
parce que fa figure eft femblable à une trompe, ou
conque marine, ou parce qu’elle trompe ceux qui la
regardent, 6c qui ne connoiffent point l’artifice-de
Ion appareil;
Trompe dans P angle ; trompe qui eft dans le coin
un angle rentrant ; il y en a une dans la rue de la
avaterieàParis, que Philibert de Lorme avoit faite
pour un banquier. Voye{ fon architecture liy.IV.
fhap, x j. 9
T R O 6 9?
Trompede Montpellier ; efpece de trompe dans l ’an-
gle qui eft en tour ronde &différente des autres trompas
en ce qu’elle a de montée deux fois la largeur de
fon cemtre. On en voit dans Montpellier , oli cette
trompe a été inventée ; une autre au quartier du pa-
lais qui eft barlongue : elle eft plus eftimée que l’au-
tre* ^rie a environ 7 pies de large fur 11 de long.
Trompe en niche ; trompe concave en maniéré de
coquille , 6c qui n’eft pas réglée par fon profil com-
me latreM/* qui porte le bout de la galerie de l’hôtel
de la Vrilliere , rue neuve des Bons-Enfans à Paris.
On la nomme auffi trotnpt Jphérique.
Trompenn tour ronde-, trompe dont le plan fur une
hgne droite racheté une tour ronde par le devant,
6c qui eft faite en maniéré d’éventail ; telles font les
trompes de l’extrémité de la galerie de l’hôtel de la
Feuillade, à la place des Vi&oires à Paris.
Trompe ondee ; trompe dont le plan eft ceintré en
onde par fa fermeture. Telle eft la trompe du château
d’Anet, qui a été démontée de l ’endroit où Philibert
de Lorme 1 avoit bâtie, pour fervir de cabinet au roi
Henri II. 6c remontée en une autre place avec beaucoup
de foin par Girard V y e t , architefte du duc de
Vendôme.
1 é, 7 r Auviei uc Apuras, presia
place Royale à Paris.
Trompé fur le coin ; c’eft une trompe qui porte l’én-
coigneure d un batiment pour faire un pan coupé au
rez-de-chauffee. Il y a une de ces trompes au village
de Saint-Cloud ;mais la plus belle qui ait été conftrui-
t e , eft celle qui eft au bout du pont de pierre fur la
Saône à Ly on ou vr ag e de M. Defargues , qui eft
un monument de fa capacité dans l’art de la coupe
des pierres. Daviler. {D . J.')
T rom p e ,.( Pyrothecn. ) une trompe eft une affem-
blage de plufteurs pots-à-feu . les uns au - deffus des
autres , 6c qui partent fucceflivement ; de maniéré
que le premier en jettant fa garniture , donne feu à la
compofitionlente du porte-feu du fécond, & ainfi
des autres. On en fait à autant de reptiles que la
longueur du fourreau en peut contenir , mais communément
à cinq ou fix.
Les trompes font peu en ufage dans les feux de
terre; on n’en fait guère-que pour le? tirer à la.
main, 6c s’amufer à:diriger leur garniture où l’on
veut ; mais on les emploie beaucoup dans les feux fur
l’eau, foit pour faire vomir du feu à un monftre matin
, foit pour en former ce qu’on appelle des barrils
de trompes dans les auteurs de Pyrotechnie ,'car i!
n’eft pas poffible d’entrer ici dans ces petits-détails.
{D . J.')
T rompe , ( terme de Mercier.) on dit à Paris guimbarde;
forte d’inftrument compofé feulement de deux
petites lames de laiton ou d’acier, réunies avec une
languette au milieu qui fait reffort, 6c qu’on touche
tellement avec les doigts, tandis qu’on la tient entre
les dents; elle rend unfrémiffement ou bourdonnement
fourd mufical par le mouvement de la langue
& l’ouverture de la bouche. {D . J.)
T rompe , eors de chaffe , petit 6c grand.
TROMPER, v. aéi. {GrammT) furprendre, fédui-
r e , décevoir, abufer de l’ignorance, de la confiance,
de la crédulité, de la facilité de quelqu’un. Il eft plus
honteux de tromper, que d’être trompé. A force d’être
fin-, on fe trompe foi-même. Ma fuite a' trompé fâ
vengeance. Les ennemis ont trompé fa prudence.
TR OMPER u n c h e v a l à l a d e m i - v o l t e d 'u n e o u d e
d e u x p r i f e s , ÇM a r é c h a l .) cela arrive, par exemple, fi
le cheval maniant à droite, 6c n’ayant encore fourni
que la moitié de la demi-volte, on le porte un tems
en avant avec la jambe de dedans, & on reprend à
main gauche dans la même cadence qu’on avoit
commencé ; par -là on regagne l’endroit qù la demi