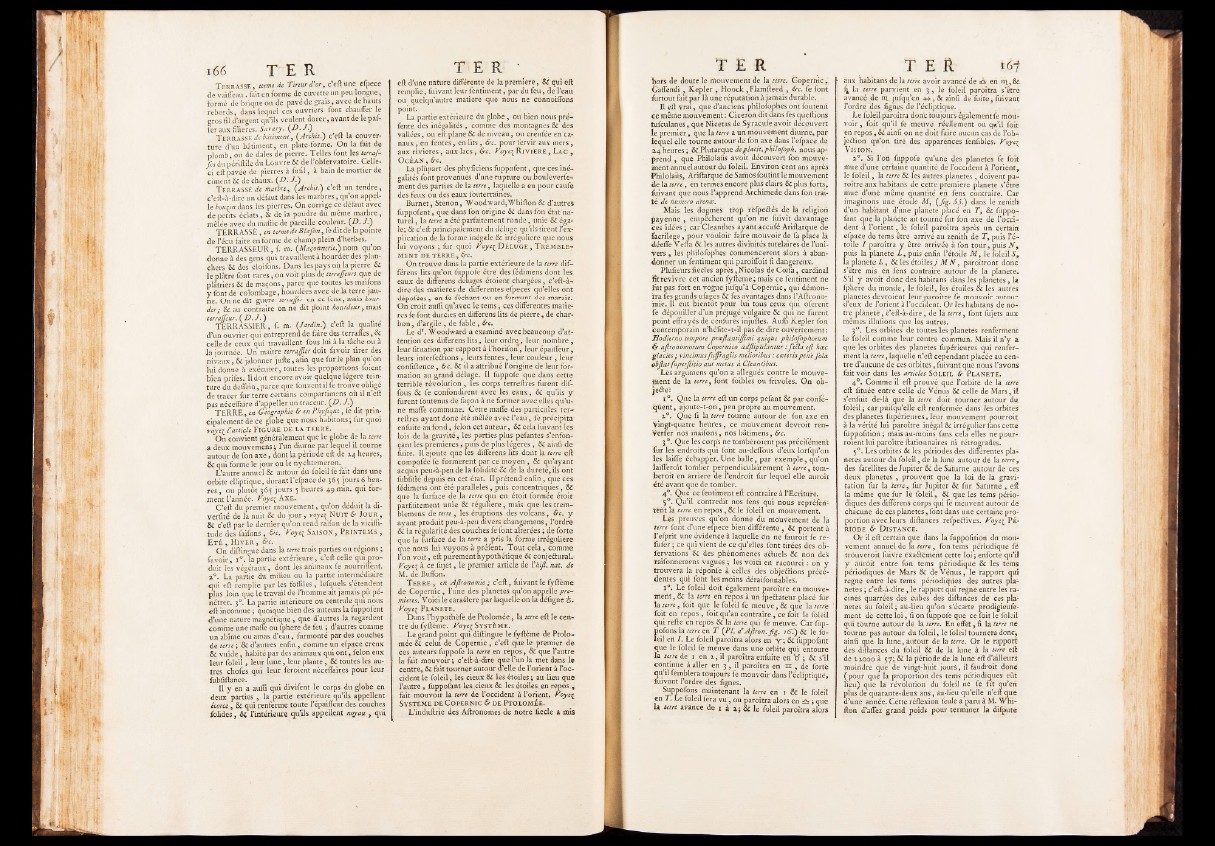
T errasse , ternit de Tireur d’or, c’eft unô çfpecé
de vaiffeau, fait en forme de cuvette un peu longue,
formé de brique ou de payé de grais, avec de hauts
rebords, dans lequel ces ouvriers font chauffer le
gros fil d’argent quîls veulent dorer, avant de le paf-
fer aux filières. Savary. {D. T )
T errasse de bâtiment, (Areh.it.) c’en la couverture
d’un bâtiment, en plate-forme. On la fait de
plomb,'pu de dales de pierre. Telles font les terraf-
fes du périftile du Louvre & de l’obfervatoire. Celle-
ci efl pavée de. pierres à fvifil, à bain de mortier de
ciment & de chaux. {D . J .) . . peéçi
T errasse de marbre, (Archit.) c’eft un tendre,
c’eft-à-dire un défaut dans les marbres , qu’on appelle
boulin dans les pierres. On corrige ce défaut avec
de petits éclats, & de la poudre du même marbre,
mêlée avec du maftic de pareille couleur. {D. / ,)
TERRASSÉ, en terme de Blafon, fe dit de la pointé
de l’écu faite en forme de champ plein d’herbes. -
TERRASSEUR, f. m. {Maçonnerie.') nom qu’on
donne à des gens qui travaillent à hourder des planchers
8c des cloifons. Dans les pays cul la pierre &
lé plâtre font rares, on Voit plus Ae terraffeurs que de
plâtriers 8c de maçons, parce que toutes les maifbns
y font de colombage, hoürdécs avec de la terre jaune.
On-ne dit guère terrnfer en ce fens,mais hour-
i o .____9S H nn ns dit rîotnt hnurÆp.ur . mais
terrajfeur. (D . J .)
TERRASSIER, f. m. (Jardin.) c’eft la qualité
d’un ouvrier qui entreprend de faire des terraffes, &
celle de ceux qui travaillent fous lui à la tache ou à
la journée. Un maître terrajjier doit favoir tirer des
nivaux, & jalonner jufte, afin que fur le plan qu’on
lui donne à exécuter, toutes les proportions foient
bien prifes. Il doit encore avoir quelque légère teinture
du deffein, parce que fouventil le trouve obligé
de tracer fur terre certains compartimens oii il n’eft
pas néceffaire d’appeller un traceur. (D . J.)
TERRE, en Géographie & en Phyjique, fe dit principalement
de ce globe que no.us habiions, fur quoi
yoye[ L'article FIGURE DE LA TERRE.
On convient généralement que le globe de la terre
a deux mouvemens ; l’un diurne par lequel il tourne
autour de fon a x e, dont la période eft de 24 heures,
& qui formé le jour ou le nychtemeron.
L’autre annuel & autour du foleil fe fait dans une
orbite elliptique, durant l’efpace de .3 6 5 jours 6 heures
, ou plutôt 365 jours 5 heures 49 min. qui forment
l’année. Voye{ A x e. ^
C ’eft du premier mouvement, qu’on déduit la di-
verfité de la nuit & du jour, voye^NuiT & Jour ,
& c’eft par le dernier qu’on rend raifon de la viciffi-
tude des faifons , &c. Voye^ Saison , Printems ,
Et é , Hiver , &c.
On diftingue dans la terre trois parties ou régions ;
favoir, i° . la partie extérieure, c’eft celle qui produit
les végétaux , dont les animaux fe nourriffent.
i ° . La partie du milieu ou la partie intermédiaire
qui eft remplie par les foffiles, lefquels s’étendent
plus loin que le travail de l’homme ait jamais pu pénétrer.
30. La partie intérieure ou centrale qui nous
èft inconnue ; quoique bien des auteurs la fuppofent
d’une nature magnétique, que d’autres la regardent
comme une matte ou fphere de feu ; d’autres commç
un abîme ou amas d’eau, furmonté par des couches
de terre ; Sc d’autres enfin, comme un efpace creux
& vuide, habité par des animaux qui ont, félon eux
leur foleil, leur lune, leur plante, & toutes les autres
chofes qui leur feroient néceffaires pour leur
fubfiftance.
Il y en a auffi qui divifent le corps du globe en
deux parties , la partie extérieure qu’ils appellent
écorce, & qui renferme toute l’épaiffeur des couches
folides, Sç l’intérieure qu’ils appellent noyau , qui
eft d’une nature différente de la première, Si qui eft
remplie, fuivant leur fentiment, par du feu, de l’eau
ou quelqu’autre matière que nous ne connoiffons
point.
La partie extérieure du globe, ou bien nous préfente
des inégalités , comme des montagnes & des
vallées, ou eft plane Sc de niveau , ou creufée en canaux
, en fentes, en lits , &c. pour fervir aux mers,
aux rivières, aux lacs , &c. R iv ie r e , La C ,
O c é a n , &c.
La plupart des phyficièns fuppofent, que ces inégalités
font provenues d’une rupture ou bouleverfe-
ment des parties de la terre, laquelle a eu pour caufe
des feux ou des eaux fouterraines.
Burnet, Stenon, "Woodward,Whifton Sc d’autres
fuppofent, que dans fon origine Sc dans fon état naturel
, la terre a été parfaitement ronde, unie Sc égale;
& c’ eft principalement du déluge qu’ils tirent l’explication
de la forme inégale Sc irrégulière que nous
lui voyons ; fur quoi Koye^ D éluge , T remble^
MENT DE TERRE , &C.
On trouve dans la partie extérieure de la terre dif-
férens lits qu’on fuppofe être des fédimens dont les
eaux de differens déluges étoient chargées, c’eft-à-
dire des matières de differentes efpeces qu’elles ont
dépofées , en fe féchant ou en formant des marais.
On croit auffi qu’avec le tems, ces differentes matières
fe font durcies en differens lits de pierre, de charbon
, d’argile , de fable , Sc.
Le dr. Woodward a examiné avec beaucoup d’attention
ces differens lits, leur ordre , leur nombre ,
leur fituation par rapport à l’horifon, leur épaiffeur ,
leurs interférions , leurs fentes, leur couleur, leur
confiftence, Sc. Sc il a attribué l’origine de leur formation
au grand déluge. Il fuppofe que dans cette
terrible révolution , les corps terreftres furent dif-
fous Sc fe confondirent avec les eaux, & qu’ils y
furent foutenus de façon à ne former avec elles qu’une
maffe commune. Cette maffe des particules terreftres
ayant donc été mêlée avec l’eau, fe précipita
enfuite au fond, félon cet auteur, Sc cela fuivant les
lois de la gravité, les parties plus pefantes s’enfonçant
les premières, puis de plus légères , Sc ainfi de
fuite. Il ajoute que les differens lits dont la terre eft
compofée fe formèrent par ce moyen , Sc qu’ayant
acquis peu-à-peu de la folidité Sc de la durete, ils ont
fubfifté depuis en cet état. Il prétend enfin, que ces
fédimens ont été parallèles, puis concentriques, Sc
que la furface de la terre qui en étoit formée étoit
parfaitement unie & régulière, mais que les trem-
blemens de terre , les éruptions des volcans, Sc. y
ayant produit peü-à-peu divers changemens, l ’ordre
Sc la régularité des couches fe font altérées ; de forte
que la furface de la terre a pris la forme irrégulière
que nous lui voyons à préfent. Tout cela, comme
l’on vo it, eft purement hypothétique Sc conjectural.-
Voyt{ à ce fujet, le premier article de VhiJK nat. de
M. de Buffon.
T erre , en AJlronomie ; c’eft, fuivant le fyftème
de Copernic, Pune des planètes qu’on appelle premières.
Voici le caraétere par laquelle on la défigne <*>•
Foye{ PLANETE.
Dans l’hypothèfe.de Ptolomée, la terre eft le centre
du fyftème. Voyt{ Sy s t èm e .
Le grand point qui diftingue le fyftème de Ptolomée
& celui de Copernic, c’eft que le premier de
ces auteurs fuppofe la terre en repos, & que l’autre
la fait mouvoir ; c ’eft-à-dire que l’un la met dans le
centre, Sc fait tourner autour d’elle de l’orient à l’occident
le foleil, les cieux & les étoiles ; au lieu que
l’autre , fuppofant les cieux Sc les étoiles, en repos ,
fait mouvoir la terre de l’occident à l’orient. Voye£
SYSTEME DE COPERNIC 6* DE PTOLOMÉE.
L’induftrie des Aftronomes de notre ficelé a mis
bors de doute le mouvement ae la terre. Gopermc,
Ôaffendi, Kepler , Hoock, Flamfteed , &ç. fe font
fiirtoùt fait par là une réputation à jamais durable.
Il eft vrai, que d’anciens philofôphes ont foutenù
ce mênie mouvement: Cicéron dit dans fes qùeftions
tufculanes, que Nicetas de Sÿracufe avoit découvert
le premier, que la terre a un mouvement diurne, par
lequel èlîe tourne autour de fon axe dans l’efpace de
2,4 heures ; & Plutarque deplacit. philojopk. nous apprend
, que Philolaiis avoit découvert fon mouvement
annuel autour du foleil. Environ cent ans après
Philolaiis* Ariftafque de Samos foutint le mouvement
<le la terre, én termes encore plus clairs & plus forts,
fuivant que nous l’apprend Archimede dans fon traité
de numéro drence.
Mais les dogmes trop rèfpeétés de la religion
payenne , empêchèrent qu’on ne fuivît davantage
ces idées ; car Cleanthes ayant accufé Ariftarque de
facrilegè, pour vouloir faire mouvoir de fa place là
déeffe Vefta Sc lés autres divinités tutélaires de l’univers
, les philofophés commencèrent alors à abandonner
un fentiment qui paroiffoit fi dangereux;
Plufie'ursfiècles après, Nicolas de Coefa, cardinal
fit revivre cét ancien fyftème ; mais ce fentiment né
fut pas fort en vôgùé jufqu’à Copernic, qui démon-
ira lés grands üfàges & fés avantagés dans l’Aftrono-
mie. il eut bientôt pour lui tous ceux qui oferent
fe dépouiller d’un préjugé vulgaire & qui ne furent
point effrayés de cenfures injuftés. Auffi Kepler fon
contemporain n’héfite-t-il pas dé dire bUvertèment :
Uodierno tempôfê prcejlanti([imi quiqUé philofophorüm
6* àfirohomorum Copernico àdflipülàntur : f ‘.cia ejl hixe
glacies ; vincimus fujfragiis tnelioribus : coeteris périt J'ola
objlat fuperjlitià aut met us d Cleantibus.
LèS àrgûmens qu’on a allégués contre lè mouvement
de la terre, font foibles ou frivoles. On ôb-
jeéte:
i ° . Que la terre eft fin corps pefant & par confé-
^ûent, àjôute-t-on, peu propre au mouvement.
20. Que fi la terre tourne autour de fon axe eh
Vihgt-quatre heiires, ce mouvement devroit ren-
V'erfër nos ihâifôns * nos bâtimens, &c.
3 °. Que les corps ne tombèroieht pas précifément
fur lés endroits qui foht au-déffoüs d’eux lorfqü’on
les laiffe échapper. Unebâllé, par exemple, qii’on
laifferoit tomber perpendiculairement à terre, tomberait
én arriéré de l’endroit fur lequel elle auroii
été avant que de. tomber;
40. Que ce fentimeht eft contraire à l’Ecrituré.
'5°. Qu’il contredit nos fens qui noüs repréfèn-
tèht là terre eh repos, & le foleil eh mouvement.
Les preuves qu’on donne du mouvement de là
terre font d’une efpece bien différente , & portent à
l’efprit une évidehee à laquelle bn ne fauroit fe re-
ïufer ; 'ce qui vient de ce qu’elles font tirées des ob-
fervatiohs & des phéhômehèS adiiels & non des
raifohnemens vagués ; les voifci en racourci : oh y
trouverâ la réponfe à celles dès obje'âions précédentes
qui foht les moins déraifonnables;
1®. Le foleil doit également paroître én mouVe-
merit, & la terre eh répos à ün ipeélateUr placé fur
la terre, foit qüe le foleil fe meüve, & que la terre
foit en repos , foit qu’au contraire, ce foit le foleil
qui refte en repos & ‘la terre qui fe meuve. Car fup-
pofbns là terre en T (PL. d'Jflràn.fig. iS.) & le fb-
leil efl I. Le foleil paroîtra alors en Y ; & fiippofarit
que lé foleil fe meuve dans une orbite qui entoure
la terre de 1 en 2, il paroîtra enfuite en V ; & s’il
continue à aller én 3 , il paroîtra en xc , de forte
qu’il femblera toujours fe mouvoir dans l’écliptiqüé,
fuivant l’ordre des fignes.
Suppofons maintenant la terre en 1 & le foleil
en T. Le foleil fera v u , ou paroîtra alors en sû* ; que
la terre avance de i à 2; Sc le foleil paroîtra alors
aux habitàns de la terre avoir avancé de ^ en nj., 6c
^ la terre parvient en 3 , lé foleil paroîtra s’êtré
avancé, de ni jufqu’en -b - , & ainfi de fuite * fuivant
l’ordre des fignes de l’écliptique.
Le foleil paroîtra don'c toujours également fe mouvoir
, foit qu’il fe meuvé réellement où qu’il foit
en repos, & ainfi on ne doit faire aucun cas de l’ob-
jeûion qù’on tiré des appàrënces fenfibles; Voye^
V ision.
2°. Si l ’on fuppofe qu’une des planètes fé ifoit
mue d’une certaine quantité.de l’occident à l’orient,
le folé il, la terre & les autres planètes , doivent .pa-
roîtré aux haBitanS de cette première planete s’etre
mue d’uné mêmè quantité en fens contraire. Car
imaginons une étoile Af, (fig. 55.) dans le zénith
d’un habitant d’une planète placé en T, & fuppofant
que la planète ait tourne fur fon axe dé l’occident
a l’orient, lè foleil paroîtra après un certain
efpace de tems être arrive au zénith de T, puis l’étoile
I paroîtra y être arrivée à fon tour, puis N 9
puis la planete Z , puis enfin l’étoile M , le foleil S9
la planete L , & les étoiles j M N , paroîtront donc
s’être mis éh fens contraire àütbur dé la planete.
S’il ÿ avoit donc des habitans dans les planètes, la
fphere du monde, le foleil * les étoiles Si les autres
planètes devroient leur paroître fe mouvoir autour
d’eux de l’orient à l’occident. Or les habitans de notre
plânetè * è’èft-à-dire, de là terre, font fujéts aux
mêmes illufions que les autrès.
3°. Les orbites dé toutes lés planètès renferment
le foleil comme leur céntre commun. Mais il n’y a
quëles orbites des planetés fupériéures qui renferment
là terre, laquelle n’eft cependant placée aù centre
d’aucune de ces orbites, fuivant que nous l’avons
fait voir dans les articles Soleil & Planete.
40. Comme il eft prouvé qué l’orbite de la terre
eft fituée entre celle dé Vénus & celle de Mars, il
s’enfuit de-là que la terre doit tourner autour du
foléil ; çàr pùifqu’elle eft renfermée dans lés orbites!
des plahetes fupérieùres, leur mouvement pourroit
à la vérité lui paroître inégal & irrégulier fans cette
fùppofitiph ; niais au-moins fans cela elles ne pour-
roieiit lui paroître ftationnaires rii rétrogrades.
50. Les orbités & les périodes des differentes planètes
autour du foleil, de la liihe autour dé la terre ,
des fâtellites de Jupiter Si de Saturne autour de ces
deux plahetes , prouvent qùë la loi dé la gravitation
fur la terre, fur Jupiter & fur Saturne , eft
la même qüe fur lè foléil, & que les tems périodiques
des differens corps qui fé meuvent autour dë
chacûné dé cés planètes, font dans uné certaine proportion
avec léurs diftânees refpéâives. Fdye[ PÉ-
feiôDE & D istance;
Or il eft certain que dans la fuppolitiori du mouvement
annuel de la terre , fon tems périodique fé
trbuveroit fuivré éxaftëment cette loi ; enforte qu’il
y âùrôit entre fon tems périodique & lès tems
périodiques de Mars & de V énus, le rapport qui
régné-entre les tems périodiques des autres planètes
; c’ëft-à-dire, le rapport qui régné entré les racines
qüarré'es des cubes des diftances de ces planètes
au foléil ; àü-lieü qu’on S’écarte prodigieufe-
ment dë cèttë lo i, fi bn luppofe que ce fbit le foleil
qui tourné autoür dé la terre. En éffet * fi la terre hé
tourne pas autour du foleil, le foléil tournera donc,
ainfi que la lune, autour de la terre. Or le rapport
des diftances du foleil & de la lune à là terre eft
de 22QQÖ à 57; & là période de là lune eft d’ailleurs
moindre qüë de vingt-huit jours, il faudroit donc
(pour que la prôportibii des tems périodiques eût
lieu) qüe là révolution du foleil ne fé fit qu’eri
plus de quarante-deux ans, àu-lieu qu’elle n’eft que
d’une année. Cette réflexibn feule a paru à M. Whi-
ftoh d’affez grand poids pour terminer la difpute