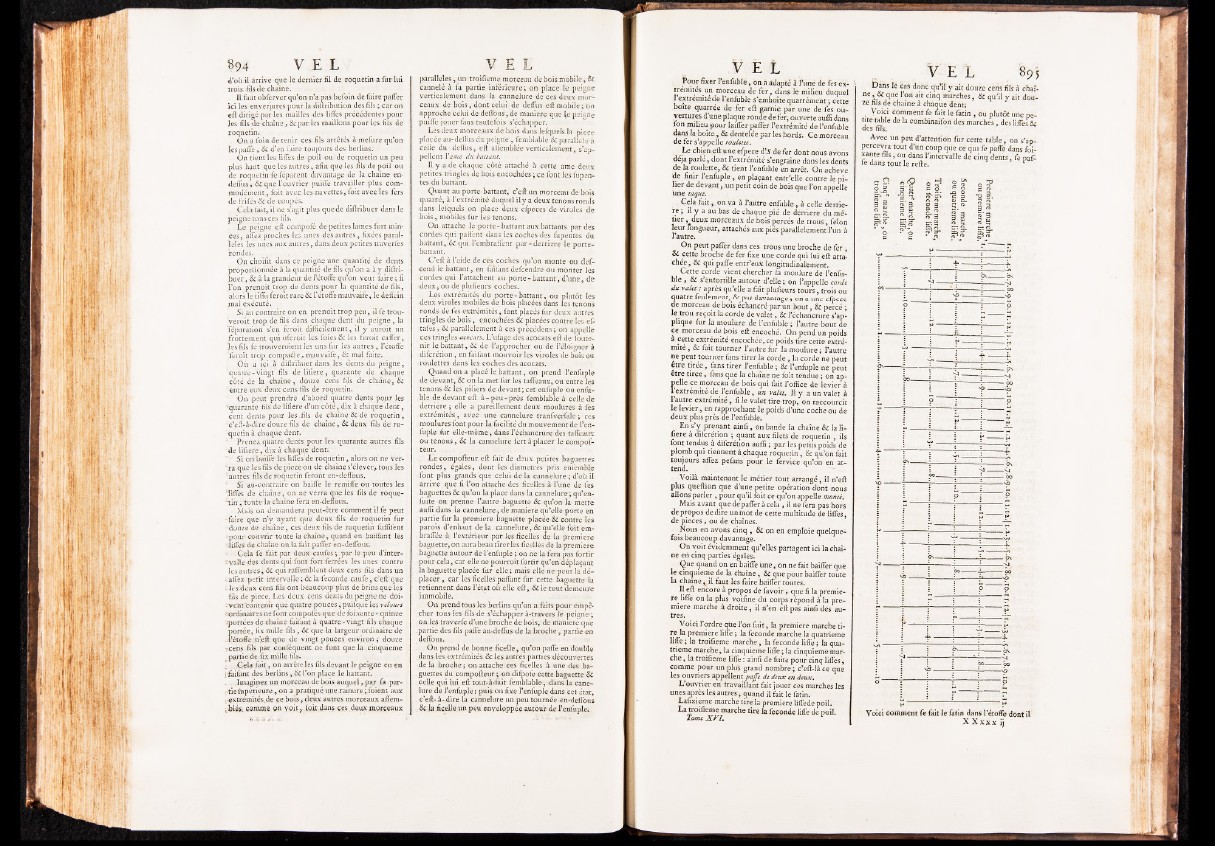
d’où il arrive que le dernier fil de rôquetiii a fur lui
trois fils de chaîne.
Il faut obferver qu’on n’a.pas befoin de faire palier
ici les envergures pour la diftribution des fils ; car on
eft dirigé par les mailles des liffes précédentes pour
les fils-clé chaîne ,& par les maillons pour les fils de
xoquetinv
On a foin de tenir ces fils arrêtés, à mefure qu’on
les paffe, & d’en faire toujours des berlins.
On tient les liffes de poil ou de roquetin un peu
plus haut .que les autres, afin que les fus de poil ou
de roquetin fe féparent davantage de la chaîne en-
deffus, & que l’ouvrier puiflè travailler plus commodément,
foit avec,leanavettes, foit avec les fers
de frifés & de coupés.
Cela fait, il ne s’agit plus que de diftribuer dans le
peigne tous ces fils.
Le peigne eft compofé de petites lames fort minces,
affez proches les unes des autres, fixées parallèles
les unes aux autres, dans,deux petites traverfes
rondes.
On choifit dans ce peigne une quantité de dents
proportionnée à la quantité de fils qu’on a à y diftri-
buer, & à la grandeur de l’étoffe qu’on veut faire ; fi
l ’on prenoit trop de dents pour la quantité de fils,
alors le tiffu feroit rare & l’étoffe mauvaife, le deffein
mal exécuté,, •
Si au contraire on en prenoit trop peu, il fe trou-
Verôit trop de fils dans chaque dent du peigne, la
Téparation . s’ep feroit difficilement , il y auroit un
frottement qui uferoit les foies & les feroit caffer,
les fils fe trouveroient les uns fur les autres , l’étoffe
"feroit trop compare, mauvaife, & mal faite.
On à ici à diftribuer dans.les dents du peigne,
"quatre-vingt- fils de lifiere, quarante de chaque
côté de la chaîne, douze" cens fils de chaîne, &c
entre eux deux; cens fils de roquetin.
On peut prendre d’abord quatre dents pour les
■ quarante fils de lifiere d’un coté, dix à chaque dent,
cent dents pour les .fils de chaîne & d e roquetin ,
x ’eft-à-dire douze fils de chaîne, 5c deux fils de ro-
quéfirn à chaque dent»
‘ Prenez.qùatre dents pour les quarante autres fils
'de lifiere, dix à chaque dent:
" ^ Si On baiffe les liffes de roquetin, alors on ne verra
que les fils de piece ou de chaîne s’élever, tous les
■ autres fils de roquetin feront en-deflbus.
■ Si au-contraire on baiffe le remifle ou toutes les
liffes de chaîne, on ne verra que les fils de roque-
îtih , 'toute la chaîne fera en-deffous.
Mais on demandera peut-être comment il fe peut
- faire que' n’ÿ ayant que deux fils de roquetin fur
"douze de chaîne, ces deux fils de roquetin luffifent
-pour coüvri-r-toutela chaîne, quand en baiffant les
-liffes déchaîné on la fait paffer en-deffous.
i .. Gela fe fait par deux* çaufes ; par le peu d’inter-
s-valle .des dents qui font fort ferrées les unes contre
les autres-; 5c qui raffemblent deux cens fils dans un
*affez petit intervalle ;Ôc la fécondé caufe, c’eft que
4 les-deux cens fils ont beaucoup plus de brins que les
fils de piece. Les deux cens dents du peigne ne doi-
-veritTCoritenir que quatre pouces, puifque 1 &s velours
^ordinaiares ne font compofés que de foixante- quinze
^portées de chaîne faifant à quatre-vingt fils chaque
portée, lix mille fils, 5c que la largeur ordinaire de
-l’étoffe n’eft qûe ; de vingt pouces environ ; douze
Tçens;fils par conséquent ne font que la cinquième
partie de fix mille fils.
^ .G.èla fait., on arrête les fils devant le peigne en en
jfaifant des berlins, ôc l’on place le battant.
. . Imaginez un morceau de bpis auquel, par fa par-
;-tie fupérieure, on a pratiqué une rainure ;,foient aux
•.-cxtrémités.de çe bois, deux autres morceaux affem-
; b léj. comme on yo it? foit dans ces deux morceaux
parallèles,.un troifieme morceau de bois mobile, &
cannelé, à fa partie inférieure ; on place le peigne
verticalement dans la cannelure de ces deux morceaux
de bois, dont celui de deffus eft mobile ; 'on
approche celui de deffous, de maniéré que Je peigne
puiffe jouer fans toutefois' s’échapper.
Les deux morceaux de. bois dans lefquels la pieçe
placée au-deflus du peigne , femblable ôc parallèle à
celle du deffus, eft alièmblée verticalement, s’appellent
l’ame du battant.
Il y a de chaque côté attaché à cette ame deux
petites tringles de bois encochées ; ce font les fupen-
tes du battant.
Quant au porte-battant, c’eft un morceau de bois
quarré, à l’extrémité duquel il y a deux tenons ronds
dans lefquels on place deux efpeces de viroles de
bois, mobiles fur les tenons. .
On attache le porte-battant aux battants par des
cordes qui paflént dans les coches des fupentes du
battant,.& qui l’embraffent par- derrière le porte-
battant.
C’eft à l’aide de ces coches qu’on monte ou def-
cend le battant, en failant defeendre ou monter les
cordes qui l’attachent au porte - battant, d’une, de
deux,ou de plufieurs coches.
Les extrémités du porte-battant, ou plutôt les
deux viroles mobiles de bois placées dans les tenons
ronds de fes extrémités, font placés fur deux autres
tringles de bois, encochées 5c placées contre les ef-
tafes, ôc parallèlement à ces précédons ; on appelle
ces tringles acocats. L’ufage des acocats eft de foute-
nir le battant, ôc de l’approcher ou de l’éloigner à
.diferétion, en faifant mouvoir les viroles de bois ou
roulettes dans les coches des acocats.
Quand on a placé le battant, on prend l’enfuple
de devant, Sc on la met fur les tuffeaux, ou entre les
tenons ôc les piliers de devant; cet enfuple ou enfu-
ble.d? devant eft. à--peu-près femblable à celle de
derrière ; elle a pareillement deux moulures à fes
-extrémités , avec une cannelure tranfverfale ; ces
moulures font pour la facilité du mouvement de l’eri-
fuple fur elle-même, dans l’échancrure des taffeaux
pu tenons, 5c la cannelure fert à placer le composteur.
,
Le compôfteur eft fait de deux petites baguettes
rondes, égales, dont les diamètres pris eniemble
font plus grands que celui de la cannelure ; d’oîi il
arrive que fi l’on attache des ficelles à l’une de fes
baguettes ôc qu’on la place dans la cannelure ; qu’en-
fuite on prenne l’autre baguette ôc qu’on la mette
auffi dans la cannelure, de maniéré qu’elle porte eh
partie fur la première baguette placée ôc contre les
parois d’enhaut delà cannelure, & qu’elle foit em-
bràffée à; l’extérieur par. les ficelles de la première-
baguette, on aura beau tirer les ficelles de lapremiere
baguette autour de l’enfuple ;on nela fera pas fortir
pour cela, car elle ne pourroit fortir qu’en déplaçant
la baguette placée fur elle ; mais elle ne peut la déplacer
j car les ficelles paffant fur cette baguette la
retiennent dans l’état.oiLelle eft, ôc le tout demeure
immobile.
On prend tous les berlins qu’on a faits pour empêcher
tous les fils de s’échapper à-tràvers lé peigne*;
on les traverfe d’une broche de bois, de manière que
.partie des fils paffe au-deffus de la broche, partie en
deffous.
On prend de bonne ficelle, qu’on paffe en double
dans les extrémités ôc les autres parties découvertes
de la broche ; on attache ces ficelles à une des baguettes
du compofteur ; on difpofe cette baguette ôc
celle qui lui eft tout-à-fait femblable,. dans la cane-
lure de l’enfuple : puis on fixe l’enfuple dans cet état,
c’eft- à-dire la cannelure un peu tournée en-deffous
.ôc la ficelle un,peu enveloppée autour de l’enfuple*
Pour fixer l’enfuble, on à adapté â l ’une de fes extrémités
un morceau de fe r , dans'le milieu duquel
1 extrémité de l’enfuble s’emhoîte quarrémeht ; cette
boîte quarrée .de fer eft garnie par une de fes ouvertures
d’une plaque ronde de fer* ouverte auffi dans
fon milieu pour laiffer paffer l’extrémité de l’enfuble
dans la boîte % ôc dentelée par les bords. Ce. morceau
de fer s’appelle roulette.
Le ch-i^n eft une efpece d’i 1 de fer dont nous avons
déjà parle, dont l’extremité s’engraine dans les dent-s
de la roulette, ôc tient l’ènfuble en arrêt. On achevé
de finir 1 enfuple,, en plaçant entr’elle contre le pilier
de devant, uh petit coin de bois que l’on appelle
une taque.
Cela fait, on va à l’autre enfuble, à celle derrie-
re ; il y a au bas de chaque pié de dérriere du mé-
tier , deu-x morceaux de bois percés de trous, félon
leur longueur, attaches aux pies parallèlement i’un à
l’autre.
On peut paffer dans ces trous une broche de fer ;
& cette broche de fer fixe une corde qui lui eft attachée
, & qui paffe entr’eux longitudinalement.
Cette corde vient chercher la moulure de l’enfu-
ble , & s entortille autour d’elle ; on l’appelle corde
du valet : apres qu’elle a fait plufieurs fours, trois ou
quatre feulement, & pas davantage ; on a une efpece
de morceau dé bois échancré par un bout, &; percé ;
le^trou reçoit la corde de valet, & l’échancrure s’applique
fur la moulure de i’enfuble ; l’autre bout de
ce morceau de bois eft encoché. On pend un poids
^ extrémité encochee, ce poids tire cette extrémité
y & fait tourner l’autre fur la moulure ; l’autre
ne peut tourner fans tirer la corde, la corde ne peut
etre tirée, fans tirer l’enfuble ; & l’enfuple ne peut
etre tiree, fans que la chaîne ne foit tendue ; on appelle
ce morceau de bois qui fait l’office de levier à
l’extrémité de l’enfuble, un valet. Il y a un valet à
1 autre extrémité, fi le valet tire trop, on raccourcit
le levier, en rapprochant le poids d’une coche ôu de
deux plus près de l’enfuble.
En s’y prenant ainfi, on bande la chaîne & la lifiere
à diferétion ; quant aux filets de roquetin , ils
font tendus à diferétion auffi ; .par les petits poids de
plomb qui tiennent à,chaque roquetin, & qu’on fait
toujours affez pefans pour le fervice qu’on en attend.
Voilà maintenant lé inétier tout arrangé, il n’eft
plus queftion que d’une petite opération dont nous
allons parler, pour qu’il foit ce qu’on appelle monté.
Mais avant que de paffer à cela * il ne fera pas hors
de propos de dire un mot de cette multitude de liffes,
de pièces, ou de chaînes.
Nous en avons cinq , & on eh emploie quelquefois
beaucoup davantage.
On voit évidemment qu’ elles partagent ici la chaîne
en cinq parties égales:
Que quand on en baiffe une ; on ne Fait baiffer que
le cinquième de la chaîne, & que pour baiffer toute
la chaîne ^ il faut les faire baiffer toutes.
Il eft encore a propos de favoif ; que fi la premie-
re_ lifté ou la plus voifine du corps répond à la première
marche à droite ; il fi’en eft pas ainfi dés autres.
Voici l’ordre qùe l’on fuit, la première marche ti-
ye la première liffe ; la fécondé marche la quatrième
liffe ; la troifieme marche, la fécondé lifté ; la quatrième
marche, là cinquième liffe ; la cinquième marche
, la troifieme liffe : ainfi de fuite pour cinq liffes $
comme poiir un plu$ grand nombre ; c’ eft-là ce que
les ouvriers appellent pajje de deux en deux.
L ouvrier en travaillant fait jouer ces marches les
unes après les autres, quand il fait le fatin.
Lafixieme marche tire la première liffede poil.
La ùroifteme marche tire la féconde liffe de poil.
Tome X F L
Dans le cas donc qu’il y ait douze cens fils à chaî-
n e , & que l’on ait cinq marches, & qu’il y ait douze
fils de Chaîne à chaque dérit;
. Y°ici Comment fe fait le fatin , ou plutôt une petite
table de la combinaifon des marches, des liffes 5c
des fils.
Avec un peu d’attentioh fur cette table, on s’ap-
percevra tout d’un coup que ce qui fe paffe dans foixante
fils, ou dans l’intervalle de cinq dents, fë pa£
fe dans tout le refte. r
Voici comment fe fait le fatin dans l’étoffe dont il
X X x x x ij