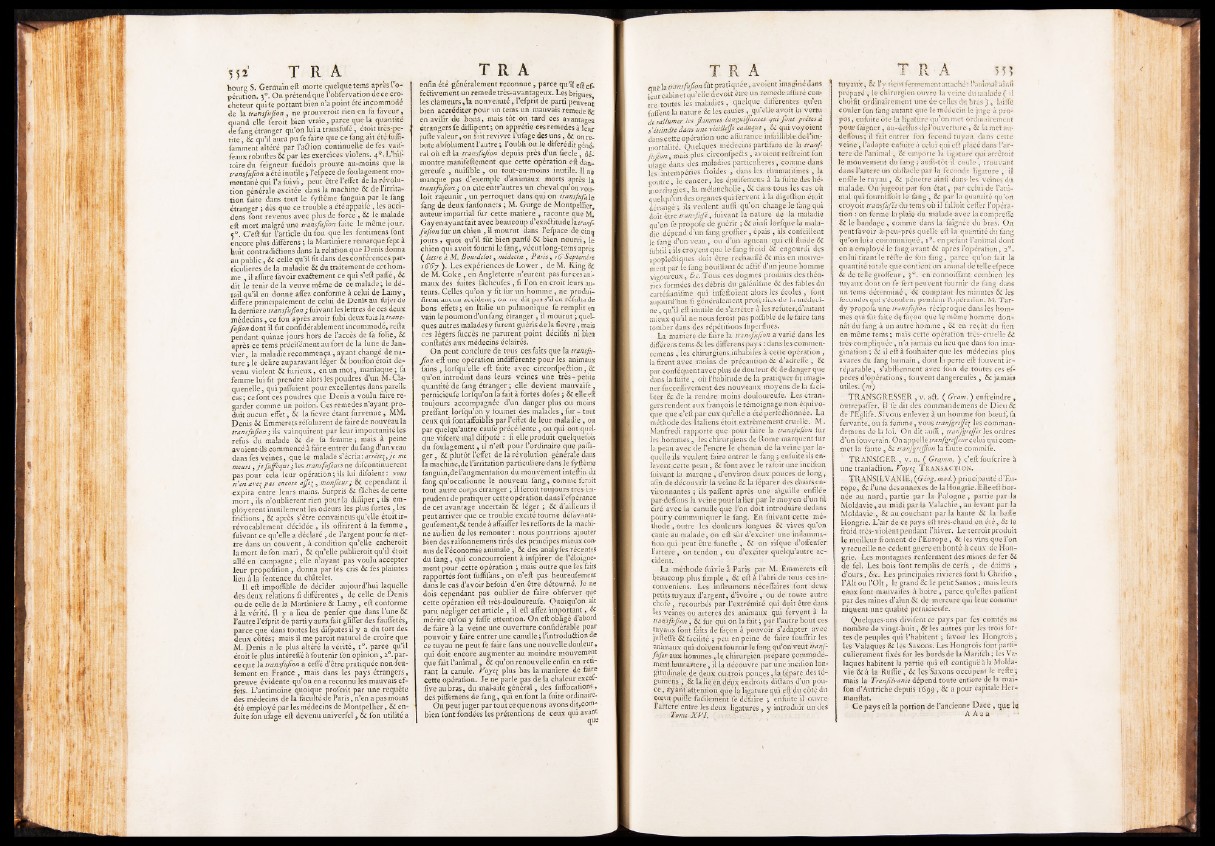
bourg S. Germain eft morte quelque tems après l'opération.
30. On prétend que l’obfervation de ce cro-
cheteur qui le portant bien n’a point été incommode
de la transfujîon , ne prouveroit rien en fa faveur,
quand elle feroit bien vraie, parce que la quantité
de fong étranger qu’on lui a transfufe, etoit tres-pe-
t ite , 8c qu’il aura pu fe faire que ce fang ait été fuffi-
fomment altéré par l’aûion continuelle de fes vaif-
feaux robuftes 8c par les exercices violens. 4°. L’hii-
toire du feigneur fuédois prouve au-moins que la
transfujîon a été inutile ; l’elpece de foulagement momentané
qui l’a fuivi, peut être l’effet de la révolution
générale excitée dans la machine & de 1 irritation
faite dans tout le fyftême fanguin par le fang
étranger ; dès que ce trouble a étéappaifé, les acci-
dens font revenus avec plus de force , 8c le malade
eft mort malgré une transfujîon faite le meme jour.
e°. C ’eft fur l’article du fou que lès fentimens font
encore plus différens ; la Martiniere remarque fept à
huit contradi&ions dans la relation que Denis donna
au public, 8c celle qu’il fit dans des conférences particulières
de la maladie 8c du traitement de cct homme
, il affure favoir exaftement ce qui s’eft paffé, 8c
dit le tenir de la veuve même de ce malade; le détail
qu’il en donne affez conforme à celui de Lamy,
différé principalement de celui de Denis au fujet de
la derniere transfujîon ; fuivant les lettres de ces deux
médecins, ce fou après avoir fubi deux fois la trans-
fufion dont il fut confidérablement incommodé, refta
pendant quinze jours hors de l’accès de la folie, 8c
après ce tems précifément au fort de la lune de Janvier,
la maladie recommença, ayant changé de nature
; le déliré auparavant léger 8c bouffon etoit devenu
violent 8c furieux, en un mot, maniaque ; fa
femme lui fit prendre alors les poudres d un M. Cla-
quenelle, qui paffoient pour excellentes dans pareils
cas; ce font ces poudres que Denis a voulu foire regarder
comme un poifon. Ces remedes n’ayant produit
aucun effet , & lafievre étant furvenue, MM.
Denis 8c Emmerets réfolurent de faire de nouveau la
transfujîon; ils vainquirent par leur importunité les
refus du malade 8c de fa femme ; mais à peine
avoient-ils commencé à foire entrer du fang d’un veau
dans fes veines, que le malade s’écria ’.arrête^ je me
meurs, je fujfoque; les transfufeurs ne difcontinuerent
pas pour cela leur opération ; ils lui difoient : vous
n'en ave^ pas encore ajfe^, monjieur; 8c cependant il
expira entre leurs mains,. Surpris Sc fâchés de cette
mort, ils n’oublierent rien pour la difliper ; ils employèrent
inutilement les odeurs les plus fortes, les
friûions , 8c après s’être convaincus qu’elle étoit irrévocablement
décidée , ils offrirent à la femme ,
fuivant ce qu’elle a déclaré, de l’argent pourfe mettre
dans un couvent, à condition qu’elle cacheroit
la mort de fon mari, 8c qu’elle publieroit qu’il étoit
allé en campagne ; elle n’ayant pas voulu accepter
leur propofition, donna par fes cris & fes plaintes
lieu à la fentence du châtelet.
Il eft impoflible de décider aujourd’hui laquelle
des deux relations fi différentes , de celle de Denis
ou de celle de la Martiniere & Lamy, eft conforme
à la vérité. Il y a lieu de penfer que dans l ’une 8c
l’autre l’efprit de parti y aura fait gliffer des fauffetés,
parce que dans toutes les difputes il y a du tort des
deux cotés ; mais il me paroit naturel de croire que
M. Denis a le plus altéré la vérité, i° . parce qu’il
étoit le plus intéreffé à foutenir fon opinion, ^ .pa rce
que la transfujîon a ceffé d’être pratiquée non-feulement
en France , mais dans les pays étrangers,
preuve évidente qu’on en a reconnu les mauvais effets.
L’antimoine quoique proferit par une requête
des médecins de la faculté de Paris, n’en a pas moins
été employé par les médecins de Montpellier, 8c en-
luite fon ufage eft devenu uniyerfel, Ôc fon utilité a
enfin été généralement reconnue, parce qu’il eft effectivement
un remede très-avantageux. Les brigues
les clameurs,la nouveauté, Pefprit de parti peuvent
bien accréditer pour un tems un mauvais remede &
en avilir de bons, mais tôt ou tard ces avantages
étrangers fe diffipent ; on apprétie ces remedes à-leur
jufte valeur, on fait revivre l’ufage des uns, 8c on rebute
abfolument l’autre ; l’oubli ou le diferédit général
où eft la transfujîon depuis près d’un fiecle, démontre
manifeftement que cette opération eft dan-
gereufe , nuifible , ou tout-au*moins inutile. Il ne
manque pas d’exemple d’animaux morts après la
transfujîon ; on cite entr’autres un cheval qu’on vou-
loit rajeunir , un perroquet dans qui on trans/ufa le
fang de deux fanfonnets ; M. Gurge de Montpellier,
auteur impartial fur cette matière , raconte que M.
Gayen ayant fait avec beaucoup d’exattitude latranf-
fujion fur un chien , il mourut dans l’efpace de cinq
jours , quoi qu’il fût bien panfé 8c bien nourri, le
chien qui avoit fourni le fang, vécut long-tems après
( Lettre à M. Bourde lot, médecin , Paris, iG Septembre
t66y ). Les expériences de Lover , de M. King &
de M. C oke , en Angleterre n’eurent pas fur ces animaux
des fuites fâcheufes , fi l’on en croit leurs auteurs.
Celles qu’on y fit fur un homme , ne produi-
firent aucun accident; on ne dit pas s’il en refultade
bons effets ; en Italie un pulmonique fe remplit en
vain le poumon d’un fang étranger , il mourut ; quelques
autres malades y furent guéris de la fievre, mais
ces légers fuccès ne parurent point décififs ni bien
conftatés aux médecins éclairés.
On peut conclure de tous ces faits que la transfujîon
eft une opération indifférente pour les animaux
foins , lorfqu’elle eft faite avec circonfpettion, 8c
qu’on introduit dans leurs veines une très - petite
quantité de fang étranger ; elle devient mauvaife ,
pernicieufe lorfqu’on la fait à fortes dofes ; 8c elle eft
toujours accompagnée d’un danger plus ou moins
preffant lorfqu’on y loumet des malades, fur - tout
ceux qui font affoiblis par l’effet de leur maladie , ou
par quelqu’autre caufe précédente , ou qui ont quel?
que vifeere mal dilpofé : fi elle produit quelquefois
du foulagement, il n’eft pour l’ordinaire que partager
, 8c plutôt l’effet de la révolution générale dans
la machine,de l’irritation particulière dans le fyftème
fanguin,de l’augmentation du mouvement inteftin du
fang qu’occafionne le nouveau fang, comme feroit
tout autre corps étranger ; il feroit toujours très imprudent
de pratiquer cette opération dansl’efpérance
de cet avantage incertain 8c léger ; 8c d’ailleurs il
peut arriver que ce trouble excité tourne défevanta-
geufement,8c tende à affaiffer les refforts de la machine
aû-lieu de les remonter : nous pourrions ajouter
bien des raifonnemens tirés des principes mieux connus
de l’économie animale, 8c des analyfes récentes
du fang , qui concourroient à infpirer de l’éloignement
pour cette opération ; mais outre que les fois
rapportés font fuffifans, on n’ eft pas heureufement
dans le cas d’avoir befoin d’en être détourné. Je ne
dois cependant pas oublier de faire obferver que
cette opération eft très-douloureufe. Quoiqu’on ait
paru négliger cet article , il eft affez important, 8c
mérite qu’on y foffe attention. On eft obligé d’abord
de foire à la veine une ouverture confidérable pour
pouvoir y faire entrer une canulle ; l’introduttion de
ce tuyau ne peut fe faire fans une nouvelle douleur,
qui doit encore augmenter au moindre mouvement
que fait l’animal, 8c qu’on renouvelle enfin en retirant
la canule. Voyt{ plus bas la maniéré de faire
cette opération. Je ne parle pas de la chaleur excel-
five au bras, du mal-aile général, des fuffocations >
des piffemens de fang, qui en font la fuite ordinaire.
On peut juger par tout ce que nous avons dit,combien
font fondées les prétentions de ceux qui avaot
que
crue la transfujîon & t pratiquée, avoient imagine dans j
leur cabinet qu’elle de voit être un remede alluré corn 1
tre toutes les maladies , quelque différentes qu’en
fuffent la nature 8c les caulès , qu’elle avoit la vertu
de rallumer. Us flammes Languijj antes, qui font prêtes à
s'éteindre dans unt vieilleffe caduque, 8c qui. vo-yoient
dans cette opération uneaffurance infaillible de l’im-
niortalité. Quelques médecins partâfons de la tranf-
fujion ,. mais plus circonfpetts, avoient reftreint fon
ufage dans des. maladies particulières, comme dans
les intempéries froides , dans. les. rhumatilrnes , la
„outre, le cancer, les épuifemens à la fuite des hémorrhagies,
la mélancholie, 8c dans tous les cas oh
quelqu’un des.organes quifervent à la digeftion étoit
dérangé ;. ils veulent aulfi qu’on change le fang qui
doit être transfufê, fuivant la nature de la maladie
qu’on fe propofe de guérir ; 8c ainfi lorfque la mala- •
die dépend d’un fang greffier , épais , ils confeillent
le fang d’un veau, ou d’un agneau qui eft fluide 8c
fubtil ; ils crôyent que le fang froid 8c engourdi des
apopleûiques. doit être rechauffé 8c mis en mouvement
par le fang bouillant 8c attif d’un jeune homme
vigoureux, &c. Tous ces dogmes produits des théories.
formées des débris du galénilme 8c des fables du
cartéfianifme qui infeftoieot alors les écoles , font
aujourd’hui fi généralement profçrites de la médecine
, qu’il eft inutile de: s’arrêter à les réfuter,.d’autant
mieux qu?il ne nous feroit pas poffible de le faire fans
tomber dans des répétitions fuperflues.
La maniéré de faire la transfujîon a varié dans les
différens tems 8c les. différens pays : dans les commen*
cemens , les chirurgiens, inhabiles à cette opération ,
la firent avec moins de précaution 8c d’adreffe , 8c
par conséquent avec plus de douleur 8c de danger que
dans.la fuite , où l’habitude de la pratiquer fit imaginer
fucceffivement des nouveaux moyensde la faciliter
& de la rendre moins douloureufe. Les étrangers
rendent aux françois le témoignage non équiv-o?
que que c ’eft par eux qu’elle a été perfettionnée. La
méthode des italiens, étoit. extrême ment cruelle. M .
Manfredi rapporté que pour faire la transfusion fur
les hommes, les chirurgiens de Rome marquent lur
la peau avec de l’encre le chemin de la veine par laquelle
ils veulent foire entrer le fang ; enfuite ils en-
levent.cette p,eau, 8c font avec le rafoir une incifion
fuivant la marque , d’environ deux pouces de long,
afin de découvrir la veine 8c la féparer des chairs en-
Yiroonantes ; ils paffent après une aiguille enfilée
par-deffo.us la veine pour la fier par le moyen d’un fil
ciré avec la canulle que l’on doit introduire dedans
poury communiquer Le fang. En fuivant cette méthode
, outre les douleurs longues & vives, qu^on
çaulè au malade, on eft sûr d’exciter une inflammation
qui peut être funefte , 8c oji rifque d’offenfer
l’artere, on tendon , ou d’exçiter quelqu’autre accident.
La méthode fuivie â Paris par M. Emmerets eft
beaucoup plus fimple , 8c eft à l’abri de tous ces in-
conveniens. Les inftmmens néceffaires font deux
petits tuyaux d’argent, d’ivoire , ou de toute autre
chofe , recourbés par d’extrémité qui doit être dans
les veines, ou arteres des. animaux qui fervent à la
tràhsfujioji, 8ç fur qui on la fait ; par l’autrç bout ces
tuyaux font faits de façon à pouvoir s’adapter avec
juftéflè 8c facilité ; peu en peine de faire fouffrir les
animaux qui doivent fournir le fang qu’on veiit tranf
fuftr aux hommes ,1e chirurgien prépare çommédé-
ment.leuicartere, il la découvre par une incifion longitudinale
de deux .quitrois pouces, la.fépai'.e.des te-
guhvénsI 8C la fie e'n deux endroits diftans d’un pouce
, âyânt'attentiôn que la ligature qui eft du côté du
Ç^UrP^iï^ë- focilémeht le 'défaire ; enfuite il ou vre-
Farteré entre les deux ligatures , y introduit un des
Tome.XVI.
tuyaux^ 8c IV tient fermement attache! t’animai ainfi
préparé , le chirurgien ouvre la veine dit malade ( il
choifit ordinairement une de celles du bras ) , laiffe
couler fon i'ang-autant que le médecin le juge à propos,
enfuite ôte la ligature qu’on met ordinairement
pour foigner, au-deffiis de l’ouverture , & la met au*
défions; il fait entrer fori fécond tuyau dans Cette
veine, l’adapte enfiûte à celui qui eft placé dans l’ar-
tere de l’animal , 8c emporte ta ligature qui arrêtoif
le mouvement- du fang ;-’au{fi-tôt il coule , trouvant
dans l’aftere un obftaele par la fécondé ligature , il
enfile le tuyau , 8c pénet-re ainfi dans les veines du
malade. On-jugèoit par fon état, par celui de l’animal
qui fournifl'bit le fang , 8c par la quantité qu’on
croyoit 'transfufée du tems où il folloit ceffer l’opération
: on ferme la plaie du malade avec la compreffe
8c le bandage , comme dans la faignée du bras. On
peut favori- à-peu-près quelle eft la quantité du fang
qn’on lui a communiqué, 1 °. en pefont l’animal dont
on a employé le fang avant- 8c après l’opération, 20.
enlui tirant le rèfte de fon fong, parce qu’on,fait la
quantité totale que contient un animal de telle efpece
& de telle groffeur, Sw en connoiffant combien les
tuyaux dont on fe fért peuvent fournir de fong dans
un tems déterminé , & comptant les minutes 8c les
fécondés qui s’écoulent pendant- l’opérat-ion. M. Tar-
dy propofo une transfujîon réciproque dans les hommes
qui fut faite de façon que le même homme don?
nât du fang à un autre homme , 8c en reçût- du fien
en même tems ; niais cette opération très-cruelle 8c
très-compliquée , n’a jamais eu lieu que dans fon imagination
; 8c il eft à fouhaiter que les médecins plus
avares du fong humain, dont la perte eft fouvent irréparable
, s’abftienflent- avec foin de toutes ces ef-
peces d’opérations ; fou vent dangereufes , 8c jamais
utiles, "(m)
TRANSGRESSER , v. a£f. ( Gram. ) enfreindre ,
ôutrepaffèr. Il fe dit des commandemens de Dieu 8C
de l’Eglifë. Si vous enlevez à un homme fon boeuf, fa
fervante, ou fa femme, vous, tranfgrejje{ les commandemens
de la loi. On dit aulfi , tranj'grejfer les ordres
d’un fouverain. Oh appelle tranfgrejfeur celui qui commet
la faute , 8c tranjgrejjîon la foute commife.
TRANSIGER , y. n. ( Gramm, ) ç’eft foufçrire à
une tranfacHon. Voye^ T ransact ion.
TR.ANSI'LVANIE, JQéog, moi.) principauté d’Europe,.
8c l’une des annexes de la Hongrie. Elle eft bor-
née au nord, partie par la Pologne , partie par la
Moldavie, au midi par la Valachie, au levant par la
Moldavie , 8c au couchant par la haute 8c la: baflè
Hongrie. L’air de ce pays eft très-chaud en é tç, 8c le
froid trèsTviolent pendant l’hiver. Le terroir produit
le meilleur froment de l’Europe , 8t les vins que l’on
y recueille ne cedent güere en bonté à ceux de Hongrie.
L.es. montagnes renferment des mines de fer 8c
de fol. Les. bais font remplis de cerfs, , de daims >
d’p.urs., fie. Les principales rivières font la Chrifio ,
l’Alt ou l’OIt, le grand 8c le petit Samos.;.mais leurs
eaux font maùvailès à boire , parce qu’elles paffent
par des, mines d’alun 8c de mercure qui leur communiquant
une qualité pernicieufe.
Quelques-uns divifentee pays par fes comtés au
nombre de vingt-huit, 8c les autres par les trois fortes
de peuples qui l’habitent ; favoir les Hongrois
• les Valàqties & lès Saxons. Les Hongrois font particulièrement
fixés fur les bords de la Marifch ; les Va?
laques habitent la partie qui eft contiguë à la Molda-
I vie 8c à la Rufîie , 8c les Saxons occupent le refte ;
mais la Tranfîlvanu dépend toute entière de la mai-
• fon d’Autriche depuis 16 9 9 ,8c a pour capitale Her-;
| manftat.
Ce pays eft la portion de l’ancienne D a c e , que iq
A A a a