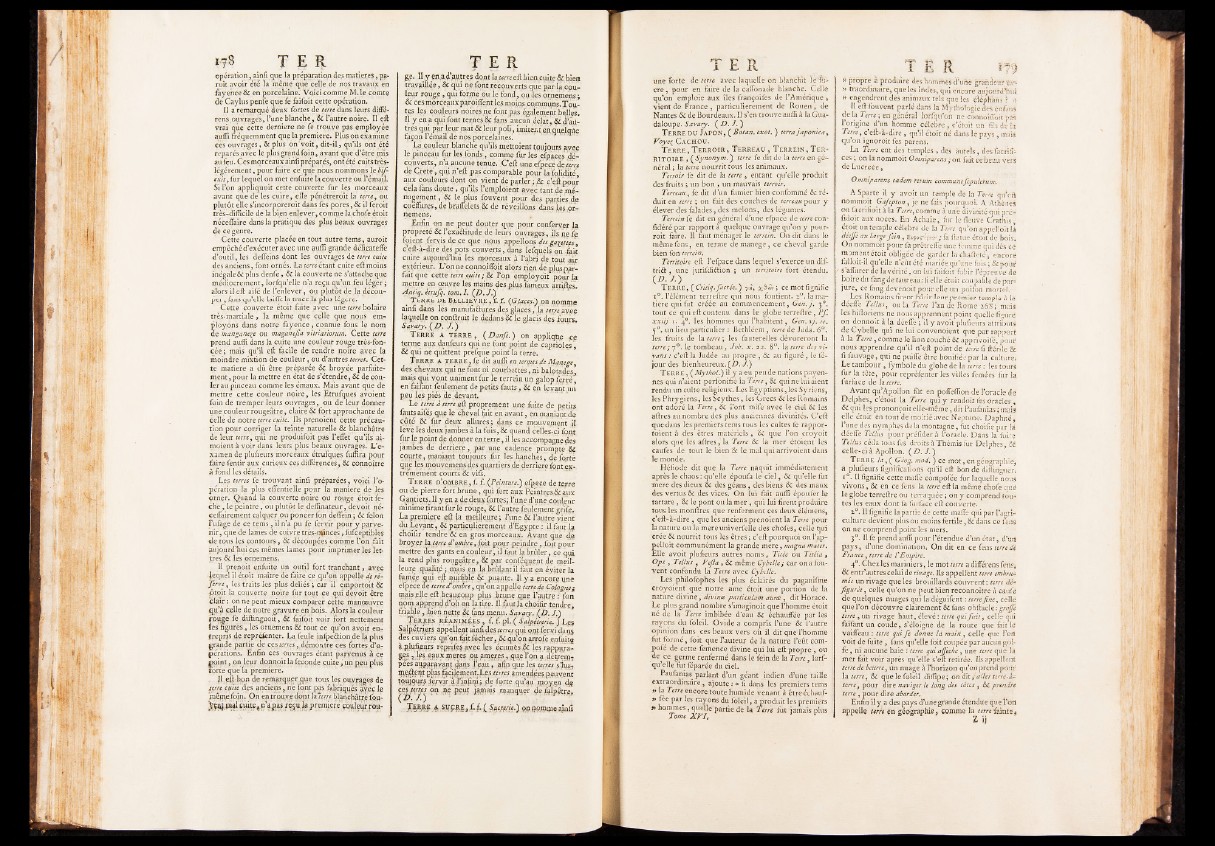
opération, ainfi que la préparation des matier.es, p£-
roît avoir été la même que celle de nos travaux en
rayence & en porcelaine. Voici comme M.^e comte
de Caylus penfe que Te faifoit cette opération.
Il a remarqué deux fortes de terre dans leurs diffère
ns ouvrages, l’une blanche, 6c l’autre noire. Il eft
vrai que cette derniere ne (è trouve pas employée
auffi fréquemment que la première. Plus on examine
ces ouvrages, & plus on'voit, dit-il> qu’ils ont été
réparés avec le plus grand foin, avant que d’être mis
aufeu. Ces morceaux ainfipréparés, ont été cuits très-
légérement, pour faire ce que nous nommons Igbif-
cuit, fur lequel on met enfuite la couverte ou l ’émail.
Si l’on appliquoit cette couverte fur le.s morceaux
avant que de les cuire, elle pénétreroit la terre, ou
plutôt elle s’incorporeroit dans les pores, & il feroit
très-difficile de la bien enlever, comme la choie étoit
néceffaire dans la pratique des plus beaux ouvrages
de ce’genre.
Cette couverte placée en tout autre tems, auroit
empêché d’exécuter avec une auffi grande délicateffe
d’outil, les deffeins dont les ouvrages de terre cuite
des anciens, font ornés. La terre étant cuite eft moins
inègale&plus denfe, & la couverte ne s’attache que
médiocrement, lorfqu’elle n’a reçu qu’un .feu léger ;
alors il eft aifé de l’enlever, ou plutôt de la découper
, fans qu’elle laiffe la trace la plus légère.
Cette couverte étoit faite avec une terre bolaire
très-martiale, la même que celle que nous employons
dans notre fayence, connue fous le nom
de mdngant^e ou magahejîa vitriàriorum. Cette terre
prend auffi dans la cuite une couleur rouge très-foncée
; mais qu’il eft facile dé fendre noire avec la
moindre mixtion de couleur, ou d’autres terres. Cette
matière a dû ê.tre préparée 6c broyée parfaitement
, pour la mettre ën état de s’étendre, & de couler
au pinceau comme les émaux. Mais avant que de
mettre cette couleur noire, les Etrufques avoient
foin de tremper leurs ouvrages, ou de leur donner
une couleur rougeâtre, claire 6c fort approchante de
celle de notre terre cuite. Ils prenoie'nt cette précaution
po.ur .corriger la teinté naturelle 6c blanchâtre
de leur terre, qui ne produifpît pas l’effet qu’ils ai-
moient à voir dans leurs plus beaux ouvrages. L’examen
de plufieurs morcéaux étrufques fuffira pour
faire fentir aux curieux ces,différences. 6c connoître
à fond les détails.
Les terres fe trouvant airçji préparées, voici .l’opération
la plus effentielle pour la maniéré de les
çrner. Quand la couverte poire ou rouge étoit fe-
ch e, le peintre, ou plutôt le deffinateur, de voit né-
ce,flairement calquer ou poncer fon deffein; 6c félon
Pufage de ce tems, il n’a pu fe feryir pour y parvenir,
que de lames de cuivre très-minces, fufcéptiblès
de iqus les contours, 6c découpées comme l’on fait
aujourd’hui,ces mêmes lames pour imprimer les lettres
& les .ornemens.
Il pren.oit enfuite un outil fort tranchant, avec
/lequel il étoit maître de faire ce qu’on appelle de ré-
Jerve, les traits les plus déliés ; car il empfortojt 6c
ptoit la ^Ouverte nqire fur topt ce. qui dey oit être j
clair: on ne peut mieux comparer cette manoeuvre j
qu’à celle de notre gravure en bois. Alors la couleur
rpqge fe.djftinguoit , ti>c faifqij: voir fort nettement I
les figurés les ornemens èc tout ce qu’on av.pit enr j
trepris 4e repréfenter. La fe.uje infpedion de la plus
grande partie de ces ^démontre ces fortes d’opérations.
Ënfin ces ^ouvrages étant parvenus à cç
point, on leur dqnnqit la feponde .cuite j un peu plus
forte que là première.
. fl e^: de r^i^querque tous Ouvrages de
je/re cuite' djes anciens ? ne font pas f^nqqes avec le
fnêqvefojn. On en trouvé dont la 'terre blanchâtre (qu-
^l^tnalcuite^n^aftâ? f ^ u fe i>r?miçre*
ge. tl,y en.a.d’!a^.tr!es dqnt hurreeft. bieçucu^tç §£,hiea
travaillée, qui ne font recouverts que paria,cour
leur rouge, qui forme pu le fond, ou lés orpçméns ;
6c ces morceaux paroijffent.les mollis .cpmpiuns. Toutes
les couleurs noires né fopt pas égalet^nt belles.
Il y en a qui font terpes.ôc fans’.aucun éclat, dc d’aii-
ù;es qui par leur mat & leur poli , Iniitéhf^n qq^que
f^çon Témpil de nos porceiainçs!
La çpuleur blanche qu’ils çpèttoient tjpujpurs avec
le .pinceau fur les fonds, comme fur les e/paces découverts,
n’a aucune tenue. .C’eft une.efpeqe $eferre
de Çrete‘, qui n’eft pas comparable poiir la Ipîîdlte
aux couleurs dont on vient de p a r l e r c ’effppur
cela fans, doute, qu’ils Remploient avec tanTje me-
nage.njent, & lejdus Touvçnt'pour ffes parties "de
qoëffures, de br£ffi2lets.§c de réveillons' dans |lesç)r-
lié.mëns. ’ " ‘ ’ '
É.nfin on ne peut douter que pour conferyer la
propreté & l’exâ&itude de leurs Ouvrages, ilsqe
feîé&t ietvis.de ce que nous appelions k s ‘gq$cttfs9
c’eft-à-dire des pots cppver.ts, d,ans iefqùels’pn fck
cuire aujourd’hui les morceàux à T ^rl de tout air
extérieur. L’on ne connpjffoit alprs i;ien dé pliijSjppr-
fait que cette terre édité ; 6c Pop employoit ppur la
mettre en oeyyre les mains des plus fam eux artjftes.
Atiù^.étfufq. tfirn. I.
T erre de Çjëlliêvrje,T. i*. (Gl)ace)s.'} .on nomme
ainfi dans les manufa&ures des gl.aces, 1^ terre avec
laquelle pn çpnftruh le dedans & le glacis des fours.
Savary. f Z). / .)
T erre a t e r r e , ( Danfe. ) on appjiqtip ^:e
tet;me aux.danfeurs qui ne font point de capriples*,
& qui né quittent prefqûe point là terre.
T'ERRE a TERaE , lp dit au|fi en terrées de Manege 9
des cheÿaux qui ne font ni courbettes, .pi balptades
ma^s qui vont uniment fur le terrein un gàlpp lorre
en faifant ieulp^ent de peûts fauts, 6c en leyant un
peu lés pies .dp .devant.
Le terre à terre eft proprement qn,e fuite çje petits
fàiits aifés que le cheval ^ it en ayant, en maniapt de
côfé .& ’ fpr de,ux pliures ; dans ce mpuyeniept il
levé les deiix jambes à la fois y 6c quand celles-ci fojiÿ
flir te point d,e donner e^terpe, il les .a.cçpmpagae dés
jambes dé derrière, par upe cadence prompte 6ç
çpyute, jnanj^pt ^oujpurs fur les hanchps, de fortè
qqe les.j^puv^eiisdesquartiers de derrière fpnt.ex-
tremëmént courts 6c vifs.
T erre dÏqi^b.RE, f. ,f. (Peinture.) .efpece de terre
ou de pierre fort brune, qui fert Peintresdéaux
Q^qtipts.d.1 y en a d,e qepx fortes; l’une d’une cpiileur
minime tirant fur lé rouge, 6c l'autre
La preipipre ed la l’unp §çTaiitré vient
dûj^eyant, 6c paxljeulierement d’Egypte : il faut la
choifir tendre & en gros morceaux. Avant que dé,
brpy,er l a ^ y f <f’g^c f,ip i.t ppqr peindre, fpjt pour
mettre des gants en copieur', il faut la brûler, ge qpi
la rend plus rougeâtre , ^ par conséquent de meir-
leure qualité : piajs ep fa. brûlant il faut en èyjter la
fuipée qui e/t qjpfjbie §c p.u^nfe. Il y a enço.re pne
efpece de terre if ombre, qu’on appelle ferre de Cçfagnfij
m^is jefle eft heauççpp plus bmne qjje l’autre : fon
nom appreud lafqe. ïl ^qt la choiflr tenche,
fri^jé f ji^ep né$P §Ç iÇWnp. §aypry. (Z?. Z.)
REANI^lEf S , f. f. pl. >( Salftctrçrie. ) Le§
^Ppél|e,nt ainj(idesrfr/-e4qui opufervi dags
des cuviçrs qu’qn fiutféçher, .qu’on arrqfe epflûtg
à plpfipqrs reprife§ ayec fes écunjes,&: les rappqra-
ges î ipçres 011 anje^es, .que l’qn a^déÿ-erppees
apppr^ÿanj {fjuftsfçfli, ahp que les
q^eyjleqt pl^ip mcilyment.jÇes tfrfftf.^mqqdé Êfp.euyent
tqqjqu^ servir.à l’infini; 4® ferte qu’ap jWPygiî'4*
™ 9n ,qe peut jaqiais manquçr d? falpêtre,
T#8## A a&£rL$iieffîk \) PP
ünê forte de terré avec laquelle on blanchit le fû>
c r e , pour en faire de la caflbnade blanche. Celle
qu’on emploie aux îles françoifes de l’Amérique,
vient de France , particulièrement de Rouën, de
Nantes & de Bourdeaux. Il s’en trouve auffi à la Gua-
daloupe. Savary. ( D . J. )
T erre DU Japon, ( Botaru exot. ) terra japonica,
Voye{ C a chou»
T erre , T erroir , T erReàü , T errein , T er-
RITOIRE , ( Synonym. ) terre fe dit de la terre en général
; la terre nourrit tous les animaux»
Terroir fe dit dé la terré , entant qu’elle produit
des'fruits ; un bon , un mauvais terroir.
Terreau, fe dit dun fumier bien eonfommé 6c réduit
en terre ; on fait des couches de terreau pour y
élever des falades, des melons, des légumes.
Terrein fe dit en général d’une efpace de terre con-
iidéré par rapport à quelque Ouvrage qu’on y pour-
roit faire» Il faut ménager le terrein. On dit dans le
mêmefens, en terme de manege, ce cheval garde
bien fon terrein*
Territoire eft l’efpace dans lequel s’exerce un dif-
trift , une jurifdiétion ; un territoire fort étendu.
{D . J .)
T erre, ( Critiq. facréex ) >», ; ce mot lignifie
i ° . l’élément terreftre qui nous foutient. i°» la matière
qui fut créée au commencement, Gen.j. 30.
tout ce qui eft contenu dans le globe terreftre, Pf.
xx iij 1. 40. les hommes qui l’habitent, G en. vj. //.
K°x un lieu particulier : Bethléem, terre de Juda. 6°.
les fruits de la terre ; les fauterelles dévoreront la
terre; 7 0. le tombeau, Job. x . 22. 8°» la terre des vi-
’vans ; c’eft la Judée au propre , 6c au figuré, le fé*
jour des bienheureux. (JD. Z.)
T erre , ( Mythol.') il y a eu peu de nations payen-
nés qui n’aient perfônifié la Terre, 6c qui ne lui aient
rendu un culte religieux. Les Egyptiens, les Syriens,
les Phrygiens, les Scythes, les Grecs 6c les Romains
ont adoré la Terre, 6c l’ont mife avec le ciel 6c les
aftres au nomhre des plus anciennes divinités» C ’eft
que dans les premiers tems tous les cultes le rappor-
toient à des êtres matériels , 6c que l’on croyoit
alors que les aftres,Ta Terre 6c la mer étoient lés
caufes de tout le bien & le mal qui arrivoient dans
le monde»
Héfiode dit que la Terre naquit immédiatement
après le chaos: qu’elle époufa le c iel, & qu’elle fut
mere des dieux 6c des géans, des biens 6c des maux
des vertus & des vices. On lui fait auffi époufer le
tartare, 6c le pont ou la mer, qui lui firent produire
tous les monftres que renferment cës deux élémens,
e’eft-à-dire , que les anciens prenoient la Terre pour
là nature ou la mere univerfelle des chofes, celle qui
crée 6c nourrit tous les êtres ; c’eft pourquoi on l’ap-
pelloit commuhément la grande mere, magna mater.
Elle avoit plufieurs autres noms, Tirée ou Titéia ,
Ops , Tellus , Fejia, 6c même Cybeile; car on a foli-
Vent confondu la Terre avec Cybtlle.
Les philofophes les plus éclairés du paganîfme
croyoient que notre ame étoit une portion de la
nature divine, divina particuLam aura , dit Horace»
Le plus grand nombre s’imaginoit que l’homme étoit
né de la Terre imbibée d’eau & échaufféè parles
rayons du foleil. Ovide a compris l’une 6c l’autre
opinion dans ces beaux vers où il dit queT’homme
fut formé, foit que l’auteur de la nature l’eût com-
pofé de cette femence divine qui lui eft propre , ou
de^ce germe renfermé dans le fein de la Terre, lorfqu’elle
fut féparée du ciel.
Paufanias parlant d’un géant indien d’üiie taille
extraordinaire, ajoute : « fi dans les premiers tems
» la Terre encore toute humide venant à être échaufi
» fee par les rayons du foleil, a produit les premiers
f> hommes, quelle partie de la Terri fut jamais plus
Tome XVI\ i R
» propre à produire des hômfnés d’u'nê grandeur 'tic-
» traordinaire, que les Indes, qui ehcore aujourd’hui
» engendrent des animaux tels que les éléphans ? »
Il eft fou vent parlé dans la Mythologie des ènfims
de la Terré ; en général lorfqu’on ne conhoiffoit pas
l’origine d’un nomme célébré ? c’e’toit un fils de la
Tèrrc, c’eft-à-dire, qu’il étoit né dans le pays , mais
qu’on ignoroit fes parens.
La Terre eut des temples > dés autels, des facrifi-
ces ; on la nommoit Omnipàrens ; on fait ce beau vers
de Lucrèce,
Omniparéns eddem rerutn commune jtpulcriim\
A Sparte il y avoit un temple de la Terre qu’cft
nommoit Gajepton, je ne fais pourquoi. A Athènes
on facrifioit à la Terré^ comme à une divinité qui pré-
fidoit aux noces. En Achaïe, fur le fleuve Crathis,
étoit un temple célébré de la Terre qu’on appellôit là
deejje au large fe in , Evpuç-ifvc!' ; fa llatue étoit de bois»
On nommoit pour fa prêtrefle une femme qui dès ce
moment étoit obligée de garder la chafteté, encorë
fàlloit-il qu’elle n’eût été mariée qu’une fois j 6c pour
s’aflurer de la vérité, on lui faifoit fubir l’épreuve dé
boire du farîg de taureau: fi elle étoit coupable de pan
jure, ce fang devenoit pour elle tin poifori mortel;
Les Romains firent bâtir leur premier temple à là
déefle Tellus, ou la Terré l’an de Rome 268; mais
les hiftoriens ne nous apprennent point quelle figuré
on donnoit à la déefle ; il y avoit plufieiirs attributs
de Cybeile qui ne lui convenoient que par rapport
à la Terre, comme le lion couché 6c apprivoifé, pour
nous apprendre qu’il n’eft point de terre fi ftérile &
fi fauvage, qui ne puiffe être bonifiée par la culture;
Le tambour , fymbole du globe de la terre : les tours
fur la tête, pour repréfenter les villes femées fur la
furface de la terre.
Avant qu’Apollon fuit en poffeffion de l’oracle dé
Delphes, c’étoit la Terre qui y rendoit fës oracles ,
6c qui les prononçoit elle-même, dit Paufanias ; mais
elle étoit ën tout de moitié avec Neptune» Daphné,
l’une des nymphes de la montagne, fut choifie par là
deeffe Tellus pour préfider à l’oracle. Dans la fuite
Tellus céda tous fes droits à Thémis fur Delphes, 6é
celle-ci à Apollon. ( D. J. )
T erre lat ( Géog. mod. ) ce mot, en géographie,
a plufieurs fignifications qu’il eft bon de diftinguen
i° . Il lignifie cette maffe compofée fur laquelle nous
vivons, & en ce fens là terre eft la même chofe aué
le globe terreftre ou terraquée ; on y comprend toutes
les eaux dont fa furface eft couverte.
20. Il lignifie la partie de cette maffe qui par i’agti-
culture devient plus ou moins fertile, & dans ce fens
on ne comprend point les mers.
30. Il fe prend auffi pour l’étendue d’un état, d’uri
pays, d’une domination» On dit en ce fens terre dé
France, terre dé L'Empiré.
40. Chez les mariniers, le mot terre a différens féris;
& entr’autres celui de rivage. Ils appellent terre embrumée
un rivage qiie les brouillards couvrent: t erre dé*
figurée, celle qu’on ne peut bien recdnnoître à caufé
de quelques nuages qui la déguifent : terrefine^ celle
que l’on découvre clairement & fahs obftacle : gràJJ'é
terre, un rivage haut, élevé : terre qui fu it , celle qui
faifant un Coude, s’éloigne de la route que fait lé
vaiffeau : terre qui fe donne la main , celle que l’on
voit de fuite , fans qu’elle foit coupée par aucun golfe
, ni aucune baie : terre qui afieche, une terre que là
'mer fait voir après qu’elle s’eft retirée. Ils appellent
terre de beitrré, Un nuage à l’horizon qu’on prend pôiir
la terre , 6c que le foleil diffipe; on dit / aller terre-à-
terre} pour dire naviger le long des côtes , 6c prendre
terre , pour dire aborder.
Enfin i ly a des pays d’une grande étendue que Î’ôiî
appelle terre en géographie j comme là terre faints,
1 >i